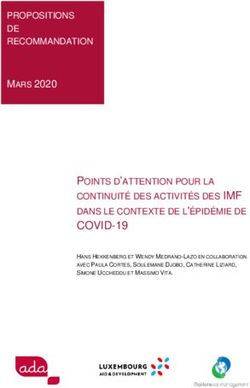La PAC post 2020 : Les propositions législatives - Pays de la Loire
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
N°2018-1 - Juillet 2018 Cette note de synthèse a été rédigée par Pascale Labzaé et Pierre-Yves Amprou à partir des projets de règlements européens, des documents de travail produits par l’APCA et la Commission européenne. Les éléments développés restent pour la plupart provisoires et conditionnés à un accord politique entre les institutions européennes avant d’être applicables dans les Etats-membres (EM).
Sommaire
Introduction …………………………………………………………………………………………….. 5
Propositions législatives ………………………………………………………..………………….. 6
Incertitudes sur le calendrier de négociation du CFP et de la PAC ..…………………………. 6
er
Les aides directes du 1 pilier (Feaga) ………………………………………………………………………. 8
Les aides directes du 2nd pilier (Feader) ……………………………………………………………………… 13
Les interventions sectorielles ………………………………………………………………………………………. 15
Le financement des 2 piliers (Feaga et Feader) …………………………………………………………. 16
OCM unique et qualité des produits agricoles ……………………………………………………………. 17
Première analyse des propositions législatives …………………………………………….. 19
Les premières analyses d’impact ………………………………………………………………………………… 19
Les premières questions posées : les opportunités et les menaces …………………………. 19
Conclusion ……………………………………………………………………………………………….. 21
Annexes …………………………………………………………………………………………………… 23Introduction Alors que les institutions européennes vont entamer la négociation du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) et des instruments de la PAC (politique agricole commune) post 2020, le bilan de la PAC actuelle est mitigé. Son efficacité face à l’évolution du contexte multifactoriel et des enjeux du secteur agricole pose question. Entre limitation des mécanismes régulateurs des marchés, développement insuffisant des instruments de gestion des risques et complexité administrative contre- productive, les instruments de la PAC sont-ils encore adaptés aux besoins des entreprises agricoles ? La Commission européenne propose un plan stratégique PAC qui laisse la subsidiarité à chaque Etat- membre (EM) pour construire, « à la carte », sa politique agricole, dans le respect des objectifs fixés par l’Union européenne, en utilisant l’ensemble des outils actuels de la PAC (1er et 2nd piliers). La profession agricole partage les objectifs stratégiques de la PAC affichés par la Commission européenne : favoriser la résilience du secteur agricole, soutenir la protection de l’environnement et les actions de lutte contre le changement climatique et renforcer le tissu socio-économique des territoires ruraux. Cependant afin de donner du sens aux bénéficiaires de la PAC et aux citoyens européens, le besoin d’une Europe forte et ambitieuse et d’une PAC plus simple et plus lisible pour tous doit être réaffirmé. Pour que la PAC remplisse convenablement les objectifs stratégiques qui lui sont assignés, il faudrait également en améliorer la « valeur ajoutée », et ce des entreprises agricoles jusqu’au consommateur. Après avoir rappelé les points essentiels des projets de règlements sur la PAC post 2020 (plans stratégiques, nouvelle architecture verte, paiements du 1er pilier, mesures du 2nd pilier, interventions sectorielles, modes de financement des 2 piliers et OCM unique), la présente note pose une ébauche d’analyse des impacts, des opportunités et des menaces des propositions législatives.
Propositions
législatives
Trois textes de référence Les propositions législatives reposent sur 3 règlements
respectivement relatifs :
Aux plans stratégiques PAC : paiements directs,
conditionnalité, développement rural, interventions
sectorielles, système de conseil agricole et transferts financiers
possibles entre les deux piliers,
A l’organisation commune des marchés des produits agricoles,
aux systèmes de qualités applicables aux produits agricoles et
aux denrées alimentaires et à différentes modalités portant sur
les IGP des produits vinicoles aromatisés (règlement
modificatif ou mini Omnibus),
Aux dispositions horizontales : financement, gestion, contrôle
de la PAC et réserve de crise.
Les 2 piliers maintenus Dans le règlement horizontal de la PAC, il est proposé de maintenir
la structure actuelle de la PAC reposant sur 2 piliers avec :
D’un côté les mesures annuelles d’application générale dans le
1er pilier,
De l’autre, dans le 2nd pilier, des mesures reflétant des
spécificités nationales et régionales dans le cadre d’une
programmation pluriannuelle.
Plus de subsidiarité mais une La Commission européenne propose de renforcer le principe de
logique de résultats et non subsidiarité pour que les EM puissent « mieux » adapter les mesures
plus de moyens de la PAC au titre des 2 piliers à leurs contextes national et
régionaux. Autre évolution, la PAC sera désormais mise en œuvre
selon une logique de résultats (et non plus de moyens) à travers les
plans stratégiques PAC.
L’application de la PAC continuera de s’appuyer sur la définition à
l’échelle européenne de ce que sont les agriculteurs et les
exploitations agricoles. La réglementation reste inchangée en la
matière (voir définitions en annexe). Le cadre européen devient par
contre plus flexible en permettant à chaque EM d’adapter les
définitions communautaires suivantes dans les plans stratégiques :
activité agricole, surfaces agricoles, surfaces admissibles, agriculteur
véritable et jeunes agriculteurs (voir définitions en annexe).
Les plans stratégiques PAC
Des objectifs généraux et Principale nouveauté proposée pour la prochaine PAC, chaque EM
spécifiques fixés au niveau devra soumettre un plan stratégique PAC à la Commission
européen européenne pour l’ensemble de son territoire. Très similaire au plan
de développement rural de la PAC 2014-20, le plan stratégique PAC
combinera la plupart des instruments de soutien de la PAC financés
par le Feaga (y compris les interventions sectorielles) et par le
Feader pour atteindre les objectifs de la PAC. Les EM peuvent décider
que certaines ou l’ensemble des interventions du plan stratégique
PAC soient établies au niveau régional.Les instruments mobilisés dans le cadre du plan stratégique PAC
doivent permettre de réaliser les 3 objectifs généraux suivants
(déclinés en 9 objectifs spécifiques : 3 économiques,
3 environnementaux, 3 sociaux) :
Favoriser un secteur agricole résilient et diversifié assurant la
sécurité alimentaire,
Soutenir les actions de protection de l’environnement et du
climat,
Renforcer le tissu socio-économique et des zones rurales.
Contenu, approbation, Le contenu du plan stratégique PAC est très similaire au plan de
gouvernance et suivi des développement rural 2014-20. Il doit inclure les sections et les
plans stratégiques PAC annexes décrites dans le tableau suivant.
Contenu du plan stratégique PAC
Sections
● Evaluation des besoins
● Stratégie d'intervention
● Description des élements communs à certaines interventions
● Description des paiements directs et des interventions du développement rural
spécifiés dans la stratégie
● Description des programmes sectoriels et de leurs interventions
● Plan de financement
● Description de la gouvernance et de la coordination des structures incluant une
évaluation des conditions ex ante
● Description des élements qui assurent la simplification et la réduction des charges
administratives pour des bénéfices financiers
Annexes
● Annexe I sur l'évaluation ex ante et l'Evaluation Environnementale Stratégique (EES)
● Annexe II sur l'analyse SWOT
● Annexe III sur la consultation des partenaires
● Annexe IV sur un plan indicatif d'évaluation
● Annexe V sur le financement national additionnel fournit dans le champ d'application
du plan de soutien de la PAC
● Annexe VI sur l'aide pour le coton
PEP Chambre d'agriculture PdL Source : proposition de règlement UE - Commission européenne
Il devra être élaboré par chaque EM selon une procédure
transparente et en accord avec leur cadre institutionnel et légal en
partenariat avec les autorités publiques concernées, les partenaires
économiques et sociaux, les organismes représentant la société
civile.
Chaque EM devra transmettre son plan stratégique à la Commission
européenne avant le 1er janvier 2020. La Commission européenne
évaluera chaque plan en examinant la prise en compte des objectifs
globaux et spécifiques, le choix des mesures et l’allocation des
budgets. Le plan devra être approuvé sous 8 mois après soumission.
Une autorité de gestion sera désignée dans chaque EM pour gérer et
mettre en œuvre le plan stratégique.
Un cadre de performance devra être construit pour chaque plan à
partir d’une liste d’indicateurs et de méthodes de calcul précisés par
la Commission européenne. Ces cadres permettront le suivi et
l’évaluation du plan stratégique par l’EM et la Commission
européenne via le rapport de performance qui lui sera transmis.
L’EM devra organiser une réunion annuelle de bilan avec la
Commission européenne pour examiner la performance de son plan
stratégique PAC. En cas de bilan insatisfaisant, la Commission
européenne peut demander la mise en œuvre de mesures correctives
nécessaires. Elle peut aussi décider une suspension des paiements
en cas de sous-performance.Le plan stratégique PAC doit également comprendre un système de
conseil aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des soutiens de la
PAC. Ces services de conseil agricole doivent couvrir les dimensions
économiques, environnementales et sociales. Ils doivent mettre à
jour les informations techniques et scientifiques développées par la
recherche et l’innovation.
Les aides directes du 1er pilier (Feaga)
La structure des paiements Les aides directes du 1er pilier de la PAC
du 1er pilier remaniée
Paiements 2014-20 Paiements post 2020
Paiement couplé Paiement couplé
VOLONTAIRE VOLONTAIRE
Nouveau
Paiement
Paiement JA
Eco-programme
OBLIGATOIRE P1
OBLIGATOIRE
Paiement JA et/ou
Paiement redistributif
mesures P2
VOLONTAIRE
OBLIGATOIRE P1/P2
Supprimé
Paiement vert Paiement redistributif
OBLIGATOIRE OBLIGATOIRE
Paiement de base Paiement de base
OBLIGATOIRE OBLIGATOIRE
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire
Source : proposition de règlement UE - Commission européenne
Les paiements directs du 1er pilier conservent globalement leur
structuration actuelle : composantes découplée et couplée (pour les
EM qui en font le choix). Leur architecture environnementale est par
contre refondue avec :
La suppression du verdissement faute de bilan satisfaisant,
L’élargissement de la conditionnalité,
L’introduction de programmes volontaires pour le climat et
l’environnement (éco-programme).
Une nouvelle architecture Nouvelle architecture verte de la PAC
verte de la PAC
PAC 2014-2020 PAC post 2020
MAEC
Mesures
volontaires
MAEC Eco-programme
Verdissement
Mesures Nouvelle
obligatoires conditionnalité
(pour tous les (conditionnalité +
Conditionnalité
agriculteurs) verdissement)
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire
Source : proposition de règlement UE - Commission européenneLa Commission européenne souhaite développer les ambitions
climatiques et environnementales en se basant sur les engagements
internationaux de l’UE en termes d’objectifs climatiques via une
nouvelle architecture verte de la PAC à 2 niveaux :
Un 1er niveau, obligatoire pour tous les agriculteurs de l’UE, y
compris les agriculteurs biologiques, qui englobe la
conditionnalité et le verdissement actuels. Les EM doivent
inclure dans leur règlementation mettant en œuvre le plan
stratégique PAC un système de conditionnalité qui comporte
des exigences européennes (directives et règlements ; voir en
annexe) et les standards des BCAE établies au niveau national
(une dizaine dont 6 nouvelles ; voir schéma). Trois enjeux
principaux sont visés : le climat et environnement, la santé
(publique, animale et végétale) et le bien-être animal. Ce
système prévoit par ailleurs des pénalités administratives aux
bénéficiaires en cas de non-respect des exigences
européennes et nationales.
Evolution de la conditionnalité (BCAE)
VERDISSEMENT
Maintien du ratio PP/SAU
NOUVELLE CONDITIONNALITE
BCAE 1* : maintien du ratio PP/SAU
Interdiction de labourer et convertir
des prairies sensibles (N2000) BCAE 2* : interdiction de labourer et convertir
5 % minimum de SIE BCAE 9* : % minimum d'éléments ou surfaces
non productifs(ves)
Diversité d'assolement
BCAE 8* : rotation des cultures
BCAE 4 : bandes tampons le long des cours
CONDITIONNALITE d'eau
BCAE 1 : bandes tampons le long
BCAE 2* : protection des ZH et tourbières
des cours d'eau
BCAE 5* : gestion durable des nutriments
BCAE 2 : prélèvement pour
l'irrigation BCAE 7 : interdiction de sols nus durant les
périodes sensibles (hiver)
BCAE 3 : protection des eaux
souterraines contre la pollution BCAE 6 : gestion du labour réduisant les
risques de dégradation des sols (pentes)
BCAE 4 : couverture minimale des
sols BCAE 3 : interdiction de brûler les chaumes,
sauf en cas de maladie
BCAE 5 : limitation de l'érosion
BCAE 9 : maintien des élements de paysage
BCAE 6 : maintien de la matière
et interdiction de coupe de haies et arbres à
organique des sols
certaines périodes
BCAE 7 : maintien des particularités
topographiques
*nouvelle BCAE
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : APCA et proposition de règlement UE - Commission européenne
Un 2nd niveau, volontaire et facultatif pour les agriculteurs :
« Eco-programme » dans le 1er pilier, qui engloberait des
mesures incitatives pour rémunérer les pratiques qui
produisent des services environnementaux. L’eco-
programme pourrait englober des mesures relatives à
l’agriculture biologique, à d’autres démarches de
certification (HVE, …), et au stockage du carbone par
exemple,
Et/ou MAEC dans le 2nd pilier, mesures qui resteraient
basées sur un modèle de compensation de la diminution du
revenu induit par le changement de pratiques.Vers un plafonnement des Les EM doivent réduire le montant annuel des paiements directs
paiements directs du 1er pilier versés à un agriculteur, allant au-delà de 60 000 €, de la manière
suivante :
Au minimum 25 % de réduction sur la tranche 60 à 75 000 €,
Au minimum 50 % de réduction sur la tranche 75 000 à
90 000 €,
Au minimum 75 % de réduction sur la tranche 90 000 et
100 000 €,
100 % de réduction sur les montants au-delà de 100 000 €.
Avant de mettre en œuvre ce plafonnement et cette dégressivité, les
EM doivent soustraire du montant des paiements versés à un
agriculteur les composantes suivantes :
Les salaires liés à une activité agricole déclarée par
l’agriculteur, y compris les taxes et les cotisations sociales
relatives à l’emploi, et
Le coût équivalent de la main d’œuvre non salariée occupée
régulièrement sur l’exploitation agricole et liée à une activité
agricole, ne percevant pas de salaire ou percevant une
rémunération inférieure au montant normalement payé pour
les prestations fournies, mais rétribuée par le résultat
économique de l’exploitation agricole.
Afin de calculer les montants de ces 2 composantes, les EM doivent
utiliser le salaire moyen lié à une activité agricole au niveau national
ou régional multiplié par le nombre d’unités de travail déclarées par
l’agriculteur.
Le produit de la réduction des paiements doit être utilisé pour
contribuer au financement des soutiens au revenu redistributif et
ensuite aux autres aides découplées. Les EM peuvent aussi utiliser
l’excédent du plafonnement pour financer les mesures du Feader au
moyen d’un transfert. Ce transfert pourra être revu en 2023 et ne
sera pas soumis à la limite maximum des transferts de fonds entre
Feaga et Feader.
Les paiements directs Les EM doivent verser les paiements directs découplés uniquement
découplés du 1er pilier aux agriculteurs véritables dont les surfaces admissibles de
l’exploitation sont supérieures à la surface seuil fixée (par l’EM).
Paiement Ils sont composés des niveaux suivants :
Eco-programme Soutien au revenu de base pour la durabilité,
OBLIGATOIRE
Soutien au revenu complémentaire redistributif pour la
durabilité,
Paiement JA Soutien au revenu complémentaire pour les jeunes
et/ou mesures agriculteurs,
second pilier Programme volontaire pour le climat et l’environnement (éco-
programme).
Paiement
redistributif
OBLIGATOIRE
Paiement de base
OBLIGATOIREPaiement Le paiement de base est un soutien découplé annuel versé à un
agriculteur véritable par hectare admissible déclaré.
Eco-programme
OBLIGATOIRE
A titre dérogatoire, les petites exploitations, telles que définies par
Paiement JA
et/ou mesures
second pilier
les EM peuvent recevoir des paiements sous forme d’un montant
Paiement
redistributif forfaitaire. Le paiement doit être uniforme par hectare si les EM ne
OBLIGATOIRE
font pas le choix de verser un paiement de base, basé sur le droit
Paiement de base
aux paiements.
OBLIGATOIRE
Les EM peuvent également décider de différencier le montant de
l’aide de base au revenu par hectare en fonction de différents
groupes de territoires qui font face à des conditions socio-
économiques ou agronomiques similaires.
Une poursuite de la Lorsque la valeur des droits au paiement n’est pas uniforme dans un
convergence interne du EM (cas de la France) ou dans un groupe de territoires, alors les EM
paiement de base d’au moins doivent assurer une convergence de la valeur des droits au paiement
75 % de base vers une valeur uniforme en 2026 au plus tard en :
Déterminant la valeur unitaire du droit au paiement avant
convergence proportionnellement à sa valeur et celle du
paiement vert pour l’année 2020,
S’assurant qu’au plus tard en 2026 tous les paiements devront
avoir une valeur d’au moins 75 % de la valeur moyenne 2026
pour le paiement de base,
Fixant, en 2026 au plus tard, un niveau maximum de la valeur
des droits aux paiements au niveau national ou pour chaque
groupe de territoires.
Les EM doivent financer les augmentations de la valeur des droits au
paiement nécessaires dans le cadre de la convergence en réduisant
la différence entre la valeur unitaire des droits au paiement
déterminés avant la convergence et le montant de la valeur
moyenne unitaire du paiement de base pour l’année 2026. Et le cas
échéant, grâce à l’établissement d’un plafond maximum de la valeur
des droits comme indiqué plus haut. Cette réduction peut être
appliquée à tout ou partie des droits au paiement sur la base de
critères objectifs et non discriminatoires. Ces critères peuvent inclure
la fixation d’une réduction maximale ne pouvant pas être inférieure à
30 %.
Une réserve nationale Les EM qui décident de verser des paiements de base basés sur les
obligatoire droits au paiement doivent gérer une réserve nationale. Les EM
doivent utiliser leur réserve en priorité aux agriculteurs suivants :
Jeunes agriculteur qui se sont installés pour la première fois,
Agriculteurs qui se sont installés pour la première fois en tant
que chefs d’exploitation avec la formation appropriée ou les
compétences nécessaires, telles que définies par l’EM pour les
jeunes agriculteurs.
A l’exception d’un cas de transfert par héritage, les droits aux
paiements ne peuvent être transférés qu’à des agriculteurs
véritables.Paiement Les EM doivent obligatoirement prévoir un soutien redistributif au
Eco-programme
OBLIGATOIRE revenu sous la forme d’un paiement découplé complémentaire par
Paiement JA hectare pour assurer une redistribution des soutiens des grandes
et/ou mesures
second pilier
exploitations vers les petites et moyennes structures. Pour ce faire,
ils doivent établir un montant par hectare ou différents montants
Paiement redistributif correspondant à différentes classes de surfaces, ainsi que le nombre
OBLIGATOIRE maximum d’hectares admissibles par exploitation. Le montant par
hectare du paiement redistributif ne doit pas excéder le montant
Paiement de base
OBLIGATOIRE
moyen national des paiements directs par hectare.
Paiement
Eco-programme Les EM peuvent octroyer un paiement complémentaire aux jeunes
agriculteurs qui sont nouvellement installés dans le cadre de
OBLIGATOIRE
Paiement JA l’obligation de dédier au moins 2 % de leurs paiements directs à
et/ou mesures
second pilier l’objectif « attirer de nouveaux agriculteurs et faciliter le
développement de l’entreprise ». Ce paiement prend la forme d’un
Paiement
redistributif paiement annuel découplé par hectare admissible. Si les fonds ne
OBLIGATOIRE
sont pas mobilisés dans le cadre du 1er pilier, ils doivent être
Paiement de base transférés dans le 2nd pour répondre au même objectif.
OBLIGATOIRE
Les EM doivent proposer un soutien pour des systèmes volontaires
Paiement
Eco-programme
favorables au climat et à l’environnement. Ils doivent établir une
OBLIGATOIRE liste des pratiques bénéfiques pour l’environnement et le climat
Paiement JA
permettant d’atteindre un ou plusieurs objectifs environnementaux
et/ou mesures et climatiques suivants :
second pilier
Paiement
redistributif
Contribuer à l’adaptation et à l’atténuation du changement
OBLIGATOIRE climatique, et à la production d’énergies durables,
Paiement de base Contribuer au développement durable et à la gestion efficace
des ressources naturelles, telles que l’eau, le sol, l’air,
OBLIGATOIRE
Contribuer à la protection de la biodiversité, développer les
services écosystémiques et préserver la nature et les
paysages.
Ces pratiques doivent inclure des engagements allant au-delà :
de la nouvelle conditionnalité,
des exigences minimum relatives à l’utilisation des fertilisants,
des produits phytosanitaires, du bien-être animal, ainsi que
des autres exigences obligatoires établies au niveau national
et par la règlementation européenne,
des conditions de maintien des surfaces agricoles.
Et sont différentes des engagements pour l’environnement et le
climat du 2nd pilier.
Ces paiements doivent prendre la forme de paiements annuels par
hectare admissible et doivent être octroyés soit :
en tant que paiements additionnels aux paiements directs
découplés,
sous forme de paiements destinés à indemniser les
bénéficiaires pour tout ou partie des coûts additionnels induits
ou des pertes de revenu causés par les engagements, tels que
définis pour les engagements agro-environnementaux et
climatiques (système de rémunération similaire aux MAEC).Les soutiens couplés du 1er Les EM peuvent octroyer des soutiens couplés destinés à soutenir
pilier des secteurs, des productions ou des types spécifiques d’agriculture
qui subissent des difficultés à améliorer leur compétitivité, leur
Paiement couplé durabilité ou la qualité de leurs produits. Au maximum 10 % des
VOLONTAIRE
soutiens directs peuvent être alloués aux soutiens couplés (contre
13 % pour la PAC 2014-20). Il est possible pour un EM de dépasser
de 2 % ce 1er plafond si ces soutiens sont alloués aux protéagineux.
Un cas dérogatoire au plafond de 10 % est cependant présenté dans
le règlement pour les EM qui utilisaient plus de 13 % des aides
directes pour les aides couplées durant la PAC 2014-20.
L’aide couplée est versée sous forme d’un paiement annuel par
hectare pour les surfaces et par têtes de bétail définies comme
éligibles. Les soutiens couplés peuvent être accordés aux secteurs
suivants (identiques à la PAC 2014-20) : céréales, oléagineux,
cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz,
fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers,
semences, viande ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers
à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte rotation.
Les aides directes du 2nd pilier (Feader)
Les domaines d’interventions du développement rural proposés par
la Commission européenne pour la prochaine PAC recouvrent
globalement ceux de la programmation 2014-20. L’ensemble de ces
interventions devra répondre aux objectifs globaux et spécifiques
poursuivis par le plan stratégique PAC. Les propositions législatives
offrent néanmoins plus de flexibilité dans le choix et l’application des
mesures tout en cadrant la part des fonds du 2 nd pilier fléchés vers
des interventions en faveur de l’environnement et du climat.Domaine d'intervention du développement rural
Cofinancement
Intervention Descriptif de l'intervention Cible (1)
Prise en compte obligatoire dans le plan stratégique PAC
Intégration possible des aides à l'agriculture biologique, à
l'agroforesterie et couvrant d'autres besoins spécifiques
Paiements pour
nationaux, régionaux, locaux.
engagements agro- Agriculteurs et
Paiements annuels versés pour engagements allant au-delà des
environnementaux et autres 80%
exigences standards et différentes des mesures de l’éco-
climatiques bénéficiaires.
programme (compensation des surcoûts et des pertes de
(> 30 % du Feader)
revenu).
Durée d'engagement de 5 à 7 ans, voire plus si nécessaire.
Paiement par ha ou forfaitaires.
Indemnisation de tout ou partie des coûts supplémentaires et de
Paiements pour
la perte de revenu résultant de contraintes naturelles ou Agriculteur
contraintes naturelles 65% (2)
spécifiques. véritable.
(ICHN)
Paiement annuel par ha.
Indemnisation de tout ou partie des coûts supplémentaires et de Agriculteur,
Paiements pour
la perte de revenu du fait de l'application d'exigences gestionnaires
désavantages
réglementaires : zones Natura 2000, autres zones de protection forestier et
spécifiques du fait 80%
de la nature avec restrictions environnementales, bassins autres
d'exigences
versants. gestionnaires de
obligatoires
Paiement annuel par ha. foncier.
Pas de 43% (2)
Soutien aux investissements matériels et/ou immatériels
Soutien aux bénéficiaires 80%
Taux de soutien maximum de 75 % augmenté pour certains
investissements explicitements (investissements
investissements spécifiques.
mentionnés. non productifs)
Soutien de l'installation des jeunes agriculteurs tels que définis
réglementairement.
Soutien des start-up rurales liées à une activité agricole ou
forestière ou la diversification de revenu des exploitations. Jeunes
Soutien aux
Soutien des activités non agricoles en zones rurales liées à agriculteurs et 43% (2)
entreprises rurales
l’agriculture ou à la forêt, ou à la diversification du revenu des start-up rurales.
exploitations.
Soutien versé sous la forme d’un montant forfaitaire limité à un
montant de 100 000€.
Participation financière pour le paiement des primes d'assurance
récolte et aux fonds de mutualisation, y compris les coûts
administratifs de mise en œuvre.
Etablissement par l'EM des conditions suivantes :
- Types et couverture éligibles à l'assurance récolte et aux
fonds de mutualisation,
Soutien aux outils de - Méthode de calcul des pertes et facteurs de déclenchement Agriculteurs
43% (2)
gestion des risques de la compensation, véritables.
- Règles de constitution et de gestion des fonds de
mutualisation.
Taux maximum de soutien du coût éligible de 70 %.
Seuil de déclenchement du soutien à partir de 20 % de perte de
production annuelle ou de revenu (par rapport à moyenne
triennale ou olympique).
Pas de
Soutien à la coopération dans le cadre du partenariat européen
bénéficiaires
Coopération d'innovation (PEI) du développement local mené par les acteurs 80%
explicitements
locaux dans le cadre de Leader.
mentionnés.
Promotion de l'accès à la formation, au conseil et au transfert Entreprises
Connaissance : d'information. agricoles,
43% (2)
information-formation Soutien équivalent à 75 % du coût des actions d'information ou forestières et
fixe de 200 000 € maximum. rurales.
Pas de
Leader bénéficiaires
80%
(> 5 % du Feader) explicitements
mentionnés.
(1)
Part prise en charge par le Feader (solde par l'EM)
(2)
Taux maximum
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : proposition de règlement UE - Commission européenneLes interventions sectorielles
Une ouverture des Les dispositions relatives aux interventions sectorielles feront partie
interventions sectorielles à intégrante des plans stratégiques PAC pour garantir une meilleure
d’autres secteurs cohérence des interventions PAC. A ce titre, elles sont supprimées du
règlement OCM unique et intégrées dans le règlement qui traite des
plans stratégiques PAC.
Les EM devront mettre en place des interventions sectorielles dans
les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture et vitivinicole. Les
EM seront libres de mettre en œuvre des interventions dans d’autres
secteurs de leur choix. Les bénéficiaires en seront des OP ou des
AOP au travers de programmes opérationnels pour inciter au
regroupement.
Interventions sectorielles par secteur d’activité
Secteur Obligatoire ou volontaire
Fruits et légumes Obligatoire
Apiculture Obligatoire
Viticulture Obligatoire pour les EM viticoles, dont la France
Houblon Volontaire
Oléiculture Volontaire
Riz, sucre, fourrages séchés,
semences, lin, chanvre,
bananes, plantes vivantes et
produits de la floriculture,
viande bovine, lait et Volontaire
produits laitiers, viande de
porc, viandes ovine et
caprine, œufs, viande de
volaille, vers à soie
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : proposition de règlement UE - Commission européenne
Ces interventions sectorielles devront permettre d’atteindre un
ensemble d’objectifs sectoriels détaillés et listés dans la proposition
législative. Certains objectifs sont obligatoires, les autres facultatifs.
Les EM devront choisir une ou plusieurs mesures pour chaque
objectif poursuivi. La proposition législative donne une liste de
mesures très peu détaillées (logique de résultats plutôt que de
moyens) et relègue l’opérationnalisation des mesures aux EM. Les
objectifs poursuivis et les mesures sélectionnées pour les atteindre
seront précisés dans le plan stratégique PAC. A titre d’exemple, pour
les filières fruits et légumes, les EM devront viser les objectifs
obligatoires suivants :
Promotion, développement et mise en œuvre de méthodes de
production respectueuses de l’environnement, utilisation
durable des ressources naturelles (particulièrement la
protection des ressources eau et sol),
Contribution à l’atténuation et à l’adaptation au changement
climatique.
Ils devront également prendre en compte 2 autres objectifs et fixer
les mesures pour atteindre l’ensemble de ces objectifs.
Les EM pourront décider de transférer jusqu’à 3 % de l’enveloppe
paiements directs vers les interventions pour les « autres
secteurs » (hors viticulture, houblon, apiculture, fruits et légumes et
olive).Le financement des 2 piliers (Feaga et Feader)
Une baisse de la part du Au maximum 10 % des soutiens directs peuvent être alloués aux
Feaga dédiée aux aides soutiens couplés (contre 13 % pour la PAC 2014-20). Il est possible
couplées pour un EM de dépasser de 2 % ce 1 er plafond si ces soutiens sont
alloués aux protéagineux. Un cas dérogatoire au plafond de 10 % est
cependant présenté dans le règlement pour les EM qui utilisaient
plus de 13 % des aides directes pour les aides couplées durant la
PAC 2014-20.
Aides à l’installation dans le Au moins 2 % des paiements directs doivent contribuer à attirer de
1er et/ou le 2nd pilier nouveaux agriculteurs et faciliter le développement de leurs
entreprises, ainsi que le renouvellement des générations, via :
Un paiement complémentaire au revenu pour les jeunes
agriculteurs ou,
Des subventions à l’installation dans le Feader et financées par
un transfert du 1er pilier vers le 2nd pilier.
Jusqu’à 3 % du 1er pilier Le financement des secteurs autres que fruits et légumes, apiculture,
pour financer les viticulture, houblon et olive) est plafonné à 3 % du Feaga. L’aide est
interventions sectorielles des limitée à 5 % de la valeur de la production commercialisée. Les
autres secteurs fonds européens ne peuvent pas participer à plus de 50 % des
dépenses dans le cadre de ces interventions.
Les taux cofinancements du Le plan stratégique PAC doit fixer un taux maximum de
Feader : taux maximum et cofinancement Feader applicable à toutes les interventions (43 %
dérogations contre 53 à 75 % selon le développement économique des régions
dans la PAC 2014-20). Les taux de cofinancement maximum sont
différents pour les régions les moins développées et les régions
ultrapériphériques (70 % contre 85 % dans la PAC 2014-20) et pour
l’CHN dans les zones à contraintes naturelles et spécifiques (65 %).
La contribution minimum du Feader est de 20 %.
Deux dérogations sont accordées à ces deux précédentes règles :
100 % de contribution du Feader pour les opérations recevant
des fonds transférés depuis le Feaga (1er pilier) : autrement
dit, maintien du fait qu’un cofinancement de l’Etat n’est pas
obligatoire en cas de transfert du 1er pilier vers le 2nd,
80 % pour :
les mesures agro-environnementales et climatiques (de
type MAEC, maintien à l’agriculture biologique,
agroforesterie…),
LEADER,
les zones désavantagées de type Natura 2000,
les investissements non productifs,
les mesures de coopération.
Au moins 30 % du total du Feader doit être dédié aux interventions
qui répondent aux objectifs environnementaux et climatiques. Sont
exclus de ce plafond de 30 % les paiements pour contraintesnaturelles et spécifiques (alors que ceux-ci y étaient inclus dans le
cadre de la PAC 2014-20). La part du total du Feader réservé pour
Leader doit s’élever à au moins 5 %.
Les transferts possibles Au 1er août 2020, les EM peuvent décider de transférer jusqu’à 15 %
entre 1er et 2nd piliers des paiements directs du 1er pilier des années calendaires 2021-26
vers le 2nd pour les années financières 2022-27. Il est également
possible de transférer 10 % du 2nd pilier vers le 1er. Le taux de ce
transfert peut être augmenté de 15 % si les EM utilisent cette
augmentation du Feader pour financer les interventions spécifiques
aux objectifs environnementaux et climatiques. Il peut être
augmenté de 2 % dans d’autres cas spécifiques. Les EM peuvent
revoir leur décision jusqu’au 1er août 2023.
L’évaluation de la La Commission européenne souhaite que 40 % de l’ensemble des
contribution des politiques fonds mis en œuvre dans le cadre des plans stratégiques PAC soient
des EM aux objectifs liés au consacrés aux objectifs liés au changement climatique. Pour en
changement climatique réaliser l’évaluation, un facteur de pondération sera appliqué aux
différentes allocations financières mobilisées par l’EM dans son plan
stratégique PAC.
Facteur de pondération représentant la contribution des politiques
européennes au changement climatique par type d’intervention
Facteurs de
Interventions publiques PAC
pondération
Eco-programme du 1er pilier 100%
Engagements agro-environnementaux et climatiques (types
100%
MAEC, maintien à l’agriculture biologique, agroforesterie)
Paiement de base au revenu durable 40%
Paiement redistributif 40%
Paiements pour les zones à contraintes naturelles et spécifiques 40%
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : proposition de règlement UE - Commission européenne
OCM unique et qualité des produits agricoles
Quelques évolutions La Commission européenne prévoit de maintenir l’architecture et les
introduites par le règlement principales caractéristiques du règlement OCM unique. Le projet de
modificatif ou mini Omnibus règlement le modifie sur un nombre limité de dispositions, tout
comme le règlement relatif aux systèmes de qualités applicables aux
produits agricoles et aux denrées alimentaires et celui portant sur les
différentes modalités portant sur les IGP des produits vinicoles
aromatisés.
Pour mémoire le règlement OCM acté en 2013 régit les domaines
suivants : les interventions sectorielles, le marché intérieur, les
règles de commerce, les filets de sécurité, les règles de concurrence
et d’autres programmes comme la distribution de fruits et de lait
dans les écoles et les régions ultrapériphériques.Un cadre commun pour les marchés
Interventions Marché Filet de Autres
sectorielles intérieur Commerce sécurité Concurrence programmes
Fruits et Règles sur le Certificats Intervention Fruits et lait à
Aides d'Etat
légumes vin (import/export) publique l'école
Nouveau : Règl.
Plan PAC
Nomes de
Aide au
Vin commercialisa- Contingents RUP*
stockage privé
tion
Règl. 1308/2013
(OCM)
Olives et huile Organisations Restitutions à Mesures
d'olive de producteurs l'exportation exceptionnelles
Règl. 1151/2012
& 251/2014
Droits à
Apiculture Quotas
l'importation
Règl. 228/2013
& 229/2013
Indications
Houblon
géographiques
Autres
secteurs
*régions ultrapériphériques
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : Commission européenne
Le projet de règlement modificatif introduit les principales évolutions
suivantes :
Transfert des interventions sectorielles du règlement OCM
unique vers la proposition de règlement qui traite des plans
stratégiques PAC puisqu’ils en feront partie intégrante,
Simplification du système des IG pour renforcer sa
compréhension par les consommateurs, favoriser sa promotion
et réduire ses coûts administratifs,
Modifications spécifiques aux règles de la politique vitivinicole
sur le marché intérieur,
Suppression des quotas sucre,
Suppression des articles relatifs aux restitutions à
l’exportation,
Plafonnement des programmes Fruits à l’école et Lait à l’école.Première analyse des
propositions législatives
Les premières analyses d’impact
40 % des paiements directs L’évolution de l’architecture environnementale de la PAC impose la
de la PAC consacrés aux mise en œuvre d’un éco-programme, financé par le Feaga, dans le
objectifs liés au changement plan stratégique PAC de chaque EM. Conjointement, la Commission
climatique européenne souhaite que 40 % des paiements directs de la PAC (1 er
et 2nd piliers) soient consacrés aux objectifs liés au changement
climatique. La projection de l’application de la structure actuelle de la
PAC en 2021 montre qu’il faudrait mobiliser plus de 200 M€ sur les
éco-programmes en France pour atteindre l’objectif de 40 %, soit
3,3 % du 1er pilier.
Le plafonnement des aides Les propositions législatives réintroduisent le plafonnement
du 1er pilier obligatoire des aides directes du 1er pilier dans chaque EM : total au-
delà de 100 000 € par exploitation après déduction des charges
salariales et de la rémunération du travail des chefs d’exploitation et
dégressif entre 100 et 60 000 €. L’analyse des données PAC 2016
indique que près de 1 400 entreprises agricoles des Pays de la Loire
reçoivent plus de 60 000 € (sur 25 500 bénéficiaires) dont près de
1 200 GAEC. Entre mécanisme de soustraction des charges de travail
et application de la transparence pour les GAEC (non évoquée par les
propositions législatives), l’impact de cette mesure qui pourrait
devenir obligatoire ne présente pas d’enjeux macroéconomiques
dans la région.
30 % des fonds du 2nd pilier Le fléchage d’au moins 30 % des fonds du 2nd pilier vers les mesures
dédiés aux mesures liées à liées à l’environnement, au changement climatique et à la
l’environnement, au biodiversité (hors ICHN) pourrait avoir des conséquences sur la
changement climatique, à la répartition des fonds du 2 nd pilier et sur de nouveaux transferts P1
biodiversité (hors ICHN) vers P2. Cette obligation vérifiée sur la prochaine programmation ne
serait en effet respectée que dans les régions de la moitié nord de la
France selon des simulations réalisées par l’APCA.
Les premières questions posées : les opportunités et les menaces
des propositions législatives
Une complexité accrue Tout en offrant la possibilité de mieux ajuster la PAC « aux réalités
du terrain », les plans stratégiques PAC introduisent une logique de
résultat dans la mise en œuvre de la PAC. Outre les questions posées
sur la nature des indicateurs qui seront suivis et sur les impacts
potentiels en cas d’écart par rapport aux objectifs fixés, quelles
seront les conséquences de cette subsidiarité accrue en termes de de
transfert de complexité, de distorsions entre EM et de risques de
renationalisation de la PAC ?
Hormis l’introduction de l’éco-programme, les propositions
législatives maintiennent globalement la structure des paiementsdirects du 1er pilier en leur assignant le rôle de premier filet de
sécurité du revenu des agriculteurs. Cependant offrent-ils une
couverture suffisante à la volatilité croissante des marchés et à la
multiplication des aléas climatiques et sanitaires ?
Une poursuite de la La poursuite de la convergence interne (au moins 75 %) est
convergence interne programmée jusqu’en 2026 malgré un effort de redistribution des
équitable ? aides du 1er pilier déjà conséquent de certaines régions comme
l’Ouest de la France, pour qui c’est le premier facteur de baisse des
soutiens. Quel équilibre introduire entre cette convergence et le
niveau global de soutien aux exploitations ? Par ailleurs quelles
seront les cibles du nouveau paiement redistributif : quelles classes
de SAU et quels montants ? L’évolution de ces 2 mécanismes devra
être expertisée car ils présentent des enjeux importants pour les
Pays de la Loire.
La mise en place de l’éco-programme pourrait s’imposer (voir
analyses d’impact). Ces mesures dédiées à la lutte contre le
changement climatique constitueront-elles de réelles opportunités
pour les entreprises agricoles (rôle dans le stockage du carbone par
exemple) ou pourraient-elles ne se réduire qu’à de l’optimisation
budgétaire 1er pilier / 2nd pilier ?
Saisir l’opportunité des Le principe des aides couplées est maintenu en reconnaissance de
interventions sectorielles en leur rôle d’accompagnement et de structuration des filières. Cet
élevage ? « effet-levier » est-il constaté dans toutes les filières concernées par
le couplage ? La possibilité offerte par les propositions législatives
d’étendre le dispositif des interventions sectorielles à d’autres
secteurs que les fruits et légumes et la viticulture, peut-elle
constituer une opportunité à saisir pour les filières d’élevage de
l’Ouest ? L’enjeu de la place de la production agricole dans la chaine
alimentaire demeure en effet toujours d’actualité dans un contexte
où les efforts d’organisation économique des filières restent à
poursuivre et de régulation des marchés réduite à sa plus simple
expression.
S’agissant du 2nd pilier, face à la baisse sensible du Feader sur la
programmation 2021-27, accentuée par le recul des taux de
cofinancement, les régions agricoles de l’Ouest ne courent-elles pas
le risque de subir des transferts 1er pilier / 2nd
pilier supplémentaires ? De même, les politiques d’investissement et
de gestion des risques pourraient-elles manquer d’ambitions
suffisantes face aux enjeux ?Conclusion Les propositions législatives sur la PAC ont, à l’instar du projet de CFP 2021-27, suscité de vives réactions de la part des EM et des organisations agricoles à l’échelle européenne comme au niveau national. Ces propositions qui constituent la base de négociation qui commencera cet automne font pour le moment l’objet de nombreuses critiques. Les interrogations sont fortes sur les conséquences multiples de la subsidiarité accrue : complexité administrative, distorsions entre EM, voire renationalisation de la PAC. Certains EM remettent en cause le caractère obligatoire du plafonnement et de la dégressivité du paiement de base. Pour d’autres, c’est la poursuite des convergences externe et interne qui est problématique. La nouvelle architecture verte est également mise en cause par la formulation d’interrogations sur la réelle distinction entre éco-programme (1er pilier) et MAEC (2nd pilier). En ce début d’été, l’heure est encore à l’appropriation des textes, aux interrogations et à l’expression des critiques. La rentrée lancera la phase des contre-propositions puis des négociations. La présidence autrichienne affiche l’ambition de faire progresser autant que possible les travaux des ministres de l’agriculture au cours du prochain semestre sur les propositions législatives de la PAC post 2020 conjointement aux débats sur le prochain CFP et à la négociation du Brexit.
Annexe :
Définitions
Définitions communautaires : une règlementation inchangée
Agriculteur Une personne physique ou morale ou un groupement de personnes
physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon
le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont
l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des
traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne,
en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, et qui exerce une activité agricole telle que
définie par les EM.
Exploitations Ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées
par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d'un même EM.
Définitions communautaires à adapter pour chaque EM
dans le plan de soutiens PAC : un cadre européen plus flexible
Les EM doivent fournir dans leur plan stratégique PAC les définitions
d’ « activité agricole », « surfaces agricoles », « surfaces
admissibles », « agriculteurs véritables », et « jeunes
agriculteurs ».
Activité agricole Doit être définie d’une manière à inclure à la fois la production de
produits agricoles listés dans l’Annexe I du TUE et du TFUE, y
compris le coton et les taillis à courte rotation, ainsi que le maintien
de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage
ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà de pratiques
agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles
courantes.
Surface agricole Doit être définie d’une manière à prendre en compte les terres
arables, les cultures permanentes et prairies permanentes. Les
termes « terre arable », « cultures permanentes » et « prairies
permanentes » devraient être spécifiées par les EM en suivant le
cadre suivant :
Terre arable : doit être une terre cultivée destinée à la
production de cultures ou superficies disponibles pour la
production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les
superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23
et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999, à l'article 39 du
règlement (CE) n° 1698/2005 et à l'article 28 du règlement
(UE) n° 1305/2013,
Cultures permanentes : doivent être des cultures hors
rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages
permanents, qui occupent les terres pendant une période de
cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y
compris les pépinières et les taillis à courte rotation, Prairies permanentes : doivent être définies comme des terres
qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de
l’exploitation depuis cinq ans ou plus, utilisées pour la
production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées
ensemencées naturellement ou non. Ces terres peuvent
inclure d’autres espèces telles que des arbustes et/ou des
arbres qui peuvent être pâturés ou produire des aliments pour
animaux.
Hectare admissible Doit être défini d’une manière à inclure toute surface agricole des
exploitations :
qui, durant l’année pendant laquelle des soutiens sont
demandés, est utilisée pour une activité agricole ou, lorsque
cette surface est également utilisée pour des activités non
agricoles, est principalement utilisée pour des activités
agricoles, et qui est à la disposition de l’agriculteur. Dans des
cas dument justifiés pour des raisons environnementales, les
hectares admissibles peuvent également inclure certaines
surfaces qui ne sont utilisées pour des activités agricoles que
tous les 2 ans,
qui donne droit aux paiements du Titre III, chapitre 2, sous-
section 1 de ce règlement ou sous le régime de paiement de
base ou le régime de paiement à la surface du Titre III du
règlement (UE) n° 1307/2013.
Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont
admissibles que si les variétés utilisées présentent un contenu en
tetrahydrocannabinol qui n’excède pas plus de 0,2 %.
Agriculteur véritable Doit être défini afin de garantir qu’aucune aide n’est octroyée à des
personnes dont l’activité agricole ne forme qu’une partie négligeable
de l’ensemble de leur activité économique ou ceux dont l’activité
économique principale n’est pas l’agriculture, tout en veillant à ne
pas exclure des aides les agriculteurs pluriactifs.
Les EM doivent définir quels agriculteurs ne sont pas considérés
comme des agriculteurs véritables, sur la base de conditions de
revenu, de main d’œuvre sur l’exploitation, de statut de la société
et/ou d’inscription dans un registre.
Jeune agriculteur Doit inclure :
un âge maximum qui ne peut dépasser 40 ans,
des conditions pour être chef d’exploitation,
les formations ou compétences appropriées.Annexe :
Exigences européennes
de la conditionnalité
La conditionnalité comporte les exigences européennes (directives et
règlements) suivantes :
Directive cadre sur l’eau 2000/60 (EC),
Directives nitrates 91/676 (EEC),
Directive oiseaux sauvages 2009/147 (CE),
Directive habitats naturels, et faune et flore sauvage 92/43
(CEE),
Règlement relatif à la sécurité alimentaire 178/2002 (EC),
Directive 96/22 (EC) sur l’interdiction d’utiliser certaines
substances, notamment hormonales, dans les élevages,
Directive 2008/71 (EC) sur l’identification porcine,
Directive 1760/2000 (EC) sur l’identification bovine,
Directive 21/2004 (EC) sur l’identification ovine et caprine,
Directive 999/2000 sur l’éradication de certaines maladies
transmissibles,
Règlement 2016/429 relatif à certaines maladies
transmissibles,
Règlement 1107/2009 relatif à la protection des plantes,
Directive 2009/128 (EC) sur l’utilisation des pesticides,
Directives relatives au bien-être animal 2008/119 (CE),
2008/120 (CE) et 98/58/EC.Réalisation : Chambre agriculture Pays de la Loire · C. LIBEER · Crédits photos : Chambres d’agriculture · Edition : Juillet 2018 Contacts Pôle Economie et Prospective Chambre d’agriculture Pays de la Loire Pierre-Yves AMPROU Tél. 02 41 18 60 60 Mail : pierre-yves.amprou@pl.chambagri.fr (Angers – La R/Y) Christine GOSCIANSKI Tél. 02 41 18 60 57 Mail : christine.goscianski@pl.chambagri.fr (Angers) Gilles LE MAIGNAN Tél. 02 53 46 61 70 Mail : gilles.lemaignan@pl.chambagri.fr (Nantes) Eliane MORET Tél. 02 43 67 37 09 Mail : eliane.moret@pl.chambagri.fr (Laval) Pascale LABZAE Tél. 02 43 29 24 28 Mail : pascale.labzae@pl.chambagri.fr (Le Mans)
Vous pouvez aussi lire