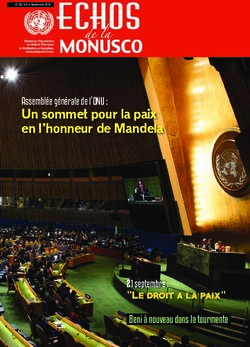Matteo Salvini, rosaire à la main
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Italie : le risque d’une “internationale des nationalistes” En Italie, La Ligue sort grande gagnante de ces élections européennes. Une victoire qui renforce sensiblement le groupe Europe des nations et des libertés (ENL ) dont font partie Marine Le Pen et Matteo Salvini. Matteo Salvini, rosaire à la main Pari réussi pour l’Italien Matteo Salvini. La Ligue du dirigeant d’extrême droite remporte près de 35 % des suffrages en Italie. Elle s’impose largement face à son allié le mouvement Cinq Étoiles. Un succès sans précédent pour un parti qui avait péniblement obtenu 6% des voix en 2014. Le leader de La Ligue confirme donc son statut de nouvel homme fort de l’extrême droite européenne. Il ne manque pas de savourer sa victoire remerciant, rosaire à la main, “celui qui est là, au- dessus, d’avoir aidé l’Italie et l’Europe”. “Le résultat des élections européennes prouve que les règles de l’Europe sont en train de changer. Je suis fier que La Ligue participe à cette nouvelle renaissance européenne fondée sur le travail, la liberté, les peuples et les droits” a-t-il déclaré. Et pour cela, Matteo Salvini compte sur ses alliées français, allemands ou encore finlandais pour former une alliance entre les douze partis nationalistes et identitaires au sein du Parlement européen. Grand rêve de Salvini qui se voit en chef de file “d’une internationale des nationalistes”. La percée des populistes Une image dont on a déjà pu avoir un avant-goût le 18 mai lors du sommet de
l’extrême droite à Milan et qui pourrait bien se concrétiser. En effet, le camp des nationalistes, europhobes et populistes, à la droite du Parti populaire européen se renforce. Le groupe Europe des nations et des libertés (ENL) compte entre autres, le Rassemblement national et La Ligue. Il gagne largement en influence au sein du Parlement européen passant de 37 sièges à 58 après ce scrutin. Une percée importante pour les populistes mais toutefois en deçà des attentes de Matteo Salvini. L’enjeu se trouve maintenant dans les systèmes d’alliances. Car si leur succès électoral est avéré, les différents partis doivent désormais être prêts à coopérer entre eux. Et sur ce point là, rien n’est moins sûr. En attendant d’initier les différentes manœuvres, Salvini continue de clamer “qu’une nouvelle Europe est née”, et avec elle une Italie en voie d’imploser. Sarah Cohen, correspondante de Réforme à Rome Les anti-européens restent minoritaires en Europe Les partis nationalistes ont encore progressé en Europe. C’est la première leçon du scrutin, la plus spectaculaire et la plus inquiétante. Cette progression n’est pas une surprise mais la confirmation d’une tendance qui affecte depuis plusieurs années la plupart des pays du Vieux Continent. Une large fraction de la population européenne est désormais séduite par le discours anti-européen que véhiculent ces partis. Certes ceux-ci ne demandent plus que leurs pays sortent de l’Union ni même de la zone euro, mais leur objectif est bel et bien de démanteler de l’intérieur la
construction européenne. Avec un nombre d’eurodéputés en augmentation, ils vont accentuer leur travail de sape. La défense du projet européen Mais la seconde leçon de ces élections est la plus rassurante pour ceux qui croient à l’intégration européenne. En dépit de leurs succès, notamment en France, ces forces d’extrême-droite restent minoritaires en Europe. Même affaiblis, les partis pro-européens, de quelque tendance qu’ils soient, demeurent les maîtres du jeu. On peut attendre du nouveau Parlement qu’il défende avec détermination, sous l’influence des démocrates-chrétiens, des sociaux-démocrates, des libéraux, des Verts, le projet européen. La question est de savoir comment ils parviendront à convaincre les opinions publiques que le renforcement de l’Union est plus conforme à leurs intérêts que le retour aux souverainetés nationales. Une nécessaire union Car il ne suffit pas d’attaquer les populismes en alertant les électeurs sur les dangers dont ils sont porteurs, il faut aussi leur montrer que l’Europe est capable d’apporter les réponses aux défis qui sont devant elles. La troisième leçon du scrutin est que, pour le moment, rares sont ceux qui le croient. Il est donc temps d’ouvrir les chantiers de l’avenir. Quels sont-ils ? La consolidation de la zone euro, au moment où plusieurs économistes disent redouter une nouvelle crise financière ; la transition écologique, devenue un des enjeux majeurs ; la gestion de l’immigration ; l’affirmation de « l’autonomie stratégique » de l’Europe face à la Chine et aux Etats-Unis. Les Européens sauront-ils s’unir pour aller plus loin sur ces grands dossiers ? Ce n’est pas sûr, mais il faut au moins l’espérer.
Europe : entretien avec François Clavairoly et l’Ambassadeur d’Allemagne en France Questions croisées à Nikolaus Meyer-Landrut, Ambassadeur d’Allemagne en France, et François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France (FPF). L’Union européenne a été bâtie sur l’espérance d’une paix durable et de relations fraternelles entre nations. Est-elle aujourd’hui malade ? Nikolaus Meyer-Landrut : Non, mais l’Europe est toujours à l’épreuve. Il faut se battre pour elle. La paix, le bien-être, les droits de l’homme ne sont jamais acquis. Je suis résolu à dire que, dans les circonstances actuelles, il y a encore plus de raisons de se battre. Cette construction transnationale est un cas unique dans notre histoire. François Clavairoly : Je dirai, dans la même ligne, que l’Europe est en quelque sorte toujours en crise, qu’elle s’interroge en permanence sur le sens de son avenir et que c’est par ce moyen, précisément, qu’elle avance et se construit inlassablement. Comme je l’ai lu récemment dans un ouvrage consacré à cette question, l’Europe n’est pas « finie », dans les deux acceptions de ce terme. Cela veut dire à la fois qu’elle ne va pas mourir et qu’elle n’est pas achevée. La crise qu’elle traverse est en effet liée, notamment, à la mondialisation, et donc à sa situation dans le monde. Cette situation nouvelle engendre des interrogations sur son identité. Le meilleur moyen pour traverser ce genre de crise est encore de passer par les élections, parce que ce geste de l’élection permet de relégitimer ceux qui dirigent l’Europe.
On a coutume d’affirmer que l’Europe est trop économique et pas assez politique. L’élection du 26 mai marque pourtant un moment politique. Pourriez-vous définir quels sont les problèmes politiques que nous devrons résoudre en priorité ? N. M.-L. : D’abord, je veux rappeler que la création de l’Union européenne, par étape, à partir du début des années 1950, a d’abord été un grand acte politique. En choisissant de rassembler les matières premières qui nous permettaient de fabriquer des instruments de guerre, nous avons pris une décision politique. Pour l’avenir, il faut évidemment préserver la paix, mais il faut aussi se rappeler que l’Union européenne ne fonctionne que sur le compromis. Il faut que nous puissions nous retrouver. Pour se retrouver, il faut s’exprimer, il faut voter. C’est une démarche démocratique et participative qui permet à chacun d’avoir un impact sur le cours des choses. Il faut ensuite que les acteurs politiques se saisissent de sujets qui intéressent le plus grand nombre. F. C. : Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’enjeu majeur aura été politique. Mais cet enjeu s’est trouvé redoublé d’un enjeu spirituel. La reconstruction de l’Europe, après 1945, portait l’immense défi de faire revivre ensemble des peuples qui s’étaient déchirés – après la Shoah. Cette idée exprimée dans le livre d’Esaïe : « De leurs épées ils forgeront des socs de charrue, de leurs lances des serpes », autrement dit que le charbon et l’acier serviraient non plus à fabriquer des armes mais à construire les infrastructures européennes, comportait une dimension spirituelle d’inspiration chrétienne. Tel était, en tout cas, l’esprit des fondateurs. Ces éléments sont aujourd’hui enfouis dans la mémoire des jeunes générations. Nous avons (volontairement ?) oublié l’origine de l’Europe en affirmant que son seul projet était économique. Mais, je le crois, il était en réalité politique et redoublé d’une dimension religieuse. Nous sommes ainsi faits : de chair et de spiritualité. N. M.-L. : Je souhaite ajouter un élément. Ce n’est pas par hasard qu’une grande partie des formations politiques fondatrices de l’Union étaient liées à la démocratie chrétienne. Avant la guerre, les mouvements n’affichaient pas leur ancrage spirituel. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il en est allé tout autrement. La CDU a été bâtie sur une convergence politique des catholiques et des
protestants, intégrés à parts égales ou presque. Dans le monde politique et médiatique allemand, les Églises conservent toujours une influence, une responsabilité importante. Après-guerre, elles disposaient en Allemagne d’une autorité morale essentielle. Elles ont donc joué un rôle très important dans les origines de l’Union européenne. Qu’est-ce que la France peut apporter à l’Allemagne aujourd’hui ? N. M.-L. : La France a accordé son pardon à l’Allemagne. La réconciliation est partie de la France et nous ne l’oublierons pas. L’Allemagne s’était complètement discréditée, par le national-socialisme, la Shoah, la Seconde Guerre mondiale. Nous savons à quoi nous amène le nationalisme : la catastrophe. Il n’y a que dans la coopération avec la France que nous parviendrons à juguler ces démons. La coopération franco-allemande consiste en un processus d’apprentissage constant et mutuel. Nos deux pays ont une culture politique et économique très différente. Ces différences sont toujours un élément d’inspiration pour tester ses propres positions. Cela inclut toute la gamme des politiques. La FrF. nce et l’Allemagne sont souvent complémentaires, ce qui nous permet de trouver ensemble des solutions viables pour l’Europe, parce que nos dirigeants sont unis dans la volonté de faire avancer la construction européenne. Qu’est-ce que l’Allemagne peut apporter à la France ? F. C. : Cette question passionnante se pose à chaque génération. Ce que peut apporter l’Allemagne à notre pays, c’est la prise au sérieux d’un projet civilisationnel, culturel et politique, la prise au sérieux d’un tel projet dans la durée. Le choix de vivre ensemble ne saurait se réduire à la seule beauté du geste fondateur. Il faut inscrire l’Europe dans l’histoire d’un projet qui nous tient à cœur. L’Allemagne a cette conscience vive qu’il ne suffit pas d’être révolutionnaire, critique, ni de toujours vouloir « mettre en cause » les principes quand nous voulons donner corps à une telle aventure. Il faut d’abord et surtout avancer, tout faire pour que la construction soit solide.
Lorsque, à l’été 2015, Angela Merkel a décidé d’accueillir un assez grand nombre de réfugiés venus de Syrie en déclarant : « Nous y arriverons », a- t-elle laissé parler sa raison de chef de gouvernement ou son cœur de fille de pasteur ? N. M.-L. : Certainement les deux parce que si les valeurs qui nous ont formés n’irriguent pas nos actes politiques, ils ne servent pas à grand-chose. L’accueil des réfugiés, bien sûr en respectant les possibilités d’encadrement de la société, en mettant en œuvre un travail d’intégration, nous semble absolument nécessaire. Ainsi, nous pourrons montrer au monde que ces valeurs d’accueil et de tolérance, en Europe, sont bien prises en compte par la réalité. D’ailleurs, à ce moment-là, les frontières en Europe étaient ouvertes. Si l’Allemagne avait choisi l’option de la fermeture, je ne veux pas imaginer les drames humains qui se seraient produits et comment les opinions publiques y auraient réagi. F. C. : J’ai écrit un texte à paraître prochainement qui s’appelle « Le signe de Berlin ». Il évoque le signal qu’une société ouverte, comme l’est la société européenne et particulièrement la société allemande, pouvant assumer une charge incroyable, très lourde, à savoir l’accueil de réfugiés venus du Proche- Orient, en mobilisant toutes ses forces, non seulement dans la capitale, ici il s’agit de Berlin, mais encore dans toutes les régions, en faisant en sorte que chacun puisse prendre sa part. Comme il arrive souvent avec les signes prophétiques, il n’a pas été entendu. Rares sont les pays qui ont suivi. Je reste honteux que la France soit placée au17e rang des pays d’Europe quant à l’octroi de la protection accordée aux demandeurs d’asile, alors que la Suède, l’Allemagne, l’Autriche, Malte et la Norvège arrivent en tête. Quelle est la place du protestantisme dans l’Union européenne et de quelle façon ce protestantisme européen peut-il apporter sa pierre à l’édifice ? N. M.-L. : Il y a deux questions dans votre interrogation. Je pense que les protestants engagés dans leur Église, en Allemagne, soutiennent la construction européenne, s’expriment d’une manière positive, encouragent la participation électorale, essaient d’informer les gens sur ces sujets fondamentaux que sont les droits de l’homme, le droit d’asile, la transparence dans le domaine économique, autant d’ambitions qui sont portées par notre Union.
C’est déjà très important. Après, peut-on dire que cette influence protestante conserve une place ? Pour l’Allemagne, je peux le confirmer. Certes, le nombre de gens qui fréquentent les temples diminue, mais le fond, le cœur du protestantisme demeure imprégné par cette tradition. J’en veux pour preuve la réaction des protestants allemands, entre autres face à l’incendie qui a frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cet accident n’a pas produit un seul mort, mais il a provoqué une vague d’émotion, de soutiens, qui montrent que notre chrétienté reste vive, même si nous avons parfois du mal à l’exprimer. F. C. : Le protestantisme, en France, est ultraminoritaire. Ce qu’on lui reconnaît, comme l’a dit le président de la République dans son premier discours adressé à un culte, lors des 500 ans organisés par la FPF à l’Hôtel de Ville en septembre 2017, c’est son rôle de « vigie de la République ». La vigie est ce matelot que l’on fait monter en haut du mât, qui n’a aucun grade particulier, mais qui est requis pour alerter jour et nuit des dangers ou donner la direction d’une terre. Nous voulons bien assumer ce rôle de vigie de la République. Même si la société française est très largement sécularisée, laïcisée. Nous parlons d’ailleurs, à son propos, « d’irreligion ». Je crois malgré tout que la spiritualité reste une ressource vive pour la République. Autant la religion, dans son expression visible, quotidienne, s’efface, malgré quelques velléités prosélytes, autant la question fondamentale de la spiritualité demeure. Le protestantisme est porteur d’un certain nombre de ces questions vives : qu’y aurait-il après la démocratie, si nous voulons toujours vivre ensemble ? Que faisons-nous et que disons-nous face à la grande pauvreté, face aux injustices économiques et climatiques ou face aux discriminations liées à la croyance, l’orientation sexuelle, la couleur de peau ? Comment avançons-nous sur les sujets éthiques ? Les chrétiens ne prétendent pas résoudre seuls ces problèmes.Mais les chrétiens – et parmi eux les protestants – se doivent de les nommer, à leur façon, pour que la République – c’est-à-dire nous tous – n’oublie pas d’y répondre. En Europe, les mouvements populistes ont acquis une grande audience auprès des électeurs. En Allemagne même, l’extrême droite est entrée au Parlement. Quelles leçons tirez-vous de cette situation ? N. M.-L. : Le fait qu’en Allemagne un mouvement de plus en plus ouvertement situé à l’extrême droite et nationaliste, remporte des suffrages, est une vraie
source de préoccupation, je dirais même de déception. Comment, dans un pays qui a été à l’origine du pire, ce type de choses est-il de nouveau possible ? D’une certaine manière, cela nous oblige à investir davantage encore dans le domaine de l’éducation, de nous adresser davantage aux citoyens qui, peut-être, se sentent un peu perdus, enfin d’en tirer les conséquences dans l’action publique et de ne pas se résigner. Nous sommes à un moment crucial du travail de mémoire. On atteint la fin de la période où les survivants de la Shoah sont encore parmi nous. Il nous faudra bientôt transmettre cette tragédie à une génération qui n’a pas été affectée par elle. C’est un défi pour nous tous, en particulier pour l’Allemagne. Réussir cette transformation pédagogique dans la durée, voilà l’épreuve à surmonter. La présence de ce parti d’extrême droite, l’Alternative für Deutschland (AFD), dans le paysage politique doit nous faire comprendre qu’on doit absolument réagir. F. C. : La France a le curieux privilège d’avoir l’un des mouvements d’extrême droite les plus anciens et les plus puissants en Europe. L’apparition ou la diffusion des idées populistes correspond à un changement d’époque. Nos mémoires, qui étaient blessées, font place à des mémoires redevenues indemnes, qui ne portent plus le poids de ce qui s’est passé lors de la Première Guerre mondiale, dans l’entre-deux-guerres et durant la Seconde Guerre mondiale, séquence longue que des historiens désignent comme une autre « guerre de Trente Ans ». L’enjeu de notre temps est de savoir si d’héritiers blessés nous allons devenir des pionniers porteurs d’une promesse encore inaccomplie ou colporteurs d’une détresse pleine de ressentiment et de haine. Il s’agit là d’un enjeu politique et spirituel majeur. Les candidats qui seront élus le 26 mai prochain, pour une bonne part, sont très jeunes. Ils n’ont pas connu cette époque à laquelle nous faisons référence. Notre extrême droite s’allie même à des partis vraiment dangereux… Êtes-vous optimiste au sujet de l’avenir de l’Union européenne ? N. M.-L. : Sur un certain nombre de sujets, je suis convaincu que l’Europe n’existera que si elle est capable d’agir de concert. Les questions de climat, les questions migratoires, la lutte contre le terrorisme sont des thèmes que nous sommes presque condamnés à affronter ensemble. Je suis persuadé que nous allons y parvenir.
Propos recueillis par Frédérick Casadesus Quelques informations pratiques Les élections européennes se dérouleront du 23 au 26 mai dans les 27 États de l’Union. Selon toute probabilité, bien que l’absence d’accord au sujet du Brexit laisse planer un doute sur la suite des événements, le Parlement de Strasbourg réunira 705 députés, soit 46 élus de moins qu’en 2014. Le départ des Britanniques a permis de mieux prendre en compte le poids démographique de quatorze pays de l’Union. C’est ainsi que 79 députés français seront élus, soit cinq de plus que lors de la mandature précédente. Il convient cependant de rappeler que les groupes parlementaires ne sont pas constitués selon des critères de nationalité mais en fonction de leurs orientations politiques. Le Parlement européen compte actuellement huit goupes. Il n’est pas exclu qu’au lendemain du scrutin la situation soit amenée à changer, les tensions face aux mouvements populistes ou l’arrivée de députés venus de la société civile pouvant provoquer des recompositions ou la naissance de nouveaux groupes. En France, le scrutin se tiendra le 25 mai en outre-mer et le dimanche 26 en métropole, dans une circonscription unique et non plus régionale. Trente-trois listes, comptant chacune 79 candidats, ont été retenues. Celles qui obtiendront plus de 5 % des suffrages bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
Christchurch : le terrorisme d’extrême droite, un autre djihadisme ? (1/2) À Christchurch, en Nouvelle Zélande, un Australien, Brenton Tarrant, présenté par la suite par le Premier ministre de son pays d’origine, comme un « violent terroriste extrémiste de droite », a tué 49 personnes, et en a blessé une vingtaine, parce qu’elles étaient de religion musulmane. On est vite passé sur ce drame en France : un énième débat autour des gilets jaunes a pris le dessus, et surtout, dès qu’un terroriste n’est pas djihadiste, on a tendance à le classer dans la catégorie des « fous », et leurs actions tombent presque dans la rubrique des faits divers. Pourtant, le soi-disant fou responsable des morts à Christchurch fait furieusement penser à un terroriste djihadiste : il a pris le temps de planifier son acte meurtrier, et il l’a fait au nom d’une idéologie qui le poussait à tuer une catégorie bien précise de la population de Christchurch. On constate que c’est la même logique raciste et d’extrême droite qui a motivé Brenton Tarrant et quelqu’un comme Dylan Roof, qui a mené une attaque meurtrière contre une église afro-américaine le 18 juin 2015, dans le but de provoquer une « guerre raciale ». On la retrouve également chez Alexandre Bissonnette, le responsable de l’attentat contre une mosquée dans la ville de Québec en 2017, qui a tué six personnes et en a blessé sérieusement cinq autres, uniquement par haine islamophobe. Et ce ne sont que trois exemples parmi d’autres d’actions dont on entend de plus en plus parler ces dernières années, suivant la même logique : une personne issue de l’extrême droite occidentale planifiant un acte de violence contre une partie de
la population vue comme ennemie par son idéologie. Comment ne pas parler, ici, de terrorisme, et d’un terrorisme qui n’est pas sans rappeler le djihadisme, c’est- à-dire fondé sur une idéologie partagée poussant à ces actes de violences ? Notamment dans le monde anglo-saxon : il y a une reconnaissance de la montée en puissance du danger que peut représenter le terrorisme d’extrême droite. Depuis 2007, on constate, aux États-Unis, une augmentation des attaques et de l’organisation d’actions violentes et/ou terroristes par des forces identitaires, selon le CTC (Combating Terrorism Center) de l’Académie militaire de West Point. Mais voir les terroristes identitaires comme des « djihadistes » ou des « néo-croisés » a un avantage : montrer qu’on n’est pas face à des explosions localisées de violence, mais face à un phénomène terroriste global, qui risque de devenir de plus en plus dangereux, si on le traite aussi cavalièrement qu’Al Qaïda avant le 11 septembre… Djihadisme, comment en est-on arrivé là ? Un rapide rappel On a tendance à l’oublier, mais jusqu’aux années 1980, la question religieuse n’obsédait pas le monde musulman. Elle n’était pas totalement absente, mais le fait est que le nationalisme, le questionnement autour du développement, le tiers- mondisme, la lutte intellectuelle autour de la guerre froide, avaient un impact autrement plus important sur le débat politique au Caire ou à Jakarta. Mais ledit débat a été bouleversé par deux attitudes en fait complémentaires : les choix à courte vue des élites politiques, cherchant à préserver leur pouvoir, autant politique qu’économique ; et le travail idéologique d’islamistes de plus en plus radicaux (radicalisés notamment par la violence de l’État, mais aussi par des influences étrangères). Leur propagande a récupéré les sujets importants pour ces sociétés (l’identité à reconstruire après le choc que fut la colonisation, le désir d’indépendance nationale, le refus du néo-impérialisme, etc.) en les adaptant à leur propre idéologie. Ils n’ont pas hésité à utiliser des arguments fallacieux, mais à première vue convaincants, pour détourner des idées importantes pour les sociétés qu’ils souhaitaient conquérir politiquement. Ainsi, ils ont repris l’idée de décolonisation non seulement des territoires mais aussi des esprits, mais pour mieux refuser l’égalité femmes-hommes, ou, pour les
partisans de la violence, soutenir l’idée d’un « choc des civilisations » permanent, rendant une bonne entente impossible entre Orient et Occident… Leur capacité à expliquer le monde par leur idéologie, et à donner des réponses simples, simplistes même, à toutes les difficultés de ces sociétés post-coloniales, leur a permis d’infecter bien des esprits, agacés par la vie difficile, la corruption, et l’hypocrisie occidentale face à des leaders politiques vus comme la source de ces difficultés. Ironie du sort, certains de ces leaders, ainsi que des États importants dans le monde musulman, n’ont pas hésité à soutenir la tendance la plus conservatrice de cette idéologie islamiste, pensant ainsi l’apaiser, voire l’utiliser pour protéger leur propre pouvoir… Quand une société confrontée par un certain nombre de difficultés se trouve face à un pouvoir et un monde intellectuel pas assez sensibles aux difficultés populaires, et qu’une idéologie radicale réussit à détourner des sujets d’inquiétude largement répandus avec des réponses séduisantes mais trompeuses, le pire est à craindre. Al-Qaïda et Daech, idéologiquement, n’ont été possibles que par un long pourrissement du débat politique et intellectuel dans le monde musulman. En fait, ces groupes terroristes ne sont que la conclusion logique d’une idéologie qui dénonçait un certain nombre de boucs émissaires : les régimes en place le plus souvent, mais aussi les progressistes, les personnes vivant leur religion différemment, ou détachés de leur religion d’origine, les femmes indépendantes, les étrangers… Les djihadistes n’ont fait qu’aller jusqu’au bout de la logique islamiste radicale, en utilisant la violence contre les ennemis dénoncés par l’idéologie identitaire qui s’est peu à peu renforcée dans le monde musulman. Islamisme radical d’Orient et extrême droite identitaire d’Occident, une évolution similaire ? Reprenez cette analyse, remplacer « islamisme radical » et « djihadisme » par « extrême droite », et vous retrouverez un portrait perturbant du terrorisme identitaire occidental. Avec quelques différentes de taille néanmoins : des gens comme Dylan Roof ou Brenton Tarrant n’ont pas connu la répression d’un régime autoritaire, ni la torture en prison, contrairement à Ayman Al-Zawahiri, l’actuel leader d’Al Qaïda.
En milieu démocratique, leurs idées ont également la possibilité d’arriver au pouvoir légalement : mais on constate que ces extrémistes, parce qu’ils n’arrivent pas à convaincre, sont de plus en plus tentés par la violence. Cela a été la logique de Brenton Tarrant, qui explique en partie son geste meurtrier par la défaite de Marine le Pen à la présidentielle de 2017, face à un Emmanuel Macron associé vu comme « mondialiste » et « anti-Blanc ». Ces radicaux sont malgré tout issus de sociétés non seulement plus libres, où ils peuvent peser politiquement et s’exprimer ouvertement, mais aussi dans des pays plus riches et bien plus stables que le terreau qui a permis l’émergence de l’islamisme radical et du djihadisme. C’est ce qui explique un succès plus limité des extrémistes identitaires d’Occident, pour l’instant. Pourtant d’un point de vue idéologique, on constate une évolution relativement similaire entre extrémistes d’Orient et d’Occident : une capacité de l’extrême droite à détourner les questionnements contemporains pour les simplifier en les associant à ses propres obsessions : par exemple, la question migratoire. Personne ne peut nier qu’il s’agira sans doute d’un sujet clé du XXIe siècle, surtout si la question climatique s’en mêle. Mais les identitaires, face à cette question, ne remettent pas forcément en question l’interventionnisme des grandes puissances à l’étranger, et n’ont pour logique pour préserver ce qu’ils considèrent être leur culture (culture française ou culture américanisée coupée de ses racines ? on est en droit de se poser la question) qu’une sorte de ligne Maginot, accompagnée d’une violence réelle et raciste, avec l’idée de « remigration ». Elle ne prend pas en compte l’idée de métissage, voire la considère comme une partie du complot : car loin d’être le résultat de questions économiques, géopolitiques et écologiques complexes, la question migratoire est, pour eux, le fait d’un complot des « élites »… Pourtant, comme dans l’Orient musulman par le passé, on constate que face aux arguments d’extrême droite, nous avons une élite politique et intellectuelle qui n’est pas à la hauteur, voire complice, incapable de contrer le discours identitaire, voire le reprenant, pour « gagner des points » politiquement, ou masquer leurs échecs et leurs erreurs. Pour prendre un exemple, il est tout bonnement mensonger d’avoir tenté de caricaturer la situation des banlieues en ne parlant que de leur « islamisation »,
alors que le vrai danger est sécuritaire, lié à un nouveau gangstérisme qui a été peu ou pas étudié, au-delà de quelques exceptions, comme l’excellent travail de Jérôme Pierrat. La réduction de bien des problèmes sociaux, économiques, politiques, et géopolitiques, à l’islam, ou à la question migratoire, est un cadeau extraordinaire à l’extrême droite identitaire. Elle confirme sa propagande, alors que la notion même de « grand remplacement » des « Blancs » par des musulmans, le cœur de son idéologie, est une triste farce : les musulmans, en Europe, représentaient 4,9% de la population européenne en 2016, et 1,1% de la population américaine en 2017. Et l’idée selon laquelle quand on est né musulman, ou reste musulman, et on se marrie uniquement avec un autre musulman, illustre bien la faiblesse de l’argumentation identitaire, qui « fixe » les identités comme autant de blocs intemporels. Une idéologie qui, comme l’islamisme radical, mène naturellement à la violence Cette idéologie d’extrême droite, comme l’islamisme radical, a un caractère fondamentalement violent, à terme. En effet, affirmer qu’on peut parler de « grand remplacement », ou présenter l’islam comme un danger en tant que religion et communauté, sans appeler à la violence est tout simplement absurde : ceux qui prônent ce type de théories du complot présentent la situation actuelle, en France et ailleurs, comme une invasion de fait, par des peuples non- occidentaux, du monde occidental, avec la complicité d’élites « mondialisées », « cosmopolites »… Cette vision de quasi-guerre civile est similaire à l’approche islamiste radicale qui présentait une bonne partie de la société entourant le « croyant » comme « anti- islamique ». Cette idéologie a justifié, par la suite, les attaques terroristes djihadistes contre des civils, vus comme des ennemis autant que les forces de sécurité d’un régime local… De même, le terrorisme d’extrême droite ne fait que prendre le discours identitaire au pied de la lettre, et va, comme son cousin islamiste, jusqu’au bout de cette logique : si on est en guerre, tuer des populations vues comme ennemies devient une obligation. On le voit quand on se penche sur son manifeste, le terroriste de Christchurch
salue et se place dans la lignée d’autres terroristes obéissant à la même idéologie, Anders Breivik bien sûr, mais aussi Dylan Roof ou Darren Osborne, qui a tué une personne en attaquant la mosquée de Finsbury Park à Londres, en 2017. Leur point commun ? Leur engagement politique identitaire, poussé jusqu’à la violence. Brenton Tarrant, lui, s’est positionné clairement comme un identitaire : à tel point, d’ailleurs, qu’il a fait un don de 1500 euros au parti identitaire autrichien, entraînant une réaction policière après Christchurch, et une possible dissolution dudit parti par le gouvernement de Sebastian Kurz. Le chancelier autrichien n’a d’ailleurs pas hésité à insister sur le lien entre idéologie d’extrême droite et terrorisme identitaire, quand il a affirmé : « Aucune forme d’extrémisme ne peut être autorisée à avoir une place dans notre société, qu’ils s’agissent d’islamistes radicaux ou de fanatiques de droite ». Sebastian Kurz a bien compris que Brenton Tarrant, loin d’être un fou, se plaçait dans une logique politique radicale qui n’a rien à envier aux djihadistes. Et que, comme ces derniers, il doit son idéologie à des forces pas forcément violentes, mais tout aussi radicales. Pourtant, comme on le verra dans un prochain billet, il existe, au niveau des médias, des intellectuels, des hommes politiques même, une dangereuse complaisance face à l’extrémisme identitaire occidental. Et cela alors que, comme le dévoile Christchurch, le terrorisme naissant de cette idéologie se structure de plus en plus.
Percée de l’extrême droite en Espagne, Vox face à Podemos Les élections locales de décembre 2019 en Andalousie ont été un véritable coup de tonnerre dans le ciel politique espagnol. Pour la première fois depuis la transition démocratique, un parti d’extrême droite, Vox, a obtenu des sièges dans un parlement régional. Un véritable séisme électoral qui n’avait pas été prédit par les enquêtes d’opinion. À la suite de ces élections, les conservateurs du Parti populaire (PP) et les centristes de Ciudadanos ont scellé un accord pour gouverner l’Andalousie, et en finir avec plusieurs décennies de gouvernement socialiste à la tête de la région. Toutefois, comme ces deux partis n’ont pas à eux seuls obtenu une majorité absolue dans un parlement régional, ils ont dû donc compter sur les élus de Vox, inaugurant pour la première fois un rapprochement entre le centre et l’extrême droite. Un accord que ni le Parti socialiste, ni Adelante Andalusia (la coalition entre Podemos et les verts) n’ont pu éviter. Deux partis populistes Fondé en décembre 2013, Vox était resté relativement en marge du jeu politique jusqu’à cette année, contrairement au parti de gauche radicale Podemos, créé à la même période. Tous deux qualifiés de populistes par les autres formations politiques, ces deux partis ont su attirer des électeurs qui ne se retrouvaient plus dans le bipartisme traditionnel. Porteurs de valeurs radicalement opposées, tous deux critiquent néanmoins les dysfonctionnements du système démocratique mis en place à la suite du régime de Franco, et particulièrement mis en exergue par la crise catalane. Les sondages avaient souligné la probabilité d’une défaite du Parti socialiste espagnol en Andalousie, après quatre décennies au pouvoir, mais aucun n’avait prévu la percée historique de Vox. « Ces résultats ont été une surprise, admet Fernando Vallespín, politologue à l’université Autónoma de Madrid. Les enquêtes n’avaient pas prédit une victoire d’une telle magnitude pour Vox. Les électeurs de droite pensaient que la gauche allait encore gagner, et ont décidé d’avoir un vote
plus expressif, plus radical, en se tournant vers Vox. » Comme Podemos avant lui, Vox a bénéficié des voix de nombreux Espagnols lassés du Parti socialiste (PSOE) et du Parti populaire (PP), et souhaitant marquer leur colère envers « l’establishment ». L’origine des deux mouvements et les motivations de leurs électeurs restent toutefois bien différentes. L’émergence de Podemos sur la scène politique ne peut en effet se comprendre sans analyser l’impact de la crise économique de 2008 et du mouvement des Indignés. « Cette crise a généré beaucoup d’inégalités et de frustrations que nous voyons encore aujourd’hui dans toutes les communautés, note Alfredo Abad, président de l’Église réformée de Madrid. Les partis traditionnels, occupés par leurs luttes internes et leurs préoccupations électorales, n’ont pas su apporter une réponse adaptée. » Si Vox se fait aussi l’écho d’une certaine inquiétude face à la précarité et à la paupérisation des classes moyennes, il ne s’appuie en revanche sur aucun mouvement social et choisit plutôt de dénoncer l’immigration comme une source de problèmes économiques supplémentaires. « La grande différence entre ces deux partis, diamétralement opposés sur l’échiquier politique, c’est que la formation de Podemos s’appuie sur les grandes manifestations sociales qui ont eu lieu en Espagne et sur le mouvement du 15 Mai, confirme Andrew Dowling, spécialiste de l’Espagne, auteur d’un récent ouvrage sur l’indépendantisme catalan, tandis que Vox ne puise ses racines dans aucun mouvement social. » Autre différence de taille : si Podemos s’est essoufflé ces derniers mois, son positionnement de départ était celui d’un mouvement neuf, séduisant pour des individus jeunes et plutôt éduqués, qui n’allaient plus voter. Les électeurs de Vox, au contraire, apportent traditionnellement leur voix au Parti populaire, et souhaitent protéger des valeurs qu’ils considèrent comme menacées. « Vox est un mouvement résolument tourné vers le passé, sur l’importance des valeurs traditionnelles – surtout celles ayant trait à la famille – et sur la vision de la patrie, précise Fernando Vallespin. On peut parler de franquisme sociologique. Le parti récupère ces électeurs d’extrême droite déçus par un PP jugé trop modéré. » Vox et Podemos se rejoignent toutefois dans leur diagnostic et leur stratégie de communication. Tous deux considèrent que le système politique espagnol est
grippé, tous deux mettent en œuvre une excellente stratégie de communication. Leurs arguments sont radicalement différents, mais de leurs discours émerge une critique du consensus démocratique de 1978. On s’en rend compte quand on soulève la question territoriale. La démocratie fragilisée Alors que Podemos souhaite évoluer vers un modèle plus poussé d’État fédéral, Vox ne cesse d’évoquer un retour à un État centralisé, dans lequel les régions perdraient une partie de leur autonomie. Dans ce contexte, la crise catalane cristallise les tensions. Avec sa rhétorique très dure à l’égard de l’indépendantisme, Vox apparaît pour certains segments de la population comme le rempart le plus efficace contre la désintégration de l’Espagne. «Le positionnement de plus en dur du PP sur les questions territoriales et sur l’immigration ouvre aussi une porte à ce parti, souligne Oriol Bartomeus, professeur et politologue à l’université Autonoma de Barcelone. Il donne une légitimité à son discours, alors même que Vox n’est pas associé aux scandales de corruption qui fragilisent les partis traditionnels. » Au-delà de la question catalane et de l’unité de l’Espagne, c’est la question de la viabilité du système politique actuel qui se pose à plus long terme. « Certains se demandent comment on a pu en arriver là, dans un pays qui n’avait pas connu l’extrême droite depuis la transition démocratique et qui semblait bien résister, du fait de son expérience avec le franquisme, explique Andrew Dowling. Il faut comprendre que les personnes acquises à ces idées n’ont jamais disparu. Une minorité se retrouvait dans ces valeurs, mais elle n’avait pas de parti jusqu’ici pour s’exprimer. » Si Vox gagnait encore du terrain, certaines valeurs démocratiques pourraient être fragilisées. Une source d’inquiétude pour de nombreux observateurs, à commencer par l’Église protestante qui se souvient des discriminations et des discours d’intolérance de l’époque de Franco. « Vox nous inquiète parce que c’est un parti qui rejette l’Autre, ajoute Alfredo Abad. Il remet en question certains droits qui sont garantis par le système démocratique espagnol depuis la fin du franquisme, comme l’égalité entre les hommes et les femmes, la protection des minorités ou encore le pluralisme religieux. » Les prochaines élections européennes permettront d’évaluer le rapport de force national.
Démocratie : et si les extrêmes se rejoignaient ? Fils d’un militant belge pronazi parti pour Tanger à la Libération, avant de devenir, au début des années soixante, une des chevilles ouvrières de l’OAS, Jorge Verstrynge a vu le jour en 1948. Il assume avoir été un jeune fasciste engagé dans l’extrême droite française avec la volonté d’en découdre. À la fin des années 1970, Jorge Verstrynge part pour l’Espagne. Élu député en 1982 et 1986 sous l’étiquette de l’Alliance populaire, une fédération de divers mouvements d’origine franquiste, il compte parmi les personnalités de cette famille de droite. La constitution du conglomérat nommé Parti populaire, en 1989, provoque son départ pour le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) en 1995. Trouvant ce parti trop timoré, il participe à la fondation de Podemos. Farouche opposant d’un système fondé sur l’alternance de deux partis modérés, il veut clairement modifier le paysage politique espagnol. Politique et sentiments « L’engagement dans la vie publique, pour moi, consiste à servir, nous a-t-il déclaré lors de son passage à Paris, voici quelques mois. Mais plus que de technique, il s’agit de sentiments. La politique, c’est une affaire de passion. Contrairement à ce que disent les bien-pensants, le peuple existe en tant qu’entité. Pour moi, le peuple, c’est la totalité de la population d’un pays, moins la classe dirigeante. Celle-ci vit dans un autre monde, elle a divorcé du peuple qui l’importune parce qu’il ne fait pas toujours ce qu’on lui dit de faire. En France comme en Espagne, la classe dirigeante méprise le peuple et n’a finalement
qu’une seule idée en tête : en changer, façonner un autre peuple, plus docile. » On discerne dans ce discours la conception classique des penseurs radicaux, pour qui le « peuple » est un groupe homogène qui aurait, parce qu’il est victime du système, toute légitimité pour briser le jeu démocratique. De quelle façon ? « Par nature, le débat public ne produit pas toujours du consensus, observe le philosophe Michel Olivier. Les partisans des partis républicains trouvent cela normal, considèrent que cela fait partie de la règle commune, s’accommodent des imperfections de la démocratie représentative. Au contraire, les populistes croient qu’il est possible d’atteindre l’unanimité. Qu’ils s’autodéfinissent en classe sociale (pour l’extrême gauche) ou en groupe ethnique menacé par les étrangers (pour l’extrême droite), ils prétendent agir au nom du vrai peuple et instruisent le procès en illégitimité des autres élus. » Pour séduire le plus grand nombre, les populistes n’ont d’autre choix que de présenter leur volonté de rupture comme un chemin d’unité. « L’argument le plus fort est de prétendre abolir les désaccords, ajoute Michel Olivier. Comme cela n’est pas réalisable, ils promeuvent une recherche de l’homogénéité des origines. Et comme cette recherche est vaine, ils emploient la violence pour en imposer le mirage. » Une telle démarche implique de nourrir à l’égard de l’exercice du pouvoir une stratégie précise. C’est ainsi que Jorge Verstrynge affirme : « Il n’est pas facile d’exercer le pouvoir et d’être favorable au peuple. La politique ne pourrit pas forcément, mais elle peut le faire. Quand on accède à des responsabilités nationales, on doit choisir avec discernement les orientations stratégiques. » En Espagne, l’extrême droite se concentre sur la question migratoire et l’extrême gauche sur les questions sociales. En France, un clivage demeure entre les deux familles extrémistes. « La dénonciation des élites les rassemble, mais la question migratoire les sépare d’une façon fondamentale, analyse le politologue Jean-Yves Camus. Alors que les populistes de droite veulent réserver aux nationaux des droits essentiels de protection sociale et de citoyenneté, l’extrême gauche fait l’éloge de la société multiculturelle. » Tout rapprochement serait-il voué à l’échec ? Jorge Verstrynge affirme en toute quiétude faire la promotion du rejet des étrangers parmi les militants de Podemos : «Ils ne sont pas tous d’accord avec moi, mais ils m’écoutent avec
attention quand je leur explique que le nationalisme est inévitable, que l’Union européenne est une machine à broyer les citoyens parce qu’elle défend les intérêts financiers des grandes entreprises dont les patrons, de tous temps, se sont révélés favorable à l’immigration d’une main-d’œuvre bon marché. » Récemment, certains porte-parole de la France insoumise ont donné le sentiment que, sur la question migratoire, ils n’étaient pas éloignés des partisans de Marine Le Pen. « C’est un trompe-l’œil, corrige Jean-Yves Camus. Les partisans de la France insoumise restent attachés à la théorie marxiste suivant laquelle la nature du capitalisme étant de faire baisser les coûts du travail, l’arrivée massive d’une main-d’œuvre étrangère participe de la recherche des profits. Cela n’a rien à voir avec la philosophie de l’extrême droite. » Un point de vue partagé par Michel Olivier, qui considère que les traditions politiques, en France, ont la vie dure : «Mais sur certains sujets, notamment à l’occasion des élections européennes, des rapprochements ponctuels, pourraient menacer les équilibres institutionnels. » De quoi rester fermes et vigilants pour défendre la démocratie. En Allemagne, l’effroyable retour de l’antisémitisme Le panneau d’une synagogue détruit à Magdebourg, un entraîneur de football qui se fait traiter de « sale juif » sur Facebook, des graffitis antisémites à Leipzig… Voici quelques exemples extraits de la « chronique des incidents antisémites » de 2018 de la fondation allemande Amadeu-Antonio. Deux cas ont particulièrement
Vous pouvez aussi lire