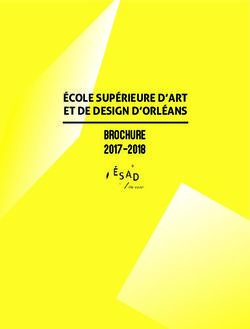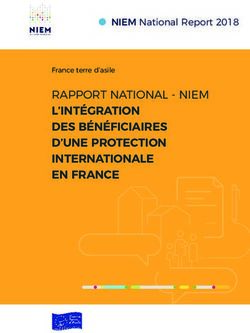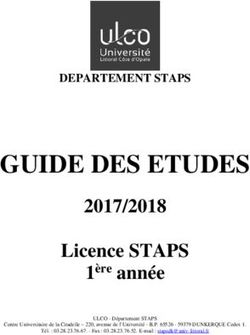LES EXERCICES PARTICULIERS EN MÉDECINE - GUIDE PRATIQUE - URPS ML PACA
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Les exercic es p arti culi ers en m édeci ne
LES EXERCICES PARTICULIERS
EN MÉDECINE
G U I D E P R AT I Q U ELe Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page1
L es exe r c ic e s pa r t ic ulie r s e n m é d e c ine 3
Dr Jean-François GIORLA
Président de l’URPS Médecins Libéraux PACA
Médecins à expertises particulières…..
La multiplicité des modes d’exercice de notre art nous a amené à élaborer
ce guide concernant tout particulièrement les MEP (médecins à exercice “dit“
particulier) afin d’éclairer tous les confrères sur ces pratiques souvent mal
connues et sources de beaucoup de débats et d’idées reçues.
Nos patients nous interrogent quotidiennement sur telle ou telle pratique
et nous sommes bien souvent démunis pour leur apporter une réponse sincère
et objective.
En préambule je tiens tout particulièrement à insister sur le fait, qu’à mon
sens, seul un Docteur en Médecine est habilité à pratiquer ce type d’activité,
car pour appliquer une thérapeutique il faut faire un diagnostic médical et
qu’à ce jour, seuls les médecins sont formés et habilités à l’établir.
La floraison d’une multitude de “praticiens autoproclamés” non médecins
ou non professionnel de santé (les NI-NI) issus de certaines écoles, est non
seulement source de confusion vis-à-vis de nos patients, mais, plus grave,
peut leur faire courir un risque par des indications non appropriées.
La pratique médicale doit rester entre les mains des médecins et dans ce
cadre ces modes d’exercice ont toute leur place dans l’arsenal thérapeutique
que nous pouvons et devons conseiller à nos patients.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page2
4
3 Les ex
exerci
e rci ces
ce s p
parti
arti culi ers en m éd e c ine
PRÉSENTATION
Dr Danielle COLONGEON - BOUKOBZA
Homéopathie
Coordonnateur de la commission MEP de l’URPS Médecins Libéraux PACA
Les médecins à exercice particulier (MEP) et autres modes d’exercice assurent
depuis fort longtemps une part non négligeable des soins en médecine libérale.
Ceux que l’on appelle couramment MEP sont des médecins qui utilisent une
méthode thérapeutique spécifique après une démarche diagnostique identique à
celle de l’ensemble de leurs confrères (homéopathie, phytothérapie, acupuncture,
ostéopathie, nutrithérapie…)
D’autres modes d’exercice regroupent des médecins qui ont un rôle de consultant
exclusif (sexologie, échographie, posturologie, médecine légale…)
Pourtant tous ont été rangés par les caisses d’assurance maladie, dans les années 70,
sous le sigle MEP qui recouvre ainsi plus de 53 spécificités différentes.
Il est très difficile de les individualiser et de les répertorier : nombre d’entre eux
ne sont pas déclarés en qualité de MEP soit parce qu’ils ne sont pas “exclusifs” soit
parce que leur spécificité n’est pas reconnue ; c’est le cas de la phytothérapie par
exemple.
Il est vraisemblable, cependant, que 60% des médecins ait recours régulièrement
ou occasionnellement à une pratique MEP.
De même, nous n’avons pas de statistique sur le plan économique. Nombre de
ces pratiques peuvent générer des économies en termes de santé publique et de “bien-
être” de la population et s’inscrivent également dans le cadre de la prévention active :
diminution de l’absentéisme par exemple, pour une maman dont l’enfant est moins
souvent malade ; diminution du nombre et/ou de la durée des arrêts de travail pour
un lombalgique, diminution de la prise d’anti-inflammatoires, d’antibiotiques,
d’antidépresseurs, traitements lourds mieux supportés, prévention des maladies
métaboliques, optimisation de leur traitement…Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page3
L es exe r c ic e s pa r t ic ulie r s e n m é d e c ine 5
Les médecins MEP peuvent mettre à la disposition de leurs confrères une véritable
expertise dans le domaine de la prévention, de la prise en charges de pathologies
chroniques, de l’alternative ou de la résistance aux antibiotiques, de
l’accompagnement des traitements anticancéreux, de la préservation de
l’environnement (pollution des eaux entre autres)…
Depuis quelques années, on assiste à une forte augmentation de l’utilisation de
ces thérapeutiques par les patients.
Cet engouement représente une part de marché importante et génère un
foisonnement d’offres de soins d’autant plus fantaisistes qu’il n’existe pas de
reconnaissance officielle de la part des pouvoirs publics. Les formations à l’usage
des non médecins, non professionnels de santé, se multiplient. Les thérapeutes auto
proclamés font florès.
L’auto médication sauvage, via internet ou les magazines, les produits en vente
libre, la grande épicerie du tout et n’importe quoi, noient les patients qui, ne se
retrouvant plus dans cette jungle, demandent conseil à leur médecin traitant.
Ce dernier, confronté à la demande des patients, est souvent peu ou mal informé
sur les possibilités offertes par les thérapeutiques MEP.
C’est pourquoi nous avons décidé de les faire mieux connaître à l’ensemble de
nos confrères et l’édition d’un guide nous est apparue comme une solution pertinente
pour une première approche.
Ce guide, nous l’avons voulu simple, parfois même schématique, pour que chacun
puisse y trouver un éclairage immédiat.
Nous avons convié à l’URPS Médecins Libéraux PACA, des responsables
d’enseignement et/ou des experts dans toutes les disciplines pour lesquelles cela a
pu être possible.
Nous leur avons demandé de se conformer à un canevas commun :
• La teneur de leur pratique
• Le cursus initial
• Les formations continues
• Les principales indications
• Les problèmes inhérents à la pratique
C’était une synthèse très difficile étant donné la complexité de certains exercices.
Tous les experts s’y sont prêtés de bonne grâce et nous les en remercions.
Par crainte de ne pouvoir être exhaustifs, nous n’avons volontairement cité
aucune école, société savante, syndicat ou enseignement d’aucune discipline, sauf
cas particulier d’enseignement unique.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page4
6 Les exerci ce s parti culi ers en m éd e c ine
Nos confrères intéressés pourront bien évidement se renseigner aisément pour
la ou les disciplines concernées.
Ces exercices sont très différents : nous avons cependant dégagé des similitudes.
Toutes les formations se déroulent sur une à trois années après les études de
médecine.
Il n’existe, pour aucune d’entre-elles, d’initiation dans le cursus des études
médicales.
Tous les confrères suivent une double formation médicale continue : la formation
classique dont le DPC obligatoire, et une formation continue dans leur spécificité.
Aucune MEP n’est reconnue au niveau des instances officielles.
Toutes demandent des consultations longues et souvent des actes techniques
chronophages.
Pour aucune d’entre elles, il n’est prévu de rémunération spécifique adaptée.
Cet écueil financier et la suppression du secteur II découragent les jeunes
médecins de faire une à trois années d’études supplémentaires sans aucun espoir
d’amélioration de leur exercice.
Notre commission, à l’URPS Médecins Libéraux PACA a toujours œuvré pour la
reconnaissance de ces thérapeutiques.
Ce guide est une “première” et une grande chance pour les MEP de se faire mieux
connaître de leurs confrères, de certaines instances, voire des patients.
Seul le médecin peut poser le diagnostic qui orientera, in fine, l’indication ou
non, d’une thérapeutique spécifique.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page5
L es exe r c ic e s pa r t ic ulie r s e n m é d e c ine 7
Les membres de la commission MEP
de l’URPS Médecins Libéraux PACA
Dr COLONGEON - BOUKOBZA Danielle,
Coordonnateur de la commission
Dr BESSON Nadine,
Rapporteur de la commission
Dr FREDENUCCI Paul
Dr GUEGUAN Jean-Claude
Dr PERRET Jean-François
Dr SABBAH Meyer
Dr SANTINI François-MarieLe Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page6
8 Les exerci ce s parti culi ers en m éd e c ine
SOMMAIRE
Acupuncture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Allergologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Aromathérapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Auriculothérapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Diététique Médicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Homéopathie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Hypnose Ericksonienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Médecine Anthroposophique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Médecins Echographistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Médecine Manuelle Ostéopathique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Médecine Du Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Mésothérapie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Micro-Nutrition, Nutrithérapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Phytothérapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Posturologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Préparations magistrales de phytothérapie
réalisées au sein du préparatoire d’une pharmacie . . . . . . . . . . . . . . . 56
Sexologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Sophrologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tabacologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page7
Le
Lses
e xe
exerc
r ic
c ic
eses
papa
rtric
t ic
ulie
ulie
rsrs
enen
mméd
édec
e ine
c ine 3
9
ACUPUNCTURE
Dr Jean Robert LAMORTE
L’acupuncture est une discipline thérapeutique de la médecine traditionnelle
chinoise (MTC). La MTC est la partie de la médecine qui a pour objet l’étude,
l’application et le développement des pratiques et des savoirs médicaux issus du
monde chinois.
Sur le plan technique “acupuncture” est un terme générique désignant
l'ensemble des techniques de stimulation ponctuelle physiques ou physico-
chimiques (principalement mécanique avec des aiguilles ou thermique avec les
moxas) des points d'acupuncture à visée thérapeutique.
Les points d’acupuncture sont répertoriés dans la tradition médicale chinoise
par leurs noms, leur localisation et rapports anatomiques, leurs fonctions et les
modalités techniques de stimulation (en particulier profondeur et inclinaison de
puncture).
Le Collège Français d’Acupuncture et Médecine Traditionnelle Chinoise (CFA-
MTC) a élaboré en collaboration avec la Société de Formation Thérapeutique du
Généraliste (SFTG) et la Haute Autorité de Santé (HAS) des recommandations de
bonnes pratiques sur le risque infectieux en acupuncture1 (aiguilles stériles à
usage unique, désinfection, hygiène des mains, élimination des déchets
piquants…).
Comme toute discipline thérapeutique l’acupuncture pose la question de son
efficacité et de la pertinence des savoirs mobilisés dans son application.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page8
10
3 Les ex
exerci
e rci ces
ce s p
parti
arti culi ers en m éd e c ine
L’ acupuncture en France
La France est le tout premier pays occidental a avoir inclu l’acupuncture dans
son système de soins avec les structures d’une discipline médicale :
•1933 : première consultation hospitalière d’acupuncture (Paris
Hôpital Bichat) ;
•1945 : première société savante occidentale (Société d’Acupuncture) ;
•1946 : première inscription de l’acupuncture dans une nomenclature
des actes professionnels ;
•1947 : première revue d’acupuncture occidentale (Archives de la
Société Française d’Acupuncture) ;
•1947 : premier congrès international d’acupuncture en Occident
(Paris)
•1950 : avis de l’Académie de Médecine sur le monopole médical de
la pratique de l’acupuncture ;
•1987 : premier diplôme interuniversitaire d’acupuncture dans les
facultés de médecine (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg,
Nantes, Nîmes…).
Formation initiale
Un Diplôme Universitaire est
obligatoire depuis 1987 :
Diplôme Inter Universitaire
d’acupuncture (3 ans) puis à
partir de 2007 Capacité
d’Acupuncture (1 an probatoire
+ 2 ans de capacité).
Formation Médicale Continue
Elle se fait sous l’égide
d’Associations de FMC en
Acupuncture et Médecine
Traditionnelle Chinoise,
regroupées au sein d’une Fédération nationale : la FAFORMEC. Ces associations
assurent la publication de Revues et l’organisation de Congrès et Séminaires.
Société Savante
Le Collège Français d’Acupuncture et Médecine Traditionnelle Chinoise (CFA-
MTC) est la société savante des acupuncteurs, il travaille à l’élaboration et la
validation des contenus scientifiques de formations et de publications.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page9
Le
Lses
e xe
exerc
r ic
c ic
eses
papa
rtric
t ic
ulie
ulie
rsrs
enen
mméd
édec
e ine
c ine 3
11
Evaluation et indications
L’acupuncture a été inscrite
dans la classification commune
des actes médicaux (CCAM) par
la Commission d’Évaluation des
Actes Professionnels (CEAP) de
la Haute Autorité de Santé
(HAS) dans les indications :
nausées et vomissements,
douleur, syndrome anxio-
dépressif, aide au sevrage
alcoolique et tabagique.
La première métaanalyse
positive a été publiée en 1999
portant sur les nausées et les
vomissements post-opératoires2.
En l’état actuel, en se basant
sur les seules données de la
Cochrane Collaboration, les
métaanalyses dans les
pathologies suivantes sont
considérées comme concluant à
un bénéfice potentiel : migraines,
céphalées de tension, lombalgies,
arthrose des articulations
périphériques, douleur durant
l’accouchement, cervicalgies,
dysménorrhée, nausées et vomissements postopératoires3.
Dans les mêmes métaanalyses un effet spécifique de l’acupuncture versus
fausse acupuncture est mis en évidence dans : nausées et vomissements
postopératoires, arthrose des articulations périphériques, céphalées de tension,
lombalgies et cervicalgies2.
En 2014, 2 368 essais contrôlés randomisés étaient indexés dans la base de
données Medline, et 5 950 dans la base de données spécialisée Acudoc2, portant
sur près de 150 situations cliniques.
De même, 500 revues méthodiques portant sur l’acupuncture étaient indexées
dans Medline dont plus de 300 les cinq dernières années. Le premier consensus
professionnel réalisé par l’OMS en 1979 listait 43 pathologies4. Une actualisation
en 19965 référençait 106 pathologies documentées par des ECR.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page10
12
3 Les ex
exerci
e rci ces
ce s p
parti
arti culi ers en m éd e c ine
Problématiques
On constate une discordance entre les données qualitatives et quantitatives
disponibles et la place effective de l’acupuncture dans la médecine française :
enseignement, recherche, inclusion dans les recommandations et les protocoles
de prise en charge.
Il existe un paradoxe entre la France pionnière depuis les années trente de
l’institutionnalisation de l’acupuncture et la lenteur de la diffusion des données
dans le champ médical et la pratique quotidienne. C’est sans doute parce que la
France a été pionnière à une époque de vide de données scientifiques probantes
que des réticences se sont installées.
•Plan général : Distinction claire à faire entre l’acupuncture
envisagée d’un point de vue médical et scientifique (les praticiens)
et l’acupuncture envisagée d’un point de vue historique et culturel
(les sciences humaines). Inscrire l’acupuncture dans les
problématiques et le contexte médicaux et récuser la terminologie
de « médecine alternative ».
•Enseignement : Nécessité d’une information pertinente et
actualisée sur l’acupuncture dans la formation primaire du
médecin.
•Profession.
- Nécessité d’une revalorisation de l’acte. La sous- cotation
actuelle (en dessous de la cotation d’une consultation de
médecine générale) constitue un frein majeur à la pratique,
en particulier en secteur 1.
- Résoudre la contradiction institutionnelle entre l’exigence
constante d’une scientificité et d’un haut niveau de preuve
pour la pratique médicale de l’acupuncture et le laisser-faire
vis-à-vis des non-médecins.
•Evaluation.
- Evaluation équitable de l’acupuncture : avec les mêmes règles
que les autres disciplines thérapeutiques non-
médicamenteuses.
- Prise en compte et inclusion de l’acupuncture dans
l’élaboration des recommandations de bonnes pratiques.
1 SFTG & Haute Autorité de Santé. Hygiène et prévention du risque infectieux au cabinet médical ou paramédical. Juin 2007. Recommandations relatives à
l’acupuncture proposées et validées par le Collège Français d’Acupuncture et MTC le 23 novembre 2006.
2 Lee A et al. The use of nonpharmacologic techniques to prevent postoperative nausea and vomiting: a metaanalysis. Anesth Analg. 1999;88(6):1362-9.
3
Barry C, Seegers V, Guegen J, Hassler C, Ali A, Falissard B. Evaluation de l'efficacité et de la sécurité de l'acupuncture. Inserm U669. 2014.
4 Bannerman RH. The world health organization viewpoint on acupuncture. American Journal of Acupuncture. 1980;8(3):131-5
5 Acupuncture: review and analysis of reports on controlled clinical trials. Geneva: World Health Organization. 2003.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page11
3 Les exerci ce s parti culi ers
Leen
s e
mxe
édreccic
ine
e s pa r t ic ulie r s e n m é d e c ine 13
ALLERGOLOGIE
Dr Yann-Patrick MASSABIE
Toujours non reconnue comme spécialité, l’Allergologie, qui concerne
pourtant un français sur trois, est exercée par seulement 2000 praticiens
français dont 600 sont des allergologues exclusifs. Elle nécessite de longues
consultations, des tests particuliers, enrichis par l’arrivée de l’Allergologie
moléculaire, encore mal organisée au niveau hospitalier sur notre territoire
et touchant plusieurs autres spécialités d’organes.
Définition de la pratique
L’allergologie est la discipline qui s’attache au diagnostic, au traitement et à
la prévention des maladies allergiques et environnementales.
Elle est très liée à une spécialité plus fondamentale : l’immunologie.
L’expertise de l’allergologue s’exerce au cabinet (interrogatoire rigoureux, tests
cutanés immédiats ou retardés, EFR (Exploration Fonctionnelle Respiratoire),
parfois provocation oculaire, mise en place des PAI (Protocoles d’Accueil
Individualisés) ou en hôpitaux/cliniques pour les provocations alimentaires,
médicamenteuses, les tests et immunothérapies aux hyménoptères,
l’interprétation des tests ISAC (112 IgE spécifiques moléculaires en un même
prélèvement) ...Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page12
14 Les exerci ce s parti culi ers en m éd e c ine
Enseignement et formation médicale continue
En France, il y a environ et seulement 2000 diplômés en Allergologie.
1/3 des allergologues dits “exclusifs” n’exercent strictement que l’allergologie
et sont considérés comme des médecins à exercice particulier (MEP).
2/3 environ des allergologues ont une spécialité reconnue (pneumo-
allergologues, dermato-allergologues, pédiatres-allergologues, ORL-allergologues...)
L’allergologie reste donc une capacité/DESC (Diplôme d’Etudes Supérieures
Complémentaires) qui se pratique en deux années (6 séminaires par an et 40
demi-journées de stage) par très grande région (par exemple, dans notre secteur,
la formation est assurée par Marseille, Montpellier, Toulouse et Bordeaux).
La formation continue est assurée par de nombreuses réunions ou congrès
régionaux, nationaux et internationaux.
Les principales indications
- Allergies respiratoires : asthmes, rhinites, conjonctivites
- Allergies alimentaires immédiates, digestives, à forme cutanée (eczéma)
- Allergies aux hyménoptères (abeilles, guêpes, frelons)
- Allergies médicamenteuses
- Eczéma de contact
- Urticaires
- Problèmes environnementaux (polluants...)
- …
Les problèmes
Malgré son 4ème rang au palmarès des préoccupations de santé publique pour
l’OMS et le fait qu’un français sur trois est concerné par au moins une allergie,
l’allergologie n’est toujours pas reconnue comme spécialité en France.
Cela signifie qu’elle n’est donc pas enseignée en tant que telle aux futurs
docteurs en médecine qui, pourtant, y seront confrontés quotidiennement.
Les consultations allergologiques sont longues à la fois pour établir un
diagnostic précis mais aussi pour tout ce qui concerne l’éducation thérapeutique
(asthme, allergie alimentaire, dermatite atopique...). Ce temps nécessaire, très
mal rémunéré en secteur 1, est le principal problème des allergologues.
L’arrivée de l’allergologie moléculaire, notamment par l’utilisation d’IgE
spécifiques des fractions protéiques allergéniques, rallonge considérablement le
temps de consultation.
L’autre problème important est le manque de structures hospitalières
consacrées complètement à l’Allergologie. Les délais d’attente pour une
provocation par exemple sont importants.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page13
L es exe r c ic e s pa r t ic ulie r s e n m é d e c ine 15
AROMATHERAPIE
Dr Alain COLONGEON
Homéopathie
Définition de la pratique
L’Aromathérapie est une branche de la Phytothérapie qui utilise pour soigner
les Huiles essentielles de plantes, fraction volatile des végétaux.
Ce sont des substances huileuses plus légères que l’eau, non miscibles dans
celle-ci, solubles dans l’alcool et tous les corps gras.
Elles sont extraites de différentes parties des plantes, essentiellement par
distillation.
Avicène, Médecin arabe du premier siècle, en parle le premier après avoir
distillé l’huile essentielle de rose. Elle parvient en Europe grâce aux Romains puis
est très utilisée, notamment au Moyen-Age. Mise un peu de côté après l’arrivée
des médicaments de synthèse, elle revient sur le devant de la scène grâce à
Maurice Gratefossé au XXe siècle qui crée, vers 1928, le terme d’Aromathérapie.
Le Docteur Valnet la développe, puis Pierre Franchomme découvre les
chémotypes. Aujourd’hui elle est très utilisée par de nombreux patients et
professionnels de santé.
Les huiles essentielles contiennent de nombreux principes actifs, parfois plus
de 200. C’est le “totum”, l’ensemble de ceux-ci dans leurs proportions naturelles
respectives, qui détermine l’activité et non un principe actif en particulier.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page14
16 Les exerci ce s parti culi ers en m éd e c ine
Elles s’utilisent en général diluées, plus rarement à l’état pur, par voie générale
ou locale.
•Par voie locale, à visée générale ou locale :
- A visée générale : sous forme de massages, au niveau des
poignets par exemple, après dilution dans une huile végétale.
- A visée locale : pour les pathologies cutanées ou muqueuses.
Sous forme liquide après dilution dans un solvant approprié,
en ovules gynécologiques, parfois pures (une goutte pure sur
un aphte par exemple).
•Par voie générale : en dilution sous forme liquide, en gélules,
suppositoires, par adsorption sur un comprimé neutre, à faire
préparer à l’officine.
• Par voie olfactive : à diffuser ou à respirer sous forme d’inhalations
sèches (quelques gouttes sur un mouchoir à respirer plusieurs fois
par jour) ou humides (quelques gouttes dans un bol d’eau chaude).
Il faut toujours utiliser des HE 100%
naturelles dont la qualité et la variété sont
attestées par chromatographie, ce qui
impose de bien connaitre le laboratoire
auprès duquel le pharmacien se fournit.
Les HE doivent être conservées en
petits flacons de verre teinté, fermés, à
l’abri de la lumière dans une boite en
carton.
Les principales indications
Leurs indications thérapeutiques sont larges. Principalement :
- Les pathologies infectieuses de toute nature, locales ou générales.
- Les douleurs : rhumatologiques, traumatologiques, dentaires,
céphalées…
- En gastro entérologie, dans l’ensemble des troubles fonctionnels et
en appoint du traitement des pathologies inflammatoires.
- Les pathologies psychiques, hors psychoses, et neurovégétatives.
- Phlébologie, hémorroïdes.
- En gynécologie : l’équilibre hormonal de la femme, les pathologies
infectieuses, la ménopause.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page15
L es exe r c ic e s pa r t ic ulie r s e n m é d e c ine 17
Correctement utilisées, elles ne sont responsables d’aucun effet secondaire
sérieux, mais leur concentration ne tolère aucune ”fantaisie”. Les risques de
banalisation, mésusage, surdosage existent bel et bien. Elles ne devraient être
prescrites que par des Médecins ou au moins professionnels de santé habilités.
Enseignement et formation médicale continue
La formation se fait comme en phytothérapie dans des écoles privées, ou en
faculté de Médecine et pharmacie (DU, DIU).
La formation continue se fait sous forme de congrès et de publications.
Les problèmes
Les problèmes de l’exercice sont les mêmes que ceux de la Phytothérapie :
non reconnaissance par les instances officielles, consultation longue et sans
rémunération spécifique, formation longue (trois ans en moyenne pour un
diplôme de phytothérapie et aromathérapie), fermeture du secteur II.
Un problème supplémentaire : le phénomène de mode actuel, fait que
l’automédication sauvage (magasins spécialisés, épiceries Bio, voire stands sur
les marchés) donne un sentiment d’innocuité aux patients. Nous risquons, à plus
ou moins long terme, de voir se multiplier les accidents.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page16
18 Les exerci ce s parti culi ers en m éd e c ine
AURICULOTHERAPIE
Dr Michel MARIGNAN
L’auriculothérapie est une approche thérapeutique née dans les années 50,
qui consiste à stimuler des zones précises du pavillon auriculaire (notamment au
moyen d’aiguilles) dans le but de remédier à diverses affections.
L’auriculothérapie ne prend pas ses sources conceptuelles dans l’acupuncture
chinoise (pas de notion fondatrice de méridien ou d’énergie) mais dans les travaux
du Docteur Paul Nogier, médecin lyonnais (1908 – 1996). Son action repose
essentiellement sur la somatotopie neuro-anatomique qui permet de construire
des représentations topiques cutanées des différents organes du corps sur le
pavillon de l’oreille (par l’intermédiaire des neurones du tronc cérébral grâce à
des convergences neuronales) et l’induction de réponses neuronales et
humorales. L’auriculothérapie est une technique de base exclusivement
scientifique.
Sa pratique est réservée aux médecins. Il existe des formations nationales
spécifiques dont un DIU.
Définition de l’expertise et de ses modalités
La pratique de l’auriculothérapie s’inscrit dans une démarche de médecine
conventionnelle bien que souvent étiquetée comme non conventionnelle. Elle est
reconnue par l’OMS. Son exercice est réservé aux médecins, qui doivent être àLe Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page17
L es exe r c ic e s pa r t ic ulie r s e n m é d e c ine 19
même d’en poser les indications, limites et contre-indications. Quand elle utilise
des aiguilles, elle utilise uniquement des aiguilles stériles à usage unique.
Ce n’est qu’à partir d’un diagnostic précis, étayé par le savoir médical et tout
son arsenal que le médecin peut proposer ce type de traitement, en fonction des
données actuelles de la science. Sa mise en œuvre nécessite la connaissance du
domaine et un matériel spécialisé et dédié à sa pratique.
Formation requise
L’auriculothérapie n’est pas abordée dans le cursus des étudiants en médecine
et nécessite une formation complémentaire volontaire. Son enseignement en
France repose essentiellement sur deux structures :
•Un enseignement historique et évolutif, au sein d’une école créée
par le Dr. Paul Nogier, le GLEM (Groupe Lyonnais d’Etudes
Médicales) qui se fait en 12 séminaires de 2 jours répartis sur 2 ans
(150 heures), avec contrôle de connaissances et soutenance d’un
mémoire,
•Une formation universitaire (DIU), récente, en 14 séminaires de 2
jours, aussi sur 2 ans.
Il n’existe pas de DPC en auriculothérapie à ce jour.
Indications principales
Les praticiens revendiquent principalement les
indications suivantes: la douleur même sévère et
les troubles musculo squelettiques (TMS), les
troubles posturaux, les dépendances, les troubles
neurofonctionnels de l’enfant ou de l’adulte (tic,
bégaiement, énurésie, trouble du langage, de
l’écriture), les syndromes anxio-dépressifs, les
allergies, l’eczéma, les infections ORL récidivantes,
les troubles du métabolisme, les troubles du cycle
menstruel, de la sexualité, la préparation à
l’accouchement, l’hypofertilité, les troubles de la
ménopause et divers troubles fonctionnels.
Problèmes actuels de cette expertise
L’auriculothérapie est une approche de choix et une alternative efficace dans
la prise en charge de nombreux troubles fonctionnels. Etant une pratique
thérapeutique considérée non conventionnelle, elle a fait l’objet d’essais en simple
et en double aveugle. L’INSERM a rédigé un rapport très complet à ce titre.
L’auriculothérapie étant une technique de régulation fonctionnelle d’organes,Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page18
20 Les exerci ce s parti culi ers en m éd e c ine
de fonctions ou de segments du corps, elle ne peut fonder ses indications que sur
une approche tout à fait conventionnelle du malade : interrogatoire, examen
clinique, prescription éventuelle d’examens complémentaires afin de faire un
diagnostic positif, différentiel et surtout étiologique.
Le médecin pratiquant ou envisageant de pratiquer un traitement
d’auriculothérapie doit donc au préalable en poser l’indication, au besoin en
faisant appel à des confrères de spécialité avec lesquels il aura un discours
conventionnel. Le traitement par auriculothérapie est donc la conclusion d’une
approche médicale, c’est un plus, un complément thérapeutique innovant et non
une fin.
Par méconnaissance de ses possibilités thérapeutiques, l’auriculothérapie
n’est pourtant pratiquement jamais proposée dans l’arsenal thérapeutique, sa
place exacte dans une prise en charge multi thérapeutique est mal connue et
devrait donc être mieux évaluée.
L’auriculothérapie n’est pas une technique spéciale de l’acupuncture car elle
ne fait pas partie de la médecine traditionnelle chinoise.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page19
L es exe r c ic e s pa r t ic ulie r s e n m é d e c ine 21
DIETETIQUE MEDICALE
Les Membres Experts de la Commission
Méthode
En procédant à l’évaluation des pratiques alimentaires, la détection des erreurs
et des troubles des comportements alimentaires, il est possible de redéfinir un
nouveau modèle d'alimentation adapté au mode de vie du patient. Un suivi est
nécessaire pour explorer les problèmes intercurrents et les récidives d'échec.
La relance de la motivation est essentielle. L'analyse du trouble par le patient
ainsi qu’une réponse adaptée, lui permettent de progresser pour améliorer sa
qualité de vie, son bien-être et sa santé.
Le but de cette méthode est d'améliorer les comportements et les pathologies
par la modification de l’alimentation, en associant éventuellement des
compléments alimentaires.
En constante évolution, elle prend en compte les critères culturels, sociaux et
les évolutions sociétales.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page20
22 Les exerci ce s parti culi ers en m éd e c ine
Principales indications
Le suivi du surpoids, des colopathies, des insuffisants rénaux, des intolérances
alimentaires, des dysorexies, de la personne âgée.
Quelles sont les limites?
Elles peuvent être liées au patient dans sa difficulté à mettre en place de façon
durable une modification de son comportement alimentaire et à la méthode elle-
même: la diététique médicale ne peut pas prétendre tout améliorer.
Formations
Il existe des DU et DIU dans différentes facultés ainsi que des formations
privées (laboratoires).
•Des FMC sur la relation patient-médecin,
•Des FMC en diététique
•Beaucoup de mises à jour se font par les lectures
Problèmes
La relation médecin patient est primordiale, nécessitant une connaissance du
vécu du patient et donc une consultation longue et personnalisée pour atteindre
un consensus sur la pratique alimentaire et sur l'utilisation de compléments
alimentaires.
•La première consultation dure en moyenne une heure.
•Il n’y a pas de reconnaissance des instances officielles
•Il n’existe pas de cotation spécifique.
•Depuis 1989 la suppression de l’accès au secteur II rend difficile la
pratique de la diététique médicale.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page21
L es exe r c ic e s pa r t ic ulie r s e n m é d e c ine 23
HOMEOPATHIE
Les Membres experts de la commission.
L’Homéopathie a été fondée en 1796 par un médecin allemand Samuel
Hahnemann. Au cours de ses recherches, il avait constaté que les
intoxications au quinquina provoquaient une fièvre de type palustre. Il en
déduisit que si ce produit pouvait déclencher la fièvre il devait avoir aussi
la capacité à réduire cette fièvre intermittente en l'administrant à doses très
faibles. En cela Samuel Hahnemann rejoignait Hippocrate : "similia
similibus curantur" (les semblables sont soignés par les semblables).
Définition
L'homéopathie est une approche qui s'appuie sur deux principes fondamentaux :
la similitude et la dose infinitésimale (cf définition d'Hahnemann) :
”Toute substance qui, administrée à dose forte, voire toxique, à l’homme en bonne
santé, déclenche des troubles précis devient, après dilution, donc à dose faible, le
remède capable de faire disparaître ces mêmes troubles lorsqu’ils sont rencontrés
chez un malade”.
Ex : la piqure d’abeille donne un œdème et une douleur brûlante améliorée par
le froid et aggravée par le toucher léger.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page22
24 Les exerci ce s parti culi ers en m éd e c ine
Apis en homéopathie sera utilisé, en rhumatologie, ou sur d’autres
phénomènes inflammatoires à condition de retrouver les signes princeps décrits
ci-dessus.
La mise en œuvre du semblable implique l'utilisation de doses dites
infinitésimales: les doses homéopathiques.
Elles consistent en la dilution et la succussion progressive de la substance de
base en multiple de 10 ou de 100 appelées décimales ou centésimales
Hahnemanniennes (ex : 2DH ou 5CH).
Les Pathogénésies
La mise en œuvre du principe de similitude implique que l'on connaisse les
symptômes provoqués sur l'homme sain par les différentes substances
expérimentées : animales, végétales, minérales, microbiennes...
Les pathogénésies sont le recueil de l’ensemble des symptômes ou effets
toxicologiques résultant de l’intoxication aiguë ou chronique de quelque origine
qu’elle soit.
L'expérimentation pathogénétique est faite en administrant de manière
répétitive à un individu en bonne santé, la substance à expérimenter à doses
infinitésimales.
Ces pathogénésies sont rassemblées dans la matière médicale homéopathique.
La notion de terrain
L’homéopathie implique une prise en considération du terrain du patient qui
explique et sous-tend la maladie aiguë, modulant sa réponse personnelle à
l’agression dont il est victime.
Le terrain d’un individu peut se définir comme : l’ensemble de ses
caractéristiques morphologiques, physiologiques, métaboliques, psychologiques
conditionnant ses possibilités
réactives normales et
pathologiques.
Une part en est
prédéterminée, l’autre est
acquise, modulée par des
contraintes en provenance du
monde extérieur, depuis la
fécondation jusqu’à la période où
nous voyons le malade.
Le terrain se définit par deux
paramètres fondamentaux : la
Diathèse et la ConstitutionLe Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page23
L es exe r c ic e s pa r t ic ulie r s e n m é d e c ine 25
La Diathèse
Elle caractérise l'être humain dans le temps, elle est donc évolutive. Elle
permet d’intégrer dans l’analyse du patient, son passé, son présent, son devenir.
La Constitution
Elle est typologie, donc appuyée sur la morphologie.
Indications
L’Homéopathie recouvre tous les champs de la médecine. Les remèdes peuvent
être administrés seuls ou en complément d'un traitement allopathique classique
pour en potentialiser les effets ou aider à en diminuer la iatrogénie.
Formations
Il existe un enseignement universitaire : DU, DIU dans certaines facultés
•Des écoles privées
•Des sociétés savantes.
•Des syndicats.
•La durée du cursus est de trois ans en moyenne.
La formation médicale continue est assurée par des EPU, des groupes
d’échange de pratique entre pairs, des congrès régionaux, nationaux,
internationaux, ainsi que la littérature : revues de sociétés savantes et syndicales.Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page24
26 Les exerci ce s parti culi ers en m éd e c ine
Problèmes
•Consultations longues et sans rémunération spécifique
•Formation longue (trois ans en moyenne)
•Fermeture du secteur II et non-mise en place d’une tarification
spécifique
•Disparition de souches homéopathiques et de dilutions (monopole
et incidences des investisseurs financiers et directives européennes)
qui posent un réel problème aux praticiens.
•Forte poussée de la mode de l’auto- médication : les patients se
soignent seuls avec des publications de vulgarisation ou sur conseils
de personnes non qualifiées. Les résultats sont faibles bien
évidemment induisant parfois un sentiment de méthode réservée à
la “bobologie”, le patient ne sachant pas toujours à qui s’adresser.
Conclusion
Pour l’Homéopathie comme pour toute médecine, le premier principe est
“primum non nocere, deinde curare”, avant tout ne pas nuire, ensuite soigner.
N’oublions pas qu’établir une prescription homéopathique c’est aussi et
d’abord faire un diagnostic, un pronostic et évaluer l’intérêt de ce traitement par
rapport au traitement allopathique de référence.
"La plus haute et même l'unique vocation du médecin est de rétablir la santé des
personnes malades c'est ce que l'on appelle guérir"*
*Samuel Hahnemann ORGANON de l'art de guérir 6° édition traduction Pierre Schmidt 1948Le Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page25
L es exe r c ic e s pa r t ic ulie r s e n m é d e c ine 27
HYPNOSE ERICKSONIENNE
Docteur Serge MELLOUL
Psychiatre libéral
Lorsque l’on parle d’hypnose, l’idée reçue la plus fréquente est celle d’un sommeil
pendant lequel la personne passive est sous la domination complète de l’hypnotiseur
qui pourra exercer son pouvoir.
Un psychiatre américain, MILTON H. ERICKSON (1901 – 1980) a permis de
modifier toutes ces idées reçues essentiellement par sa pratique originale de
l’hypnose en psychothérapie. Pour lui, l’hypnose est à la fois un état, une technique,
et en même temps un mode relationnel privilégié.
Un état : selon Erickson, tout le monde a la capacité d’entrer en transe hypnotique
spontanément. Il s’agit d’un état de dissociation naturel et habituel pouvant se
produire dans beaucoup de circonstances de la vie quotidienne (sorte de rêverie
intérieure).
Une technique :
•La transe hypnotique formelle a pour objectif d’accroître cet état
dissociatif afin d’accéder à l’inconscient. Pour Erickson, l’inconscient
est le réservoir de ressources et de créativité du sujet qui lui permettra
de surpasser ses difficultés. L’état de transe permet d’y accéder.
Ce qui caractérise cette pratique est l’utilisation de suggestions
essentiellement indirectes destinées à produire l’état hypnotique au
cours duquel viendront s’insérer d’autres suggestions plutôt de typeLe Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page26
28 Les exerci ce s parti culi ers en m éd e c ine
métaphorique à visée thérapeutique. La métaphore est un langage qui
s’adresse plus au cerveau des émotions qu’au cerveau cartésien. Le
conte métaphorique est une forme plus élaborée qui permettra une plus
grande identification du sujet au héros du conte pour atteindre des
objectifs précis (par exemple la cicatrisation de blessures émotionnelles
parfois très anciennes).
•L’hypnose conversationnelle s’intègre volontiers à un entretien.
Un mode relationnel privilégié : il s’agit d’une relation particulière entre
le patient et le thérapeute axée sur la confiance, l’observation,
l’empathie mais aussi l’intuition.
Indications de l’hypnose
- En psychiatrie, il s’agit d’un outil thérapeutique et non d’une thérapie. Aussi,
avant d’envisager son utilisation, un bilan psychologique approfondi permettra de
mieux appréhender la problématique afin de faire du « sur mesure ». Classiquement
son efficacité est réelle dans l’anxiété psychique et physique pouvant aller jusqu’aux
crises de panique. Il est également utilisé dans les états dépressifs en complément
du travail psychothérapeutique verbal. Son action dans les phobies, les TOCS, les
troubles des conduites alimentaires (anorexie, boulimie) et le syndrome de stress
post-traumatique a été reconnue.
- En médecine générale, l’hypnose est utilisée pour aider à apaiser les douleurs,
qu’elles soient chroniques (migraines, lombalgies, douleurs cancéreuses) ou aiguës
(grands brûlés). Elle a été mise en place également pour la rééducation des
hémiplégiques. Elle peut être utilisée dans les addictions de toutes sortes (tabac,
alcool, drogue…) parallèlement à d’autres prises en charge.
- En dermatologie : eczéma, zona, psoriasis, pelade.
- En ORL : vertiges, acouphènes.
- En pneumologie : asthme.
- En soins dentaires : utilisation au cours de l’acte pour diminuer l’anxiété et le
ressenti douloureux.
- En cardiologie : action sur la composante psychologique de certains troubles du
rythme cardiaque et dans l’hypertension artérielle essentielle.
- En anesthésie : Depuis 1992, le professeur Faymonville à Liège a relancé
l’utilisation de l’hypnose en anesthésie moderne (9000 patients opérés sous «
hypnosédation » dans son service avec seulement 18 échecs). Elle permet la réduction
médicamenteuse (sédatifs, analgésiques) en anesthésie locale.
- En soins palliatifs : l’hypnose peut être d’une grande aide pour accompagner
les personnes en fin de vie.
- En pédiatrie : l’enfant est très réceptif à l’hypnose. Dans cet état il accède
facilement au monde imaginaire grâce aux contes. Aussi son action dans l’énurésie,
l’anxiété, les troubles du sommeil, les symptômes psychosomatiques mais aussi enLe Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page27
L es exe r c ic e s pa r t ic ulie r s e n m é d e c ine 29
complément dans le cadre de la prise en charge de pathologies sévères.
- En gériatrie : utilisation de l’hypnose dans le cadre de consultations mémoire.
- En gynécologie : l’hypnose est intéressante tout au long de la grossesse mais
aussi au cours de l’accouchement afin de réduire le stress, les douleurs et l’anxiété.
- En sexologie : chez la femme : les troubles du désir, la frigidité, le vaginisme.
chez l’homme : les difficultés d’érection d’origine psychique,
l’éjaculation prématurée.
Mais il ne faut pas oublier que l’hypnose est avant tout un outil mis à la disposition
du patient d’où l’intérêt de l’apprentissage de l’autohypnose afin qu’il soit autonome.
Contres indications absolues de l’hypnose
•Absolues : les psychoses (paranoïa, schizophrénie) et la dépression
mélancolique.
•Relatives : personnalité border-line, attente d’une action magique.
Formations
Formations Universitaires : DU d’hypnose en faculté de médecine (durée 1 an).
Formations privées : elles se sont multipliées ces dernières années devant
l’engouement que suscite cette pratique. En particulier, depuis 25 ans, ont été créés
dans toutes les régions de France, avec l’aval de la fondation Erickson aux USA, desLe Guide MEP 2 21/05/15 14:03 Page28
30 Les exerci ce s parti culi ers en m éd e c ine
instituts Milton H. ERICKSON regroupés au sein de la confédération francophone
d’hypnose et de thérapies brèves qui organise, tous les 3 ans, un congrès francophone.
Les formations sont ouvertes aux médecins, dentistes, infirmiers, sages-femmes,
psychologues, l’exercice se faisant dans le champ de leurs compétences.
Le coût de ces formations est variable et dépend essentiellement de l’objectif allant
de l’initiation à la formation complète (cf les sites concernés).
Rémunération
•Médecin secteur 1 : aucun tarif spécifique prévu par la sécurité
sociale, certains praticiens la pratiquent hors sécurité sociale.
• Médecin secteur 2 : dépassement pour l’hypnose.
Durée de la séance : variable selon le praticien, en moyenne 30 minutes.
Revues : il existe, depuis 2006, une revue trimestrielle “Hypnose et thérapies brèves”.
Problèmes :
Non reconnaissance financière du temps passé à la préparation d’une séance
d’hypnose ainsi que du temps et de l’énergie nécessaires au déroulement de cette
séance.
Existence de non professionnels de santé exerçant l’Hypnose.
Résumé
L’hypnose Ericksonienne est à la fois un état, une technique et un mode relationnel
privilégié avec le patient.
C’est un outil thérapeutique puissant utile dans des domaines médicaux très
différents (allant de la psychiatrie à l’anesthésie en passant par différentes disciplines
médicales).Vous pouvez aussi lire