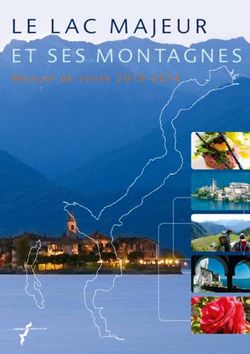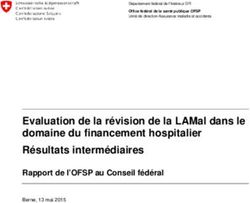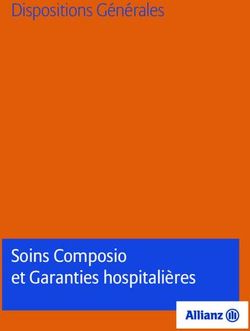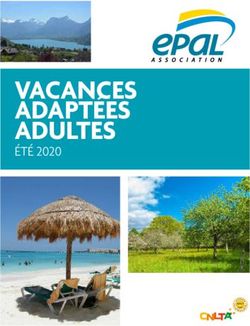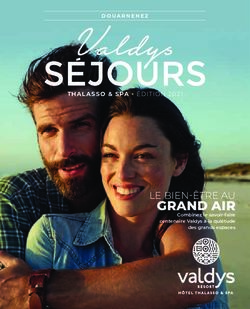Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l'horizon 2005 et extrapolation pour 2010 et 2015
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Perspectives des besoins en lits
hospitaliers pour le canton de Vaud
à l’horizon 2005
et extrapolation pour 2010 et 2015
Août 2000
CANTON DE VAUD Rue de la Paix 6
1014 Lausanne
Service cantonal de Tél. 021/316 29 99
recherche et d’information Fax 021/316 29 50
statistiques http://www.scris.vd.chPerspectives des besoins en lits
hospitaliers pour le canton de Vaud
à l’horizon 2005
et extrapolation pour 2010 et 2015
Alexandre Oettli
Citation autorisée avec mention de la source
Août 2000
CANTON DE VAUD Rue de la Paix 6
1014 Lausanne
Service cantonal de Tél. 021/316 29 99
recherche et d’information Fax 021/316 29 50
statistiques http://www.scris.vd.chPerspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
Remerciements
L’auteur a bénéficié de l’appui d’un comité de projet composé de :
§ Madame Geneviève Stucki, Service de la santé publique (SSP)
§ Monsieur Yves Ammann, Service cantonal de recherche et d’information statistiques (SCRIS)
§ Monsieur Martial Barbier, Institut de santé et d’économie (ISE)
§ Monsieur Adrian Griffiths, SSP
§ Monsieur Michel Montavon, SSP
Il les remercie chaleureusement pour les conseils appréciables dont il a pu bénéficier tout au long de la
préparation de ce document.
En particulier, la réalisation de ce travail n’aurait pu se faire sans l’aide constante apportée par
Monsieur Yves Ammann tout au long de son élaboration. Qu’il soit remercié de sa précieuse
collaboration et de son appui généreux.
L’auteur remercie également Monsieur Roger Krüger (ISE) pour la détermination des durées de séjour
de référence ainsi que pour la rédaction de l’annexe méthodologique.
Finalement, l’auteur émet sa plus vive reconnaissance à Monsieur Christian Lugrin (SCRIS) pour
l’aide fructueuse apportée lors du développement informatique.
SCRIS – août 2000 3Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
Table des matières
1 Préambule _____________________________________________________________ 6
2 Pourquoi une nouvelle étude sur les besoins en lits ? ___________________________ 7
3 Définitions _____________________________________________________________ 9
4 Méthodologie __________________________________________________________ 10
5 Le modèle _____________________________________________________________ 12
5.1 Hospitalisation ___________________________________________________________ 12
5.2 Semi-hospitalisation (HdJ) _________________________________________________ 15
5.3 Hypothèses sous-jacentes __________________________________________________ 16
5.4 Paramètres du modèle_____________________________________________________ 16
5.4.1 Durée de séjour de référence par AP-DRG _________________________________________ 16
5.4.2 Taux d’occupation des lits ______________________________________________________ 16
5.4.3 Evolution démographique ______________________________________________________ 16
5.5 Catégories d’établissements ________________________________________________ 18
6 Résultats ______________________________________________________________ 19
6.1 Résultats « bruts » ________________________________________________________ 19
6.1.1 Hospitalisation _______________________________________________________________ 19
6.1.1.1 Scénario 0 : Scénario de constance des durées de séjour _____________________________ 20
6.1.1.2 Scénario 1 : Scénario de la meilleure durée de séjour _______________________________ 20
6.1.1.3 Scénario 2 : Scénario de la meilleure durée de séjour ajustée _________________________ 21
6.1.1.4 Scénario 3 : Scénario de la seconde meilleure durée de séjour ajustée __________________ 21
6.1.1.5 Durées moyennes de séjour par scénario _________________________________________ 22
6.1.2 Semi-hospitalisation (HdJ) ______________________________________________________ 22
6.1.3 Récapitulatif des résultats « bruts » _______________________________________________ 23
6.1.4 Indication de la volatilité des prévisions ___________________________________________ 23
6.1.4.1 Erreur d’estimation sur la durée de séjour ________________________________________ 23
6.1.4.2 Erreur d’estimation sur la population ____________________________________________ 24
6.1.4.3 Erreur d’estimation sur le taux de recours de la population ___________________________ 24
6.1.4.4 Cumul des trois types d’erreur d’estimation_______________________________________ 25
SCRIS – août 2000 4Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
6.2 Résultats « nets » _________________________________________________________ 26
6.2.1 Etablissements psychiatriques ___________________________________________________ 26
6.2.2 Cliniques privées en soins généraux_______________________________________________ 26
6.2.3 Récapitulatif des résultats « nets » ________________________________________________ 27
6.3 Répartition par secteur géographique et type de lits ____________________________ 28
6.3.1 Répartition par type de lits ______________________________________________________ 28
6.3.1.1 Situation actuelle (1998) _____________________________________________________ 28
6.3.1.2 Scénario 0 : Scénario de constance des durées de séjour _____________________________ 28
6.3.1.3 Scénario 1 : Scénario de la meilleure durée de séjour _______________________________ 29
6.3.1.4 Scénario 2 : Scénario de la meilleure durée de séjour ajustée _________________________ 29
6.3.1.5 Scénario 3 : Scénario de la seconde meilleure durée de séjour ajustée __________________ 29
6.3.2 Répartition géographique _______________________________________________________ 30
6.3.2.1 Hospitalisation _____________________________________________________________ 30
6.3.2.2 Semi-hospitalisation _________________________________________________________ 31
7 Conclusions ___________________________________________________________ 32
8 Bibliographie __________________________________________________________ 33
Annexes__________________________________________________________________ 34
Annexe 1 : Calcul de durées moyennes de séjour attendues à l'horizon 2005 _____________ 34
Annexe 2 : Population 1998 et prévisions démographiques par groupe d’âges ____________ 37
Annexe 3 : Taux d’hospitalisation par groupe d’âges et type d’établissement en 1998______ 38
Annexe 4 : Répartition des lits théoriques A et B par scénario et année__________________ 39
Annexe 5 : Répartition géographique de la prise en charge hospitalière _________________ 43
Annexe 6 : Lits déclarés et lits théoriques __________________________________________ 48
Annexe 7 : Importation et exportation de patients ___________________________________ 49
Annexe 8 : Durées moyennes de séjour utilisées dans les divers scénarii, par AP-DRG _____ 50
Annexe 9 : Séjours hospitaliers selon le type d’assurance et évolution des contrats de type
privé ou semi-privé_____________________________________________________________ 54
Annexe 10 : Comparaison avec les études précédentes du SCRIS sur les besoins en lits ____ 56
SCRIS – août 2000 5Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005 1 Préambule La nouvelle loi sur l’assurance-maladie (LAMal), entrée en vigueur en 1996, confie aux cantons la responsabilité de planifier le domaine hospitalier (article 39 alinéa 1 lettre d). Elle instaure par ailleurs des règles de répartition du financement hospitalier entre l’Etat et les assureurs-maladie, notamment celle d’exclure du financement à charge de ces derniers la part des frais d’exploitation liée à des surcapacités hospitalières (article 49 alinéa 1). Les cantons ont donc la lourde tâche de planifier au plus près le secteur hospitalier, en tenant compte de manière adéquate du secteur privé. Quels sont les déterminants de la demande en structures hospitalières ? 1. Les déterminants que nous appellerons « indirects » sur la demande, tels que la modification du contexte social et des mesures de prévention ; ces effets ne seront pas étudiés ici. 2. Les déterminants « directs » ou « quasi-directs » , essentiellement l’évolution des pratiques médicales (développement de la semi-hospitalisation, nouvelles technologies médicales, etc.) et l’évolution de la démographie (allongement de l’espérance de vie de la population, émigration/immigration, modification de la structure par âge de la population) ; ce sont ces déterminants que nous allons tenter d’appréhender. Afin de ne pas se trouver dans une situation de demande insatisfaite (on assisterait alors à un rationnement des soins) ni dans une situation où l’offre serait largement excédentaire, il est indispensable d’ajuster l’offre à la demande, elle-même fonction, notamment, de l’évolution de ces déterminants « directs ». C’est pour cette raison que le Service cantonal de recherche et d’information statistiques réalise depuis plusieurs années des prévisions sur les besoins futurs en lits hospitaliers, sur mandat du Service de la santé publique du canton de Vaud. On peut notamment citer l’étude 1997 et son actualisation 1998 dont les références figurent dans la bibliographie. SCRIS – août 2000 6
Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005 2 Pourquoi une nouvelle étude sur les besoins en lits ? C’est en 1968 que débuta en Suisse le projet d’introduction d’une classification unifiée des diagnostics médicaux. La VESKA, l’association suisse des hôpitaux entre-temps devenue H+ Les Hôpitaux de Suisse, était responsable de mener à bien ce projet. Les diagnostics étaient alors codés sur la base de la 8ème révision de la classification internationale des maladies (CIM) de l’OMS, puis selon la 9ème révision dès la parution de celle-ci en 1978. Les opérations étaient codées selon une classification développée en Suisse sous la houlette de la VESKA. Le relevé était effectué majoritairement par les établissements hospitaliers de soins aigus, et ceci sur une base volontaire, ce qui rendait toute tentative de comparaison intercantonale stérile. Dès 1990, le canton de Vaud rendit le relevé obligatoire auprès des établissements de soins aigus somatiques du réseau d’intérêt public1 (RIP). La statistique VESKA s’éteignit à la fin de l’année 1997 avec l’entrée en vigueur d’un large projet de statistiques sanitaires devant couvrir l’intégralité du domaine intra-muros, portant l’appellation « Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros) » et placé sous la responsabilité de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Ce projet comprend trois modules : la statistique administrative des établissements de santé non hospitaliers, la statistique administrative des hôpitaux ainsi que la statistique médicale des hôpitaux. C’est ce dernier module qui nous intéresse ici : on y recense l’ensemble des séjours hospitaliers et semi-hospitaliers2, et ceci de manière obligatoire pour tous les établissements hospitaliers suisses, publics ou privés, subventionnés ou non, de soins généraux, de réadaptation, psychiatriques ou encore spécialisés. Notons encore que la statistique VESKA s’est arrêtée à la fin de l’année 1996, le canton de Vaud ayant renoncé à exiger des hôpitaux la statistique VESKA pour les données 1997 afin de permettre à ceux-ci de consacrer cette année aux changements induits par la nouvelle statistique fédérale et pour tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvaient une majorité des hôpitaux, liée aux mutations de plates-formes informatiques et de manière plus générale au renouvellement des systèmes d’information. Ainsi, en 1998 pour la première fois, le domaine hospitalier et semi-hospitalier dans son intégralité est décrit en Suisse, permettant, notamment, des études épidémiologiques et des comparaisons intercantonales et internationales. Les études précédentes sur les besoins en lits – l’étude 1997 et son actualisation 1998 – portaient sur l’ancienne statistique VESKA qui, dans le canton de Vaud, était uniquement remplie par les hôpitaux de soins aigus somatiques du RIP. Dès lors, une nouvelle étude sur les besoins en lits dans le canton de Vaud s’imposait, car la statistique médicale de l’OFS a introduit de profondes modifications par rapport à l’ancienne statistique VESKA ; relevons-en les plus importantes : • les diagnostics sont désormais codés selon la 10ème révision de la classification internationale des maladies (CIM-10) et les traitements selon une adaptation américaine de la 9ème révision de la CIM, qui compte trois volumes, le troisième étant dédié aux traitements (ICD-9-CM volume 3, ICD pour international codification diseases et CM pour clinical modification). En Suisse, la traduction en français de l’ICD-9-CM volume 3 se nomme CHOP ; • l’extension de la statistique à toutes les catégories d’hôpitaux, notamment la réadaptation et la psychiatrie ; • l’obligation de renseigner imposée à tous les établissements hospitaliers, c’est-à-dire également aux établissements privés non reconnus d’intérêt public, à savoir les cliniques privées ; • l’inclusion dans la statistique médicale des séjours semi-hospitaliers3. 1 Le réseau d’intérêt public recouvre les hôpitaux publics ainsi que les hôpitaux privés reconnus d’intérêt public. 2 Voir définition infra au chapitre 3. 3 Voir définition infra au chapitre 3. SCRIS – août 2000 7
Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005 Dans le cadre des études antérieures sur les besoins en lits, les séjours de la statistique VESKA étaient regroupés en DRG (Diagnosis Related Group)4, une classification comportant 473 catégories cliniquement cohérentes et homogènes du point de vue de leur consommation de ressources, lesquels DRG étaient encore regroupés en 119 GPH (Groupes de patients hospitalisés). La classification par DRG est devenue obsolète puisque les codifications internationales utilisées dans le cadre de la statistique médicale des hôpitaux permettent de regrouper les séjours en AP-DRG (All Patient Diagnosis Related Group), de conception plus récente et plus exhaustive que les DRG, en les répartissant en 641 catégories iso-consommatrices de ressources et cliniquement homogènes. Par contre, le regroupement en GPH, par ailleurs contesté du point de vue de son homogénéité clinique, n’est plus disponible avec les AP-DRG. Par ailleurs, le SCRIS vient d’actualiser ses perspectives démographiques pour le canton. Celles-ci montrent un accroissement de la population, lié notamment à une reprise du solde migratoire (différence entre arrivées et départs) et une reprise de l’accroissement naturel (différence entre naissances et décès, notamment lié à l’augmentation de l’espérance de vie). Ceci aura donc un impact non négligeable sur l’effectif de la population à l’horizon 2005 et au-delà, et en définitive sur la demande hospitalière. Toutes ces raisons prônent donc pour une refonte de l’étude sur les besoins en lits, tenant compte notamment des modifications intervenues depuis dans le système d’information sanitaire helvétique en général et vaudois en particulier. Ces nombreuses différences et nouveautés montrent également les difficultés à établir des comparaisons avec les résultats antérieurs de l’étude 1997 et de son actualisation 1998. 4 Méthode de classification des patients utilisée depuis 1983 pour le remboursement des hôpitaux par Medicare, l’assurance obligatoire des personnes âgées aux USA. SCRIS – août 2000 8
Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
3 Définitions
Voici les définitions de quelques termes dont il sera largement fait usage dans le texte :
Séjour hospitalier : Séjour pour un traitement, un examen ou des soins de 24 heures et plus
dans un lit d’une unité de soins. Les urgences qui conduisent à une
hospitalisation, les transferts dans un autre hôpital et les décès survenus
en moins de 24 heures sont également comptés comme hospitalisation.
Séjour semi-hospitalier : Séjour médicalement justifié et programmé de moins de 24 heures avec
utilisation d’un lit d’une unité de soins. Les hospitalisations dans des
cliniques d’un jour ( « one-day-surgery » ou institutions de chirurgie
ambulatoire) sont également prises en compte.
Hospitalisation d’un jour : Dans le canton de Vaud, le terme hospitalisation d’un jour (HdJ) est
utilisé pour parler de semi-hospitalisation ; il s’agit d’un certain nombre
d’actes pouvant être pratiqués en moins de 24 heures et identifiés dans
un catalogue figurant en annexe de la convention tarifaire regroupant
les fournisseurs de soins vaudois (médecins, établissements
hospitaliers) et les assureurs (assureurs-maladie et assureurs-accidents).
Cas : Le cas est défini comme le traitement d’un patient fondé sur un
diagnostic principal établi dans le même hôpital. Le diagnostic principal
est le diagnostic qui a essentiellement causé l’hospitalisation. Si le
diagnostic principal du patient change en cours d’hospitalisation, il est
considéré comme un nouveau cas. Lorsque différents traitements
reposant sur le même diagnostic principal et correspondant, dans un
même hôpital, à différentes spécialités ou différents postes de coûts, se
suivent sans interruption, ceux-ci sont considérés comme un seul séjour
hospitalier.
Durée de séjour : La durée de séjour d’un patient est calculée comme suit :
durée de séjour = date de sortie – date d’entrée + 1
Le principe est de compter tous les jours d’hospitalisation durant
lesquels un patient a utilisé un lit, raison pour laquelle on comptabilise
aussi bien le jour d’entrée que le jour de sortie.
Taux d’hospitalisation : Il s’agit du rapport entre le nombre de séjours hospitaliers effectués
dans un espace géographique donné durant une année donnée et la
population résidante la même année dans le même espace
géographique.
Lit : Les lits considérés ici sont des lits « théoriques calculés », à savoir des
lits basés sur une activité exprimée en termes de nombre de journées
d’hospitalisation et convertie grâce à un taux d’occupation standard.
SCRIS – août 2000 9Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
4 Méthodologie
Dans ses grandes lignes, la démarche ne diffère guère de celle utilisée en 1997-1998 : il s’agit, pour
l’essentiel, d’étudier l’évolution des besoins en lits hospitaliers en fonction d’un certain nombre
d’indicateurs :
1. le taux d’hospitalisation, à savoir la fréquence d’utilisation des services hospitaliers par la
population ;
2. la durée des séjours hospitaliers ;
3. les prévisions d’évolution de la population ;
4. le taux d’occupation des lits, comme paramètre standard en fonction des recommandations du
Préposé à la surveillance des prix, c’est-à-dire le rapport entre les journées d’hospitalisation et
les lits.
Le premier indicateur, le taux d’hospitalisation, sera défini comme le rapport entre les séjours
hospitaliers effectués en 1998 dans le canton de Vaud et la population résidante du canton la même
année.
Le second indicateur, la durée de séjour, fera l’objet de plusieurs scénarii élaborés à l’aide de l’ISE ;
sur la base d’un collectif de cas comprenant tous les hôpitaux du canton de Vaud ainsi que les
hôpitaux participant au projet APDRG-Suisse5, trois durées de séjour de référence ont été
déterminées6 :
1. La valeur de durée de séjour par AP-DRG de l’hôpital le plus performant en 1998, parmi les
hôpitaux ayant au moins 25 cas du même AP-DRG ; dans la suite du rapport, le scénario
utilisant cette durée de séjour sera appelé « valeur Best ».
2. La valeur de durée de séjour par AP-DRG de l’hôpital le plus performant en 1998, ajustée
comme décrit à l’annexe 1 ; pour la suite, nous nommerons cette durée « valeur Best* ».
3. La valeur du second hôpital le plus performant par AP-DRG en 1998, ajustée comme décrit à
l’annexe 1 ; nous nommerons cette durée par « valeur Second best* ».
Parmi l’ensemble des AP-DRG pour lesquels des durées de séjour de référence ont été déterminées, il
y en a 51 à 55% – en fonction du scénario – pour lesquels c’est un hôpital vaudois ou la moyenne des
hôpitaux vaudois qui a déterminé la valeur de référence. Si l’on se place du côté du nombre de séjours,
cela représente une proportion de séjours comprise entre 60 et 67% selon le scénario.
La méthode utilisée par l’ISE pour calculer les durées de séjour est identique à celle adoptée au sein du
groupe APDRG-Suisse, à savoir une modélisation des durées de séjour par AP-DRG selon la loi
Gamma et calcul des bornes des valeurs extrêmes inférieures et supérieures.
Dans les situations suivantes, la durée de séjour réelle sera conservée :
1. Lorsque l’AP-DRG fait partie des AP-DRG dits inclassables ou « poubelles » (AP-DRG 467,
468, 469, 470, 476, 477).
2. Lorsque les durées de séjour réelles sont à l’extérieur des bornes des valeurs extrêmes
inférieures ou supérieures (outliers) ; en effet, dans ce cas, on part du principe qu’il s’agit d’un
séjour atypique et il n’y a aucune raison d’en modifier la durée.
3. Lorsque l’AP-DRG fait partie de ceux qui regroupent moins de 25 cas par hôpital au sein du
collectif APDRG-Suisse y compris Vaud.
5
Il s’agit des HUG (hôpitaux universitaires de Genève), du CHUV, de l’hôpital de Morges, des 7 hôpitaux
tessinois de l’Ente Ospedaliero Cantonale et de 15 hôpitaux zurichois (y compris l’hôpital universitaire).
6
Voir la méthodologie de détermination de ces durées de séjour en annexe 1.
SCRIS – août 2000 10Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
La classification des séjours par AP-DRG ayant essentiellement été élaborée pour les soins aigus
somatiques, elle n’est applicable ni aux hôpitaux psychiatriques ni aux centres de traitement et de
réadaptation. Ainsi, seuls les séjours hospitaliers des établissements universitaires, de zone et
régionaux feront l’objet de scénarii d’évolution des durées de séjour par AP-DRG. Quant aux
cliniques privées, au vu de la faible qualité du codage et de la non-exhaustivité des codes saisis,
l’utilisation des valeurs de référence par AP-DRG n’a que peu de sens. Aussi, aucune hypothèse sur
les durées de séjour des cliniques privées ne sera faite dans un premier temps.
Pour le troisième indicateur, les prévisions d’évolution de la population, nous exploiterons les
perspectives démographiques 2000 du SCRIS, version 27, correspondant à un scénario moyen
(hypothèses raisonnables). Comme mentionné supra, ces nouvelles prévisions démographiques
tiennent compte de deux éléments nouveaux : un accroissement de la population, lié notamment à une
reprise du solde migratoire (différence entre arrivées et départs) et une reprise de l’accroissement
naturel (différence entre naissances et décès, notamment lié à l’augmentation de l’espérance de vie).
Quant au dernier indicateur, le taux d’occupation des lits, nous utiliserons 85% pour les soins aigus
et 90% pour les soins de réadaptation et spécialisés, ces taux étant ceux de référence utilisés par les
instances fédérales lors de l’évaluation des surcapacités hospitalières.
En définitive, l’estimation des besoins en lits hospitaliers mesurera essentiellement l’impact de
l’évolution des perspectives démographiques et des pratiques médicales – appréhendée par la durée
des séjours hospitaliers.
7
En cours de publication.
SCRIS – août 2000 11Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
5 Le modèle
Nous commençons par décomposer l’activité en hospitalisation « traditionnelle » et en semi-
hospitalisation (ou encore hospitalisation d’un jour, HdJ). La qualité de la variable identifiant les
séjours par type de prise en charge (hospitalisation ou semi-hospitalisation) étant par trop aléatoire
dans les données médicales de l’année 1998, nous avons choisi une règle simplificatrice pour
distinguer les séjours semi-hospitaliers : lorsque le patient est sorti le même jour qu’il est entré, nous
sommes partis du principe qu’il s’agit d’une semi-hospitalisation. Cette règle induit un double biais :
- un biais vers le haut, c’est-à-dire une surestimation du nombre de semi-hospitalisations : en effet,
les patients décédés le jour de leur entrée à l’hôpital ou les patients transférés le jour de l’entrée
dans un autre établissement sont considérés, dans le canton de Vaud, comme des hospitalisations ;
- un biais vers le bas, c’est-à-dire une sous-estimation du nombre de semi-hospitalisations : un
patient en semi-hospitalisation peut, dans certaines situations, sortir le lendemain de son entrée à
l’hôpital.
La probabilité que les deux biais se compensent est nulle, mais la probabilité que la somme soit faible
est élevée. Aussi, nous avons fait l’hypothèse de neutralité de ces deux biais.
Une méthode de détermination des lits théoriques nécessaires différente pour l’hospitalisation et la
semi-hospitalisation a été choisie :
5.1 Hospitalisation
Mathématiquement, le modèle peut être schématisé de la manière suivante :
a) Les équations (1) à (3) ci-dessous sont appliquées individuellement à chaque séjour hospitalier :
(1) (
e B = max e; e L )
(2) (
sˆ Bn = min e + dˆ n ; s L )
(3) dˆ Bn = sˆ Bn − e B + 1
où n désigne le scénario de durée de séjour
L désigne une valeur limite
B désigne une valeur bornée
e = la date d’entrée du patient
e L = la limite inférieure de date d’entrée, soit le 1er janvier 1998
e B = la date d’entrée corrigée (bornée par le bas)
d̂ n = la durée de séjour standard par scénario
s L = la limite supérieure de date de sortie, soit le 31 décembre 1998
ŝ Bn = la date de sortie corrigée en fonction de la durée de séjour standard et bornée par le haut,
par scénario
d̂ Bn = la durée de séjour sur l’année 1998 corrigée en fonction de la durée de séjour standard,
par scénario
SCRIS – août 2000 12Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
b) On applique maintenant les équations (4) et suivantes sur des catégories de séjours :
s1998,i ,k
(4) tˆ2005,i , k = t1998,i ,k =
p1998,i
∑ (dˆ Bi , j , k , n * s1998,i , j ,k )
dˆ Bi , k , n =
j
(5)
s1998,i ,k
(6)
s
∑ (
dˆBi , j ,k ,n * s1998,i, j ,k )
∑i pˆ 2005,i * p1998,i,k * j s
∑(pˆ * tˆ2005,i,k * dˆBi ,k ,n )
1998,i 1998,i ,k
2005,i
Lˆ2005,k ,n = i
=
365* ak 365* ak
∑ p
pˆ 2005,i
(
* ∑ dˆ Bi , j , k , n * s1998,i , j ,k
)
=
i 1998 ,i j
365 * a k
où B désigne une valeur bornée
i désigne le groupe d’âges
j désigne l’AP-DRG
k désigne le type d’établissement
n désigne le scénario de durée de séjour
t1998,i ,k = le taux de recours à l’hospitalisation par groupe d’âges et type
d’établissement en 1998
tˆ2005,i ,k = le taux de recours à l’hospitalisation par groupe d’âges et type
d’établissement, estimé en 2005
s1998,i ,k = la quantité de séjours par groupe d’âges et type d’établissement en 1998
s1998,i , j , k = la quantité de séjours par AP-DRG, groupe d’âges et type d’établissement en 1998
p1998,i = la population résidante du canton de Vaud par groupe d’âges en 1998
pˆ 2005,i = la population résidante du canton de Vaud, estimée par groupe d’âges en 2005
dˆ Bi , j ,k ,n = la durée de séjour bornée, par groupe d’âges, AP-DRG, type d’établissement
et scénario
dˆBi ,k ,n = la durée de séjour bornée, par groupe d’âges, type d’établissement et scénario
ak = le taux d’occupation des lits par type d’établissement
Lˆ 2005 , k , n = la quantité de lits théoriques nécessaire par type d’établissement et scénario,
estimée par le modèle à l’horizon 2005
SCRIS – août 2000 13Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
Equations (1) à (3) :
Ces trois équations sont appliquées individuellement à chaque séjour.
Nous appliquons une durée de séjour standard par AP-DRG à chaque séjour, en partant de la date
d’entrée ; on recalcule ainsi une nouvelle date de sortie pour chaque séjour – excepté pour les cas où
aucune modification des durées de séjour n’est faite comme mentionné supra sous Méthodologie. Ce
faisant, il est important de noter que la date d’entrée des patients demeure fixe et la date de sortie est
déterminée comme suit :
date de sortie = date d’entrée + durée de séjour standard – 1
Etant donné que nous cherchons à définir la quantité de lits nécessaire durant une année donnée, les
séjours seront bornés au 1er janvier et au 31 décembre 1998. En effet, ce n’est pas la durée de séjour
globale des patients qui nous préoccupe dans l’estimation de l’offre nécessaire, mais bien la durée de
séjour durant l’année 1998. Ainsi, la date d’entrée de tous les séjours ayant débuté avant le 1er janvier
1998 sera ramenée au 1er janvier 1998, et la date de sortie de tous les séjours s’étant terminés après le
31 décembre 1998 sera ramenée au 31 décembre 1998. Une nouvelle durée de séjour théorique et
tronquée est ensuite calculée. Il est intéressant de remarquer à ce stade que, théoriquement, il est
possible par cette procédure de « perdre » des séjours : par exemple, un patient entré le 20 décembre
1997 et sorti le 3 janvier 1998 (durée de séjour à l’hôpital : 15 jours) peut se voir attribuer une durée
de séjour de référence de 11 jours au lieu de 15 ; ainsi, le patient serait sorti le 30 décembre 1997 au
lieu du 3 janvier 1998 et il aurait échappé au collectif de cas 1998 : on aurait ainsi « perdu » un séjour.
Equation (4) :
Le taux de recours à l’hospitalisation correspond au rapport des séjours effectués en 1998 par la
population résidante la même année. On fait ici l’hypothèse que ce taux est constant dans le temps par
groupe d’âges et par AP-DRG.
Equation (5) :
Pour chaque scénario, groupe d’âges et type d’établissement, on prend les diverses durées de séjour
bornées sur l’année 1998 que l’on pondère par le nombre de séjours par AP-DRG. On obtient ainsi une
durée de séjour moyenne par groupe d’âges, type d’établissement et scénario.
Equation (6) :
La demande théorique en lits d’hôpitaux est déterminée comme la somme par groupe d’âges du
produit de la population prévue par groupe d’âges, du taux d’hospitalisation par groupe d’âges et
d’une durée moyenne de séjour par groupe d’âges. Le tout est ensuite divisé par le nombre de jours
dans l’année (365) et par le taux d’occupation théorique des lits (85% pour les lits de type A8 et 90%
pour les lits de type B9).
8
Lits destinés à des personnes atteintes d’affections aiguës nécessitant la mise en œuvre de mesures médicales
continues et intensives. Les moyens d’investigation, d’intervention et de traitement qui en découlent sont
importants en termes d’équipement et de personnel. Le séjour est en règle générale de courte durée.
9
Lits destinés à des personnes atteintes d’affections aiguës ou non stabilisées, nécessitant la mise en œuvre de
traitements médicaux, de mesures de réadaptation ou de soins palliatifs. Les moyens d’investigation et de
traitement qui en découlent sont moins importants en termes d’équipement et de personnel que pour les lits A. Le
séjour est en règle générale de moyenne durée.
SCRIS – août 2000 14Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
Le numérateur de l’équation (6) peut aussi être exprimé comme le produit, par groupe d’âges, de
l’activité standardisée des hôpitaux (en journées) en 1998 par le rapport des populations entre 2005 et
1998.
Correctifs :
La statistique médicale 1998 de l’OFS en étant à sa première année d’exploitation, nous avons
constaté des différences parfois importantes entre le nombre de séjours recensé dans cette statistique et
le nombre de séjours émanant du système de financement des hôpitaux publics et reconnus d’intérêt
public10. Aussi, partant du principe que dans cette phase de démarrage de la statistique médicale les
indications sont certainement moins fiables que celles qui proviennent de la formule de correction des
hôpitaux, le nombre de séjours provenant de cette dernière a été utilisé pour extrapoler les résultats
provenant de la statistique médicale. En ce qui concerne les cliniques privées, il n’existe pas de
données financières équivalentes et c’est la statistique administrative de l’OFS qui a servi de source à
l’extrapolation des résultats provenant de la statistique médicale.
5.2 Semi-hospitalisation (HdJ)
Pour les cas de semi-hospitalisation, étant donné que la durée de séjour est fixe à 1 jour, seule
l’évolution démographique a un impact sur les besoins théoriques en lits semi-hospitaliers – sous
l’hypothèse de stabilité des pratiques de semi-hospitalisation . La formule suivante a été utilisée pour
calculer les lits théoriques :
pˆ 2005,i
∑ p * s1998,i,k
i 1998,i
Lˆ2005,k =
260
où i désigne le groupe d’âges
k désigne le type d’établissement
s1998,i ,k = la quantité de séjours semi-hospitaliers par groupe d’âges et type d’établissement
en 1998
p1998,i = la population résidante du canton de Vaud par groupe d’âges en 1998
pˆ 2005,i = la population résidante du canton de Vaud, estimée par groupe d’âges en 2005
Lˆ2005 , k = la quantité de lits théoriques nécessaire par type d’établissement,
estimée par le modèle à l’horizon 2005
Partant du principe que les interventions HdJ se déroulent en général du lundi au vendredi, soit 5 jours
par semaine, l’activité semi-hospitalière annuelle est limitée à 260 jours (= 5 * 52).
Ici aussi, les résultats provenant de la statistique médicale ont été extrapolés par rapport aux nombres
de séjours émanant soit de la formule de correction pour les hôpitaux, soit de la statistique
administrative pour les cliniques privées.
10
Il s’agit de la formule de correction des hôpitaux qui permet d’assurer la garantie de leur enveloppe
budgétaire.
SCRIS – août 2000 15Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
5.3 Hypothèses sous-jacentes
1. Le taux de recours à l’hospitalisation (y compris la semi-hospitalisation) par groupe d’âges
demeure constant dans le temps.
2. La proportion d’activité dévolue aux patients résidant hors du canton reste constante dans le
temps11.
3. Le proportion de patients vaudois ayant recours à des structures hospitalières extracantonales
demeure constante dans le temps12.
4. Le case mix (lourdeur de prise en charge moyenne) des patients – à savoir la répartition des patients
entre les différents AP-DRG – est invariant dans le temps.
5.4 Paramètres du modèle
Trois paramètres figurent dans le modèle de détermination des besoins en lits hospitaliers :
1. La durée de séjour de référence pour chaque AP-DRG, en fonction des divers scénarii évoqués
supra.
2. Les taux d’occupation des lits.
3. Les prévisions démographiques
En se fondant sur l’analyse des séjours HdJ par AP-DRG et centre de prise en charge, et en
comparaison avec l’hospitalisation, des perspectives de développement de la semi-hospitalisation
pourront par la suite permettre d’affiner les présentes perspectives. L’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive (IUMSP) est chargé par le SSP de mener une étude sur ce potentiel de
développement de l’HdJ, dont les résultats devraient être connus vers la fin du troisième trimestre
2000.
5.4.1 Durée de séjour de référence par AP-DRG
Comme nous l’avons vu plus haut, les trois durées de séjour de référence correspondent aux valeurs
« Best », « Best* » et « Second best* ».
5.4.2 Taux d’occupation des lits
Tel que mentionné supra, les taux d’occupation choisis sont de 85% pour les lits de type A et 90%
pour les lits de type B.
5.4.3 Evolution démographique
Comme on peut le constater sur le graphique ci-dessous, un net accroissement de la population est
prévu dès les années 2005-2010. Alors que la hausse du nombre d’enfants de moins de 18 ans est
faible, celle des adultes de plus de 18 ans est particulièrement élevée. Cette évolution fortement
positive de la population prévue aura un effet certain sur l’activité des hôpitaux, sous l’hypothèse que
le taux de recours à l’hospitalisation demeure constant.
11
Voir annexe 7.
12
Voir annexe 7.
SCRIS – août 2000 16Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
Evolution1 démographique par groupe d'âges
350 000
300 000
250 000 0 - 17
18 - 49
200 000
50 - 69
70 et +
150 000
100 000
50 000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
Prévisions depuis 2000
En partant d’une population totale résidant dans le canton de Vaud de 607'879 personnes en 1998, les
prévisions démographiques nous amènent à 679'363 personnes en 2010, soit une progression de 12%
durant cette période et 709'969 en 2015, soit une progression de 17% durant la période. En se
focalisant sur les personnes âgées, on passe de 68'935 résidants de 70 ans et plus en 1998 à 81'492 en
2010, soit une progression de 18% et 93'684 en 2015, soit une hausse de 36%. Le taux de recours
actuel à l’hospitalisation est de 41% chez les plus de 70 ans alors qu’il est de 12% dans le reste de la
population, soit un rapport de 3,4 pour 1. Cette progression du nombre de personnes âgées aura donc
un impact non négligeable sur la demande potentielle en soins hospitaliers à l’horizon 2010-2015. Si
l’on se place du point de vue des journées d’hospitalisation, les personnes âgées de 70 ans et plus en
consomment même 4,8 fois plus que le reste de la population, leur durée de séjour moyenne étant 40%
plus longue.
SCRIS – août 2000 17Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
5.5 Catégories d’établissements
Les catégories d’établissements choisies dans le cadre de l’étude sont les suivantes :
Types d’établissements hospitaliers Hôpitaux
13
CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
Autres hôpitaux universitaires Ophtalmique, Orthopédique, Enfance, Policlinique médicale
universitaire (PMU)
Hôpitaux en soins généraux Morges, Montreux, Samaritain, Nyon, Yverdon, Payerne,
Aigle, St-Loup/Orbe, Lavaux, Aubonne, Rolle, Vallée de Joux,
Ste-Croix, Moudon, Pays-d’Enhaut
Hôpitaux psychiatriques Secteurs Centre, Ouest, Nord et Est, Le Vallon
Centres de traitement et de réadaptation Grande Fontaine, Mottex, La Côte, Chamblon, Sylvana,
et hôpitaux spécialisés Miremont, Lavigny, Plein-Soleil, Rive-Neuve
Cliniques privées en soins généraux Cecil, Bois-Cerf, Genolier, Montchoisi, Longeraie, Providence,
La Source
Cliniques privées spécialisées Beau Réveil, La Lignière, La Métairie, La Prairie, Valmont
L’hôpital de la Grande Fontaine ainsi que les cliniques privées La Rosiaz et Bon Port n’ayant pas
rendu leurs statistiques médicales, leurs données ne peuvent pas faire partie du collectif de cas
exploités.
Par ailleurs, la clinique Bois-Cerf n’a pu fournir en 1998 qu’un relevé minimal ne contenant ni les
diagnostics ni les traitements des patients.
Les patients de la Grande Fontaine14 (environ 40 séjours en 1998) ainsi que de Bois-Cerf (environ
1750 séjours en 1998) seront pris en compte à la fin de l’analyse sur la base des données
administratives fournies, par extrapolation, sous l’hypothèse que les séjours « absents » sont distribués
comme l’ensemble des autres séjours de leur catégorie. Par contre, La Rosiaz et Bon Port n’ayant pas
non plus fourni leurs relevés administratifs, les patients y ayant séjourné ne pourront pas être intégrés ;
l’activité de Bon Port étant faible, l’effet de son omission est négligeable, quant à La Rosiaz, elle a
cessé son activité entre-temps.
13
De par sa double mission d’établissement universitaire de dernier recours et d’hôpital de zone pour la région
lausannoise, le CHUV constitue à lui seul une catégorie.
14
A signaler que la Grande Fontaine a changé de mission au début de l’année 1999 pour devenir un
établissement médico-social (EMS).
SCRIS – août 2000 18Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
6 Résultats
Nous présenterons les résultats en trois étapes distinctes :
a) Les résultats « bruts », en termes de lits hospitaliers, séparément pour l’hospitalisation et la semi-
hospitalisation (HdJ) (extrapolés pour tenir compte des établissements manquants) ;
b) Les résultats « nets », à savoir les résultats « bruts » modifiés pour tenir compte des hypothèses
d’évolution des durées de séjour du Service de la santé publique en ce qui concerne les
établissements psychiatriques et les cliniques privées en soins généraux ;
c) Les répartitions par secteur géographique et type de lits (A et B).
Comme mentionné supra, afin de pallier la non-exhaustivité des séjours de la statistique médicale -
due notamment au fait que 1998 constitue la première année de relevé - le nombre de séjours de la
statistique médicale a été corrigé globalement par catégorie d’hôpitaux sur la base des formules de
correction 1998 de la Convention vaudoise d’hospitalisation pour les hôpitaux du RIP et selon la
statistique administrative OFS pour les cliniques privées.
En termes de nombres de lits théoriques (y compris la semi-hospitalisation), voici les résultats des trois
scénarii de durées de séjour ainsi que le scénario de base qui inclut uniquement l’effet
démographique :
6.1 Résultats « bruts »
6.1.1 Hospitalisation
Le tableau ci-dessous indique l’offre théorique actuelle, fondée sur l’activité A et B, à savoir 3'088
lits15 pour l’ensemble des catégories d’établissements, sans l’HdJ. Cela correspond à l’observation de
la situation en 1998 compte tenu des taux d’occupation retenus.
Lits Hospitalisation – Situation actuelle
Type établissement / Année Lits 1998
CHUV 685
Autres universitaires 118
Zone et régionaux 954
Sous-total soins généraux RIP 1 756
CTR 263
Psychiatriques 395
Clin. privées en soins généraux 412
Clin. privées spécialisées 261
Total 3 088
Nous présentons ci-dessous séparément les résultats en 2005 et l’extrapolation en 2010 et 2015 en
fonction des divers scénarii élaborés :
15
Voir l’annexe 6 sur la différence entre les lits théoriques et déclarés.
SCRIS – août 2000 19Perspectives des besoins en lits hospitaliers pour le canton de Vaud à l’horizon 2005
6.1.1.1 Scénario 0 : Scénario de constance des durées de séjour, seules les perspectives
démographiques étant prises en compte.
Lits Hospitalisation - Scénario 0
Type établissement / Année Lits 2005 Lits 2010 Lits 2015
CHUV 738 787 847
Autres universitaires 127 135 145
Zone et régionaux 1 032 1 104 1 207
Sous-total soins généraux RIP 1 897 2 026 2 199
CTR 288 310 348
Psychiatriques 420 447 474
Clin. privées en soins généraux 444 476 510
Clin. privées spécialisées 281 302 323
Total 3 330 3 562 3 854
La colonne 2005 indique le besoin théorique en 2005 sous l’hypothèse de stabilité des hypothèses de
durée de séjour, seules les prévisions d’évolution démographique étant prises en considération. Ainsi,
la démographie implique un surplus théorique de 242 lits (= 3'330 – 3'088) à l’horizon 2005. Les
colonnes 2010 et 2015 représentent les effets de la poursuite de l’évolution démographique.
6.1.1.2 Scénario 1 : Scénario de la meilleure16 durée de séjour (meilleure pratique, « valeur Best »)
appliquée dès 2005 et prise en compte des perspectives démographiques.
Lits Hospitalisation - Scénario 1
Type établissement / Année Lits 2005 Lits 2010 Lits 2015
CHUV 684 729 782
Autres universitaires 106 112 120
Zone et régionaux 931 996 1 086
Sous-total soins généraux RIP 1 720 1 836 1 989
CTR 288 310 348
Psychiatriques 420 447 474
Clin. privées en soins généraux 444 476 510
Clin. privées spécialisées 281 302 323
Total 3 154 3 372 3 643
Ce scénario, le plus optimiste quant à l’évolution des pratiques médicales et leur traduction en baisse
de la durée des séjours hospitaliers, a été appliqué sous l’hypothèse qu’il peut être réalisé à l’horizon
2005. Les colonnes 2010 et 2015 extrapolent ces données avec les perspectives démographiques à
l’horizon 2010 et 2015. On pourrait également faire l’hypothèse que ces cibles de durées de séjour ne
se réalisent qu’en 2010 : dans ce cas, les colonnes 2010 et 2015 restent identiques, seule la colonne
2005 devrait faire l’objet d’une interpolation des résultats. Néanmoins, la réalisation de ces cibles
implique une réduction des durées de séjour pour les établissements en soins généraux du réseau
d’intérêt public de 0,8 jour en l’espace de 7 ans17. Nous avons estimé cette hypothèse réaliste et avons
donc retenu comme présentation des résultats l’atteinte des cibles de durées de référence d’ici à 2005.
Concrètement, ce scénario implique par exemple un besoin en lits théoriques de 3'154 lits en 2005,
comparé à l’offre actuelle théorique de 3'088, soit une hausse de 66 lits. Par rapport au scénario de
constance des durées de séjour, ce sont 176 (= 3'330 – 3'154) lits théoriques qui pourraient ainsi être
« économisés ». Ce scénario, bien qu’impliquant la plus forte réduction des durées de séjour parmi
ceux qui sont ici proposés, ne suffit pourtant pas à compenser entièrement l’évolution de la population
16
La meilleure s’entend ici comme la plus courte, dans une optique purement économique.
17
Voir infra le chapitre 6.1.1.5.
SCRIS – août 2000 20Vous pouvez aussi lire