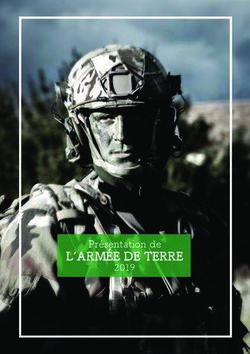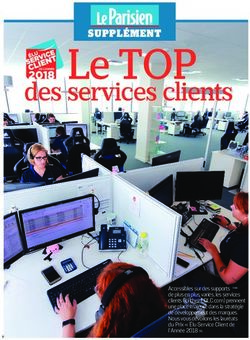Territoire national : soutien des armées, flexibilité et réactivité - Association nationale des croix de guerre ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Territoire national : soutien des armées, flexibilité et réactivité Pour protéger la métropole et les outremers en cas de crise, les armées apportent leur appui par une combinaison des effets à tous les niveaux, quand les moyens des autorités civiles sont inexistants, insuffisants, inadaptés ou indisponibles. Leurs missions ont été présentées à la presse, le 22 juillet 2021 à Paris, par Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, et le colonel chargé du territoire national au Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO). Primo-interventions permanentes. Les menaces sur le territoire national risquent d’augmenter de façon exponentielle en période estivale, souligne Hervé Grandjean. Sous l’autorité, directe ou déléguée, du Premier ministre, les armées interviennent en premier en cas de crise dans les domaines aérien et maritime. La « posture permanente de sûreté aérienne » détecte, identifie et classifie 12.000 aéronefs qui survolent le territoire national chaque jour (hors contexte Covid-19). Mobilisés 24 heures sur 24, des équipages d’avions ou d’hélicoptères peuvent décoller en moins de 7 minutes le jour, 15 minutes la nuit ou même de 2 minutes en cas d’alerte renforcée. La « posture permanente de sauvegarde maritime » mobilise 1.300 marins dans les eaux territoriales (brigandage) et de la zone économique exclusive (luttes contre la pêche illégale et les narcotrafics). Les
préfets maritimes de Cherbourg (Manche et mer du Nord), Brest (Atlantique) et Toulon (Méditerranée) exercent la police en mer. En outre-mer, ces postures sont assurées par les forces de souveraineté déployées aux Antilles, en Guyane, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Zone Sud Océan Indien (La Réunion et Mayotte). Dialogue civilo-militaire. La « posture de protection terrestre » complète le dispositif des sécurités intérieure et civile, qui relève du préfet, précise Hervé Grandjean. Une chaîne de commandement militaire en garantit la cohérence et l’efficacité. L’opération « Sentinelle » déploie quotidiennement 7.000 militaires dans les gares et aérogares, sites culturels ou touristiques, écoles et établissements institutionnels et lieux de forte affluence, rappelle le colonel du CPCO. En été, une posture renforcée se concentre notamment autour des festivals. Face à un événement d’ampleur exceptionnelle, le président de la République peut engager une réserve de 3.000 militaires. L’opération « Héphaïstos » de lutte contre les feux de forêts porte sur 23 départements du Sud de la France, du 25 juin au 16 septembre. Elle mobilise : 48 militaires pour la surveillance et la sensibilité du public ; 3 hélicoptères, dont 1 Gazelle pour la reconnaissance des zones de feux et 2 Cougar pour le transport de pompiers ; 1 groupe du génie pour ouvrir des pistes forestières et créer des coupe-feux ; 20 véhicules pour la sécurité civile. Ce dispositif est complété par des détachements de pompiers militaires du camp de Canjuers et des bases d’Istres, de Solenzara et de Toulon, ainsi que par des camions-citernes de l’armée de Terre. Les aéronefs de la sécurité civile se ravitaillent à la base aéronavale d’Hyères. L’opération « Résilience » de vaccination contre le Covid-19 implique 500 personnes de 7 hôpitaux des armées, des Ecoles militaires de santé de Lyon-Bron et de 3 centres civilo-militaires (Olivet, Mérignac et Dijon). L’opération « Harpie » (300 militaires) en Guyane porte sur la destruction de sites et la neutralisation de flux logistiques de l’orpaillage clandestin. Loïc Salmon Territoire national : protection permanente contre intrusions aériennes et maritimes Armée de Terre : création d’un commandement pour le territoire national Défense : opération « Résilience » contre le covid-19
Défense : les infrastructures, de la construction à l’expertise Le Service d’infrastructure de la défense (SID) intervient, partout et en tout temps, pour assurer la résilience du ministère des Armées, des hébergements aux grands programmes d’armement et sites nucléaires. Son directeur central, le général de corps d’armée Bernard Fontan, l’a présenté à la presse, au cours d’une visioconférence à Paris le 27 mai 2021. Eventail complet de capacités. Placé sous l’autorité du Secrétariat général pour l’administration, le SID construit et adapte les infrastructures des forces armées, directions et services, en métropole, outre-mer et opérations extérieures (Opex). Outre la maintenance lourde des infrastructures communes, il réalise celles destinées à l’entraînement des forces et à la collecte de données. En Opex, il met en œuvre centrales électriques, installations pyrotechniques, centres médico-chirurgicaux et unités de traitement de l’eau (captage, filtrage, distribution, retraitement des eaux usées et leur rejet dans la nature). Ses 6.600
personnels (67 % civils et 33 % militaires) traitent 4.100 immeubles et 2,7 Mdsm2 de terrain, 30,5 Mm2 de surface bâtie et 230 M€ d’achat d’énergie. Leurs domaines de compétences incluent les ports, installations nucléaires, centres de traitement des déchets, monuments historiques et forêts. Programmes majeurs. Dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025, le SID réalise notamment les infrastructures d’accueil et de soutien des sous-marins d‘attaque Barracuda à Toulon et les travaux à l’Ile Longue (Brest), base de la Force océanique stratégique. Pour l’armée de l’Air et de l’Espace, il adapte les infrastructures des bases de Mont-de-Marsan et d’Orange pour le soutien des avions de chasse Rafale. Il reconfigure la base d’Istres pour l’accueil des Airbus A330 MRTT de la 31ème Escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégique dédiée à la dissuasion nucléaire. Pour l’armée de Terre, le SID réalise les infrastructures relatives au programme de combat collaboratif Scorpion (écoles, centres de maintenance et régiments). Organisation. Créé en 2011, le SID a réalisé un maillage fin du territoire, indique le général Fontan. Son réseau s’articule autour d’une direction centrale, d’un centre d’expertise et d’un centre national de production à Versailles et de sept établissements répartis en métropole. Ces derniers comprennent 49 unités de soutien au plus près des bases de défense, qui disposent d’antennes pour soutenir les régiments, bases aériennes et navales ainsi que les centres de la Direction générale de l’armement. A ces quelque 200 sites s’ajoutent les unités implantées hors du territoire métropolitain, à savoir à Cayenne (Guyane), Fort-de- France (Martinique), Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Papeete (Polynésie française), Saint-Denis (La Réunion), Abou Dhabi (Emirats arabes unis), Abidjan (Côte d’Ivoire), Dakar (Sénégal), Libreville (Gabon) et Djibouti. Le SID suit les consommations d’énergie et optimise les contrats d’achat d’électricité et de gaz. Il assure la transition énergétique globale en identifiant les sites les plus gourmands, afin de diminuer leur consommation, respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de recourir aux énergies alternatives. Cela implique le remplacement des chaudières à gaz, l’arrêt du charbon en 2024 et l’installation de panneaux photovoltaïques. Depuis 2017, le SID recrute plus de 400 personnes par an. Son budget est passé de 1,5 Md€ en 2015 à 2,1 Mds€ en 2020. Loïc Salmon
Défense : relance de la politique immobilière des armées La sûreté nucléaire des installations de défense Défense : la stratégie énergétique, un atout opérationnel pour la résilience Défense et sécurité : la réserve, résilience et cohésion nationale L’engagement dans la réserve constitue une référence pour la résilience en cas de crise, affectant la sécurité du pays, et une contribution à la cohésion nationale.
Cette question a fait l’objet d’une visioconférence organisée, le 24 novembre 2020 à Paris, par l’Institut de relations internationales et stratégiques. Y sont notamment intervenus : la générale Véronique Batut, secrétaire générale de la Garde nationale (Gn) ; Jean-Marie Bockel, ancien ministre et sénateur ; le professeur Sébastien Jakubowski, directeur de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Lille. Témoin et ambassadeur. La réserve de masse, constituée par les appelés du contingent a été remplacée, lors de la professionnalisation des armées au début des années 2000, par la réserve d’emploi, rappelle la générale Batut. Cette nouvelle réserve a servi à renforcer les effectifs des armées, protéger les sites de défense et maintenir le lien Armée-Nation. Créée le 16 octobre 2016, la Gn y a intégré les réserves de la Police et de la Gendarmerie. Elle développe le partenariat avec les employeurs civils (800 accords conclus) et renforce son action sur les territoires avec ses 150 correspondants. Elle dispose de moyens budgétaires maintenus par la loi de programmation militaire 2019-2025 et le ministère de l’Intérieur. Face aux besoins futurs de personnels pour la cyberdéfense, le renseignement et la police, elle vise à un engagement plus fort des réservistes, en leur garantissant une employabilité dans le secteur civil par la valorisation de leurs missions auprès du grand public. La formation reçue en matière de résilience leur permettra de réagir en période de crise dans leur activité professionnelle. La Gn doit se préparer aux changements de société et de comportement, avertit sa secrétaire générale, car les jeunes d’aujourd’hui n’hésitent pas à changer de métier au cours de leur parcours. Proximité et gouvernance. Auteur d’un rapport sénatorial pour redynamiser les réserves après les attentats terroristes de 2015-2016, Jean-Marie Bockel souligne que les armées ne peuvent plus fonctionner sans la réserve opérationnelle. La Police et la Gendarmerie, qui assurent la sécurité de proximité, ne disposent pas encore des ressources de réservistes au niveau souhaité en cas de crises grave (climat, troubles sociaux ou terrorisme organisé). Outre la constitution d’unités de réservistes dans les départements à proximité des bases de défense, le sénateur préconise la restauration de l’Inspection générale des réserves au sein de l’institution militaire. Risques et leviers. La professionnalisation des armées a produit une « indifférence positive » à l’égard de l’institution, souligne Sébastien Jakubowski. Les armées ont perdu leur circuit d’alimentation naturelle. Mais on ne devient pas
réserviste sans un lien avec elles. L’engagement dans la réserve, soutenu dans les administrations publiques et les grands groupes, s’avère plus difficile dans les entreprises petites, moyennes et de taille intermédiaire. Sa valorisation passe par le Service national universel (en cours d’élaboration), le sens du collectif consécutif à la crise du Covid-19 et la montée en puissance de la Gn. Toutefois, la réserve militaire risque de se trouver reléguée à des missions de second ordre, à la suite de formations déconnectées de celles des personnels d’active. La légitimation de la Réserve, perçue comme réservoir de ressources via la chaîne formation, entraînement et fidélisation, tirerait profit du nom « Force militaire non permanente ». Loïc Salmon Défense : la réserve opérationnelle, outil indispensable aux armées Garde nationale : objectif, fidéliser les réservistes SNU : succès du module « Défense et mémoire » Défense : opération « Résilience » contre le covid-19
Le ministère des Armées a déclenché l’opération « Résilience » dès le 18 mars 2020, pour contribuer à la lutte quotidienne contre l’épidémie de covid-19 (coronavirus), tout en maintenant ses activités de défense et de sécurité. Les mesures sanitaires de prévention sont appliquées au sein de chaque unité, direction et service pour limiter la propagation du covid-19 au sein des armées. Les plans de continuité des activités sont déclinés pour assurer la permanence des missions : dissuasion nucléaire, en mer et dans les airs ; lutte contre le terrorisme sur le territoire national (opération « Sentinelle ») et sur les théâtres d’opérations extérieurs (« Barkhane » au Sahel et « Chammal » au Levant) ; protection de l’espace aérien et des satellites ; surveillance et sauvegarde maritimes ; lutte contre les trafics. Les relèves ont lieu tous les 15 jours. Des
hélicoptères ont évacué des patients français vers des hôpitaux allemands et suisses. Moyens déployés. L’opération « Résilience » déploie 40.000 militaires sur le territoire national et en opérations extérieures et met 12.000 pompiers militaires à la disposition du ministère de l’Intérieur. Pendant la semaine du 21 au 27 mars, le Service de santé des armées (SSA) a monté à Mulhouse (département du Haut- Rhin) un « élément militaire de réanimation » avec des équipements médicaux lourds et du personnel soignant venu de toute la France : 30 lits de réanimation pour des patients intubés et ventilés ; 83 personnels du SSA et 8 auxiliaires santé du Régiment médical de l’armée de Terre ; 30 personnes chargées de la logistique ; 182 t de matériel dans 23 conteneurs. En outre, « Résilience » a mobilisé : le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre, qui dispose d’un hôpital embarqué avec deux salles d’opération et 69 lits médicalisés ; l’avion polyvalent A330 Phénix, équipé du module MORPHEE (MOdule de Réanimation pour Patient à Haute Elongation d’Evacuation). Ce dernier, basé à Istres (photo), a évacué 6 patients de Mulhouse vers les hôpitaux militaires de Marseille et Toulon, puis 6 autres de Mulhouse vers le centre hospitalo-universitaire (CHU) de Bordeaux et enfin 6 nouveaux patients de Mulhouse vers les CHU de Brest et Quimper. Des moyens logistiques militaires ont acheminé des masques vers des stockages dédiés dans tous les départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Parti de Toulon, le Tonnerre a embarqué 12 patients à Ajaccio (Corse) à destination de Marseille pour une prise en charge par les hôpitaux de la Région de Provence- Alpes-Côte d’Azur. Sur l’île de La Réunion, le Régiment du service militaire adapté à mis en place une structure modulaire d’accueil pour le CHU de Saint- Pierre. Recherche biomédicale. En janvier, l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) participe à la sécurisation du rapatriement des ressortissants français en Chine. Depuis le 11 mars, il met en œuvre une chaîne de diagnostic à grande capacité pour la Force océanique stratégique et le SSA. En outre, les experts de l’IRBA délivrent des formations sur les sites de Creil, de Balard, d’Istres et de l’élément militaire de réanimation de Mulhouse : procédures d’habillage/déshabillage ; délimitation de zones ; port des équipements de protection individuelle. Ils évaluent les procédés de désinfection : rédaction de procédures ; évaluation du risque résiduel ; prélèvements environnementaux analysés par le Centre de maîtrise radiologique, biologique et chimique de la
Délégation générale de l’armement. Loïc Salmon Service de santé : médecine de guerre, efficacité maximale Service de santé : renforcement des capacités biomédicales Opex : la chaîne de santé, une course contre le temps Les grandes affaires de la Libération 1944-1945
La représentation mémorielle de la seconde guerre mondiale a tendance à surévaluer l’apport des Etats-Unis et l’ampleur de la « collaboration » en France et à oublier l’impunité d’anciens nazis et le passé « douteux » de certaines personnalités d’après-guerre. Cet ouvrage met en lumière une vingtaine d’épisodes à partir d’archives militaires et civiles des pays belligérants. Entre 1941 et 1945, les Etats-Unis ont perdu 416.837 soldats mais l’URSS 9.168.400. Du côté allemand, 3.543.000 soldats sont morts contre l’armée soviétique et environ 374.470 contre les troupes américaines. Entre 1939 et 1945, 740.000 soldats allemands sont tués sur le front de l’Ouest (France, Belgique, Pays-Bas et Allemagne de l’Ouest), dont 644.941 en 1944-1945 contre les armées américaines, britanniques, canadiennes et françaises. Lors de la bataille de Dunkerque (26 mai-4 juin 1940), la défense par les troupes françaises des poches de Dunkerque, Lille, Calais et autres secteurs fixe la majorité des divisions allemandes, facilitant le rembarquement de 224.686 soldats professionnels du corps expéditionnaire britannique, qui permettront la poursuite de la guerre. En outre, 300 navires de la Marine française embarquent 102.570 soldats alliés. En métropole et pendant toute la guerre, 266 réseaux de résistance sont créés par les services spéciaux de la France libre avec 150.000 membres permanents et 300.000 « occasionnels » et 125 autres par le SOE britannique avec des résistants français. Ces réseaux ont fourni 80 % des renseignements sur le dispositif militaire allemand. S’y ajoutent 300.000 maquisards homologués des Forces françaises de l’intérieur. En 1944, les Etats- Unis tentent de placer la France sous leur protectorat par la mise sur pied d’une administration militaire dénommée « AMGOT ». Mais le Gouvernement provisoire de la République française, qui ne sera reconnu par les Alliés que le 29 octobre, avait élaboré, deux jours avant le débarquement en Normandie, 400 décrets et ordonnances pour restaurer la légalité dans le pays. Fin février 1944, la division allemande « Das Reich », de retour du front soviétique où elle a subi de lourdes pertes, est envoyée dans le Sud-Ouest de la France pour reconstituer ses effectifs en hommes et matériel. Dès le mois de mai, elle mène des opérations féroces contre les maquis et les populations civiles et, le 8 juin, reçoit l’ordre de se porter le plus vite possible vers la Normandie. Au mois d’août, elle a massacré ou déporté 3.000 personnes en tout dans le Sud-Ouest. Par ailleurs, la Gestapo a recruté 6.000 agents français actifs et 24.000 informateurs occasionnels, aux motivations diverses. Mais de nombreux Français anonymes sauvent de la déportation 75 % des juifs présents en France (95 % de Français et 50 %
d’étrangers). De son côté, l’Italie, quoique fasciste et alliée de l’Allemagne nazie, sauve 83,6 % de juifs sur son territoire et ses zones d’occupation. Pourtant plusieurs chefs gestapistes allemands, coupables de séries de crimes en France, seront épargnés ou faiblement condamnés après la guerre. Des responsables nazis seront exfiltrés vers l’Amérique latine. D’autres seront récupérés par les services de renseignements soviétiques ou américains. Des écrivains et journalistes français connus, compromis sous l’Occupation, dissimuleront leur passé, après avoir rendu de menus services à la Résistance lors de la débâcle allemande. Loïc Salmon « Les grandes affaires de la Libération 1944-1945 » par Dominique Lormier. Editions Alisio, 350 pages, 19,90€. Nouvelles histoires extraordinaires de la Résistance Parachutée au clair de lune Provence 1944 Garde nationale : objectif, fidéliser les réservistes
Trois ans après sa création, la Garde nationale compte déjà près de 76.000 réservistes. Elle en emploie plus de 6.600 par jour, dont 1.200 dans le cadre de missions de protection pour le compte du ministère des Armées. Sa secrétaire générale, le général de Gendarmerie Anne Fougerat, en a dressé le bilan et présenté les perspectives à la presse, le 2 octobre 2019 à Paris, à l’occasion des « Journées des réservistes » (12 octobre-12 novembre). Il s’agit de confirmer la progression constatée (50 %) des engagements dans la réserve, initiée par les attentats terroristes de Paris (2015) et Nice (2016). L’émoi s’étant estompé, la perception de la menace devient moins évidente. Pourtant, 20 % des jeunes de 18-19 ans, en quête de sens et de supplément d’âme, souhaitent se rendre utiles dans la défense ou la sécurité de leur pays. La réserve, militaire ou civile, implique don de soi, envie de s’engager et compétences particulières. Dix composantes. La Garde nationale fournit des réservistes aux ministères des Armées et de l’Intérieur. Au 1er janvier 2019, la réserve opérationnelle de premier niveau des armées, directions et services se monte à 38.529 personnels. L’armée de Terre en emploie 21.926 pour la protection des populations sur le
territoire national (opération « Sentinelle » et plan « Vigipirate »), celle des installations militaires, l’assistance aux services publics et secours en cas de catastrophes naturelles, industrielles ou technologiques. La Marine nationale en emploie 5.838 pour la protection du territoire national (métropole et outre-mer) et sa défense maritime (surveillance du littoral et protection des eaux territoriales), la protection des navires de guerre et bases navales et aéronavales, le recrutement et le rayonnement de l’institution. L’armée de l’Air en emploie 5.829 pour la protection permanente de l’espace aérien national, des systèmes de combat et des sites militaires et civils. Les autres composantes des armées se répartissent les 4.141 restants. Le Service du commissariat des armées emploie des diplômés au minimum bac + 3, pour des missions militaires au sein d’une unité, d’un état-major ou d’un service, l’apport de compétences en finances, droit, logistique et achats sur le territoire national et/ou à l’étranger. Le Service des essences des armées en affecte à des postes de tous niveaux, dans l’approvisionnement, le transport, le stockage, la distribution et le contrôle de la qualité des produits pétroliers ainsi que la maintenance des matériels pétroliers. Le Service d’infrastructure de la défense en emploie dans la construction, la maintenance immobilière et la gestion technique et administrative du patrimoine. Le Service de santé des armées emploie des professionnels de santé et des étudiants en sciences de la santé, pour renforcer les centres médicaux, les hôpitaux, ses propres établissements et sur des opérations extérieures. La Direction générale de l’armement recherche des ingénieurs, chercheurs et autres diplômés (minimum bac + 5), disposant d’une solide expérience professionnelle valorisable dans la fonction armement. Au 1er janvier 2019, le ministère de l’Intérieur dispose de 37.388 réservistes. La Gendarmerie nationale en emploie 30.288 pour renforcer des unités d’active dans la sécurité et la bonne exécution des lois : protection des personnes et des biens, renseignement, alerte et secours. La Police nationale en emploie 7.100 pour des missions de soutiens opérationnel et logistique, de spécialiste (juridique ou informatique) ou d’agent de police judiciaire adjoint. Loïc Salmon Défense : des moyens face aux menaces de demain Garde nationale : faciliter l’engagement et fidéliser Défense et sécurité : de la menace à la résilience
SNU : succès du module « Défense et mémoire » Le module « Défense et mémoire nationales » du Service national universel (SNU) a été expérimenté avec succès auprès de 2.000 volontaires dans 13 départements
(16-28 juin 2019). Lors d’une conférence de presse le 9 juillet à Paris, Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées a précisé qu’il avait été jugé satisfaisant par 90 % de ces jeunes de 15-16 ans et que les résultats en seront présentés en septembre à Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès de ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse. Cérémonies patriotiques. « Un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir », maréchal Ferdinand Foch (1851-1929), artisan de la victoire de 1918. Depuis 1870, le ministère des Armées met en œuvre un programme commémoratif autour de 274 nécropoles nationales, 2.200 carrés militaires, 9 hauts lieux de la mémoire nationale et 1.000 cimetières militaires dans près de 80 pays. Il organise 11 journées commémoratives sur les conflits contemporains : 19 mars, victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ; dernier dimanche d’avril, victimes et héros de la Déportation ; 8 mai, victoire du 8 mai 1945 ; deuxième dimanche de mai, Jeanne d’Arc et le patriotisme ; 27 mai, la Résistance ; 8 juin, « Morts pour la France » en Indochine ; 18 juin, l’Appel du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi ; 16 juillet, victimes de crimes racistes et antisémites de l’Etat français et « Justes » de France, qui ont recueilli, protégé ou défendu, au péril de leur propre vie et sans aucune contrepartie, une ou plusieurs personnes menacées de génocide ; 25 septembre, harkis et autres membres des formations supplétives ; 11 novembre, armistice de 1918 et tous les « Morts pour la France » ; 5 décembre, militaires et supplétifs morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Ces cérémonies sont l’occasion de remises de décorations et de dépôts de gerbes de fleurs aux monuments aux morts par les autorités. L’engagement mémoriel. « Evoquer la mémoire n’est pas juste évoquer le passé. C’est essentiel pour vivre le présent et construire l’avenir ». Tel est l’objectif d’un atelier d’échanges, proposé à des groupes de 25 jeunes et incluant la projection d’un film de 8 à 10 minutes sur la Grande Guerre, la seconde guerre mondiale, les guerres de décolonisation et les opérations extérieures. Tout volontaire du SNU pourra, ensuite, témoigner devant d’autres jeunes de son expérience et de sa volonté de poursuivre son engagement, sous réserve que son projet reste dans le cadre d’un retour d’expérience national. Ainsi, au sein du ministère de l’Education nationale, le « trinôme académique » regroupe, dans
chaque académie, l’ensemble des acteurs de « l’esprit de défense », qui contribuent à l’organisation de formations de jeunes pour les sensibiliser aux enjeux de défense et de citoyenneté. De son côté, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, présent dans chaque département, peut proposer la mise en œuvre d’une action mémorielle auprès du jeune public, la participation à une campagne de collecte de témoignages d’acteurs de conflits contemporains ou un travail de recherches dans le cadre de la valorisation de la mémoire locale. Il peut aussi orienter un jeune du SNU vers une association patriotique, pour participer à l’organisation d’une cérémonie mémorielle dans sa commune ou même devenir…porte-drapeau ! Loïc Salmon Défense : les blessés et les jeunes du SNU à l’honneur Défense : la jeunesse au cœur du lien Armées-Nation Défense et citoyenneté : la journée des jeunes pour en comprendre les enjeux Terrorisme : les forces armées préservées de la radicalisation
L’étanchéité des armées vis-à-vis de la radicalisation islamique s’explique par leur métier au service de la nation et des valeurs républicaines et dans le respect de la loi. Les enquêtes préalables au recrutement renforcent la prévention. C’est ce qui ressort d’un rapport d’information de la commission des lois de l’Assemblée nationale, élaboré par les députés Eric Diard et Eric Poulliat et rendu public le 27 juin 2019. La loi SILT. La loi du 30 octobre 2017, qui renforce la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT), permet de vérifier, tout au long de leur carrière, l’éventuelle radicalisation de personnels exerçant des missions relatives à la souveraineté de l’Etat. Le Service national des enquêtes administratives de sécurité donne son avis sur le recrutement, l’affectation, la titularisation des militaires, policiers, douaniers, officiers de port et agents de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. En cas de comportement devenu incompatible avec ses fonctions, la personne est mutée ou affectée à un autre emploi. Les armées. Du fait de la menace grave sur la sécurité publique, l’enquête sur un militaire peut déboucher sur sa radiation des cadres ou la résiliation de son contrat. Toutefois, la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense considère comme faible le niveau de la menace de radicalisation liée à l’islam djihadiste sunnite au sein du ministère des Armées, tant du profil que du volume de personnels concerné. Au sein de l’armée de Terre, la radicalisation islamique
ou politique (ultra-droite, surtout dans la réserve) est estimée à 0,05 %. Aucun risque de radicalisation au contact des populations lors d’opérations extérieures n ‘a été constaté. La proportion tombe à 0,03 % dans la Marine, car les périodes à terre restent trop courtes pour être propices au prosélytisme. Aucun marin n’est fiché « S ». Dans l’armée de l’Air, le nombre très limité de signalements de radicalisation concerne des militaires convertis à l’islam, surtout des hommes du rang. La très grande majorité des anciens militaires, candidats aux filières djihadistes, n’avait passé que peu de temps dans les armées et était partie en Irak et en Syrie plusieurs années après. Une radicalisation protéiforme. Le rapport cite une étude, menée de septembre 2016 à décembre 2017 par des chercheurs de l’Université Paris X Nanterre et qui distingue quatre types de radicalité. La 1ère, qualifiée de « radicalité apaisante », concerne surtout les jeunes filles en quête de protection contre des violences subies ou des désordres familiaux. La 2ème, « radicalité rebelle », touche des enfants de familles plus protectrices, où l’adoption d’un discours radical répond à un besoin d’opposition au cadre familial. La 3ème, « radicalité agnostique », porte sur des garçons vivant dans des familles déstructurées et qui cherchent la revalorisation de soi par la provocation, surtout envers les éducateurs. La 4ème, « radicalité utopique », concerne des enfants d’immigrés de la première génération et stables socialement. Leurs parents, plutôt ouvriers qualifiés ou artisans qu’ouvriers spécialisés, les poussent à réussir scolairement, afin de connaître une ascension sociale par procuration. Bons élèves du primaire au collège, ils résistent mal à la confrontation résultant de la compétition dans le secondaire et se sentent incapables de remplir le rôle que leurs parents attendent d’eux. Ils trouvent alors dans le djihadisme un vecteur pour porter la critique de l’école et de la famille. Loïc Salmon Terrorisme : impacts et enjeux du « cyberdjihadisme » Terrorisme : compétence judiciaire dès la préparation Terrorisme djihadiste : prédominance de la dimension psychoculturelle
Les Français du jour J
Parachutistes, fusiliers-marins commandos, aviateurs et marins, soit plus de 3.000 militaires français participent au débarquement du 6 juin 1944 (15 tués) en Normandie et plus de 20.000 dans la bataille éponyme qui suit (plusieurs
centaines de morts). L’opération « Overlord » a mobilisé des milliers d’aviateurs (227 Français à bord de 135 appareils) pour assurer la maîtrise du ciel, 196.000 marins (environ 2.600) qui arment les navires, 24.000 parachutistes (38) largués derrière les lignes allemandes et 132.715 hommes (177) pour le débarquement proprement dit. La modicité des effectifs français, issus surtout des anciennes Forces françaises libres, s’explique par la nécessité de conserver le gros des troupes françaises stationnées en Afrique du Nord et en Italie pour le débarquement de Provence, qui aura lieu le 15 août suivant. La participation française doit beaucoup à la compréhension des chefs militaires britanniques, qui parviennent à convaincre leurs homologues américains, réticents au début, d’engager la 2ème Division blindée dans la bataille de Normandie et la libération de Paris le 25 août. Le général de Gaulle, chef de la France libre, avait pourtant demandé, à la fin de 1943, un engagement terrestre d’au moins une ou deux divisions le jour J. Prévenu la veille, il a été profondément déçu de la faiblesse de la participation française, reflet selon lui d’un manque de considération des Alliés et d’une représentativité de la force reconstituée de la France insuffisante pour asseoir sa légitimité dans le monde. En fait, sur le plan opérationnel, les Alliés n’informent pas les Français par crainte que le renseignement parvienne aux oreilles des Allemands. Sur le plan politique, le président américain Roosevelt et le Premier ministre britannique Churchill tiennent de Gaulle à l’écart, car ils ne lui reconnaissent pas encore la légitimité de gouverner les territoires français qui seront libérés. Pourtant, les premiers soldats alliés à fouler le sol de France seront les 177 Français du 1er Bataillon de fusiliers marins au béret vert avec l’insigne orné de la croix de Lorraine. Le jour J, la participation française inclut : plus de 1.500 marins des croiseurs Georges-Leygues et Montcalm, venus d’Afrique du Nord ; 500 parachutistes intégrés au 4ème Régiment de la Brigade SAS (Special Air Service) britannique ; des navires d’escorte, à savoir les corvettes Aconit, Renoncule, Roselys et Commandant-d’Estienne-d’Orves et les frégates Aventure, Découverte, Escarmouche et Surprise ; les groupes de chasse « Alsace » et « Ile-de-France » des Forces aériennes françaises libres (FAFL) et les groupes de chasse « Cigognes » et « Berry », venus d’Afrique du Nord ; le groupe de bombardement « Lorraine » (FAFL) ; les combattants de l’ombre de la Résistance, qui entreront en action sur les arrières des troupes allemandes. Pendant les années de pouvoir du général de Gaulle (1944-1946 et 1958-1969), le jour J sera exclu de la mémoire française de la Libération. Cela s’explique par
l’effectif français, trop petit pour coller au grand récit de « la France libérée par elle-même », à savoir à peine 3.000 hommes par rapport aux 150.000 Résistants et 250.000 hommes des forces françaises du débarquement de Provence. Abondamment documenté, l’ouvrage relate, à partir de nombreux témoignages, les péripéties diplomatiques, la préparation et la conduite des opérations du jour J concernant la participation française. Loïc Salmon « Les Français du jour J » par Benjamin Massieu. Editions Pierre de Taillac, 418 pages, nombreuses illustrations, 24,90 €. Jour-J Churchill De Gaulle Provence 1944 Armée de l’Air : anticipation, audace et créativité
Les capacités de décider et de gérer l’aléatoire entrent dans la formation des cadres de l’armée de l’Air, qui devra créer compétences et scénarios pour les missions du futur, plus complexes. Ces questions ont fait l’objet du colloque qu’elle a organisé le 29 novembre 2018 à Paris. Y sont notamment intervenus : le chef d’état-major de l’armée de l’Air (CEMAA), le général d’armée aérienne Philippe Lavigne ; Olivier Zadec, maître de conférences, université Lyon 3 « Jean Moulin » ; le général de brigade aérienne Frédéric Parisot, sous-chef d’état-major « préparation de l’avenir » ; le lieutenant- colonel Anne-Laure Michel, directrice générale de la formation militaire à l’Ecole de l’air de Salon-de-Provence (photo). Projets structurants 2019-2025. Dans le document « Plan de vol » de l’armée de l’Air présenté lors du colloque, le CEMAA avertit que l’emploi de la puissance aérienne pourrait se trouver, à terme, entravée par la contestation croissante du milieu aérien. Cela résulte du durcissement de la dynamique des Etats puissances (Russie et Chine) et des organisations non étatiques ainsi que de la fragilisation des mécanismes de régulation internationaux. Le « Plan de vol » s’inscrit dans la remontée en puissance de l’armée de l’Air, initiée par la loi de programmation
militaire 2019-2025. Il doit lui permettre de garder un temps d’avance et de conserver à la France une position forte sur la scène internationale. L’armée de l’Air assure en permanence la maîtrise du domaine aérien et spatial ainsi que la composante aérienne de la dissuasion nucléaire, avec la Marine nationale. Ses modes d’action vont du recueil de renseignement au déploiement de forces terrestres et de la destruction des moyens militaires adverses aux missions humanitaires. La puissance permet de conserver l’avantage en opération, souligne le CEMAA. Elle se combine avec une « agilité », accrue notamment par : l’avion de ravitaillement en vol et de transport stratégique Phénix ; le commandement des opérations aériennes « JFAC France » dans le cadre de l’OTAN ; les opérations spatiales ; le Rafale au standard F3-R, équipé du missile air-air longue portée Meteor, de la nacelle de désignation d’objectif Talios et de la version à guidage terminal laser de l’armement air-sol modulaire, adapté aux cibles mobiles ; le drone Reaper armé ; les capacités de lutte contre le déni d’accès à un théâtre ; la modernisation de la composante nucléaire aéroportée ; le système franco-allemand de combat aérien futur. Lors d’une rencontre avec la presse, le CEMAA a indiqué que l’avion de transport tactique A400M est en train d’acquérir les capacités d’atterrissage sur terrain sommaire et de largage de parachutistes par la porte arrière (ouverture commandée) et par les portes latérales (ouverture automatique). En outre, le ravitaillement en vol d’hélicoptères, qui leur permettra d’aller plus loin dans la profondeur, évitera d’installer des plots de ravitaillement au sol. Il réduira d’autant « l’empreinte au sol » des forces spéciales, qui imaginent l’usage de certains équipements pour répondre aux menaces existantes ou futures. Par ailleurs, « agilité » et « audace » induisent le décloisonnement des organisations et le recours aux « Big data » (mégadonnées), à l’intelligence artificielle (IA, transformation numérique) et à la connectivité. Sont ainsi concernés : le combat aérien ; la capacité de l’hélicoptère lourd ; l’action aérienne de l’Etat ; le Rafale au futur standard F4, successeur du F3-R à partir de 2025, équipé d’un système de reconnaissance capable de trier en direct les éléments d’intérêt militaire ; l’avion léger de surveillance et de reconnaissance ; la capacité universelle de guerre électronique, à savoir trois avions de renseignement stratégique livrables entre 2025 et 2027. Enfin, la coopération en interalliés porte sur l’interopérabilité entre les armées de l’Air française, américaine et britannique ainsi que sur l’installation d’un escadron de transport franco-allemand de six Hercules C-130J à la base d’Evreux. Complexité et accélération. La complexité politique d’un conflit, consécutive à
la culture et à l’Histoire, s’inscrit dans le temps long, explique Olivier Zadec. Elle inclut le temps réel des opérations, avec des lignes de réaction politiques à prévoir. Il s’agit de trouver l’équilibre entre le temps prévisible et le temps imprévu. La transformation de très nombreuses données en connaissance entre dans l’accélération de la boucle décisionnelle, en vue de réduire l’adversaire. L’OTAN a fabriqué de l’interopérabilité mais laisse l’indispensable autonomie de décision. Or la réactivité se vit au quotidien avec une action sur court préavis, rappelle le général Parisot. Les frappes en coalition se décident en quelques heures. Les avions peuvent décoller entre 2 et 7 minutes, avec la capacité de rappel pour un raid limité au résultat le plus significatif. La réussite de la mission rend impératif le recours à l’innovation technologique. L’IA prépare les informations utiles, complétées par celles de l’état-major, et présente des options au chef, qui décidera en toute connaissance de cause. Ainsi, au Levant, indique le général Parisot, média et réseaux sociaux influencent le rythme des opérations. En effet, une mission peut être interrompue à la suite d’une information, dont la vérification fera perdre du temps. Seul un modèle d’armée complet permet de trouver une place dans une coalition, mener une action autonome et disposer d’une certaine masse pour rester longtemps sur plusieurs théâtres et affronter une menace nouvelle, souligne le général. Enfin, le maintien de la supériorité opérationnelle, par l’innovation technologique, répond à l’ambition de pouvoir, en permanence, entrer en premier sur un théâtre, capacité des seules forces armées américaine, britannique et française. Loïc Salmon Le taux de féminisation dépasse 20 % dans l’armée de l’Air et dans son Ecole de Salon-de-Provence. Quoique toutes les spécialités soient ouvertes aux femmes, faute de volontaires aux aptitudes suffisantes, elles ne sont que 12 pilotes de chasse, dont le lieutenant-colonel Anne-Laure Michel. Selon elle, les élèves de l’Ecole de l’air, âgés de 18 à 30 ans, ultra-connectés car nés à l’ère du numérique et des réseaux sociaux, s’adaptent vite à la formation scientifique et technique dispensée. Une « smart school » ou formation à la carte, via la communication par internet, est en cours ainsi que des licences d’excellence sur le cyber, l’espace et les drones. Tout au long de sa carrière, un officier pourra accéder à son « passeport numérique de compétences ». La préparation au commandement consiste à faire prendre conscience de l’engagement en alliant compétences et qualités humaines pour obtenir l’adhésion des équipiers. Par exemple, lors de
l’opération « Pamir » en Afghanistan (2001-2014), une mission de 6 heures, avec ravitaillements en vol dans un environnement hostile avec tirs possibles de missiles sol-air, était toujours dirigée par un « leader » apportant précision et audace. L’incertitude fait partie du métier de pilote de chasse, qui doit prendre la bonne décision au bon moment pour remplir sa mission. Les exercices interalliés permettent d’élaborer des méthodes communes par un travail « collaboratif », en vue d’une opération ultérieure en coalition. Armée de l’Air : l’humain, les opérations et la modernisation Armée de l’Air : le combat numérique au cœur des opérations
Vous pouvez aussi lire