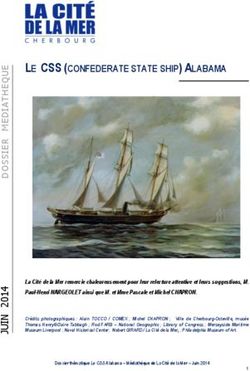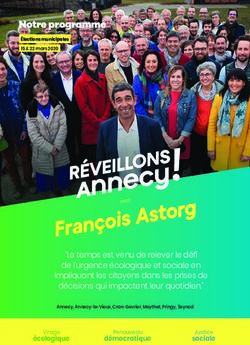REVUE DE PRESSE ET DES RESEAUX SOCIAUX - Mercredi 13 juin 2018 Outre-mer - mayotte.pref.gouv.fr
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
A LA UNE
VISITE MINISTERIELLE;
Pages, 6 à 12, 33 à 37.
Antilles, la sargasse, une algue à valoriser ? Rencontre
internationale sur les sargasses début octobre en Martinique
(Hulot)
ASSISES DES OUTRE-MER;
Pages, 41 à 42, 52 à 53.
Outre-mer, Dernière ligne droite pour soutenir les projets
des Assises de l’Outre Mer.
ORPAILLAGE;
Pages, 13 à 14.
Guyane, l’or et le projet Montagne d’or attise l’intérêt des
plus grands producteurs mondiaux.
EUROPE AGRICULTURE;
Pages, 18, 68 à 69.
Outre-mer, inquiétude autour des aides agricoles européennes
pour les Outre-mer, le député de La Réunion David Lorion
saisi Edouard Philippe.
2Le gouvernement annonce un plan de 10 millions d'euros contre les sargasses
Papier Général Pointe-à-Pitre, France mardi 12/06/2018 - 13:38 UTC+3 | par Amandine ASCENSIO avec Cecile AZZARO
à Paris
Nicolas Hulot et Annick Girardin ont annoncé lundi en Guadeloupe un plan de 10 millions d'euros sur deux ans
pour lutter contre les sargasses, ces algues brunes nauséabondes et toxiques qui polluent les rivages des Antilles
depuis plusieurs mois. Le ministre de la Transition écologique et sa collègue chargée des Outre-mer, arrivés
dimanche en Guadeloupe, se sont ensuite rendus en Martinique, fortement touchée également par ce
phénomène. Ils doivent notamment visiter mardi une entreprise spécialisée dans la valorisation des sargasses.
Lundi, M. Hulot et Mme Girardin ont constaté l'ampleur des dégâts dans les îles de Guadeloupe, La Désirade,
Marie-Galante et les Saintes, dont les ports et les rivages sont envahis par les sargasses. Début mai, ces îles
avaient été partiellement coupées du monde par des algues trop nombreuses à l'entrée du port, bloquant les
hélices des bateaux. Depuis février, ces algues brunes, dont l'origine reste incertaine, s'amoncellent sur les
rivages, salissent plages et ports, mais surtout dégagent, en séchant, de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac,
qui peuvent provoquer maux de tête, nausées et vomissements.
Ce n'est pas la première fois que ces algues envahissent le littoral antillais depuis leur apparition massive, en
2011. Mais le phénomène n'a "jamais été aussi important que cette année", selon Annick Girardin. Les mesures
annoncées lundi concernent "la Guadeloupe, les îles du Nord, la Martinique et la Guyane", précise un
communiqué conjoint des deux ministères. Elles "seront financées à hauteur de 10 millions d’euros par l’Etat et
permettront d'accompagner les investissements et les opérations de ramassage des collectivités territoriales
concernées", explique le communiqué. L’Etat prendra en charge près de 50% du financement de ce plan prévu
jusqu'en 2019. Le reste sera financé par l'Union Européenne et les collectivités, ont précisé à l'AFP les services
du ministère de la Transition écologique. "Il faut qu'à la prochaine saison, on puisse atteindre l’objectif de
ramassage 48h après les échouages", ont-ils indiqué. C'est au-delà de ce délai que se dégagent les gaz toxiques,
lors de la décomposition des algues.
- site internet -
Par ailleurs, "trois millions d'euros supplémentaires viennent s'ajouter immédiatement au fonds d’urgence (de 3
millions d'euros, ndlr) débloqué durant les semaines précédentes", annoncent les services du ministre. Cet
argent doit venir financer l'achat de matériel de déblayage pour les communes touchées, jusqu’en septembre. Le
plan comprend également le déploiement de 22 capteurs en Guadeloupe, mais aussi en Martinique, qui
permettront de remonter les données d’échouages, de dégagement de gaz, et d’améliorer la surveillance, afin
que les collectivités puissent émettre des bulletins quotidiens. L'ensemble des données seront mises en ligne sur
un site en open data et participatif.
Une étude scientifique sera lancée en juillet par l'université Antilles Guyane "pour mieux documenter la
composition des sargasses afin de faciliter leur valorisation", et le réseau de suivi et d'échouage des sargasses
par satellite sera renforcé à hauteur de 300.000 euros. Enfin, une mission, dirigée par le sénateur de Guadeloupe
Dominique Théophile, se rendra dans les îles voisines de la Caraïbe à la recherche de solutions de ramassage et
de valorisation. Du point de vue des indemnisations, si "des mesures conservatoires", notamment un moratoire
sur les charges sociales et fiscales des entreprises, seront mises en place, les discussions avec les assureurs
doivent se poursuivre. Car les conséquences sont lourdes pour l'économie touristique, les entreprises de pêche
ou les compagnies maritimes. "Il s’agit aussi d'anticiper sur les années suivantes", notent les services du
ministère, pour qui les territoires doivent "être prêts" à affronter de nouvelles crises dans le futur.
Cette pollution a également des conséquences sur les appareils électroniques ménagers, que le sulfure
d'hydrogène détruit. Face aux critiques sur sa visite tardive, l’équipe ministérielle indique que les choses "n'ont
pas commencé là", et que les élus locaux, ainsi que les populations ont pris le problème à bras-le-corps, avec
des gens "exaspérés mais mobilisés".
asa-caz/frd/phc
6Rencontre internationale sur les sargasses début octobre en Martinique (Hulot)
Fort-de-France, France | AFP | mercredi 13/06/2018 - 04:55 UTC+3 | 446 mots
Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a annoncé mardi à Fort-de-France la tenue
d’"évènements internationaux" aux Antilles, notamment début octobre en Martinique, sur la problématique des
sargasses, ces algues brunes nauséabondes et toxiques qui polluent les rivages des Antilles depuis plusieurs
mois..
Aux côtés de la ministre des Outre-mer Annick Girardin, Nicolas Hulot dressait le bilan sa visite aux Antilles
consacrée à la "crise des sargasses", lors d’une conférence de presse à la résidence préfectorale.
"Si toute la région des Caraïbes est touchée, elle ne l’est pas avec le même niveau de gravité", a indiqué le
ministre. Selon lui, pour la compréhension et la résolution de la crise des sargasses, il faut "mutualiser nos
expériences, nos intelligences et nos moyens".
Dans cette perspective, "nous engagerons et nous organiserons un certain nombre d’événements internationaux,
ici aux Antilles, et particulièrement début octobre en Martinique, pour aborder cette problématique au niveau
régional et au niveau international", a indiqué Nicolas Hulot.
Le ministre est également revenu sur le plan de 10 millions d‘euros annoncés la veille en Guadeloupe pour
lutter contre l’invasion des sargasses. "Nous avons entendu la détresse, l’inquiétude et la colère salutaire et
nécessaire de celles et ceux qui vivent au quotidien" cette situation, a-t-il dit.
A la mi-journée au Robert, une commune côtière particulièrement touchée, Nicolas Hulot et Annick Girardin,
avaient été interpellés par des riverains excédés devant l’incapacité de l’Etat, selon eux, à régler ce problème.
"On est venu vous dire la vérité, leur a répondu Nicolas Hulot. Ce phénomène nous dépasse tous. Il vous affecte
en priorité. On est là à vos côté."
"On va essayer de résoudre les problèmes un par un et sur la durée. Je ne peux pas vous dire autre chose et je ne
peux pas vous faire de mensonges et je n’ai pas de solutions immédiates", a ajouté d’un ton vif le ministre de la
Transition écologique. Plus tôt dans la matinée, les ministres avaient visité Holdex Environnement, un site de
traitement des algues sargasses et de valorisation agronomique, au François.
Un centre de valorisation qui "ouvre beaucoup d’espoir en aval de la collecte des sargasses qui a bénéficié
d’une participation de l’Ademe à hauteur de 3,5 millions d’euros pour sa mise en place", selon Nicolas Hulot.
"Nous mobiliserons la banque publique d’investissement (BPI) pour faire en sorte de développer cette structure
et la valorisation des sargasses", a indiqué le ministre.
Enfin conscient de l’impact de cette crise sur le secteur du tourisme, Nicolas Hulot a invité les touristes à ne pas
déserter cette région. "Toutes les Antilles ne sont pas affectées par les sargasses et il y a beaucoup plus
d’endroits préservés que d’endroits affectés", a-t-il souligné.
jpl/dar
© Agence France-Presse
712/06/2018
Les Antillais vont-ils pouvoir éliminer les sargasses ?
Denis Sergent ,
Alors que les ministres Nicolas Hulot et Annick Giradin viennent d’annoncer un plan de 10 millions
d’euros sur deux ans pour lutter contre les sargasses, ces algues toxiques qui envahissent les plages
antillaises, des essais de traitement semblent être fructueux.
La Guadeloupe est envahie depuis plusieurs années par des nappes
importantes d'algues Sargasses (la décomposition de ces algues est
néfaste pour la santé) qui envahissent les plages de l'île. / Emmanuel
Lelaidier/MaxPPP
► D’où viennent ces algues ?
« Il existe plusieurs dizaines d’espèces de sargasses. Celles qui
constituent les « marées brunes » et polluent depuis 2011 les îles
Caraïbes sont constituées de deux espèces, Sargassum fluitans et
S. nuitans, qui, contrairement à d’autres espèces, passent toute leur
vie, comme le plancton, à la surface de l’eau et au gré des courants,
du vent et des nutriments », explique Pascal Saffache, professeur
de géographie à l’Université de Martinique, spécialiste du littoral
martiniquais. Elles ne se forment pas uniquement dans la mer des Sargasses (environ 1100 sur 3200 km), située dans
l’océan Atlantique nord, au large de la Floride. Elles apparaissent aussi d’une part à l’embouchure de l’Amazone et
d’autre part, côté africain, en face du fleuve Congo. En pleine mer, elles peuvent former des bancs ou radeaux
gigantesques, jusqu’à 800 à 1000 km de long, alors que les îles antillaises mesurent moins de 100 km de long. Elles
semblent nourries par l’abondance de sels minéraux provenant des régions d’agriculture intensives brésiliennes où l’on
cultive la canne à sucre pour l’éthanol à grand recours de fertilisants et pesticides. Au Congo, l’avènement des sargasses
est plus dû à l’urbanisation côtière.
► Pourquoi sont-elles arrivées aux Antilles ?
Depuis 5 ou 6 ans, les pêcheurs ont observé un changement dans les courants marins de surface, laissant les
océanographes quelque peu sceptiques. Selon eux, le Gulf stream aurait dérivé vers l’ouest, grignotant les bancs
d’algues et les poussant vers le nord, dans l’archipel antillais. Majoritairement volcaniques, les îles antillaises possèdent
une côte déchiquetée avec de nombreuses baies et criques, ce qui joue le rôle de culs-de-sac pour les bancs d’algues.
« Aujourd’hui, non seulement leur quantité augmente, mais également la durée de leur échouage massif sur les plages :
d’avril à septembre habituellement on a, cette année, débuté en décembre, et malgré les images satellitaires, on est
incapable de prévoir l’évolution du phénomène », indique Pascal Saffache.
► Y a-t-il des techniques pour les détruire ou les valoriser ?
« Il y a environ 6 mois, j’ai suggéré de traiter les bancs massifs de sargasses en mer, avant même qu’ils n’arrivent sur les
côtes, explique le géographe. Une expérience est d’ailleurs en cours avec un bateau muni d’une sorte de tapis roulant qui
charge les algues, mais il ne ramasse que 40% du volume. Une amélioration de la technique consisterait à utiliser deux
chalutiers pour tracter les bancs d’algues vers la côte, puis les charger sur des barges de façon à décharger des algues
propres à terre, avant de les valoriser.
Il existe en Martinique une entreprise qui les transforme en polymères végétaux, tandis qu’à Saint-Malo (Ile-et-Vilaine), la
société Algopack affirme avoir mis au point une technique pour fabriquer des biomatériaux à partir de sargasse. Enfin, en
juillet, l’université des Antilles lancera une étude scientifique de valorisation. Une solution semble marcher en République
dominicaine (partie ouest de l’île d’Hispaniola, Haïti occupant l’ouest), un pays dont l’économie actuelle repose
essentiellement sur le tourisme international. Après avoir ramassé les algues en mer, elles sont finement broyées puis
immergées au large, à l’aplomb de fosses profondes d’au moins 2000 mètres. « En Martinique, sous réserve de
vérification et de surveillance, on pourrait imaginer de faire la même chose, suggère Pascal Saffache. En attendant, le
plan Hulot vise à ramasser les algues dans les 48 heures après les échouages, délai au-delà duquel elles dégagent des
gaz toxiques. En effet, autant à peine arrivées elles dégagent de l’hydrogène sulfuré (odeur d’œuf pourri) et de
l’ammoniac, gaz nauséabonds entraînant irritation des muqueuses et larmoiements, autant au bout de 48 heures, on ne
sent plus rien, mais le gaz dégagé est alors toxique, pouvant entraîner vomissements, coma et mort.
9LE JOURNAL DU DIMANCHE.FR
12/06/2018
Nicolas Hulot : ce que contient son plan contre les
sargasses, ces algues toxiques qui polluent les rivages
antillais
En déplacement aux Antilles, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot et la ministre des Outre-
mer Annick Girardin ont annoncé un plan de 10 millions d’euros pour lutter contre les sargasses, ces algues
brunes qui polluent les rivages antillais. "Le phénomène n’a jamais été aussi important que cette année." En
Guadeloupe dimanche puis en Martinique lundi, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, n'a pu que
constater les dégâts causés par les sargasses, ces algues brunes toxiques qui se sont multipliées sur les rivages
antillais ces dernières semaines. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, se trouvait à ses côtés.
Critiqués pour leur visite tardive, les deux ministres ont annoncé un plan de dix millions d'euros pour lutter
contre ce phénomène.
La sargasse, une algue brune toxique
Les sargasses sont une variété d’algues brunes, que l'on trouve historiquement dans la mer des Sargasses, au
large de la côte est des Etats-Unis. Mais depuis plusieurs années, un phénomène a été constaté : les algues se
déplacent vers les eaux tropicales, notamment dans les Caraïbes depuis 2011. Inoffensives en pleine mer, elles
représentent un danger lorsqu'elles s'échouent sur les rivages et se décomposent. Elles dégagent en effet des gaz
nocifs pour l'homme et les animaux : l’hydrogène sulfuré et l’ammoniac. Leur inhalation peut notamment
provoquer des infections des voies respiratoires. La baignade a d'ailleurs été interdite sur plusieurs plages,
notamment en Guadeloupe.
Le gouvernement veut réagir plus vite en cas d'échouage
Le gouvernement a détaillé ses objectifs et ses mesures dans un communiqué officiel, dont voici ce qu’il
retenir :
Afin de renforcer le suivi et la prévision des marées de sargasses, 22 capteurs seront installés sur les plages de
Martinique et de Guadeloupe. Ces capteurs, reliés à un site internet, permettront de mesurer et de transmettre
en direct les dégagements de gaz. Par ailleurs, le réseau de suivi et d’échouage des sargasses par satellite sera
renforcé à hauteur de 300.000 euros.
Pour éviter que les algues entrent en décomposition et diffusent des gaz toxiques, des solutions de collectes
plus rapides et plus efficaces seront mises en place avec pour objectif de pouvoir intervenir en moins de 48
heures. En plus des dix millions d'euros promis par le gouvernement, dont 50% seront financés par l’Union
européenne, trois millions d’euros seront débloqués dans les semaines prochaines et viendront compléter le
fond d’urgence prévu pour l’achat de matériels de déblayage.
Les recherches concernant l’origine des algues vont s’intensifier, tout comme l’innovation pour trouver des
solutions durables.
Le gouvernement veut ouvrir le dialogue entre les compagnies d'assurance et les particuliers et entreprises
touchés par le phénomène.
On ignore toujours les raisons exactes de l’échouage massif des sargasses
Le dossier est complexe, car on ignore toujours les raisons de l’échouage massif des sargasses sur les plages
antillaises. Ce phénomène serait lié à l'élévation des températures des eaux marines mais aussi au trafic
maritime dans les Caraïbes, qui accentuerait le déplacement des algues. Une autre piste est étudiée : celle de la
déforestation en Amazonie. "L’agriculture se développe dans des milieux où il n’y avait pas d’agriculture
autrefois. De ce fait, les grands fleuves comme l’Amazone se chargent en sels nutritifs qui peuvent, une fois
arrivés en mer, vraisemblablement être utilisés par les algues", explique ainsi l’océanographe Jean Blanchot à la
chaîne la 1ère. Une vaste étude est en cours mais les résultats ne sont pas attendus avant fin 2018.
Par Agathe Fourcade
10lefigaro.fr
12/06/2018
Antilles : Hulot annonce un plan antisargasses de 10 millions d'euros
Par Morgane Rubetti et AFP agence
Ces algues s'échouent en masse sur les côtes de la Guadeloupe et de la Martinique. Elles s'amoncellent sur les
rivages et dégagent, en séchant, de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac, qui peuvent provoquer maux de tête,
nausées et vomissements.
Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a annoncé lundi en Guadeloupe un plan de 10 millions
d'euros contre les sargasses, ces algues brunes nauséabondes qui polluent les rivages. L'État prendra en charge
près de 50 % du financement de ce plan prévu sur deux ans (jusqu'en 2019). Le reste sera financé par l'Union
Européenne et les collectivités, dont l'investissement sera à adapter en fonction des besoins. «Il faut qu'à la
prochaine saison on puisse atteindre l'objectif de ramassage 48h après les échouages», ont indiqué à l'AFP les
services du ministère.
Ces algues envahissent les Caraïbes depuis 2011. Mais c'est surtout depuis le mois de février que les algues
arrivent en masse sur les côtes. Les sargasses servent également d'abri à plusieurs espèces marines.
Inconvénient: il s'agit avant tout d'animaux toxiques ou venimeux comme le poisson lion. Elles s'amoncellent
sur les rivages, salissent plages et ports, bloquent parfois l'accès des bateaux, mais surtout dégagent, en séchant,
de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac, qui peuvent provoquer maux de tête, nausées et vomissements.
Le plan Hulot prévoit donc de déployer 22
capteurs en Guadeloupe qui permettront de
remonter les données d'échouages, de
dégagement de gaz, et d'améliorer la
surveillance, afin que les collectivités
puissent émettre des bulletins quotidiens
par exemple. L'ensemble des données
seront mises en ligne sur un site en open
data et participatif. Enfin, une mission,
dirigée par le sénateur Dominique
Théophile se rendra dans les îles voisines à
la recherche de solutions de ramassage et
de valorisation, mais aussi dans l'optique de favoriser une coopération régionale.
Ce plan sera également appliqué en Martinique, où, samedi, des manifestants ont lancé des sacs remplis de
sargasses à travers les grilles de la préfecture de Fort-de-France. Près d'une cinquantaine de personnes vêtues de
noir ont manifesté à l'appel du collectif «Matinik pou anlot vision de Lafrik (Martinique pour une autre vision
de l'Afrique en créole) pour protester contre l'action de l'État selon eux insuffisante face à l'invasion des
sargasses. «Jamais, il (l'État) n'aurait laissé un problème durant des années se faire comme ça en Bretagne ou à
Marseille, enfin sur les côtes du littoral français» a assuré dimanche Olivier Bérisson, porte-parole du collectif,
interrogé par RCI Martinique.
Du point de vue des indemnisations, si «des mesures conservatoires», notamment un moratoire sur les charges
des entreprises, seront mises en place, les discussions avec les assureurs doivent se poursuivre. «Il s'agit aussi
d'anticiper sur les années suivantes», notent les services du ministère, pour qui les territoires doivent «être
prêts» à affronter de nouvelles crises dans le futur.
11lefigaro.fr
12/06/2018
Des essais peu concluants
De son côté, le conseil départemental de Guadeloupe avait envisagé à la mi-mai d'utiliser «un bateau de dragage
de fond» pour «aspirer en haute mer» les sargasses «avant qu'elles n'arrivent sur les côtes». Mais, lepremier
essai fin mai s'est avéré «peu concluant» d'après Jean-Yves Bremer, responsable interdépartemental Polmar,
interrogé par Guadeloupe 1ère.
Photo prise en 2011 des algues sargasses en Martinique. - Crédits photo : PATRICE COPPEE/AFP
Après cet échec, une société de chaudronnerie guadeloupéenne a créé le «Sargator», une embarcation capable
d'aller jusqu'à 1m80 de profondeur et pouvant récolter 6 tonnes d'algues par heure. Une initiative intéressante
mais insuffisante puisque pour soigner la totalité de l'île, il faudrait posséder une dizaine d'engins.
Pendant leur déplacement, Nicolas Hulot et ses équipes assurent «avoir pris la mesure» tant de la situation que
de la nécessité d'une plus grande transparence sur les actions menées. Face aux critiques sur sa visite tardive,
l'équipe ministérielle indique que les choses «n'ont pas commencé là», et que les élus locaux ainsi que les
populations ont pris le problème à bras-le-corps, avec des gens «exaspérés mais mobilisés», dont l'action et
l'ingéniosité, malgré la lassitude et l'épuisement ont été salués.
Afin de protéger les habitants de ces rejets toxiques, la commune de Petit-Bourg, située au bord de la mer, a
annoncé fin mai la «fermeture préventive des établissements scolaires». Le maire Guy Losbar a pris un arrêté
qui ferme «jusqu'à nouvel ordre», les écoles maternelles et élémentaires du bourg, ainsi que d'un autre quartier
de la ville. Le dispositif «concerne également le collège et le lycée», indique le communiqué. Au total, plus de
2000 élèves dans huit établissements scolaires sont concernés par la mesure.
Morgane Rubetti ET AFP.
1213
14
15
Plus d'un millier personnes défilent à Fort-de-France pour "sauver l'hôpital"
Fort-de-France, France | AFP | mardi 12/06/2018 - 23:37 UTC+3 | 223 mots
Entre 1.300 et 2.000 personnes, selon la police ou les organisateurs, ont manifesté mardi dans les rues de Fort-
de-France pour la défense et la survie du CHU de la Martinique, à l’appel d'un collectif de professionnels et de
syndicats du secteur de la santé.
Face à "la déliquescence du CHUM (rupture fréquentes d’approvisionnements, disparitions de spécialités
médicales) le collectif entendait ainsi attirer l’attention du gouvernement et mobiliser la population à propos
d'une situation "d’une gravité extrême" et qui pose la question de la survie même du système de santé en
Martinique, selon lui.
Aux cris de "Buzyn, où es-tu, l’hôpital est dans la rue", les manifestants, soutenus par des élus et un syndicat de
camionneurs, ont parcouru les artères de Fort-de-France avant de se rendre à la préfecture. La mobilisation doit
se poursuivre mercredi avec une opération ville morte à l'initiative de l'association des maires de l'île.
Annick Girardin, ministre des Outre-mer, actuellement dans l’île avec le ministre de la Transition écologique
Nicolas Hulot pour traiter la crise des sargasses, ces algues brunes toxiques qui ont envahi les rivages antillais
depuis février, a reçu durant près d'une heure et demie à la préfecture des membres du collectif. Face aux
difficultés du CHU, sa gestion a été placée sous administration provisoire depuis janvier 2018. L'Agence
régionale de santé avait souligné une "sévère dégradation de sa situation financière".
Jpl/caz/cam
L'épidémie de dengue ne faiblit pas à La Réunion
Paris, France | AFP | mardi 12/06/2018 - 17:56 UTC+3 | 277 mots
L'épidémie de dengue, qui a débuté début janvier à La Réunion, ne faiblit pas malgré l'hiver austral, avec 4.604
cas de dengue confirmés depuis le début de l’année, et une moyenne de 300 à 400 nouveaux cas par semaine, a
indiqué la préfecture mardi. "L’épidémie se poursuit dans l'ouest et le sud à un niveau constant, toujours aux
alentours de 300 à 400 cas par semaine", explique la préfecture dans un communiqué.
"La mobilisation de tous est nécessaire durant l’hiver austral pour freiner cette dynamique et éviter une
épidémie de plus grande ampleur au cours de l’été prochain", ajoute-t-elle. La dengue est transmise à l'homme
par l'albopictus, communément appelé moustique tigre en raison de ses rayures.
La préfecture précise que les opérations de démoustication sont réalisées "autour du domicile des personnes
malades signalées par les médecins ou les laboratoires, et dans les zones connues de circulation du virus", afin
de "réduire les populations de moustiques adultes dans ces zones et ainsi d’éliminer des moustiques déjà
infectés ou susceptibles de le devenir", une fois avoir piqué une personne malade.
Dans les zones de circulation virale les plus actives de l’île, notamment sur Saint-Paul, "les opérations de
pulvérisation spatiale de nuit", menées grâce à des appareils de pulvérisation insecticides montés sur des
véhicules pick-up, "sont dorénavant privilégiées compte tenu du nombre important de cas de dengue et donc de
l’impossibilité d’intervenir individuellement et systématiquement auprès de chaque cas", précise la préfecture.
Dans les zones moins étendues ou encore peu impactées, "les traitements en porte à porte de jour" sont menés
en journée dans les cours et jardins des particuliers grâce à des appareils de pulvérisation portés à dos.
caz/frd/sd
© Agence France-Presse
16Polynésie: près de la moitié des jeunes en surpoids
Paris, France | AFP | mardi 12/06/2018 - 16:42 UTC+3 | 409 mots
En Polynésie, 43,2% des élèves de 13 à 17 ans sont en surpoids, dont 20% au stade de l'obésité, 40,9% ont déjà
été ivres au moins une fois dans leur vie, et 14,4% ont envisagé sérieusement de se suicider, selon une enquête.
Cette enquête, dans le cadre de l'enquête mondiale "the Global schoolbased student health survey" (GSHS), a
été menée dans 32 établissements scolaires, auprès de 2.678 jeunes Polynésiens scolarisés âgés entre 13 et 17
ans, soit 1.271 garçons et 1.407 filles, du 18 janvier au 24 mars 2016.
Selon les résultats de cette enquête, révélée par le site Outremers360, "43,2% des élèves polynésiens âgés de 13
à 17 ans sont en surpoids dont 19,8% au stade de l’obésité". Mais "10,2% des élèves ont eu faim la plupart du
temps ou tous les jours en raison d'une quantité insuffisante de nourriture disponible chez eux au cours des 30
derniers jours".
Une majorité (70,1%) affirme consommer au moins une fois par jour des fruits, mais seulement 46,8% en
consomment plus de deux fois par jour. Ils sont 77,4% à déclarer consommer au moins une fois par jour des
légumes, mais seulement 27,7% à en consommer au moins trois fois par jour.
Près de la moitié (43,6%) indiquent avoir bu au moins une boisson alcoolisée au cours des 30 derniers jours. Et
40,9% ont déjà été ivres au moins une fois dans leur vie. Près d'un quart (23,2%) disent même avoir été ivres au
cours des 30 dernier jours.
Ils sont également plus d'un quart (28,6%) à avoir déjà consommé au moins une fois dans leur vie de la drogue
(marijuana-paka, ICE, cocaïne, substances inhalées, solvants). 27,1% déclarent avoir déjà consommé du paka
(marijuana), et 15,5% déclarent en avoir consommé dans les 30 derniers jours.
Un quart (25,7%) a consommé du tabac, au moins un jour au cours des 30 derniers jours et 65,5% des élèves
ayant déjà fumé, l'ont fait avant 14 ans.
Enfin, 39,8% des élèves déclarent avoir déjà eu des rapports sexuels, les garçons plus que les filles (45,2%
contre 34,6%). Parmi ceux ayant déjà eu des rapports sexuels, 36,2% ont eu leur premier rapport sexuel avant
l’âge de 14 ans, les garçons plus que les filles (43,1% contre 27,9%).Par ailleurs, au cours des 12 derniers mois,
14,4% des élèves ont envisagé sérieusement de se suicider, les filles plus que les garçons (20,1% contre 8,8%).
Et 9,9% déclarent avoir fait au moins une tentative de suicide.
caz/mat
© Agence France-Presse
17Inquiétude autour des aides agricoles européennes pour les Outre-mer
Paris, France | AFP | mardi 12/06/2018 - 19:01 UTC+3 | 320 mots
Le député de La Réunion David Lorion (LR) a saisi Edouard Philippe, dans une lettre dont l'AFP a eu copie,
pour lui demander de défendre le programme d'aides européennes agricoles spécifiques aux Outre-mer, que la
Commission européenne veut baisser.
Le 1er juin, la Commission européenne a fait part de son intention de baisser de 3,9% les aides directes de la
PAC (Politique agricole commune), et donc de baisser du même taux le budget accordé au Programme d'option
spécifique à l'éloignement et à l'insularité (POSEI), déclinaison de la PAC pour les Outre-mer.
Or "ce mécanisme vital permet de compléter, de garantir dans les différentes filières organisées, le revenu des
producteurs locaux", souligne M. Lorion.
"Cette annonce est incompréhensible tant elle est contraire aux annonces faites le 27 octobre dernier par le
président Jean-Claude Junker, qui s'était engagé, en Guyane devant le président Macron, à poursuivre le POSEI
pour l'agriculture et à ne pas le réduire", insiste-t-il.
M. Junker avait alors déclaré: "Nous allons poursuivre les POSEI pour l'agriculture. Je ne compte pas les
réduire et les corriger vers le bas".
Pour M. Lorion, "la France doit tout entreprendre pour qu'il y ait un maintien de l'enveloppe agricole consacrée
aux Régions ultrapériphériques (RUP)" (nom donné aux Outre-mer par l'Union européenne).
Faute de quoi, "les conséquences seraient dramatiques" pour "le développement de la production locale", "les
filières exportatrices et la sécurité alimentaire", dit-il.
Le POSEI est distinct de la politique continentale agricole. Il est "adapté pour permettre le développement
d’une production agricole et agro-industrielle locale en butte à la concurrence féroce des importations, ainsi que
d'une production exportatrice", souligne la Fédération des entreprises d'outre-mer (Fedom), dans sa lettre
hebdomadaire.
Outre une "chute de la production locale, sur le plan quantitatif et qualitatif", la Fedom estime que la baisse du
POSEI entrainera une "menace pour la survie des agriculteurs" et "des entreprises agro-alimentaires qui
constituent le cœur du réacteur industriel dans les RUP".
caz/mat/phc
© Agence France-Presse
1812/06/2018
Tourisme en Outre-mer : Inès Bouchaut-Choisy « au
plus près des territoires » pour présenter son
rapport sur le Tourisme durable
©Facebook / Inès Bouchaut-Choisy
La représentante de Saint-Barthélemy au CESE et
présidente du groupe Outre-mer dans cette même
institution, Inès Bouchaut-Choisy, a entamé une
campagne de sensibilisation et de présentation de son
rapport sur le Tourisme durable en Outre-mer, adopté
le 28 mars dernier, « au plus près des territoires ».
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Guadeloupe. La semaine
dernière, la présidente du groupe Outre-mer au CESE,
auteure d’un rapport sur le Tourisme durable Outre-mer, a sillonné la Caraïbe pour sensibiliser sur la nécessité
« d’envisager un nouveau modèle » de développement touristique. Tour à tour, Inès Bouchaut-Choisy a
rencontré le président de la Collectivité de Saint-Barthélemy, Bruno Magras, le président et les membres du
CESE de la même île, « qui travaillaient déjà sur la problématique », le président de la Collectivité de Saint-
Martin, Daniel Gibbs, la sous-préfète des îles du Nord, la Première ministre de Sint-Marteen, Leona Marlin
Romeo et enfin, le président et les membres du CESER de Guadeloupe. « Nos constats sont partagés et il y a
une volonté d’envisager un modèle alternatif au modèle balnéaire. Les comités du tourisme sont bien
conscients qu’un cycle a été atteint mais ils s’interrogent sur la structuration d’une filière tourisme durable »,
explique-t-elle.
« La Guadeloupe s’inscrit totalement dans cette démarche de tourisme durable. La crise des sargasses a mis
davantage en relief cette nécessité de repenser le modèle et surtout, sans opposer tourisme durable et tourisme
balnéaire, se dire qu’il y avait une alternative possible. C’est dans cette approche que nous avons approfondi
notre identité de nos territoires, les atouts que nous avons et tout ce patrimoine culturel et naturel que nous
avons valorisé dans les stratégies du tourisme », poursuit-elle. Pour Inès Bouchaut-Choisy, si la sensibilisation
sur le terrain est une nécessité, celle des plus hauts dirigeants l’est tout autant. « Le 24 mai dernier, nous avons
remis l’avis à la ministre des Outre-mer qui nous a proposé de consacrer les prochaines rencontres nationales
du tourisme Outre-mer au tourisme durable. Un événement que nous pourrions par ailleurs co-organiser »,
indique-t-elle.
Ce lundi 11 juin, ce fut au tour de l’Elysée, notamment au Conseiller à l’Outre-mer Stanislas Cazelles, d’être
sensibilisé sur le sujet du tourisme durable. Non sans raison, car au-delà des palabres, Inès Bouchaut-Choisy
veut « arriver à un plan d’action, à la mise en place d’une politique de développement du tourisme durable ».
Sur les interrogations des professionnels concernés sur la structuration de la filière, Inès Bouchaut-Choisy pose
une solution : « Dans nos préconisations, on propose que soient organisées des conférences stratégiques du
tourisme (…) et permettre aux professionnels du tourisme, aux représentants des chambres consulaires et
agricoles et aux citoyens de travailler ensemble et bâtir une stratégie de tourisme durable ». Pour la suite, Inès
Bouchaut-Choisy poursuit sa campagne de sensibilisation sur le tourisme durable en Outre-mer. Ce mardi, la
présidente du groupe Outre-mer au CESE a notamment été reçue par le Ministère de l’Economie.
1920
Chubb nomme Steven Goldman vice-président exécutif en charge des lignes financières pour l'assurance générale d'outre-
mer
communiqué - | PR Newswire | mardi 12/06/2018 - 15:30 UTC+3 | 621 mots
Michael Mollica dirigera les institutions financières de détail en Amérique du Nord
NEW YORK, 12 juin 2018 /PRNewswire/ -- Chubb a annoncé aujourd'hui que Steven F. Goldman a été nommé vice-
président exécutif en charge des lignes financières pour l'assurance générale d'outre-mer, l'activité d'assurance générale
internationale de la société dans 51 pays.
Dans ce nouveau rôle, M. Goldman sera responsable de la division des lignes financières internationales de Chubb qui
couvrent la responsabilité des administrateurs et des dirigeants, les institutions financières, les erreurs et omissions, le
risque transactionnel et le cyber-risque. Cette nomination prendra effet le 1er juillet. M. Goldman sera basé à New York
et relèvera de Timothy O'Donnell, qui a été nommé hier vice-président du Chubb Group et président de la division des
assurances commerciales générales pour l'assurance générale d'outre-mer.
M. Goldman est actuellement vice-président exécutif de la division des lignes financières de Chubb aux États-Unis où il
dirige le segment des institutions financières de détail. Il dirige également l'activité de risque transactionnel de Chubb,
une division qu'il a aidé à créer et qu'il dirige depuis sa création. « Steve est un dirigeant hautement expérimenté dans le
domaine des lignes financières », a déclaré M. O'Donnell. « Il possède d'excellentes compétences en leadership et
souscription technique et je me réjouis à l'idée de travailler avec lui à l'heure où nous développons la présence et les
capacités de Chubb dans les lignes financières internationales. »
« Chubb s'est forgé une solide réputation de leader dans la souscription de lignes financières à l'échelle mondiale avec un
vaste vivier de cadres talentueux dans le monde », a confié pour sa part Juan Andrade, vice-président exécutif du Chubb
Group et président de la division d'assurance générale d'outre-mer. « Je suis heureux d'accueillir Steve dans l'équipe
générale d'outre-mer de Chubb et je me réjouis à l'idée de l'impact qu'il aura sur notre entreprise. »
M. Goldman possède près de vingt ans d'expérience en souscription et gestion du risque et est un juriste titulaire d'une
licence en taxation. Le successeur de M. Goldman est Michael Mollica, qui a été nommé vice-président exécutif en
charge des lignes financières pour l'Amérique du Nord. M. Mollica a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur. Il sera
basé à New York et relèvera de Scott Meyer, président de la division des lignes financières en Amérique du Nord.
« Les solides antécédents et connaissances de Michael dans cet espace, de pair avec son expérience approfondie en
leadership, font de lui la personne idéale pour ce rôle,» a ajouté M. Meyer. « Je suis impatient de collaborer avec lui et
confiant que sa profonde compréhension des exigences de nos clients contribuera à la croissance future de cette
entreprise. »
À propos de Chubb
Chubb est la plus grande compagnie d'assurance de biens et de risques cotée en bourse au monde. Avec des opérations
dans 54 pays et territoires, Chubb propose des assurances de biens et de risques personnelles et commerciales, des
assurances individuelles contre les accidents et des assurances complémentaires de santé, de la réassurance et des
assurances-vie à un groupe diversifié de clients. En tant que société de souscription, nous évaluons, assumons et gérons
les risques avec vision et discipline. Nous traitons les sinistres et les indemnisons équitablement et rapidement. La société
se définit également par son offre étendue de produits et de services, ses vastes capacités de distribution, son
exceptionnelle santé financière et ses opérations locales dans le monde entier. La société mère Chubb Limited est cotée à
la bourse de New York (NYSE : CB) et figure dans l'indice S&P 500. Chubb dispose de bureaux exécutifs à Zurich, New
York, Londres et à d'autres endroits, et emploie environ 31 000 personnes dans le monde. Pour plus d'informations,
consulter : chubb.com.
Copyright © 2018 PR Newswire Association LLC. All Rights Reserved. A Cision company.
Avertissement :
Ce document n’est pas un document de l’AFP et l’AFP ne peut être tenue responsable pour son contenu. Pour toute
question concernant le contenu, nous vous demandons de bien vouloir contacter les personnes/sociétés indiquées dans le
corps du communiqué de presse.
21L’OUTRE-MER
DANS LA PRESSE
LOCALE
22LES UNES DE LA PRESSE LOCALE
23LES UNES DE LA PRESSE LOCALE
24GUADELOUPE
2526
27
GUYANE 28
29
30
31
MARTINIQUE
3233
34
12/06/2018
Un plan d'action gouvernemental de 13 millions d'euros contre les échouages des
algues sargasses
Le gouvernement s'attaque à la problématique des sargasses et annonce un plan de 13 millions pour
accompagner les investissements et les opérations de ramassage des collectivités territoriales concernées. Ces
mesures concernent "la Guadeloupe, les îles du Nord, la Martinique et la Guyane
© cap/fb/préfecture Nicolas Hulot et Annick Girardin au cours d'une réunion en préfecture en Martinique (11 juin 2018)
Par Jean-Claude SAMYDE
Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire et Annick Girardin, ministre des outre-mer, se rendent ce
mardi 12 juin dans les communes de Martinique. Ils iront au Diamant, au François et au Robert afin d’aborder la
problématique des sargasses.
En visite officielle en Guadeloupe, Nicolas Hulot et Annick Girardin ont annoncé, (lundi 11 juin) une série de mesures
pour faire face à cette situation exceptionnelle.
Les principales mesures
Ces mesures pour la Guadeloupe, les îles du Nord, la Martinique et la Guyane, seront financées à hauteur de 10 millions
d’euros par l’État, et permettront d’accompagner les investissements et les opérations de ramassage des collectivités
territoriales concernées. 10 millions d'euros auxquels s'ajoutent 3 millions supplémentaires débloqués en urgence.
3512/06/2018
© Martinique1ere
Les collectivités devront mettre en place des solutions de
collectes permettant d'intervenir en moins de 48h pour
éviter la décomposition des algues.
L'État va renforcer la recherche et l’innovation ainsi que
la coopération régionale et internationale pour apporter
des réponses sur la question de l’origine des algues.
Une mission, dirigée par le sénateur de Guadeloupe
Dominique Théophile, se rendra dans les îles voisines de la caraïbe à la recherche de solutions de ramassage et de
valorisation.
© Martinique la 1ere Algues sargasses au Robert.
Anticiper l'arrivée des algues
Les ministres prévoient la mise en place de capteurs en
Guadeloupe et en Martinique permettant de réaliser des
mesures en direct des dégagements de H2S et
d’ammoniac.
Un site internet donnera les mesures en direct, pour
renforcer la transparence et l’information de la population.
Une étude scientifique ECOSAR sera lancée en juillet par l’Université Antilles Guyane pour mieux documenter la
composition des sargasses afin de faciliter leur valorisation (avec l’appui de l’ADEME 350 000 euros et des collectivités
locales).
Le renforcement du réseau de suivi et d’échouage des sargasses par satellite, doté de 300 000 euros pour continuer à
améliorer la prévision et le suivi des nappes qui dérivent vers les Antilles et qui présentent un risque d’échouage.
Le risque "sargasse" dans les contrats d'assurance
Une première réponse est apportée dans le volet économique. Il y a l'objectif d'accompagner les citoyens et les
entreprises touchés par les sargasses pour limiter les pertes économiques, en lien avec les assureurs qui pourront
proposer d’inscrire désormais le risque sargasse dans les contrats d’assurance.
3613/06/2018
Rencontre internationale sur les sargasses début octobre en Martinique (Hulot)
Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a annoncé mardi à Fort-de-France la tenue
d'"évènements internationaux" aux Antilles, notamment début octobre en Martinique, sur la problématique des
sargasses.
© PPF Conférence de presse d'Annick Girardin et Nicolas Hulot
sur le plan sargasses à la résidence préfectorale en Martinique.
Aux côtés de la ministre des Outre-mer Annick Girardin, Nicolas
Hulot dressait le bilan sa visite aux Antilles consacrée à la "crise
des sargasses", lors d'une conférence de presse à la résidence
préfectorale. "Si toute la région des Caraïbes est touchée, elle ne
l'est pas avec le même niveau de gravité", a indiqué le ministre.
"Mutualiser nos expériences"
Selon lui, pour la compréhension et la résolution de la crise des sargasses, il faut "mutualiser nos expériences, nos
intelligences et nos moyens". Dans cette perspective, "nous engagerons et nous organiserons un certain nombre
d'événements internationaux, ici aux Antilles, et particulièrement début octobre en Martinique, pour aborder cette
problématique au niveau régional et au niveau international", a indiqué Nicolas Hulot. Le ministre est également revenu
sur le plan de 10 millions d'euros annoncés la veille en Guadeloupe pour lutter contre l'invasion des sargasses. "Nous
avons entendu la détresse, l'inquiétude et la colère salutaire et nécessaire de celles et ceux qui vivent au quotidien" cette
situation, a-t-il dit.
"Ce phénomène nous dépasse tous"
A la mi-journée au Robert, une commune côtière particulièrement touchée, Nicolas Hulot et Annick Girardin, avaient été
interpellés par des riverains excédés devant l'incapacité de l'Etat, selon eux, à régler ce problème. "On est venu vous dire
la vérité, leur a répondu Nicolas Hulot. Ce phénomène nous dépasse tous. Il vous affecte en priorité. On est là à vos côté."
"On va essayer de résoudre les problèmes un par un et sur la durée. Je ne peux pas vous dire autre chose et je ne peux
pas vous faire de mensonges et je n'ai pas de solutions immédiates", a ajouté d'un ton vif le ministre de la Transition
écologique.
Plus tôt dans la matinée, les ministres avaient visité Holdex Environnement, un site de traitement des algues sargasses
et de valorisation agronomique, au François. Un centre de valorisation qui "ouvre beaucoup d'espoir en aval de la
collecte des sargasses qui a bénéficié d'une participation de l'Ademe à hauteur de 3,5 millions d'euros pour sa mise en
place", selon Nicolas Hulot. Nous mobiliserons la banque publique d'investissement (BPI) pour faire en sorte de
développer cette structure et la valorisation des sargasses", a indiqué le ministre. Enfin conscient de l'impact de cette
crise sur le secteur du tourisme, Nicolas Hulot a invité les touristes à ne pas déserter cette région. "Toutes les Antilles ne
sont pas affectées par les sargasses et il y a beaucoup plus d'endroits préservés que d'endroits affectés", a-t-il souligné.
37Vous pouvez aussi lire