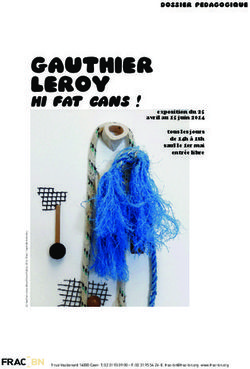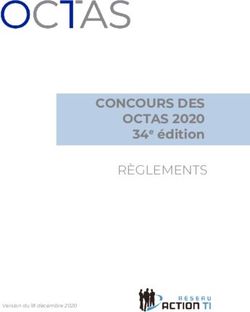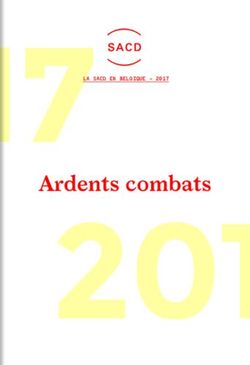APPEL À PROPOSITION POUR UNE COMMANDE ARTISTIQUE
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
APPEL À PROPOSITION POUR UNE COMMANDE ARTISTIQUE
I – Objet de la consultation :
Création d’un projet artistique pour la Nuit Blanche 2017 sous forme d’une œuvre multimédia ou installation
audiovisuelle originale conçue en réaction à un corpus de documents d’archives et de pièces patrimoniales
documentant le début de l’activité spatiale « ballon » du CNES (Centre national d’études spatiales). À l’issue
de cette consultation, trois projets d’artistes ou de collectifs d’artistes seront sélectionnés. Après une phase
d’approfondissement et de recherche au cours de laquelle une documentation complémentaire sera apportée
par l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire arts-sciences du CNES, les trois projets lauréats seront mis en scène
dans la salle de l’Espace du CNES à Paris lors de la prochaine Nuit Blanche.
A/ Le contexte de la commande
Pour cette prochaine édition de Nuit Blanche, l’Observatoire de l’Espace du CNES souhaite, au travers
d’une nouvelle rencontre arts-sciences, mettre en scène l’Espace par des échanges créatifs et itératifs avec les
artistes à partir des archives spatiales. Pour cette édition 2017, l’Observatoire de l’Espace propose aux artistes
de s’intéresser à un corpus documentaire témoignant des débuts de l’aventure spatiale française afin d’en
extraire - à partir de concepts fédérateurs ou de résonances particulières - une dynamique, une esthétique ou
une réflexion s’appuyant sur ces documents. Ce corpus composé de schémas, documents écrits, dessins, films
et photographies met en lumière une aventure certes scientifique et technique mais avant tout humaine et
créative.
Comme pour chacun des événements lancés par l’Observatoire de l’Espace du CNES, l’écriture artistique et sa
mise en scène sont un moyen d’interroger le rapport des hommes avec l’Espace autour d’un corpus significatif de
l’aventure spatiale en le mettant en perspective au travers d’une autre grille d’analyse. A l’heure où ces sujets liés
à l’aventure spatiale et où les imageries scientifiques s’imposent quotidiennement dans l’actualité, la réflexion
que nous souhaitons engager ici, sur la place et le sens de préoccupations spatiales dans un processus large de
création, apparaît plus que jamais essentielle.
B/ Le commanditaire : l’Observatoire de l’Espace du CNES
Convaincu que l’aventure spatiale a été l’un des vecteurs de transformations culturelles majeures au XXème
siècle, et que le rêve spatial s’est révélé un puissant moteur pour alimenter les désirs de changement des
hommes, l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire arts-sciences du CNES, réaffirme en 2017, sa vocation de bâtir
au jour le jour des rapports nouveaux entre la culture et l’Espace.
Pour cela, il s’attache à analyser et montrer la place qu’occupe l’Espace dans notre histoire, nos représentations
et notre imaginaire. Il met à disposition ces recherches sous forme de matériaux à destination des artistes afin
qu’ils élaborent des créations inspirées par des notions liées aux problématiques spatiales telles que les mutations
du corps, les télécommunications, ou encore l’indépendance et la souveraineté. À travers les différents processus
d’appropriation que l’Observatoire de l’Espace invente, l’Espace devient un puissant embrayeur d’imaginaire et
une source de nouveaux récits.
II – Un projet pour la Nuit Blanche 2017
A/ Une création à partir des archives documentaires
Pour la prochaine Nuit Blanche 2017, l’Observatoire de l’Espace du CNES s’intéresse - au travers des archives
témoignant des débuts de l’activité ballon dans les années 60 - à la notion de réseaux et d’une façon plus
générale à la dynamique collaborative de la chaine de création spatiale. Sources d’inspiration, ces archives sont
proposées aux artistes ou collectifs d’artistes comme éléments de réflexion à une création intégrant ces données
spatiales afin de produire de nouveaux «récits» de l’espace.
Rappelons qu’au début des années 60, la France ne dispose comme technique spatiale que de fusées sondes qui
offrent de brefs moments d’expérimentations lors de trajectoires balistiques. Les ballons stratosphériques qui
peuvent rester longtemps dans l’atmosphère ouvrent par contre la possibilité d’étudier l’atmosphère, d’observer
le Soleil et les étoiles ou encore d’analyser l’impact des radiations sur des cellules vivantes. À cette époque, seuls
les États-Unis disposent de cette technique. La France, sous l’impulsion du CNES nouvellement créé en 1961, va
s’attacher à importer cette technique en France et à la développer pour la mettre au service des scientifiques. Le
premier programme qui verra le jour sera le programme d’étude de l’atmosphère, Eole.
Par la suite, le CNES, devenant un expert et pendant longtemps le seul acteur avec la NASA de cette technique,
© Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 1développera de nombreux modèles de ballons pour répondre aux différents usages des scientifiques. Ils iront
de plus en plus haut (40 km) d’altitude, seront de plus en plus gros (jusqu’à 1 million de m3), et resteront plus
longtemps en l’air (plusieurs mois). Pour ces raisons techniques et son faible coût de mise en œuvre relativement
aux autres activités spatiales, cette activité ballon subsiste jusqu’à nos jours à côtés des satellites.
Aujourd’hui cette activité se poursuit pour des usages scientifiques, mais se voit également envisagée par des
industriels comme Google pour distribuer ses services dans des endroits isolés.
Reste qu’en France, cette aventure puise sa source et a pu se concrétiser par l’engagement dans les années 60
d’un ingénieur et de sa famille qui se sont largement investis dans la mise au point de cette technique et de son
développement (Cf. Annexe 1)
Ce projet propose ainsi aux artistes ou collectifs d’artistes sélectionnés de se plonger, au côté de l’équipe de
l’Observatoire de l’Espace du CNES, dans les archives de ce programme ballon, de les utiliser comme une source
d’inspiration, de les détourner ou de se les approprier afin d’en faire émerger une création originale porteuse à
son tour d’un imaginaire culturel et artistique contemporain qui répond à l’esprit innovant de ces pionniers de
l’aventure spatiale.
Une sélection de documents d’archives est proposée aux artistes comme support à la réflexion et à la création
pour bâtir leur projet. Ils sont joints en annexe de ce document, accompagnés de petits textes introductifs
précisant le contexte historique et scientifique afin de les aider dans la démarche de restitution de ces archives
dans un contexte créatif plus large. (Cf. Annexe 2)
B/ Une commande de 3 œuvres et une exposition pour la Nuit Blanche 2017 au sein du CNES
Le projet Nuit Blanche 2017 est constitué de deux phases dépendantes l’une de l’autre.
La première est une commande de 3 œuvres audiovisuelles ou multimédia originales auprès de 3 artistes ou
collectifs d’artistes, sélectionnés sur note d’intention et dossier à l’issue de cet appel à proposition.
La seconde est une mise en espace des projets lauréats présentés au sein du CNES lors de la prochaine Nuit
Blanche 2017. Cette installation mettra en scène les œuvres produites lors de la phase précédente, dans la
perspective de créer un évènement significatif pour le public de Nuit Blanche 2017 autour de ce corpus spatial.
L’Observatoire de l’Espace du CNES prendra en charge le commissariat de cette exposition.
Les œuvres
Les œuvres audiovisuelles ou multimédia proposées par les artistes répondront, éclaireront, interpréteront
ou s’inspireront des archives proposées par l’Observatoire de l’Espace du CNES. Elles répondront aux notions de
réseaux, de chaines scientifiques, et technologiques et s’intéresseront plus largement à la dimension humaine et
collective des processus de conception de véhicules spatiaux tels que les ballons.
Ces créations, plastiques dans leur conception ne sont pas forcément linéaires, ni dans leur forme, ni dans leur
propos, mais doivent suivre une forme narrative ou expressive qui s’inscrit dans les partis pris esthétiques de
l’artiste. L’enjeu étant de déplacer l’angle d’observation de ce programme spatial du point de vue historique et
scientifique à celui de l’artiste, afin de l’éclairer d’un regard nouveau.
D’un point de vue pratique, des pièces ou documents peuvent être conçus ou rassemblés par l’artiste afin
d’être intégrés à l’œuvre audiovisuelle et multimédia. Dans le cas d’utilisation de sources (films, documents,
sons, images) autres que celles fournies par l’Observatoire de l’Espace, elles doivent être impérativement libres
de droits. Les œuvres audiovisuelles ou multimédia créées pour la Nuit Blanche 2017 pourront également être
complétées par des dispositifs créatifs qui précisent, soulignent ou accompagnent l’œuvre. Elles ne feront pas
partie de la pièce acquise par l’Observatoire de l’Espace du CNES même si elles font partie intégrante du projet
d’installation présenté pour Nuit Blanche 2017.
Les œuvres audiovisuelles et/ou multimédia réalisées s’inscriront dans l’approche cognitive et l’écriture plastique
des artistes ou collectifs d’artistes sélectionnés, mais devront également être issues des phases de définitions et
d’interaction qui mettront en regard les choix et positions de l’artiste (note d’intention) et l’approche culturelle
de l’Espace des équipes de l’Observatoire de l’Espace du CNES.
L’œuvre acquise est la pièce centrale de l’installation vidéo ou multimédia proposée. Elle peut être sous forme
numérique ou argentique (production audiovisuelle, installation vidéo, œuvres multimédia et interactives,
installation sonore, etc.). Sa forme comme son dimensionnement sont laissés à l’appréciation des artistes ou
© Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 2collectifs d’artistes, mais l’Observatoire de l’Espace du CNES veillera, dans la phase de réalisation, à la cohérence
générale des trois projets dans la salle d’exposition.
Les sculptures, peintures, photographies ou œuvres graphiques produites par les artistes au cours du processus
de création de l’œuvre audiovisuelle ou comme éléments constitutifs d’une installation vidéo, peuvent être mis
en scène dans l’espace de la salle d’exposition lors de la Nuit Blanche, mais resteront propriété de l’artiste. Les
productions audiovisuelles acquises par l’Observatoire de l’Espace du CNES restent la pièce majeure du dispositif.
Les œuvres audiovisuelles et/ou multimédia créées dans ce cadre seront propriété de l’Observatoire de l’Espace
du CNES et conservées par ses soins au sein de sa collection. Les équipes de l’Observatoire de l’Espace du CNES
assureront le suivi auprès des artistes ainsi que la cohérence de la proposition générale de l’exposition.
Les pièces présentées en annexe de ce document forment une partie du corpus d’archives sur le sujet. Un
travail commun entre l’artiste et l’Observatoire de l’Espace pourra aboutir à la mise à disposition de pièces
complémentaires. Par ailleurs, l’Observatoire de l’Espace du CNES accompagnera les artistes ou collectifs
d’artistes retenus dans leurs interrogations scientifiques et culturelles comme dans leurs besoins documentaires
en relation avec leurs pratiques artistiques.
L’exposition et la mise en scène des œuvres audiovisuelles
Les contraintes majeures pour la réalisation des œuvres proposées par les artistes sont celles liées à l’exposition
même des œuvres pour cette édition de Nuit Blanche 2017 dans la salle d’exposition du CNES.
L’exposition collective sera mise en scène dans un même espace ouvert, il sera donc nécessaire, au cours
du processus commun de travail, de prendre en compte, avant la réalisation de l’œuvre, cette contrainte
d’interaction avec les autres œuvres présentées, notamment les œuvres sonores.
Dans le cas d’une intervention de textes sonores ou écrits, l’œuvre devra alors être réalisée et interprétée « en
français ». La nature de l’œuvre et son dimensionnement dans l’espace sont laissés à l’appréciation de l’artiste.
Toutefois, de par la configuration de la salle d’exposition, la contrainte d’installation des œuvres en association
les unes avec les autres est forte. Ainsi, les œuvres sonores devront être réfléchies pour être présentées dans un
accrochage collectif. L’Observatoire de l’Espace du CNES veillera, lors de la phase de définition des œuvres, à ce
que soit trouvé un équilibre entre la mise en scène de chaque pièce et le projet collectif.
Phase de création-production et phase de communication autour des œuvres
La création-production des œuvres et la communication autour de ces œuvres se déploieront sur deux
grandes étapes temporelles parfois superposées : une première étape de création et de production des œuvres
s’étalera d’avril à août et sera centrée sur le travail et les besoins de chacun des artistes. Elle s’articulera autour
de trois rencontres collégiales au CNES à Paris.
La seconde étape se déploiera de mai à septembre et concernera les besoins de textes et d’images nécessaires
au projet d’édition et à la communication sur le projet. L’objectif éditorial est de témoigner du projet et de son
processus. Les artistes devront être disponibles lors de cette seconde phase pour répondre aux besoins spécifiques
du projet (édition, exposition, communication). Les artistes devront documenter tout le long de la phase de
travail la création de leur pièce (images, rencontres, documents, etc.) afin d’alimenter la communication autour
de l’exposition et de préparer le travail éditorial.
Production et acquisition des œuvres
La phase de sélection ne fait l’objet d’aucune rémunération. Un budget de 3500 € sera attribué à chacun des
artistes ou collectifs d’artistes sélectionnés. 1500 € seront versés pour la production des œuvres et 2000 € pour
l’acquisition de l’œuvre produite, la cession des droits patrimoniaux, se faisant quant à elle à titre gracieux. Cette
dernière somme sera attribuée à la livraison de l’œuvre après acceptation définitive du projet par l’Observatoire
de l’Espace du CNES. L’Observatoire de l’Espace prend en charge les frais relatifs à la scénographie de l’exposition.
L’Observatoire de l’Espace du CNES conservera l’œuvre audiovisuelle ou multimédia réalisée pour Nuit Blanche
dans ses collections. Cette pièce est unique et ne pourra être reproduite. L’œuvre finale, même si elle est
augmentée lors de l’exposition d’une installation comprenant d’autres pièces (issues de créations réalisées
pour intégrées la production audiovisuelle ou conçues directement pour la mise en scène de l’exposition Nuit
Blanche), restera la pièce maitresse de l’œuvre. La définition de l’œuvre finale sera déterminée par contrat en
fonction de la nature du projet proposé par l’artiste ou le collectif d’artiste sélectionné.
© Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 3Documentation et achats de droits
Les œuvres s’appuient sur des archives patrimoniales libres de droits. Une liste non exhaustive de documents
proposés aux artistes par l’Observatoire de l’Espace du CNES est jointe au dossier. Ces pièces sont mises à
disposition de l’artiste à titre de documentation pour concevoir leur projet. Elles peuvent éventuellement être
utilisées en reproduction dans l’œuvre elle-même, mais en aucun cas ne peuvent être utilisées pour tout autre
usage que répondre à cet appel.
Il est à préciser que le CNES ainsi que les personnes qui y sont rattachées et encore vivantes ne sauraient être
désignées explicitement dans les créations proposées.
Par ailleurs, toute proposition à visée raciste ou pornographique, indépendamment de tout jugement sur la qualité
de la création, ne pourra être acceptée en l’état. Le cas échéant, ces questions seront à traiter au cas par cas.
L’édition
L’Observatoire de l’Espace du CNES édite semestriellement la revue Espace(s) qui témoigne de son engagement
culturel dans l’univers de la création autour de l’univers spatial. Un dossier spécifique sera consacré à ce projet
au sein du numéro de la revue qui paraitra à l’occasion de l’exposition en octobre.
Pour ce dossier, qui présentera chacun des projets artistiques retenus pour Nuit Blanche 2017, les artistes devront
fournir à l’Observatoire de l’Espace du CNES des matériaux documentaires illustrant leur démarche tout au long
du processus de création. Ceci dans le but de mettre en valeur leur travail artistique et son élaboration à partir
des archives proposées par l’Observatoire de l’Espace du CNES.
Un planning indicatif est mentionné dans la fiche de candidature.
Dossier de candidature
Pour être recevable, le dossier de candidature, rédigé en langue française, sera obligatoirement constitué des
pièces suivantes, datées et signées par le candidat.
1/ Le formulaire de candidature complété et signé accompagné d’un résumé de la proposition de l’artiste.
2/ Une note d’intention (2 pages A4 maximum - caractère 10 pts minimum).
L’artiste évoquera les modalités d’utilisation des archives, comment elles entrent en résonance avec ses propres
interrogations et ce qu’elles lui évoquent ainsi que la forme de restitution envisagée pour la création de sa
pièce. Pour la conception de leur proposition artistique, les artistes doivent se référer à la note jointe en annexe
illustrée d’une sélection d’archives.
L’artiste doit proposer à partir de cette première documentation, un projet de création qui témoignera d’un parti
pris artistique fort et dont les ambitions esthétiques et intellectuelles se nourriront des archives proposées. La
piste documentaire évoquée dans le dossier n’étant pas exclusive, les artistes peuvent tout aussi bien s’engager
sur une piste fictionnelle, ou bien proposer des expérimentations plus formelles, toujours en mettant en
perspective cette histoire spatiale.
Il s’agit dans cette note d’intention de signifier l’identité du travail proposé afin que l’Observatoire de l’Espace
du CNES puisse évaluer la direction de travail souhaitée par l’artiste. Les modalités d’utilisation des archives sont
laissées à l’appréciation de chacun, dans le respect de l’intégrité des éléments. L’artiste reste également libre
d’alimenter sa création de ses propres sources. Dans tous les cas, l’artiste doit justifier dans sa note d’intention,
de ses choix artistiques en cohérence avec le projet et formuler la manière dont il entend se saisir du matériau
proposé (élément d’inspiration sous-jacent, utilisation de l’archive brute, utilisation d’extraits etc.).
3/ Un dossier artistique présentant une sélection de créations antérieures avec un curriculum vitae actualisé.
Ces références seront accompagnées d’une légende de quelques lignes précisant le type d’œuvre, leur coût, la
date de réalisation et le destinataire public ou privé (inclure tout visuel / DVD / CD-R, liens vidéos ou sonores,
etc. permettant une meilleure compréhension de la démarche artistique et des projets antérieurs).
4/ Un texte d’une page maximum sur la démarche artistique générale de l’artiste et sur ses motivations
pour une création dans le cadre de l’Observatoire de l’Espace, laboratoire arts-sciences du CNES.
© Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 4Admissibilité
Cet appel à projet s’adresse à des artistes professionnels, seuls ou en collectif, âgés d’au moins 18 ans au
moment du dépôt du dossier.
L’appel à projet est ouvert à tous les artistes de nationalité française ou étrangère.
Les textes et échanges avec l’Observatoire de l’Espace du CNES se feront en français. La maitrise de la langue
française est impérative.
Commission de choix
Une commission associant personnalités culturelles et spatiales se réunira dans un délai de 15 jours après la
date limite du dépôt des dossiers.
Les artistes seront contactés individuellement par mail dans un délai d’une semaine après la tenue de la
commission.
L’Observatoire de l’Espace du CNES rencontrera une sélection d’artistes afin qu’ils puissent présenter leur projet
à la commission.
Trois projets seront choisis en fonction de leur nature et de leur impact dans la salle de l’Espace, lieu de
l’exposition Nuit Blanche 2017.
Critères de choix
Après examen des dossiers de candidatures, la commission choisira les artistes ou collectifs d’artistes, selon
les critères suivants :
1/ Motivation pour le projet
2/ Adéquation de la démarche artistique avec la commande et le contexte du projet
3/ Originalité et qualité du projet proposé : proposition et écriture plastique, innovation
4/ Pérennité de l’œuvre au regard du dispositif envisagé et des matériaux employés
5/ Précision et sérieux du budget prévisionnel de l’opération
6/ Références professionnelles
Déroulement du projet
À l’issue de la phase de sélection début avril, les artistes auront accès aux archives documentaires présentées
dans l’appel associées à un appareil documentaire complémentaire, qui détaillera et apportera de nouveaux
éclairages sur les archives spatiales mises à disposition. Ces archives supplémentaires sont des compléments
de travail ciblés en fonction de la demande et du projet, et sont à considérer comme un support à la création
artistique pour aboutir à l’œuvre finale.
Une journée d’étude autour des questions relatives à la représentation spatiale des ballons sera organisée à Paris
dans la deuxième quinzaine d’avril.
Les rencontres et rendez-vous autour des thématiques de travail des artistes et des pièces patrimoniales mises à
dispositions par l’Observatoire de l’Espace du CNES se feront au siège du CNES à Paris, 75001.
Si un grand nombre d’échanges peut se faire par courriers électroniques, 2 à 3 rencontres seront nécessaires tout
au long de l’élaboration du projet. Les déplacements pour ces rencontres sont aux frais des artistes.
L’artiste s’engage à soumettre une proposition libre de droits (vidéo, son et image) qui respecte les conditions
juridiques et financières prévues ci-dessous. Il s’engage également à respecter le calendrier prévisionnel établi
par l’Observatoire de l’Espace du CNES (cf. formulaire de candidature).
Dans le cas où, cette phase de travail n’aboutirait pas à des résultats significatifs dans les temps impartis,
l’Observatoire de l’Espace du CNES se réserve le droit de ne pas exposer l’œuvre pour Nuit Blanche 2017.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS : 3 avril 2017 (Voir formulaire de candidature)
Pour toute information complémentaire :
observatoire.espace@cnes.fr
sophie@costamagna.net
© Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 5APPEL À PROPOSITION POUR UNE COMMANDE ARTISTIQUE :
Conception d’une œuvre originale, réalisation et installation de l’œuvre au sein du CNES, dans le cadre de Nuit
Blanche 2017
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
A remplir électroniquement, imprimer et signer
Artiste
Nom, Prénom : .................................................................................................................................................................
Numéro de Siret (obligatoire ): ......................................................................................................................................
Numéro d’ordre Maison des artistes, Agessa : ............................................................................................................
Nationalité : .....................................................................................................................................................................
Adresse :
...........................................................................................................................................................................
Code postal : ..................... Ville : ........................................................................ Pays : ................................................
Tél. : ................................... E-mail : ............................................................................................................................
Site internet : ...................................................................................................................................................................
Résumé du projet
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
© Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 6...........................................................................................................................................................................................
Admissibilité
Cet appel à proposition s’adresse à des artistes professionnels, seuls ou en collectifs âgés d’au moins 18 ans
au moment du dépôt du dossier.
L’artiste sélectionné s’engage à soumettre une proposition libre de tout droit (vidéo, son et image). Il s’engage
aussi à respecter le calendrier préétabli et notamment à être présent pour l’inauguration de l’exposition le
7 octobre 2017.
Calendrier du projet 2017
— fin février : mise en ligne de l’appel d’offre
— 3 avril : date limite de réception des dossiers
— fin avril : première réunion des artistes retenus et visite de la salle d’exposition
— fin avril à fin août : création et production des œuvres
— mi-mai ou fin mai : deuxième réunion de travail au CNES autour de la définition des œuvres
— mai à août : préparation du catalogue et de l’exposition/installation avec mi-juillet remise des textes et
des projets pour le catalogue
— fin juillet : troisième réunion de travail au CNES autour de l’exposition
— fin août : envoi de la fiche technique par les artistes pour l’exposition, mise au point des créations, étude
des points pratiques en vue de l’exposition
— 4-5-6 octobre : montage de l’exposition au CNES
— 7 octobre : inauguration en présence des artistes
— 7 octobre : événement Nuit Blanche
Contenu du dossier de présentation de l’artiste
1/ Le présent formulaire de candidature complété et signé avec un résumé du projet
2/ La note d’intention
3/ Le dossier artistique avec CV
4/ La note présentant la démarche générale de l’artiste
Date limite de réception des dossiers
Le dossier de candidature complet doit être reçu par l’Observatoire de l’Espace du CNES, le 3 avril au plus
tard à 16h00 (cachet de la poste faisant foi d’un envoi antérieure à cette date)
Envoi du dossier
Envoi postal en une seule fois, par courrier recommandé avec accusé de réception.
CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES
Observatoire de l’Espace
2, place Maurice Quentin
75039 Paris cedex 01
OU
Transmission par courrier électronique, via wetransfer.com, à l’adresse suivante : observatoire.espace@cnes.fr
OU
Dépôt en mains propres au Centre national d’études spatiales du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00
à l’attention de l’Observatoire de l’Espace, 2 place Maurice Quentin 75001 Paris
Pour toute information complémentaire sur le projet, veuillez vous adresser par courrier électronique à :
observatoire.espace@cnes.fr
Fait à Date
Signature
© Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 7ANNEXE 1
Les ballons tétraédriques
La premiére campagne scientifique de lancement de ballons stratosphériques a été réalisée aux îles Kerguelen
en 1961. Ce fut à l’origine une idée du professeur Jacques-Emile Blamont, alors directeur adjoint du Service
d’Astronomie, d’utiliser ce site, qui présentait des conditions favorables pour mener toute une série d’expériences
sur les phénoménes créés au sein de l’atmosphére terrestre par l’activité solaire.
Outre cet intérét scientifique, il y voyait aussi le moyen d’introduire en France la technologie des ballons qui
était alors seulement utilisée par les Américains. En effet, jusqu’à cette date, les seuls véhicules dont disposait la
recherche spatiale étaient les fusées-sondes dont le temps de vol ainsi que l’altitude restaient limités. A l’inverse,
les ballons présentaient l’avantage de pouvoir effectuer des mesures pendant plusieurs heures à un plafond
assez élevé, de l’ordre de 40 kilométres. Dés lors, il devenait possible de mettre en œuvre des investigations
scientifiques de grande portée.
Mais dans un premier temps, il fallut apprendre à développer ces ballons. Pour cela, les locaux de l’ETAG
(établissement technique d’autopropulsés et de guidage) ont été mis à disposition de la mission scientifique.
Robert Régipa, officier de l’armée de l’air, a été recruté pour diriger cette nouvelle activité. Plusieurs contraintes
se sont posées et notamment la question de l’assemblage des films de polyéthyléne par soudure, puis le
positionnement des films sur la table d’assemblage. C’est la forme tétraédrique qui fut choisie in fine pour
fabriquer les ballons, en raison du caractère exigu des locaux. Il s’avéra que cette forme était bien plus adaptée
pour assembler les films selon le principe de soudure continue. Ainsi, ce fut en s’appuyant sur une équipe
de fabrication familiale (les familles Régipa et Béreyziat) que Robert Régipa réussit, de manière artisanale, à
concevoir et à fabriquer des ballons tétraédriques.
Note sur les ballons non dilatables en
polyéthylène.
© Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 8Ébauche du contrat de travail des « petites
mains » de l’atelier familial.
Lettre de Claudie Fhari, employée de l’atelier
de fabrication.
© Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 9Schéma du principe d’entraînement
du film de la machine à confection-
ner les ballons. Robert Régipa.
Croquis du ballon tétraédrique.
Robert Régipa.
© Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 10Mme Régipa et Mme Béreyziat déroulent le film polyéthylène dans l’atelier de fabrication.
Mme et Mlle Régipa autour du poste de soudure dans l’atelier de fabrication.
© Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 11Le premier lâcher de
ballon à Trappes.
Étapes du gonflage d’un ballon.
© Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 12ANNEXE 2 Les ballons stratosphériques peuvent tout transporter à bord de leur nacelle : de petits capteurs de température, de gigantesques télescopes, des antennes internet et même des hommes en quête de sensations fortes, comme l’autrichien Felix Baumgartner ! En premier lieu, ce sont les météorologues et les scientifiques qui utilisent ces ballons gonflables. Ils peuvent, grâce à eux, affiner leurs connaissances sur les évènements météorologiques, suivre des panaches de pollutions ou bien étudier l’évolution du trou de la couche d’ozone. De leur côté, les astronomes utilisent ces aéronefs pour emporter au sommet de l’atmosphère des télescopes, comme celui de l’expérience Pilot, et pouvoir scruter le fond de l’Univers. Et les idées d’applications ne cessent de fleurir. Google envisage ainsi de faire appel aux ballons pour apporter Internet aux coins les plus reculés de la planète tandis qu’une société américaine prévoit de faire du tourisme « spatial » grâce à eux. Lâcher un ballon stratosphérique, surtout lorsque celui-ci mesure plusieurs centaines de mètres et que sa nacelle pèse quelques centaines de kilos, nécessite un réel savoir-faire et un vrai travail d’équipe. Pas moins de 10 ballonniers sont nécessaires au gonflage du ballon, au positionnement et au lâcher, à proprement parler, de l’aérostat… Et le tout, en douceur. Car le moindre heurt pourrait endommager la charge utile ou l’enveloppe du ballon. Pour réussir un lâcher de ballon, il faut également des conditions climatiques particulières et très peu d’habitants aux alentours. C’est ainsi que l’île du Levant, en France, ou la ville de Timmins, au Canada, ont été choisies pour y installer des bases de lancement. Il existe ainsi une trentaine de bases à travers le monde. Et chaque année, pendant plusieurs semaines, des équipes du CNES investissent les lieux pour y mener des campagnes de mesures. Présentation de l’activité ballon du CNES : https://www.cnes-multimedia.fr/cnes_fr/cnesmag/cnesmag11_FR_dossier.pdf Plus léger que l’air On ne peut imaginer moyen de transport plus simple : un ballon en plastique gonflé à l’hélium naviguant dans le ciel au gré des courants atmosphériques… Equipez-le d’instruments de mesures et voilà l’outil idéal pour explorer les couches de l’atmosphère inaccessibles aux satellites, comprises entre 10 et 40 km d’altitude. Une zone stratégique où les masses d’air brassent nombre de particules et de composés chimiques émis depuis la Terre. Dès sa création, le CNES s’intéresse aux ballons stratosphériques, et en 1966, il participe à la 1ere campagne météo de grande ampleur, baptisée Eole. Le CNES avec l’usine Z Marine, fabrique alors 500 ballons d’un genre nouveau – des ballons pressurisés en mylar (plastique de type polyester saturé utilisé principalement en film) capables de voler en continu pendant plusieurs mois – et impose dès lors son savoir-faire. Depuis 1962, le CNES a ainsi lancé plus de 3 500 ballons. Les petites couturières de L’espace https://vimeo.com/103128449 La première campagne de Ballons aux iles Kerguelen http://nospremieresannees.fr/ballons/2_kerguelen/sommaire1.html © Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 13
Des ballons pour l’espace Ballons pour l’espace - 1967- https://videotheque.cnes.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=3182 Programme météorologique Eole - 1970 Les années 1960 et 1970 sont marquées par de rapides progrès des connaissances théoriques sur la circulation générale de l’atmosphère et la dynamique des fluides géophysiques en général. Cependant les moyens conventionnels d’observation de l’époque sont insuffisants pour valider ces théories. Les mesures in situ du projet Eole vont confirmer les bases mathématiques des modèles. Le projet Eole associe une flottille de ballons dérivant dans l’hémisphère Sud à un satellite chargé de les localiser et de recueillir leurs mesures de pression et de température. Des stations au sol collectent ces informations qui sont ensuite envoyées à un centre de traitement. L’objectif d’Eole est ambitieux : couvrir l’atmosphère australe pendant un mois avec une flotille de 300 ballons en vol au moins. La première campagne de ballons surpressurisés réalisée par des expérimentateurs français a lieu en juillet 1966 à partir de l’aéroport de Tontouta en Nouvelle-Calédonie. Elle sera suivie de plusieurs autres campagnes. La campagne principale met en œuvre 480 ballons en liaison avec le satellite. Plus de soixante d’entre eux sont suivis en vol pendant plus de six mois et quatorze pendant plus d’une année. C’est la faisabilité théorique de prévisions météorologiques à échéance d’une semaine ou deux qui se voit confirmée par le projet Eole. Cette coopération entre la NASA et le CNES a été l’occasion d’échanges fructueux entre les scientifiques et de collaborations efficaces entre les ingénieurs de chaque pays. Les résultats scientifiques (Laboratoire de Météorologie Dynamique) ont permis de mieux comprendre la circulation atmosphérique, la dispersion de l’énergie dans l’atmosphère et de calibrer les mesures de température avec celles faites par les satellites TIROS. Ce film est un documentaire technique visant à présenter le programme Eole se déroulant en Argentine et plus précisément dans la station de Neuquen. C’est dans la station de Neuquen que le lâcher de ballon et les différentes étapes de préparation (depuis le réassemblage des ballons, jusqu’à leur envol en passant par l’assemblage des différents éléments de la nacelle) est montré. © Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 14
https://videotheque.cnes.fr/mobile/index.php?urlaction=doc&id_doc=3398&rang=2&id_panier=755
Récit de Jacques-Émile Blamont, directeur scientifique
et technique du CNES en 1962
https://vimeo.com/103128448
Station de lancement Eole en Argentine
© Observatoire de l’Espace du CNES/Nuit Blanche 2017 15Vous pouvez aussi lire