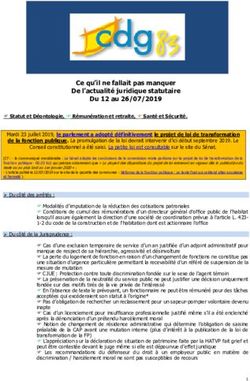Bioagresseurs de type pathogènes - Dr. ROUAG Noureddine - REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE - FSNV
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
UNIVERITE FERHAT ABBAS SETIF 1
FACULTE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE
DEPARTEMENT DES SCIENCES AGRONOMIQUES
Bioagresseurs de type
pathogènes
Dr. ROUAG Noureddine
Année universitaire 2020 - 2021LES MALADIES DES PLANTES
Chapitre I
Concepts généraux
1.1-Terminologie
La phytopathologie (Phytopathology ou Plant Disease) est la science qui traite les maladies
des plantes. Elle correspond dans ses grandes lignes au concept de « médecine des plantes ».
Les études phytopathologiques reposent sur la mise en œuvre de notions de botanique, de
microbiologie, de biologie moléculaire, de génétique, de biochimie, de physiologie végétale,
d’écologie, phytotechnie, de toxicologie végétale, d’épidémiologie. Elle a recoure à
l’ensemble des données biologiques, chimiques et physiques d’un écosystème déterminé.
Classiquement la science phytopathologique n’englobe pas les problèmes liés aux ravageurs.
Toutefois, la littérature anglophone, contrairement à la francophone, inclut traditionnellement
les nématodes parmi les maladies des plantes. Si l’on considère qu’une culture résulte de
l’introduction de génotypes particuliers des végétaux (cultures ou variétés) dans un
environnement déterminé, le concept « maladie » se rapporte aux anomalies pathologiques
produites au niveau du phénotype.
Les anomalies du phénotype par rapport à la normale attendue, portent le nom de symptômes.
Les altérations du produit économique de la culture ou du potentiel de production sont
généralement appelés dégâts, tandis que le déficit économique ou social résultant des dégâts,
exprimé en quantité du produit ou en valeur financière, porte le nom de perte.
La pathogenèse représente l’ensemble du processus inducteur de la maladie et aboutit à
l’expression des symptômes.
Nombre de symptômes résultent des conditions écologiques inadéquates. Parmi les
paramètres altéragènes du milieu inadéquat susceptibles d’induire des maladies figurent la
lumière, la température, l’eau et les différents aspects de la nutrition minérale, ainsi que divers
facteurs anthropiques (polluants). Les maladies qui résultent des conditions écologiques
inadéquates sont dites « non parasitaires », alors que les maladies « parasitaires » sont
causées par l’action d’agents pathogènes parasites « virus, champignon, bactérie…etc. ». Les
agents parasites se développent aux dépens d’un végétal vivant. Les parasites sont
généralement infectieux (ils envahissent l’hôte et s’y multiplient) et contagieux (ils se
transmettent d’une plante infectée à une autre plante saine). Pour pouvoir mettre en œuvre des
moyens de lutte adéquats contre une maladie, il faut identifier la cause exacte des symptômes
observés ; c’est à dire poser un diagnostic correct.
La science qui étudie les causes des maladies est l’éthologie ; elle constitue la base de
réflexion et d’action phytopathologique qu’on rencontre dans la pratique agronomique
reposant sur la connaissance approfondie de la plante hôte, de son environnement et des
modalité de sa culture d’une part et des agents pathogènes et des conditions de la pathogenèse
d’autre part
La prévision du développement des maladies classiques dans une culture déterminée, est en
fonction de l’espèce et de la variété végétale cultivée, des conditions du milieu qui lui sont
faits aux différents stades de son développement, des techniques culturales qui lui sont
appliqués et des sources potentielles d’agents pathogènes.A cet état de fait, des moyens de lutte préventifs et curatifs doivent être mis en œuvre pour
bloquer l’évolution d’une maladie en cours de son développement dans l’hôte.
Symptômes Etiologie Connaissance des agents
pathogènes
Diagnostic Lutte économie
Plante connaissance de la
phytotechnie
1.2 – Historique de la phytopathologie
Dès les premières origines de l’agriculture, l’homme créa des conditions favorables aux
maladies des plantes cultivées à travers la concentration des populations uniformes de
végétaux sur certaines surfaces et en effectuant des cultures successives de la même plante sur
la même sole.
Plus tard, la sélection des variétés à haut rendement (souvent plus sensibles aux agents
pathogènes) et l’industrialisation des méthodes de production ont donné une importance
croissante aux problèmes posés par les maladies, malgré la mise en œuvre de moyens de lutte
toujours plus élaborés et toujours plus coûteux. Toutes ces raisons ont pour conséquence la
naissance de la phytopathologie en tant que science nouvelle s’intéressant aux maladies des
plantes. On cite ici plusieurs évènements historiques qui ont marqué cette l’apparition et
l’évolution de cette science :
Au début du 18ème siècle, les armés du tsar russes qui étaient en guerre contre les
ottomans, furent décimés en consommant de la farine de seigle empoisonnée par des
alcaloïdes provenant du champignon de l’ergot Claviceps purpurea.
En 1729, MICHELLI montre que les champignons saprophytes (Mucor, Aspergillus)
apparaissant sur des tranches de melon, se développent à partir de spores transportées par
l’air.
En 1846, l’introduction en Irlande du champignon Phytophthora infestans, agent du
mildiou de la pomme de terre, décima la population et a provoqué une immigration massive
vers les USA (plus de 2.500 000 de personnes).
C’est la phytopathologie, aussi qui fut des anglais les buveurs de thé que nous connaissons
de nos jours, alors qu’ils étaient des buveurs de café jusqu’aux alentours de 1880, époque à
laquelle les caféiers de Cylan furent détruit par un champignon Henileis vastatrix agent de la
rouille et remplacés par des théiers.
En 1865, HOOKE décrit le phénomène de la première observation d’un champignon
phytopathologique par microscope optique.
Ce n’est qu’en 1888 que DE BARY confirme de façon indiscutable que le Phytophtora
infestans l’agent du mildiou de la pomme de terre. Il faut attendre 1898 pour que
BEIYERNIEK définisse la notion de : molécule infectieuse : « Contagium Vivum Fluidum »
et 1935 pour que Stanley prouve que les phytovirus sont de macromolécules.
Au cours des années 1970, on identifia plusieurs nouveaux types d’agents
phytopathogènes tels que les rickettsies, les phytoplasmes, les viroïdes, etc. Malgré toutes ces découvertes, il reste de nombreuses maladies dont l’étiologie de l’agent
responsable est toujours inconnue. Ces maladies sont souvent attachées à l’un des trois grands
groupes connus à savoir les champignons, les bactéries et les virus.
1.3 -Signification d'une maladie chez une plante
La plante cultivée est menacée depuis sa plantation jusqu'à sa récolte et sa consommation du
fait qu'elle est sujette à quatre types de facteurs limitants, à savoir : les conditions de
l'environnement, les mauvaises herbes, les insectes et les maladies. Les agents
phytopathogènes responsables de maladies représentent les principaux problèmes
phytosanitaires que rencontre le végétal au cours de son développement et sa croissance.
L'état de souffrance que subisse la plante suite à l'infection par un agent pathogène engendre
un déséquilibre dans les actions métaboliques des organes végétatifs. Ceci, nous permet de
définir la maladie des plantes comme étant un déséquilibre phénologique accompagné par
l'apparition de symptômes spécifiques. Les agents pathogènes, sont définis comme étant tout
organisme vivant jouissant de la faculté de produire l’infection par une phase ou toutes les
phases de son développement chez les plantes hôtes.
Les maladies des plantes résultent souvent de l'interaction de trois facteurs essentiels, qui
sont :
Un agent causal de la maladie vivant : organisme pathogène.
Une plante hôte sensible : hôte susceptible.
Des conditions de l'environnement favorables.
Les plantes hôtes doivent être prédisposées à accepter l’agent parasite et subissent les
conséquences de l’infection à travers :
La concurrence et la compétition avec la plante hôte suite à la consommation des
contenus cellulaires.
Le déséquilibre des activités métaboliques des cellules de l’hôte à travers la
production des toxines, d’enzymes et substances inhibitrices de la croissance.
L’empêchement de la circulation des éléments nutritifs et de l’eau dans les vaisseaux
conducteurs.
1.4 - Classification des maladies des plantes :
Les plantes cultivées sont sujettes à des attaques d’agents phytopathogènes au niveau des
parcelles et des vergers. Ceci engendre des pertes économiques considérables à cause des
effets néfastes tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
Un agent parasitaire peut infecter plusieurs familles botaniques et chaque plante cultivée peut
être attaquée par plus d’un agent phytopathogène. Pour une meilleure maîtrise des aspects liés
à la pathologie des plantes, on classe les maladies des plantes et les agents pathogènes dans
des groupes cohérents obéissant à des critères bien déterminés. L’objectif de ces
classifications ci-dessous vise surtout à l’étude de l’agent pathogène dont son identification
est une opération nécessaire pour la réalisation d’un diagnostic, clé de réussite des méthodes
de lutte préconisées.
Généralement les maladies des plantes sont classées comme suit :A - Classification selon les symptômes produits par les agents parasitaires, exemple :
pourriture des racines, chancre, flétrissement, gale, brûlure, mosaïque, …etc.
B - Classification selon l’organe végétal attaqué, exemple : maladies des racines, des tiges,
des feuilles, des fruits,…etc.
C - Classification selon les cultures, exemples : maladies des céréales, des arbres fruitiers, des
légumes secs,…etc.
D - Classification selon la nature biologique de l’agent pathogène. C’est la classification la
plus suivie. Elle s’intéresse à l’identification de l’agent causal, l’étude du cycle de la maladie
et les conditions de l’environnement favorables.
A- Les maladies parasitaires :
Sont considérés comme agents de maladies des plantes les microorganismes vivants
(pathogènes) : les champignons, les bactéries, les virus, les viroïdes, les phytoplasmes et les
Rickettsies. A cette liste, l'école anglophone ajoute les nématodes et les plantes phanérogames
parasites.
B- les maladies non parasitaires :
Ce sont les maladies qui apparaissent suite à l’action et l’influence des conditions
environnementales extrêmes (abiotiques) sur la plante. Il en résulte, la souffrance et la
faiblesse qui peuvent parfois provoquer la mort de la plante. Les maladies non parasitaires
sont moins fréquentes que les maladies parasitaires et sont provoquées par les températures
extrêmes, excès ou carence d'oxygène, excès ou carence d'humidité du sol, les minéraux
toxiques, les pH du sol acide ou basique, excès ou carence de la lumière et ses composantes,
excès ou carence des éléments minéraux, pollution de l'air, les pesticides toxiques et quelques
opérations agricoles mal réalisées.
C- les pertes économiques causées par les maladies des plantes :
Au plan économique, les pertes causées par les maladies sont principalement les diminutions
de production et de rendement et les restrictions apportées à la commercialisation des récoltes.
Généralement les pertes occasionnées sont classées en pertes directes et pertes indirectes.
Pertes Primaires : Affectant la production Diminution de la qualité des
directes (Échéance immédiate) produits récoltés
Secondaires : Affectant le potentiel de Contamination des cultures
production (Échéance différée) suivantes
Diminution du capital de
production
Pertes Pertes au cours de la conservation
indirectes Pertes chez les transformateurs et négociants
Pertes dans la filière de transformation
Pertes chez les consommateurs
Malgré les progrès réalisés en matière de protection phytosanitaire par diverses méthodes de
lutte, les pertes agricoles dues aux différents agents ne cessent d'augmenter. Selon les données
statistiques fournies par la FAO (1997), pour les cultures les plus importantes au monde (riz,
maïs, blé, cotonnier, pomme de terre et caféier) : Il se trouve que les pertes potentielles sont
presque égales au tiers de la production annuelle.
Au plan mondial, on estime à des centaines de millions de dollars de pertes directes en plus
des pertes indirectes et les coûts de protection. Par ailleurs on a constaté que les niveaux de
pertes agricoles diffèrent d'un continent à un autre, elles sont estimées à 25 % de la productiontotale en Europe, 29 % en Amérique du nord et centrale, 30 % en Russie et Chine, 28 % en
Afrique et 43 % en Asie. Ceci est du principalement à la disponibilité des moyens de
protection, technicité, technologie avancée, etc.
Chapitre II
Les principes de la phytopathologie
2.1 - Principes d’Etiologie
C'est une subdivision de la phytopathologie qui s'intéresse aux agents parasites souvent
d'origine et de nature exogènes (facteurs exogènes). Ceci correspond aux variables de
l'environnement et des microorganismes parasites. Il existe plusieurs facteurs endogènes de
maladies telles que les perturbations d'origine héréditaires (il faut noter que le même
symptôme peut être induit par plusieurs et différentes causes, à titre d’exemple, le symptôme
de jaunissement peut être induit par des causes non parasitaires (excès d'eau, manque de fer,
absence de lumière, herbicides) et par des causes parasitaires (virus, viroïdes, phytoplasmes,
champignons vasculaires).
Le même agent infectieux, peut induire des symptômes très différents selon la plante hôte, la
phase végétative et la période d'infection, les conditions du milieu et également de la période
d'observation. Il existe des infections qui donnent des symptômes spécifiques permettant
l'identification de la maladie directement telle que (le charbon des céréales, les rouilles,
l'oïdium), par contre, dans la majorité des cas, le diagnostic de la maladie exige des analyses
approfondies au niveau des laboratoires, ceci a donné naissance à la science de diagnostic.
2.2 - Diagnostic des maladies des plantes :
L'opération du diagnostic de l'agent infectieux et l'identification de la nature de la maladie
représente la première étape pour la détermination de la manière dont il sera effectué la lutte.
Le diagnostic est défini alors comme étant la technique de l'identification des facteurs
essentiels responsables de la maladie, en faisant appel à l'expérience théorique et pratique.
Cependant, il existe un certain nombre de connaissances qui doivent être bien maîtrisés pour
la réalisation du diagnostic des maladies et qui sont :
1- Connaissance de la manière de distribution des symptômes sur les plantes infectées dans
le champ : déterminé si toutes les plantes sont touchées ou un taux inférieur.
2- Observation et identification des insectes présents (les plus importants et abondants) dans
le champ qui peuvent constituer de vecteurs potentiels.
3- Détermination et connaissance des maladies les plus importantes qui touchent la culture et
qui peuvent avoir les mêmes symptômes.
4- Suivi de l'évolution des symptômes et les phases de développement de la plante et les
conditions de l'environnement.
2.3 - Relation entre la plante et l’agent infectieuxL'agent pathogène a besoin d'un végétal sensible et des conditions environnementales favorables pour que l'infection se réalise et les symptômes apparaissent. Ce microorganisme qui vit au dépends de la plante y puise son alimentation, se multiplie à l'intérieur, s'appelle parasite, et se caractérise par : 1- La faculté de pénétrer à l'intérieur de l'hôte directement ou avec un intermédiaire 2- La faculté de se multiplier 3- La faculté de se disséminer 4- La faculté de résister aux conditions défavorables. 5- La faculté de s'adapter à ces conditions. La relation biologique entre le pathogène et l'hôte végétal, s'appelle parasitisme. Le pathogène puise son alimentation nécessaire à partir de la plante parasitée. Il s’ensuit des effets sur la quantité d’énergie dont la plante à besoin pour accomplir ses activités physiologiques et métaboliques. Le résultat est un affaiblissement de la croissance normale et l’apparition de la maladie qui évolue et se développe ; dans ce cas la relation devient négative pour la plante hôte. D’une manière générale, les microorganismes sont classés soit en parasites obligatoires, c'est-à-dire qu’ils ont besoin des tissus végétaux pour survivre ; en parasites facultatifs, ceux qui peuvent vivre aussi bien sur les plantes vivantes que sur les tissus morts et les saprophytes qui vivent uniquement sur les tissus morts. La différence entre les deux premiers groupes réside dans la manière d'infection de l'hôte. Si la majorité des parasites facultatifs secrètent des enzymes et des toxines nécessaires à la destruction des tissus de la plante attaquée, en revanche, les parasites obligatoires gardent la plante infectée vivante aussi longtemps que possible. L'évolution de la relation entre le pathogène et l'hôte représente l'infection. L'hôte qui ne peut être attaqué est dit indemne, exempt ou immune, alors que l'hôte chez lequel l'infection se développe lentement ou le cycle biologique est incomplet, est désigné comme résistant, tolérant. Si la maladie se développe et devient favorable à l'hôte donc la plante est susceptible à l’infection, on la désigne alors comme sensible. 2.4 - Les phases de développement de la maladie : Sont définis comme étant la série de faits qui arrivent successivement l'un après l'autre et qui aboutissent à la fin au développement de la maladie et l'apparition des symptômes. L’ensemble de ces phases représente le cycle de la maladie. De façon générale, le cycle de la maladie comprend les étapes essentielles suivantes : 2.4.1 - l’inoculation : C'est le premier contact entre l'agent pathogène et la plante hôte. L'inoculum désigne la partie qui assure l'inoculation. Il est constitué du pathogène complet (particule complète ou une partie de ses organes de fructification). Dans le cas des champignons, l'inoculum est constitué de mycélium, de spores ou de sclérotes (masses mycéliennes), dans le cas des bactéries, virus, viroïdes et phytoplasmes, l'inoculum est représenté par la particule complète du microorganisme. La réussite de l'inoculation repose sur quelques facteurs majeurs et qui sont les suivants : a- Nature de la surface végétale externe. b- Température et humidité favorables pour le développement et la germination des spores. c- Présence de substances stimulatrices ou inhibitrices secrétées par la plante hôte.
d- Présence d'autres organismes antagonistes ou protagonistes sur la surface du végétal. En ce qui concerne les sources d'inoculum, on distingue : - Les débris végétaux morts restant à l'intérieur de la parcelle cultivée et également dans le sol. - les semences, plantules, plants de pépinières, importés ou transportés d'une région à une autre - les plants infectés présents dans les parcelles avoisinantes. - les plantes spontanées et les hôtes secondaires. Il existe plusieurs types d'inoculum, les plus importants : A - Inoculum primaire : C'est l'inoculum qui conserve sa vitalité pendant l'hiver et dés le démarrage de la végétation au printemps, il provoque l'infection, il en résulte l'infection primaire. B- Inoculum secondaire : C'est l'inoculum résultant de l'infection de l'infection primaire, il en résulte une infection secondaire. Les étapes d'inoculation : L’inoculation passe par plusieurs étapes avant d’atteindre la phase de germination, et sont les suivantes : 2.4.1.1 - Arrivée de l’inoculum : L'inoculum est transporté par le vent, l'eau les insectes, etc., souvent une partie de cet inoculum se met en contact avec une plante hôte sensible et le plus gros atterrit sur des plantes non hôtes ou résistantes. 2.4.1.2 - Germination de l’inoculum : Pour certains pathogènes, l'infection peut être engendrée par des parties de l'agent pathogène, le cas des spores de champignons. Dans ce cas, il est impératif que la spore germe pour que l'infection survienne et elle a besoin dans de conditions de température et d'humidité favorables. La spore forme par la suite un tube germinatif : ceci représente la première partie du mycélium qui pénètre à l'intérieur de la plante hôte. 2.4.2 - La pénétration : On distingue trois types de pénétration. 2.4.2.1 - Pénétration directe de la surface d'un végétal : C'est la voie la plus utilisée par les champignons. Les champignons exploitent cette voie pour pénétrer en formant des filaments très petits désignés (hyphes) ou à travers un organe de fixation appelé l’appressorium (qui se forme à partir du mycélium pénétrant dans la plante) soit par une pression mécanique, soit par la sécrétion d'enzymes qui aident à la destruction des composants de la paroi cellulaire, ce qui facilite la pénétration du tube de germination. 2.4.2.2 - Pénétration à travers les blessures : Plusieurs agents phytopathogènes ne peuvent pénétrer directement à l'intérieur des plantes à travers les ouvertures naturelles. Ils exploitent donc, les blessures de la surface des plantes causées par plusieurs facteurs, telles que : les facteurs de l'environnement, les vents forts, rayons du soleil, vents de sable, le gel, les incendies et les opérations culturales et provoquées également par des organismes prédateurs. Si les bactéries exploitent les blessures pour
pénétrer, les virus, les viroïdes et les phytoplasmes, sont généralement transmis par des vecteurs biologiques comme les insectes et les nématodes ou transmis par les outils agricoles. 2.4.2.3 - Pénétration à travers les ouvertures naturelles : Tous les types d’ouvertures naturelles qui comprennent les stomates aquifères, les ouvertures aromatiques et les lenticelles constituent des points d’entrée et le démarrage d’une infection parasitaire. 2.4.3 - L'infection : Elle désigne la fixation et l'installation de l'agent pathogène dans les cellules de l'hôte et la satisfaction de ses besoins alimentaire pour qu'il survive et subsiste, et évolue à l'intérieur. Ceci se traduit par son développement et sa multiplication et également sa dissémination à tous les organes de la plante infectée, et l'apparition des symptômes sur le plan interne et externe. L’intervalle de temps compris entre l'inoculation et l'apparition des premiers symptômes est désigné : période d'incubation ou de latence. Et si les conditions nécessaires sont réunies, l'infection passe par deux phases : 2.4.3.1 - l'invasion ou l'envahissement : L’invasion est définie comme étant le passage de l'agent pathogène des cellules et des tissus infectés lors de l'infection primaire vers d'autres cellules et des tissus avoisinants dans la même plante hôte. De nombreux agent phytopathogènes sont situés à l’extérieur de la plante mais émettent des organes de succion (haustoria) à l'intérieur des cellules de la cuticule, dans ce cas sont dits extracellulaires. Comme ils peuvent être situés à l'intérieur des cellules et dans ce cas on les appelle les intracellulaires, ou sont localisés entre les cellules dans les espaces intercellulaires et portent le nom d’intercellulaires. Certains agents pathogènes n’infectent qu’un tissu bien particulier à savoir le tissu conducteur et dans ce cas on ils induisent le flétrissement vasculaire, alors que les bactéries, les phytoplasmes et les virus, se déplacent entre une cellule et une autre à travers les canaux intercellulaires appelés : plasmodesmes. 2.4.3.2 - Multiplication de l'agent pathogène : Les agents phytopathogènes sont caractérisés par la faculté de se multiplier à l'intérieur de la plante hôte infectée. Si la multiplication de quelques microorganismes pathogènes est semblable, le cas des bactéries, des phytoplasmes et de rickettsies. Par contre, elle est très différente chez les virus et les champignons. Les champignons se multiplient soit par voie sexuée ou asexuée à travers les conidies, parfois les deux voies ensemble dans certaines classes. La majorité des champignons pathogènes des plantes forment un mycélium à l'intérieur des cellules infectées alors que d’autres peuvent se développer à l'extérieur, l'exemple des oïdiums. Généralement, les champignons forment des spores dans la partie infectée et se libèrent à l'extérieur dans l'air, comme ils peuvent formés des spores uniquement à l'intérieur des cellules infectées à l’instar des champignons des conduites vasculaires (Verticillium) et ne se libèrent à l'extérieur qu’à la mort de la plante hôte. Les bactéries, les rickettsies et les phytoplasmes se multiplient par division binaire simple qui se réalise à l'intérieur des cellules. D'une manière générale, les rickettsies et phytoplasmes ne
peuvent se libérer à l'extérieur de la plante qu'une fois meurt et leur développement se fait exclusivement au niveau des tissus conducteurs. Concernant les virus et les viroïdes, leur multiplication se fait par réplication de l'acide nucléique par une cellule végétale infectée sur laquelle on assiste aussi à la synthèse des protéines nécessaires à la formation de la particule virale. 2.4.4 - Dissémination de la maladie : Ceci représente le déplacement de l'agent pathogène ou une partie des ses formes de reproduction (spores par exemple) de la source d'infection vers d'autres hôtes sains dans le voisinage ou vers d'autres régions exemptes d'infection. En général, toutes les voies responsables de dissémination de la maladie pour provoquer des infections limitées ou des épidémies causent de gros dégâts économiques. On distingue plusieurs voies de dissémination, les plus importantes sont l'eau, les vents, les insectes et autres animaux et l'homme. 2.4.4.1 - Dissémination par les vents : Les agents pathogènes qui vivent à l'extérieur de la plante hôte ont la faculté de se déplacer par les vents forts vers des endroits lointains à travers les spores. Les graines des plantes contaminées peuvent être véhiculées par les vents à différents endroits. Une partie des ces spores et semences, une fois en contact avec des parties humides, elles sont emprisonnées, à l’arrêt des vents ou de la pluie, les spores et graines tombent sur des plantes hôtes, et germent pour donner de nouveaux foyers. 2.4.4.2 - Dissémination par l'eau : L'eau joue un rôle important dans la dissémination des agents pathogènes. Les gouttelettes d'eau de pluie et d'irrigation, accrochent les spores fongiques et les bactéries et les transmettent à des plants saines sensibles et provoquent de nouvelles infections. La dissémination à travers le courant d'eau offre à certains pathogènes la condition d'humidité qui permette la germination lors du déplacement, ce qui accélère l'infection. En ce qui concerne les distances parcourues, elles diffèrent de la qualité de l'eau. Les gouttelettes de pluies ne permettent le déplacement que pour quelques centimètres, alors que les courants d'eau, les distances peuvent être, plusieurs kilomètres. 2.4.4.3 - Dissémination à travers l'homme et les animaux domestiques de la ferme : L'homme représente l'un des grands responsables de la dissémination des maladies. L'agriculteur lors de ces visites aux parcelles infectées permet le passage de l'agent pathogène aux parcelles saines, à travers le contact direct où à travers les outils agricoles utilisées. Egalement, la plantation de plants de pépinières infectés ou toute partie végétative de multiplication, constitue des voies de contamination et de dissémination. Les animaux domestiques de ferme participent également à la dissémination entre les parcelles saines et infectées soit par le contact ou indirectement en consommant des parties végétales infectées, et une fois rejetées dans des endroits non infectés, permettent le déplacement des agents pathogènes. 2.4.4.4 - Dissémination biologique : Elle est définie comme étant le transport des agents pathogènes par d'autres agents biologiques comme les insectes, les nématodes, les champignons. Les plus importants groupes
de pathogènes qui exploitent cette voie sont les virus qui sont portés intérieurement ou
extérieurement. L'agent qui transmet la maladie est désigné comme vecteur. Les
phytoplasmes sont eux aussi transmis par des vecteurs, surtout les insectes de types
ciccadelles à l’aide de leur stylet. Les nématodes également véhiculent un grand nombre de
virus, regroupés dans le genre des Nepovirus.
2.4.5 - Dormance ou hivernation du pathogène :
Quand les conditions de l'environnement deviennent défavorables ou la plante arrive à la fin
de son cycle végétatif, les agents pathogènes passent par une période de dormance à travers
plusieurs manières sous forme de particules complètes pour les virus, bactéries, et
phytoplasmes ou sous forme de mycélium ou conidies pour les champignons.
- Dans le reste des plantes mortes, dans les produits finis (tubercules, rhizomes, graines,
etc.)
- Dans les sols contaminés par diverses formes de résistance (Sclérotes, Chlamydospores,
rhizomorphes).
- A l'intérieur des plantes pérennes (arbres fruitiers, forestiers, …etc.).
- A l'intérieur des plantes hôtes secondaires (pérennes ou annuelles).
- A l'intérieur de vecteurs biologiques.
Dans tous les cas, quand les conditions de l’environnement deviennent favorables, l'agent
pathogène reprend son activité et renouvelle l'infection.
Chapitre III
Les symptômes des maladies des plantes
Le moment ou apparaissent les symptômes est souvent considéré comme le début de la
maladie, alors qu’il s’agit en réalité de l’extériorisation d’un processus dont l’origine est
évidemment antérieure et qui aurait pu être détectée plutôt, si l’on avait utilisé des techniques
appropriées. La maladie commence dès que la première cellule réagit, mais ne se manifeste
que lorsque les réactions deviennent perceptibles extérieurement. La période qui sépare les
deux stades (temps d’incubation) est encore appelée temps de latence.
Les symptômes révèlent des altérations du végétal par rapport à l’état naturel, tandis que les
dégâts se rapportent au produit ou en potentiel de production. Les symptômes peuvent être
localisés ou généralisés ; s’ils s’étendent par la voie du système conducteur, on les qualifie de
systémiques. Les symptômes comportent essentiellement des changements de couleur, des
altérations d’organes, des modifications anatomiques, des productions anormales de
substances et des altérations divers du métabolisme.
3.1 Modifications de couleur :
Les anomalies de coloration affectent surtout les feuilles mais peuvent également concerner
les fleurs (parenchymes), les fruits et les tiges (striures).
3.1.1 - Chlorose :Le manque de chlorophylle se traduit par une pâleur de la coloration du feuillage (chlorose). Lorsque la chlorophylle est totalement absente on obtient une jaunisse due à la couleur des carotènes et des xanthophylles. Les causes de ce jaunissement peut être du à la carence en azote, carence ferrique, virus, phytoplasmes, asphyxie. 3.1.2 - Albinisme : Ce phénomène se caractérise par l’absence totale de toutes les pigmentations. Il peut être d’origine génétique et affecte la plantule entière ou une partie des tissus. Comme, il peut être du à des causes externes tels que les traitements herbicides agissant au niveau de la chlorophylle. 3.1.3 - Mosaïque : Ce titre décrit une gamme de symptômes caractérisés par une alternance de zones de coloration vert pâle ou vert foncée et des zones chlorotiques ou jaunâtres. Lorsque la séparation des zones verdâtres et jaunâtres est diffuse, on leur donne le terme de marbrure. 3.1.4 - Hyperchlorophyllose : Ce terme désigne l’apparition de tâches verdâtres foncées liées à l’excès d’azote ou la carence du phosphore. 3.1.5 - Anthocyanose : L’excès de pigments rouges violacés peut résulter, soit d’une destruction de la chlorophylle qui révèle la présence d’anthocyanes normalement présentes, soit la production abondante de ces pigments suite à une cause pathologique, ex. l’attaque de phytoplasme sur trèfle. 3.1.6 - Mélanose : La formation de substances foncées s’observe fréquemment en tant que manifestation pathologique (accumulation de mélanines). Le noircissement des tissus semble être du, le plus souvent, à l’action des oxydases sur les substrats phénoliques ex. Alternaria sp. 3.2 - Altérations d’organes : 3.2.1 - Nécroses : Les nécroses correspondent à la mort des cellules et des tissus. Souvent, elles apparaissent sur une aire limitée, mais peuvent parfois s’étendre à des organes, ou encore se généraliser à la plante entière. Au niveau des feuilles, on observe des tâches nécrotiques ou la nécrose de nervures. Les tiges présentent parfois des nécroses apicales, des nécroses corticales (chancre) ou des nécroses des tissus conducteurs. 3.2.2 - Perforation d’organes : La formation de lésions locales sur des feuilles à la suite d’infection, suivie par la chute des tissus morts, laissent dans l’organe lésé des perforations plus au moins circulaires (feuilles criblées). 3.2.3 - Flétrissement : Le flétrissement provient d’une altération du système conducteur par des parasites radiculaires ou vasculaires. Le flétrissement peut être brutal ou progressif, réversible ou irréversible. 3.2.4 - Pourritures : Les pourritures procèdent généralement une décomposition des tissus, suite à la dislocation des cellules résultant de l’altération enzymatique des pectines des lamelles mitoyennes.
Souvent, les cellules meurent, les tissus perdent leur consistance et deviennent le siége d’une colonisation par des organismes secondaires surtout des bactéries. 3.2.5 - Taches subéreuses : Suite à des attaques parasitaires ou à des anomalies physiologiques, le suber peut se former anormalement au niveau de l’écorce ou au niveau de fruit donnant une peau rugueuse. 3.3 - Modifications anatomiques : 3.3.1 - Anomalies des rameaux et des tiges : 3.3.1.1 - Fasciation : La fasciation consiste en une morphogenèse anormale des tiges qui s’aplatissent en une bandelette symétrique par apport à un plant. C’est un développement simultané de nombreux bourgeons donnant naissance à des tiges accolées les unes aux autres. 3.3.1.2 - Balais de sorcière : Les anomalies de ramification des tiges correspondent à une prolifération abondante des rameaux à entre noeuds raccourcis et à des feuilles petites, souvent déformées. 3.3.1.3 - Chancre : Les chancres sont typiquement des altérations localisées de l’écorce des plantes ligneuses, entourés de bourrelets subéreux en réponse à des stress pathogènes (champignons, bactéries,…etc.) 3.3.1.4 - Bois souple : Les tiges d’arbres peuvent présenter parfois un défaut de rigidité du à un manque de lignification, résultant d’infection par des phytoplasmes (bois caoutchouteux). 3.3.2 - Anomalies des feuilles : 3.3.2.1 - Polyphyllie : C’est une subdivision du limbe des feuilles normalement simples et un accroissement du nombre de folioles chez les feuilles composées, ou encore une augmentation anormale du nombre total de feuilles. 3.3.2.2 - Frisolée : Le limbe devient gaufré, cloque, boursouflé. Ce symptôme arrive souvent suite à des attaques virales ou à des coups du froid. 3.3.2.3 - Enations : Ce sont des excroissances tissulaires (énations), qui peuvent se former au niveau des nervures foliaires (attaque virale) 3.3.3 - Anomalies des fleurs : 3.3.3.1 - Virescence : Les pièces florales restent vertes, alors qu’elles sont colorées chez la plante normale. Ce phénomène s’accompagne souvent d’anomalies morphologiques des organes floraux, désigné sous le terme de chloranthie.
3.3.3.2 - Chloranthie : Phyllodie C’est une transformation ou régression d’un ou plusieurs verticilles floraux en structures foliacées. 3.3.4 - Anomalies de croissance : 3.3.4.1 - Nanisme et atrophie : C’est la réduction de la taille de la plante ou de ses organes. Il arrive souvent suite à des attaques virales. 3.3.4.2 - Gigantisme et hypertrophie : Croissance anormale de certains organes ou de la plante entière, suite à un accroissement des dimensions des cellules (hypertrophie) et l’accélération de la division cellulaire (hyperplasie). 3.4 - Production anormales de substances : 3.4.1 - Exsudation : L’exsudation d’eau ou de sève par une surface foliaire est un phénomène normal. Cependant, il y a des cas où par son abondance et sa nature, présente un caractère pathologique. Les exsudats permettent l’installation de nombreux champignons et bactéries. 3.4.2 - Gommose : C’est une exsudation jaune - ambrée qui se solidifie rapidement au contact de l’air. La gommose peut apparaître chez certains plants sains, mais en cas de production abondante, constitue une indication de trouble pathologique. Ex. gommose bactérienne. 3.5 Altérations du métabolisme : 3.5.1 - Altération de la photosynthèse : Le manque de lumière provoque une chlorose accompagnée d’un allongement des entre- nœuds. 3.5.2 - Altérations de la respiration : L’excès d’eau ou de gaz, provoque un déficit en oxygène dans le sol (asphyxie) et aboutit à la formation de composés toxiques. 3.5.3 - Altération du métabolisme minéral : Les carences ou les excès en éléments minéraux peuvent provoquer des modifications de couleur, des altérations de racines, des malformations d’organes aériens etc.… 3.6 - Anomalies internes : 3.6.1 - Symptômes macroscopiques : En effectuant une coupe dans un organe malade, on peut observer des brunissements, des nécroses ou des pourritures internes au niveau de l’écorce, du tissu conducteur ou de la moelle des rameaux. 3.6.2 - Symptômes microscopiques : 3.6.2.1 - Thyllose : Les thylles sont des expansions vésiculaires qui se forment dans le xylème à partir des cellules parenchymateuses. S’ils sont nombreux et volumineux, les thylles peuvent entraîner l’obstruction du lumen et l’apparition des flétrissements externes. 3.6.2.2 - Callose :
La callose est un polysaccharide qui recouvre normalement l’intérieure des cellules phlométiques et qui peut, dans le cas de certains maladies, obstruer celles-ci (maladie – virale). 3.6.2.3 - Inclusions dans les cellules : Dans certaines maladies virales, le Microscope Electronique révèle la présence d’inclusions amorphes ou cristallines (concentration de particules virales). 3.7 - Excroissance pathologiques : 3.7.1 - Tumeurs : Excroissances pathologiques globuleuses résultant de la transformation génétique des cellules de l’hôte suite à l’action de certaines bactéries et champignons (Agrobacterium, Plasmodiophora) à travers la sécrétion d’enzymes ayant les mêmes caractéristiques des hormones de croissance. 3.7.2 - Galles : Ce sont des excroissances externes provoquées par certains champignons et bactéries à travers des secrétions enzymatiques (Pseudomonas). 3.7.3 - Gales : Ce sont des altérations superficielles de l’épiderme de la plante, ex : gale ordinaire de la pomme de terre induite par Streptomyces scabies.
Vous pouvez aussi lire