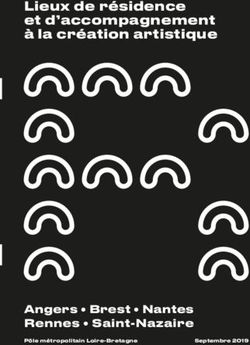Code de la sécurité sociale
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21
Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale
Version en vigueur au 22 mars 2022
Annexes (Articles Annexe à l'article A931-10-10 à Annexe 5)
Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (application de l'article R. 434-32)
(Articles Annexe I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17))
Annexe I à l'art. R434-32 (1) Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1
CHAPITRE PRELIMINAIRE
I - PRINCIPES GENERAUX.
L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est
déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut
avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde,
lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il
doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du
travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime
général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans
l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les
facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au
médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir
entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief
ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les
correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale
de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain.
Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer
l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant
de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu
compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à
l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences
de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de
l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge
apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur
elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème,
si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 1 sur 46Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21 normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. II - MODE DE CALCUL DU TAUX MEDICAL. Il faut d'abord rappeler que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. " La consolidation " est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. L'article L. 433-1 du Code la Sécurité sociale autorise le maintien de l'indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d'un travail " léger " susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure. La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé. Dans ce cas, il appartient au médecin chargé de l'évaluation de bien mettre en évidence dans ses conclusions la nécessité d'un changement d'emploi. 1. Séquelles résultant de lésions isolées. Ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci- dessus. 2. Infirmités multiples résultant d'un même accident. On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents. Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème. Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités. Exemple. - Une lésion " A " entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %. Une lésion " B ", consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L'incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %. L'incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite ... Dans le cas d'une troisième lésion, pour l'exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %. Cette façon de calculer l'incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif. Le médecin chargé de l'évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation. 3. Infirmités antérieures. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 2 sur 46
Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors
d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il
est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera
évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet
sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la
maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit
antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état
antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui
perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur,
le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli.
Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra
l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
III - REVISIONS.
Hormis les cas où les séquelles présentent d'emblée un caractère définitif, l'état de la victime est susceptible de subir, en
aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de
l'appareillage.
Il peut être alors indiqué de procéder à des révisions périodiques prévues par le Code de la Sécurité sociale (Art. L. 443-1). Dans
les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la Caisse peut faire procéder à tout
moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l'intervalle séparant deux révisions doit être d'au moins un an, sauf
accord entre les parties intéressées (art. R. 443-4 et R. 443-5).
Pour l'estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l'examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure
où les sequelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
Le décès de la victime par suite des conséquences de l'accident entraîne une nouvelle fixation des réparations allouées à ses
ayants droit éventuels ; elles sont sans relation avec le taux du barème (articles L. 434-7 et suivants).
Annexe I à l'art. R434-32 (2) Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1
1 - MEMBRE SUPERIEUR.
Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.
Dominance cérébrale.
La notion de dominance hémisphérique cérébrale découle de la constatation de la prévalence d'un hémicorps dans l'action,
avec une plus grande force ou une plus grande habileté des membres opposés à l'hémisphère dominant et commandés par lui.
Elle est renforcée par le développement des structures du langage au sein de cet hémisphère dominant, ce qui aboutit à une
prévalence de l'hémisphère dominant, le gauche, chez le droitier, pour l'ensemble des fonctions symboliques, de même que
pour l'habileté manuelle.
L'hémisphère dit dominant est habituellement l'hémisphère gauche, chez le droitier et il semble exister un lien assez étroit entre
la dominance du langage et la préférence manuelle.
L'hémisphère non dominant dit mineur (hémisphère droit chez les droitiers), n'est cependant pas dépourvu de fonctions, et il a
des spécialisations particulières pour la manipulation de l'espace, la connaissance des rythmes, l'individualisation des
physionomies.
Il existe, par ailleurs, des cas de dominance hémisphérique gauche, mais elle est beaucoup plus rare. Si certains sujets vrais
gauchers ont une préférence invincible pour l'usage de leur main gauche, comme les droitiers pour celui de leur main droite, la
majorité des sujets dits gauchers sont en fait ambidextres et se servent seulement mieux de leur main gauche ; ils apprennent
assez facilement à se servir de leur main droite, du fait de la pression de la société, où tous les outils sont conçus pour les
droitiers ("gauchers contrariés"). Il en résulte que, bien souvent, les lésions de l'hémisphère droit chez le "gaucher" n'entraînent
pas des désordres en miroir, par rapport à ceux observés pour les lésions unilatérales gauches chez le droitier. Les anomalies
sont incomplètes, atypiques et de moindre importance avec une meilleure compensation.
La détermination de l'hémisphère dominant n'est pas toujours facile. Elle se base sur la localisation habituelle du même côté du
contrôle du langage et du contrôle gestuel, la dissociation de latéralisation entre ces deux fonctions restant rare. La recherche
de la dominance se fera donc sur l'étude de la préférence gestuelle : manuelle, podale ou oculaire, qui permettra de déterminer
le caractère droitier ou gaucher ou ambidextre du sujet examiné, et, par voie de conséquence, la dominance hémisphèrique
gauche, droite ou incertaine.
Cette recherche, de préférence gestuelle, fait appel à :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 3 sur 46Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21
- L'étude de la force musculaire, plus importante du côté du membre supérieur utilisé de préférence ;
- La recherche du côté utilisé pour certains gestes précis de la vie courante : couper sa viande, se brosser les dents, gestes de
toilette intime. Le véritable gaucher écrit, tient son couteau pour couper son pain ou un marteau pour planter un clou, une
aiguille pour coudre avec la main gauche, boutonne son pantalon, lance une pierre, joue aux cartes, taille un crayon avec un
canif tenu avec sa main gauche ;
- La recherche de l'usage préférentiel d'un membre : main pour lancer un objet, pour donner les cartes, pied pour " shooter "
dans un ballon, œil pour viser.
Il faut cependant savoir que certaines préférences peuvent se modifier par l'apprentissage, notamment chez les ambidextres, et
qu'une gêne fonctionnelle permanente d'un côté peut entraîner une compensation centro-latérale, aboutissant à une pseudo-
dominance. Il est donc nécessaire, dans les cas incertains, de composer les différentes prévalences manuelle, podale ou
oculaire, avant de conclure.
L'ambidextrie professionnelle est la règle chez les travailleurs du bois : menuisiers, ébénistes, toupilleurs, dégauchisseurs, etc.
Amputations.
Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle.
Lorsque cet appareillage ou cette intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain de capacité
ainsi obtenu, mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 5 %.
1.1 MEMBRE SUPERIEUR A L'EXCLUSION DE LA MAIN
1.1.1 AMPUTATION.
DOMINANT NON DOMINANT
Epaule :
- Amputation interscapulothoracique avec résection totale ou 95 85
partielle de la clavicule et de l'omoplate, ou de l'un de ces deux os
- Désarticulation de l'épaule 95 85
Bras :
- Au tiers supérieur 95 80
- Au tiers moyen ou inférieur 90 80
- Désarticulation du coude, avant-bras au tiers supérieur 90 80
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une
main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune
gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts
au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux,
l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires.
Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 4 sur 46Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des
5 5
mouvements, on ajoutera
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et
demi ou deux ans.
Luxation récidivante de l'épaule :
La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les
séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou
en cas d'échec opératoire :
DOMINANT NON DOMINANT
Formes graves avec récidives fréquentes 40 30
Formes moyennes avec récidives espacées 20 15
Formes légères 10 à 15 8 à 10
Luxation acromio-claviculaire :
La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L'I.P.P. sera donc appréciée en
fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles.
Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un
mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans
celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité
provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ
(selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre
60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
- Angle favorable 25 22
- Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o) 40 35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 5 sur 46Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21
- Mouvements conservés de 70o à 145o 10 8
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable 20 15
- Mouvements conservés de 0o à 70o 25 22
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction
(inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage du poignet :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination 15 10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination 35 30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l'importance 10 à 15 8 à 12
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents.
1.1.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS.
Les taux indiqués sont susceptibles, pour les pseudarthroses, d'être minorés selon les possibilités d'appareillage.
Clavicule :
DOMINANT NON DOMINANT
Cal difforme, sans compression nerveuse, selon gêne 2à5 1à3
fonctionnelle
Compressions nerveuses (voir séquelles portant sur le système
nerveux périphérique)
Pseudarthrose 5 3
Epaule :
DOMINANT NON DOMINANT
Epaule ballante consécutive à des pertes de substance osseuse
étendues, sans séquelles nerveuses, autres que celles 70 60
conditionnant le ballant de l'épaule
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 6 sur 46Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21
Bras :
Les déformations proviennent essentiellement de cals volumineux, exubérants, en crosse, etc. Le raccourcissement du bras
n'est pas gênant au-dessous de 4 centimètres.
DOMINANT NON DOMINANT
Déformation du bras avec atrophie musculaire (taux s'ajoutant
aux séquelles articulaires, nerveuses, etc. éventuellement 5 à 10 4à8
associées)
Pseudarthroses de la diaphyse humérale :
- Serrée 20 15
- Lâche 50 40
(Au voisinage de l'épaule et du coude, voir Epaule ballante » ou
Coude ballant»).
- Raccourcissement important (supérieur à 4 centimètres) 5 à 10 4à8
Coude :
DOMINANT NON DOMINANT
Coude ballant, consécutif à des pertes de substance osseuse 55 45
Avant-bras :
DOMINANT NON DOMINANT
Les deux os :
- Pseudarthrose serrée 20 15
- Pseudarthrose lâche (avant-bras ballant) 50 40
Un seul os :
- Pseudarthrose serrée du radius 8 6
- Pseudarthrose lâche du radius 30 25
- Pseudarthrose serrée du cubitus 5 4
- Pseudarthrose lâche du cubitus 25 20
Poignet :
DOMINANT NON DOMINANT
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 7 sur 46Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21
Poignet ballant, à la suite de pertes de substance du carpe 40 25
A ces taux s'ajoutent éventuellement les taux pour limitation des mouvements des doigts, le taux global ne pouvant dépasser le
taux fixé pour l'amputation.
Main-bote radiale ou cubitale.
L'évaluation se fera selon le retentissement sur la gêne fonctionnelle des poignets et des doigts.
1.1.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES.
DOMINANT NON DOMINANT
Rupture du deltoïde 10 à 25 6 à 20
Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale,
mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste
souvent une déformation du muscle à la contraction, et une
diminution de la force :
Séquelles légères 4 3
Rupture de l'un des deux chefs non réparée 12 10
Rupture complète de l'insert inférieure non réparée 25 20
Syndrome de Volkmann : selon l'importance de la répercussion
30 à 70 25 à 60
sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques
1.2 LA MAIN.
L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte
motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment
de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d'examen sera le
suivant :
Un goniomètre ;
Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;
Un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;
Un pinceau ou crayon ;
Une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
Un dynamomètre marqueur ;
Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de
monnaie.
Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d'une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la
valeur fonctionnelle de la main.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 8 sur 46Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21
NORMALE INTERMEDIAIRE NULLE
Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle) 3,5 1,5 0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique) 10,5 7 à 3,5 0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique) 10,5 7 à 3,5 0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil,
10,5 7 à 3,5 0
pinceau)
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau) 21 14/7/3,5
Crochet (poignée) 7 3,5 0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique) 7 3,5 0
Total 70
(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d'une estimation sur 100 de la valeur d'une main normale,
multipliée par le coefficient 0,7 puisque l'incapacité totale de de la main représente un total de 70 %.
1.2.1 AMPUTATIONS.
Main :
DOMINANT NON DOMINANT
Amputation métacarpienne conservant une palette 70 60
Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son
amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une
importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des
articulations sus-jacentes.
Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des
pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
DOMINANT NON DOMINANT
Pouce :
- Avec le premier métacarpien 35 30
- Les deux phalanges 28 24
- Phalange unguéale 14 12
Index ou Médius :
- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 14 12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 9 sur 46Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21
- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule 7 6
Annulaire :
- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 6 5
- Deux phalanges ou la phalange unguéale 3 3
Auriculaire :
- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 8 7
- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule 4 4
1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Articulation carpo-métacarpienne :
L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions
combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) :
DOMINANT NON DOMINANT
En position de fonction (anté-pulsion et opposition) 14 12
En position défavorable (adduction, rétropulsion) 28 24
Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à
9 à 12 7 à 10
l'exclusion du pouce
Doigts :
L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de
90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la
paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de
l'amputation du doigt.
Pouce :
DOMINANT NON DOMINANT
Articulation métacarpo-phalangienne :
- Blocage en semi-flexion ou en extension 6 4
- Blocage en flexion complète 10 8
- Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non
15 12
réduite
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 10 sur 46Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21
Articulation inter-phalangienne :
- Blocage en flexion complète 10 8
- Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne
6 4
non réduite
Autres doigts :
Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.
DOMINANT NON DOMINANT
Index 7 à 14 6 à 12
Annulaire et médius 4à6
Auriculaire 4à8
La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions.
1.2.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS.
Métacarpien :
- Cal saillant entraînant une gêne fonctionnelle : 2 à 4.
Les pseudarthroses ou les cals vicieux des métacarpiens et des phalanges seront appréciés selon le retentissement sur le
fonctionnement général de la main.
1.2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES.
Les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront
évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées.
1.2.5 SEQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES.
(Voir séquelles portant sur le "système nerveux périphérique" et séquelles portant sur le "système cardio-vasculaire.").
Il ne faudra pas oublier d'évaluer les séquelles nerveuses (anesthésie en particulier), liées aux lésions du nerf collatéral et les
douleurs par névrome.
1.2.6 OSTEITE ET OSTEOMYELITE.
Venant s'ajouter aux mêmes éléments séquellaires.
- Fistule persistante unique : 10
- Fistule persistante avec déformation osseuse 10 à 25
Annexe I à l'art. R434-32 (3) Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1
2 - MEMBRE INFERIEUR.
Dans le calcul des incapacités permanentes, les deux membres inférieurs sont considérés comme ayant une valeur fonctionnelle
égale.
Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle.
Lorsqu'un appareil ou une intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain obtenu mais ne pourra
appliquer une réduction du taux supérieur à 15 %.
- Perte de fonction des deux membres inférieurs, quelle que soit la cause 100
2.1 AMPUTATION.
- Amputation inter-ilio-abdominale 100
Cuisse :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 11 sur 46Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21 - Désarticulation de la hanche 100 - Amputation inter-trochantérienne 100 - Amputation sous-trochantérienne 100 - Amputation au tiers moyen ou au tiers inférieur 80 Genou : - Désarticulation 80 Jambe : - Amputation au tiers supérieur 70 - Amputation au tiers moyen ou inférieur 70 Cheville : - Désarticulation tibio-tarsienne 50 - Amputation du pied, avec conservation de la partie postérieure du calcanéum avec bon appui talonnier (avec mouvement du pied restant satisfaisant et sans bascule en varus) 40 Pied : - Désarticulation médio-tarsienne de Chopart 45 - Amputation transmétatarsienne de l'avant-pied 30 Orteils : L'amputation d'orteils prend surtout de l'importance, lorsqu'il s'agit du premier orteil, ou de plusieurs orteils voisins. - Perte de cinq orteils 25. Premier orteil. - Les deux phalanges avec le métatarsien 20 - Les deux phalanges 12 - Phalange distale 5 Autres orteils. - Amputation d'un orteil 2 - Deuxième ou cinquième orteil avec leur métatarsien 10 - Troisième ou quatrième orteil avec leur métatarsien L'incapacité résultant de la perte de plusieurs orteils sera évaluée en estimant la perte de chaque orteil séparément, et en en faisant la somme. Le taux global ne pourra dépasser le taux fixé pour l'amputation de tous les orteils. 2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES 2.2.1 SYMPHYSE PUBIENNE. Disjonction (selon le diastasis, la gêne à la marche, l'impossibilité des efforts, les douleurs éventuelles, compte non tenu des retentissements sacro-iliaques) 10 à 20 2.2.2 ARTICULATIONS SACRO-ILIAQUES. Diastasis (entraînant une mobilité anormale du sacrum, avec retentissement sur la marche, accroupissement impossible, sacralgies) 45 Arthropathie sacro-iliaque douloureuse chronique d'origine traumatique 15 2.2.3 HANCHE. Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l'étude de la flexion, de l'abduction et de l'adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l'étude de l'extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) : - Extension : 0° ; - Flexion : 140° (variable selon l'adiposité du sujet) ; - Hyperextension : 15° à 30° ; - Abduction : 50° ; - Adduction : 15° à 30° ; - Rotation interne : 30° ; - Rotation externe : 60°. On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l'amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L'accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 12 sur 46
Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21 - Blocage en rectitude (position la plus favorable) 55 - Blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation) 70 - Blocage des deux hanches 100 Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés : - Mouvements favorables 10 à 20 - Mouvements très limités 25 à 40 2.2.4 GENOU. L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ... On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. Blocage du genou. - Rectitude (position favorable) 30 - De 5° à 25° 35 - De 25° à 50° 40 - De 50° à 80° 50 - Au-delà de 80° 60 - Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 Limitation des mouvements du genou. - L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5 - L'extension est déficitaire de 25° 15 - L'extension est déficitaire de 45° 30 - La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5 - La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15 - La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 Mouvements anormaux. - Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35 - Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15 Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou. - Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10 - Luxation récidivante 15 - Patellectomie 5 A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou. Hydarthrose chronique. - Légère 5 - Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15 Corps étranger traumatique. (A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés). 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED. Articulation tibio-tarsienne. L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio- péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 13 sur 46
Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21 - Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15. - En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35 - Blocage de la cheville, pied en talus 25 - Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35 - Déviation en varus en plus 15 - Déviation en valgus en plus 10 Limitation des mouvements de la cheville. - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 - Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 - Déviation en vargus, en plus 15. - Déviation en valgus, en plus 10. Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes. Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans). - Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15. Articulations métatarso-phalangiennes. Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion. Blocage isolé de cette seule articulation : - Gros orteil : En rectitude (bonne position) 5 En mauvaise position 10 - Autres orteils : En rectitude 2 En mauvaise position 4 Limitation des mouvements. - Gros orteil 2 à 4 - Autres orteils 1 à 2 Articulations interphalangiennes. Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil. - Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3 - Limitation de ses mouvements 1. 2.3 PSEUDARTHROSES, DEFORMATIONS ET RACCOURCISSEMENTS 2.3.1 CEINTURE PELVIENNE. Les séquelles pouvant entraîner une incapacité permanente seront estimées d'après la gêne fonctionnelle qu'elles apportent aux articulations de voisinage, en particulier pour les déformations. 2.3.2 CUISSE. - Angulation, déformation, selon le retentissement sur la marche 10 à 30 - Pseudarthrose du fémur 70 2.3.3 GENOU. - Pseudarthrose consécutive à une résection du genou 50 - Genou ballant 60 2.3.4 JAMBE. - Angulation, déformation en baïonnette, etc., selon le retentissement sur la marche 5 à 25 - Pseudarthrose du tibia ou des deux os 70 2.3.5 PIED. - Affaissement de la voûte plantaire 5 à 15 - Pied creux post-traumatique 5 à 10 - Exostose sous-calcanéenne 15 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 14 sur 46
Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (appli… I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)) - Légifrance 22/03/2022 15:21 - Cal vicieux, exubérant. Selon répercussion sur la marche 5 à 15 Raccourcissements. Le taux évalué pour le raccourcissement post-traumatique s'ajoutera aux autres taux ayant pu être éventuellement estimés par ailleurs pour d'autres séquelles. - Moins de 2 cm 0 - De 2 à 3 cm 2 à 4 - De 4 cm 9 - De 5 cm 15 - De 6 cm 18 - De 7 cm 21 - De 8 cm 24 - De 9 cm 27 - De 10 cm 30 Le raccourcissement sera toujours soigneusement mesuré entre repères osseux (par exemple : épine iliaque antéro-supérieure - malléole interne). On peut recommander la méthode de Rey. 2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES (1). (1) Pour une appréciation plus précise, on pourra se reporter au chapitre IV (système nerveux : 4.2.5.), où sont exposés les six degrés de force musculaire. - Rupture musculaire complète (triceps, adducteurs, etc.) 10 à 15 - Maladie de Pellegrini Stieda (à évaluer selon les séquelles fonctionnelles) - Rupture du tendon rotulien ou quadricipital : Non réparée 30 Réparée (à évaluer selon le déficit fonctionnel résiduel du genou). - Rupture d'un aileron rotulien, avec mobilité anormale de la rotule 15 - Rupture du talon d'Achille : Non réparée 30 Réparée (à évaluer selon limitation des mouvements de la cheville et l'atrophie du mollet). - Rupture des péroniers latéraux : Complète 20 Incomplète 10 - Luxation des tendons péroniers (l'origine traumatique étant démontrée) 10 2.5 OSTEITES ET OSTEOMYELITES. (Venant s'ajouter aux autres éléments séquellaires) - Fistule persistante unique 10 - Fistule persistante multiple, avec déformation osseuse résistant à la cure chirurgicale 15 à 25 2.6 LESIONS MULTIPLES DES MEMBRES INFERIEURS. Lorsque des lésions traumatiques ont laissé des séquelles portant sur les deux membres inférieurs, il y a lieu d'évaluer l'incapacité de chaque membre séparément, puis d'additionner les taux, sans que la somme puisse dépasser 100 %. 2.7 SEQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES. On se reportera au chapitre des séquelles portant sur le système nerveux périphérique et des séquelles portant sur l'appareil cardio-vasculaire. 2.8 LOMBOSCIATIQUES. Se reporter au chapitre 3 : " Rachis ". Annexe I à l'art. R434-32 (4) Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 3 - RACHIS 3.1 RACHIS CERVICAL. La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028678079/ Page 15 sur 46
Vous pouvez aussi lire