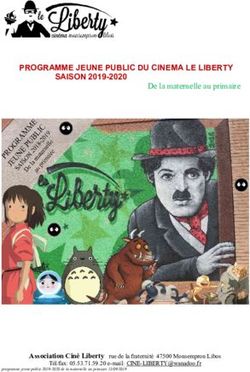DE L'INTERGENERICITÉ ET DE L'INTERARTIALITÉ DANS LUMIÈRES DE POINTE-NOIRE D'ALAIN MABANCKOU OU LE ROMAN N'ZASSA EN QUESTION
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Kouakou Paul DABLE
DE L'INTERGENERICITÉ ET DE L'INTERARTIALITÉ DANS LUMIÈRES
DE POINTE-NOIRE D'ALAIN MABANCKOU OU
LE ROMAN N'ZASSA EN QUESTION
Kouakou Paul DABLE
Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
ramzybeni2dieu@gmail.com
Résumé : La question identitaire est un enjeu discret, mais persistant des
littératures africaines coloniales et postcoloniales. C'est elle que Lumières
de Pointe-Noire d'Alain Mabanckou voudrait interroger à travers les
nombreuses stratégies scripturales qu’elle met en jeu. Cette œuvre littéraire
caractérisée par l'intergénéricité et l'interartialité apparaît comme un roman
n'zassa, ce type d'écrit qui rassemble harmonieusement des genres
littéraires et des arts aux formes, poétiques et fonctions différentes. Par
cette pratique littéraire de la polyphonie générique et artiale, ce roman
traduit, en réalité le cosmopolitisme de son auteur et, par extension, celui
des Africains du continent et de la diaspora, une identité qui fluctue entre
afropolitanisme et afropéanisme.
Mots clés : intergénéricité, interartialité, écriture n’Zassa, identité,
cosmopolitisme
INTERGENERIC AND INTERARTIALITY IN THE LIGHTS OF
POINTE-NOIRE BY ALAIN MABANCKOU OR THE NOVEL N’ZASSA
EN QUESTION
Abstract : The question of identity is a discret but persistent issue of
colonial and postcolonial African literatures. That is what lumiere de
pointe-noire de Alain Mabanckou would like to question through the
several spiritual strategies it puts forth. This literary work characterized by
intergenerality and interrartiality appears as N’zassa, this type of writing
that harmoniously brings together literary genres and arts with differents
forms, poetics and functions . Through this literary practice of the generic
and artistic polyphony, this novel translate, in reality, the cosmopolitanism
of the author and, by the extension, that of the Africans of the continent
and the dispora, an identity that fluctuates between afropolitanism and
afropeanism.
Keywords: intergenericity, interartiality, writing n'zassa, identity
Introduction
Durant la période coloniale, les romanciers africains avaient fait de leurs
œuvres un instrument de combat et de réhabilitation de la personnalité
africaine. Au tournant des années 1960, à dater surtout de 1968 avec les Soleils
des indépendances d'Ahmadou Kourouma, le roman africain transcende cette
option thématique pour accorder une place de choix à l'écriture qui apparait
désormais comme l'enjeu du jeu romanesque. Cette pratique littéraire s'affine
Akofena çn°004, Vol.1 163De l'intergénéricité et de l'interartialité dans Lumières de Pointe-Noire d'Alain Mabanckou
ou le roman N'zassa en question
au fil du temps si bien que, depuis quelques décennies, une certaine tendance
scripturale matinée de poésie, de contes, de mythes, de légendes, etc., mais
aussi d'expressions artistiques diverses telles que la musique, la peinture, la
sculpture, la photographie, le cinéma... semble devenir la marque de fabrique
du nouveau roman africain. Cette écriture à la fois intergénérique et interartiale
à laquelle l’écrivain ivoirien Ade (2000) avait appliqué le qualificatif agni de N'
Zassa et qui fait du roman africain un «genre sans genre », un « genre fourre-
tout » est du reste au principe de Lumières de Pointe-Noire d’Alain Mabanckou.
Une œuvre littéraire dont les ingrédients révèlent une intertextualité féconde
entre le romanesque et les autres genres et arts. Considérant le récit d’Alain
Mabanckou à titre d’œuvre d’art favorisant une rencontre avec d’autres arts, ne
peut-on pas l’analyser sous l’angle de l’interartialité qui selon (Müller, 2000,
P.44) « implique toujours l’intermédialité ». (Müller, 2000, PP99-110),
l’inventeur du concept d’intermédialité, le définit comme le « fait qu’un média
recèle en soi des structures et des possibilités d’un ou de plusieurs médias et
qu’il intègre à son propre contexte ». L’exégèse de cette définition appliquée au
roman le positionne au rang de premier média dans lequel s’invitent au second
rang d’autres médias qui établissent entre eux et le premier média une suite de
corrélations itératives et continues. Ou plutôt, le roman comme média principal
accueille dans sa structure narrative d’autres médias auxquels il donne une
impulsion nouvelle tout comme ceux-ci lui dictent leurs systèmes analogiques.
Cette dynamique de compensation mutuelle entre les différents médias instaure
un nouveau type de récit ou l’imaginaire romanesque traditionnel côtoie
désormais le virtuel médiatique moderne. L’intermédialité comme l’indique
l’auteur de ce concept, se situe dans le prolongement de l’intertextualité qui
sert uniquement à la description des textes écrits, pour lui, l’intermédialité
vient combler un vide ; celui des rapports entre les médias. C’est fort de cette
conviction qu’il n’hésite pas à soutenir que « le concept d’intermédialité est
donc nécessaire et complémentaire à la notion d’intertextualité dans la mesure
où il prend en charge les processus de production du sens liés à des
interactions médiatiques » (Müller, 2000 p.106). Dans le domaine spécifique de
la littérature, on parle d’intermédialité quand dans un texte donné, on observe
la présence d’un autre ou de plusieurs médias. C’est ce qui fait dire à (Müller,
1996, p.5) que l’intermédialité « vise la fonction des interactions médiatiques
pour la production du sens ». Abondant dans le même sens que lui (Mariniello,
2003, p.7) indique que l’intermédialité : « désigne le croisement de plusieurs
médias dans un texte littéraire ». Pour (Mechoulan, 2003, p.22) l’intermédialité
« (…) peut désigner les relations entre diverses médias (…) diverses pratiques
artistiques ».
L’étude des relations entre les arts, pour lesquelles (Moser, 2000, P.44)
propose, le terme « interartialité » fait partie du grand ensemble qu’est
l’intermédialité finalement les différents théoriciens de ce concept retiennent
surtout le critère de la rencontre de médias ou de supports médiatiques.
L’objectif de cette étude est de voir comment Alain Mabanckou arrive à
produire à travers lumières de pointe noire , un texte hybride ou chaque média
164 Septembre 2021 ç pp. 163-174Kouakou Paul DABLE
s’insère dans le tissu romanesque en conservant ses particularités ou en
s’influençant mutuellement avec les autres supports du récit qui le
métaphorsent. Comment la pratique interartiale ou intermédiale s’effectue-elle
dans la fiction ? Quel impact cela produit-elle sur l’évolution de l’intrigue et à
quelles fins ? Se fondant sur la perspective d'une approche socio-sémiotique de
l'œuvre, et partant du postulat que l'interaction des genres littéraires et des arts
fait du roman de Mabanckou un roman n'zassa, la présente contribution se
noue autour de trois points essentiels dont le premier propose de voir la
déconstruction genrologique à laquelle s'adonne l’auteur en convoquant
différents genres littéraires dans son roman ; le second tente de faire ressortir
les arts divers à partir desquels celui-ci tisse son texte, quand le point de flexion
de l'étude laisse entrevoir le roman N’ zassa comme une poétique de l’identité.
1. De la déconstruction genrologique
L’une des spécificités des romans africains actuels se manifeste dans
l'imbrication des genres. La question des genres constitue, de ce fait, un item
heuristique polémique qui met de l'avant le problème de l'intergénéricité, c'est-
à-dire les diverses formes d'interaction entre les catégories génériques,
canoniques ou non. L'intergénéricité étudie, en effet, les processus de
production de sens provoqué, par l'union ou l'affrontement de deux ou
plusieurs genres, par l'entremise de stratégies diverses. Harvey, identifie trois
processus d'interaction générique :
[...] La différenciation, l'hybridation et la transposition. La différenciation
est une procédure de dérivation à partir des genres existants qui conduit
habituellement à une variété nouvelle de genre, par exemple, l'autofiction
émanant de l'autobiographie.
Harvey (2011, p.128)
L'hybridation se présente comme la combinaison de traits génériques
hétérogènes dans une même œuvre. Lumières de Pointe-Noire, autobiographie
romancée, se réalise principalement par hybridation à travers une
déconstruction genrologique qui laisse découvrir une architextualité prégnante
par le décloisonnement du romanesque, du récit traditionnel oral et des
pratiques modernes discursives. Comme le pense (Assi, 2003, p. 68), cette
recherche d'une écriture propre, parmi l’une des plus originales de ces
dernières années, allie créativité, intertextualité, message qui sont les maîtres
mots de ces romans d'un nouveau genre auxquels Adiaffi avait appliqué le
terme agni de « n’zassa » (assemblage de type patchwork). Bien des intertextes
utilisés par Mabanckou procèdent des genres oraux africains. L'œuvre s'ouvre
ainsi par une légende, celle de « la femme aux miracles » (pp. 11-18), une femme
mythique prise comme sacrifice expiatoire pendant la plus grande sécheresse
qu’a connue Louloubou, le village de l'auteur-narrateur. Cette légende
introduite dans le récit à travers un métadiscours est, par la suite, entièrement
narrée sans typographie particulière, signe qu'elle fait partie intégrante du
roman. Il en est de même de la légende de Mami Watta, cette femme fabuleuse,
Akofena çn°004, Vol.1 165De l'intergénéricité et de l'interartialité dans Lumières de Pointe-Noire d'Alain Mabanckou
ou le roman N'zassa en question
cette sirène des eaux nantie d'une queue de poisson et de longs cheveux en or
(pp.255-256). La légende rapporte que quand vous tombez sur elle très tôt le
matin, le moment où elle sort de la mer, vous devenez très riche. Ces deux
légendes s'allient, du reste, à des proverbes qui poursuivent le décloisonnement
générique dans le texte romanesque de Mabanckou. Les proverbes que l'on
retrouve dans Lumières de Pointe-Noire se révèlent à partir des propos de certains
personnages selon les modalités du discours direct. Le premier proverbe qui
intéresse cette étude est édicté lors de la visite d'adieu de maman Pauline à son
fils, Mabanckou, qui s'apprête à partir pour la France en vue d'y poursuivre ses
études. En prenant congé de lui, maman Pauline lui conseille de devenir celui
qu’il voudra devenir et de garder en mémoire le proverbe qui dit que « l'eau
chaude n’oublie jamais qu’elle a été froide » (p. 34), une façon, pour elle, de lui
demander de ne jamais oublier ses origines.
Le second proverbe est livré par Maitre Mabiala, ceinture noire de karaté
shotokan. Face à l'impatience de ses disciples, exténués par les nombreux
exercices physiques qu’il leur faisait faire en lieu et place du «décollage» de
Bruce Lee qu’ils voyaient au cinéma, il leur répond: « [...] L’oiseau ne vole pas
dès sa naissance, il faut que ses ailes poussent!» (p. 190). Maitre Mabiala
souhaiterait ainsi instruire ses disciples sur le fait que, pour atteindre un
objectif, il est impératif de suivre des étapes préalables. La discursivisation
romanesque de Mabanckou accorde aussi une place de choix à plusieurs
mythes que l'on pourrait regrouper en fonction de leurs modes d'insertion. La
première catégorie de mythes est directement insérée dans la narration et
permet ainsi à la diegèse d’avancer. Le mythe sur les Etoiles filantes (p. 13), qui
annonce la naissance d'un enfant, et celui des Etoiles qui, s'éteignant dans leur
course, (p. 13) préfigure la mort d'un homme, participent de cette esthétique.
Les deux mythes sont rattachables, d'après le texte, au mythe expliquant la
querelle entre la Terre et le Ciel que Dieu trancha en faveur du Ciel puisqu'il y
habitait.
On racontait que son histoire remontait au temps où la Terre et le Ciel se
chamaillaient sans répit. La Terre reprochait au Ciel son inconstance, ses
caprices, ses sauts d'humeur. Et ses rugissements pendant que le Ciel
blâmait la Terre pour son inconscience. Entre ces deux griefs, Dieu devait
trancher et donna raison au Ciel parce que c'était là qu'il habitait.
Mabanckou (2011, p.13)
Ces trois mythes, tout comme celui sur les pouvoirs surnaturels des albinos
(p.262), sont directement introduits dans le texte et constituent la trame normale
du récit. Deux autres mythes apparaissent également dans le roman, mais selon
le miroir déformant d'histoires anecdotiques dont l'une évoque les repas que la
mère de Mabanckou gardait aux sœurs défuntes de celui-ci (pp. 39-41) et
l'autre, la certitude de cet auteur qu' il n' avait pas à aller au cimetière s' incliner
sur la tombe de ses parents dès l’instant ou ceux-ci étaient tout le temps
présents dans la pièce où il résidait, le voyant écrire, corriger ses égarements, et
même lui soufflant ce qu'il fallait consigner. Le dernier type de mythe qu'il est
donné de voir est une série de mythes sur les jumeaux (p. 127), simplement
166 Septembre 2021 ç pp. 163-174Kouakou Paul DABLE
évoqués pour justifier certaines attitudes des personnages. Comme le pense
(Durand,1971, p. 12) pour qui, « au sein du récit littéraire oral ou écrit, les
séparations entre le mythe, la légende, le conte et le roman sont floues », les
légendes, les proverbes et les mythes s' entremêlent dans Lumières de Pointe-
Noire sans que l’on ne puisse dissocier avec précision les différents genres ; ce
qui n' est pas le cas des pratiques discursives modernes telles que la dépêche
journalistique de l’agence Syfia traitant des prostituées de Brazzaville (pp. 212-
213), l'hymne congolais Les trois glorieuses (pp. 142-143) et la chanson Le
Mauvais Sujet repenti de Georges Brassens (p. 210) que Mabanckou introduit
par citations directes en caractères italiques.
Pour (Piegay-Gros, 1995, p. 45), « la citation apparait légitimement comme
la forme emblématique de l'intertextualité : elle rend visible l'insertion d'un
texte dans un autre ». La typographie devient ici un signe distinctif du dialogue
textuel, une technique indicative permettant au romancier de souligner le
décalage dans la prise de parole du narrateur et l'expression de ses
personnages. Lumières de Pointe-Noire est ainsi un texte hétérogène, hybride qui
se situe au confluent de divers genres d'écriture, littéraire ou non. Il apparait
comme une suite de collages littéraires par références ou par citations. Cette
pratique intergénérique qui l'intègre à l'écriture n'zassa est, par ailleurs,
transcendée par une mise en collusion de l'œuvre avec des éléments artistiques
disparates, le roman de Mabanckou se présentant, en définitive, comme un
genre n'zassa d'une incontestable déconstruction genrologique, l'écrivain
aboutit à une remarquable pratique interartiale.
2. La Pratique interartiale chez Alain Mabanckou
Pour Bakhtine (1987), le discours romanesque se caractérise par le
dialogisme, c'est-à-dire le dialogue des textes, la manifestation de voix plurielles
qui sillonnent l'énoncé. Le roman est, en effet, un genre dont le fonctionnement
intègre plusieurs genres littéraires. Aujourd'hui, en plus d'amalgames des
genres, il prend en compte des arts divers ; d’où la naissance des concepts
d'intermédialité et d'interartialité dont les points communs ne devraient
pourtant pas masquer le fait que ces termes conduisent sur des terrains de
recherche différents. Pour (Müller, 2006, pp. 100-101), l'intermédialité opère
dans un domaine qui inclut les facteurs sociaux, technologiques et médiatiques,
alors que l'interartialité se limite à la reconstruction des interactions entre les
arts et les procédés artistiques, et s'inscrit plutôt dans une tradition
poétologique. La présente étude s'intéressera particulièrement à l'interartialité
certes considérée, par (Guiyoba, 2012, p. 22), comme « une déclinaison
spécifique de l'intermédialité », mais vue surtout selon la perspective de
(Moser, 2000, p.70) pour qui « l'interartialité […] se réfère à l'ensemble des
interactions, possibles entre les arts que la tradition occidentale a distingué et
différencié ». Il s'agira de voir comment Mabanckou insère dans son roman
différents éléments artistiques qui l'inscrivent dans la poétique n' zassa.
Lumières de Pointe-Noire convoque, de fait, plusieurs arts qui se confondent au
roman selon des procédés multiformes. Le premier procèdé d'intégration de
1'artistique au romanesque consiste à faire référence aux arts à travers les
Akofena çn°004, Vol.1 167De l'intergénéricité et de l'interartialité dans Lumières de Pointe-Noire d'Alain Mabanckou
ou le roman N'zassa en question
discours des personnages. Lors de sa visite à son fils qui s'apprête à partir pour
la France, maman Pauline fait, par exemple, allusion à la musique, le quatrième
art, en rappelant le temps des orchestres comme l'orchestre national du Congo
et celui des Trois frères de Youlou Mabiala, Loko Massengo et Michel
Boyibanda. « Retrouvant sa voix, elle me parla des concerts de notre orchestre
national. Les Bantous de la capitale, dans les années 1960, et surtout de
l'orchestre Les Trois Frères de Youlou Mabiala, Loko Massengo et Michel
Boyibanda. » Mabanckou (2011, P30). La sculpture, deuxième art selon le
classement hégélien, est également évoquée à travers l'image du Penseur du
sculpteur français Auguste Rodin collée sur l'attaché-case du professeur de
philosophie de Mabanckou (pp. 248- 249). « Le surveillant général ancien
professeur de philosophie on le croisait le long de l’avenue de l’indépendance,
devant un abribus, avec son attaché-case sur lequel il avait collé une image du
Penseur d’Auguste Rodin. » Mabanckou (2011, P248-249). Il en est de même du
huitième art qualifié d'« arts médiatiques » vu ici par le détour de l'émission
télévisée Apostrophes du journaliste français Bernard Pivot.« Plus tard, arrivé à
Nantes pour poursuivre mes études de droit, je tombai un vendredi soir sur
Apostrophes, une émission littéraire animée par Bernard Pivot » Mabanckou
(2011, p.272).
Le séjour à l'Institut français de Mabanckou lui rappelle aussi que ce lieu,
qui fut la seule bibliothèque de la ville, lui a permis de prendre contact avec les
livres, en commençant par les bandes dessinées. L'auteur revient sur ce
neuvième art à travers l'énumération des personnages marquants de la bande
dessinée Zembla que sont Rasmus, Petoulet, Bwana, Satanas, etc. (pp. 270-271).
C'est dans ce bâtiment de l’Institut français que Mabanckou fait également un
clin d' œil significatif au troisième art qu' est la peinture à partir d' un tableau
inachevé à l’arrière-plan ou les oiseaux sont dépourvus d' ailes, et le ciel à peine
esquisse .
Ce tableau n'a pas été achevé à l'arrière-plan où quelques oiseaux sont
dépourvus d'ailes, et le ciel est à peine esquissé. Je songe de temps à autre
au film Le Tableau de Jean-François Laguionie, dans lequel un peintre a
laissé un tableau inachevé et où l'on voit un château, des jardins et une
étrange forêt. Il y a trois catégories de personnages dans l'œuvre : les
Toupins - entièrement peints -, les Pafinis - dont il manque encore quelque
chose - et les Reufs - qui sont tout juste ébauchés. Les Toupins traquent les
Pafinis et prennent les Reufs en captivité. Il n'y a plus que le Peintre lui-
même qui pourrait ramener la paix entre ses protagonistes. Ramo, Lola et
Plume partent alors à la recherche de cet artiste pour que celui-ci vienne
terminer le tableau […] Je ne voudrais pas, moi aussi, traquer le peintre de
ce tableau congolais. Je me contenterai de ce que m'a dit Eric Miclet: ne
jamais bousculer ce qui se fond dans le décor.
Mabanckou (2011. p. 268)
En dehors de ces références lapidaires et allusives aux arts, l'écrivain use
surtout d'un découpage inhabituel nominalement pour ce qui est du genre
romanesque qui affectionne les séquentialisations en parties et en chapitres. Son
œuvre est ainsi subdivisée en deux grandes sections intitulées Première
168 Septembre 2021 ç pp. 163-174Kouakou Paul DABLE
semaine, pour la première partie, et, pour la seconde, Dernière semaine. Ce
morcellement à repères temporels arrime sur le mode cinématographique
transpire dans les intitulés des chapitres de l'œuvre qui ne sont essentiellement
que des titres de films.
Dans la Première semaine, l'on découvre ainsi 16 titres de film : La Femme
aux miracles (film américain de Franck Capra 1931); La Femme de nulle part
(film français réalisé en 1922 par Louis Delluc); Va, vis et deviens (film franco-
israélien de Radu Milhaileanu 2005) ; Les Mille et une Nuits (film américain de
John Rawlins sorti en 1942); La Gloire de mon père (film français de Yves
Robert 1990); La Femme d'à côté (film français de François Truffaut 1981); La
Mort aux trousses (film américain d'Alfred Hitchcock 1959) ; Mademoiselle ma
mère (film du Français Henri Decoin 1937) ; La Paysanne aux pieds nus (film
franco-italien de Vittorio de Sica 1960) ; Le Château de ma mère (film réalisé par
le Français Yves Robert en 1990); Pour une poignée de dollars (western
spaghetti de l'Italien Sergio Leone sorti en 1964) ; La Femme aux deux visages
(film américain de George Cukor 1941); Les Enfants du paradis (film du
Français Marcel Carne 1945) ; Les Dragueurs (film français de Pierre Mocky
1959); Mon oncle (film français de Jacques Tati 1958) et Rencontre du troisième
type (film américain de science-fiction réalisé en 1977 par Steven Spielberg).
Dernière semaine, la deuxième partie du roman, renferme 10 chapitres dont les
titres empruntent également aux titres d'œuvres cinématographiques : Le Pas
suspendu de la cigogne (film réalisé en 1991 par le Grec Théo Angelopoulos) ;
Cinéma paradiso (film italien de Guiseppe Tonatore réalisé en 1989) ; Les Nuits
fauves (film franco-italien réalisé en 1992 par Cyril Collard); Guerre et Paix
(film de guerre américano-italien d'inspiration historique de King Vidor sorti en
1956) ; Le Cercle des poètes disparus (film de l'Américain Peter Weir 1989) ; Les
Dents de la mer (film d'horreur américain de Steven Spielberg 1975); Le Tableau
(film français de Jean-François Laguionie 2011); La Maison des contes film
franco-italien sorti en 2009 et réalisé par Dominique Monfery) ; Adieu ma
concubine (film chinois de Chen Kaige 1993) et « Post-scriptum » (titre partiel
du film Post-scriptum d’un vieux film réalisé en 1979 par l’Ukrainien Viktoras
Starosas). Outre les titres de parties et de chapitres relevant du septième art,
l'incorporation directe de photographies dans les pages de l'œuvre constitue
également une des stratégies de prise en compte des arts dans le roman de
Mabanckou. La photographie, partie intégrante des « arts médiatiques », le
huitième art, parcourt de part en part Lumières de Pointe-Noire. Sur les vingt-six
chapitres de l'œuvre, l'on dénombre dix-neuf photographies. Tous les chapitres
ne sont certes pas illustrés, mais il y en a comme « La gloire de mon père » et «
Le cercle des poètes disparus » qui renferment chacun deux photographies.
Lumières de Pointe-Noire accueille ainsi, en plus des genres littéraires
protéiformes qui le composent, diverses sortes d'arts. Cette écriture à la fois
intergénérique et interatiale qui lui donne un caractère hybride et qui en fait un
roman parfaitement n'zassa est, au demeurant, symbolique d'une véritable
poétique de l'identité.
Akofena çn°004, Vol.1 169De l'intergénéricité et de l'interartialité dans Lumières de Pointe-Noire d'Alain Mabanckou
ou le roman N'zassa en question
3. Le roman n'zassa, une poétique de l'identité
Dans la langue agni, le terme n'zassa appartient au vocabulaire de la
couture. Il désigne « un pagne africain, une sorte de tapisserie qui rassemble,
qui récupère des petits morceaux perdus chez les tailleurs pour en faire un
pagne multi pagne, un pagne caméléon qui a toutes les couleurs, qui a plusieurs
motifs » (Ade,2000, p.6). Dans le contexte de la création littéraire, le n'zassa
renvoie à cette écriture qui rassemble harmonieusement des genres littéraires
aux formes, poétiques et fonctions différentes. A l'image du tailleur qui
compose son pagne n'zassa au hasard des morceaux de tissus récupérés, le
créateur de l'œuvre littéraire n'zassa recourt, au gré de son inspiration et de ses
intentions esthétiques et idéologiques, aux genres constitutifs de sa compétence
artistique. Il aboutit, selon l'expression d'Adiaffi, à un «genre sans genre ». Cette
esthétique nouvelle est, en réalité, emblématique d'une identité africaine
mouvante et dynamique, une identité plurielle.
Le roman africain, en plus donc de sa propension à développer des
thématiques orientées vers le pouvoir et le développement social, se pare, ces
dernières décennies, d'une certaine exigence scripturale qui donne à lire une
poétique singulière, signe caractéristique d'une identité mutante, une identité
rhizomique, à la fois endogène et transculturelle, qui intègre la condition
humaine cosmopolite du XXIe siècle. Le cosmopolitisme est, en effet, le mélange
de plusieurs identités, et donc le sentiment d'être un citoyen du monde au-delà
des nations, sans être rivé à l'une d'elles. Il consiste à considérer comme sa
patrie aussi bien sa nation d'origine que d'autres pays. Pour Beck (2001), la
cosmopolitisation renvoie à un processus multidimensionnel et complexe
caractérisé par les interdépendances qui relient de fait les hommes les uns aux
autres, de gré ou de force. Il pense ainsi que la vie quotidienne, le travail, et
même les rapports amoureux deviennent cosmopolitiques au sens où ils sont
le mélange de différentes cultures. La distinction analytique entre nous et les
autres est donc désormais brouillée.
Les personnages qui se meuvent dans Lumières de Pointe-Noire et les
différentes situations qui y sont campées laissent éclore ce cosmopolitisme
actuel vers lequel semble tendre le continent africain, s'il ne le caractérise pas
déjà. Ces personnages dont l'origine congolaise est incontestable demeurent
pourtant culturellement extravertis. Leurs préférences cinématographiques
d'emblée tournées vers les aventures américaines de Bud Spencer et Terence
Hill dans On l'appelle Trinita, On continue à l'appeler Trinita, et les westerns
spaghettis américains Le bon, la brute et le truand de Clint Eastwood, Lee Van
Cleef et Eli Wallach sont remplacées, avec la venue des films asiatiques d’arts
martiaux, par les affiches de Bruce Lee dans La fureur du dragon, Opération
dragon ou Le jeu de la mort (pp. 187-189). Les réminiscences littéraires de
Mabanckou logé à l'Institut français, l'unique bibliothèque de la ville à l'époque,
demeurent elles aussi essentiellement braquées sur des œuvres et auteurs
français : Le Grand Meaulnes d'Alain-Fournier, Antigone de Jean Anouilh, Les
Contes du chat perché de Marcel Aymé, Une tête de chien de Jean Dutourd, les
textes poétiques Le Pont Mirabeau et Les Yeux d' Eisa respectivement de
170 Septembre 2021 ç pp. 163-174Kouakou Paul DABLE
Guillaume Apollinaire et Louis Aragon, et les allusions à Balzac et Zola (pp.
271-272). Cet éclectisme augure de la culture cosmopolite de Mabanckou et,
partant, de celle des Africains aujourd'hui. Par le jeu des nombreux commerces
qu'il a entretenus durant sa vie de migrant en France et aux Etats-Unis,
Mabanckou est, à l'image des Africains actuels, un citoyen du monde. Il
n'occulte pas, de ce fait, son identité plurielle quand bien même il exprimerait et
réclamerait ouvertement son appartenance congolaise à travers la confidence
qu'il fait sur sa naissance : « [...] Je me délivrai de son ventre dans un bâtiment
délabré de la maternité du district de Mouyondzi en cette nuit à la fois torride
et glaciale du 24 février 1966 » (p. 24). Congolais déterritorialisé depuis vingt-
trois ans, devenu français par naturalisation, vivant et exerçant désormais sa
profession d'enseignant chercheur aux Etats-Unis, Mabanckou se retrouve
dorénavant dans une véritable spatialisation identitaire dont les traces sont
outre-Atlantique. Cette identité par le territoire, du fait que le lieu érigé en
territoire contribue à la formation d'une identité nouvelle, se décline aussi bien
à travers le regard porté par les autres sur lui que par le caractère singulier de
l'inconscient qui parle en lui. Mabanckou apparait, pour les autres Congolais,
comme un inconnu. Au restaurant « Chez Gaspard », par exemple, la seule
personne qui se vante de le connaître ne le sait que par ses occurrences à la
télévision, et non en tant que compatriote congolais : « Vous êtes écrivain, je
vous ai parfois vu à la Télé ! Tous ces gens qui mangent là sont des incultes, ils
ne savent pas qui vous êtes ! Mais moi je suis un type qui suit l'actualité ! » (p.
219). Ses parents, eux-mêmes, ne l'identifient que par rapport à un univers
identitaire autre. La visite qu'il effectue sur la parcelle de tonton Albert
concourt a le présenter comme un extraterrestre pour ses propres neveux :
Pour ces mômes je suis une apparition, une ombre qui s'évanouira lorsque
le soleil se couchera. Dans leur esprit je ne suis qu'un personnage
habilement construise par leurs parents [...]. Un d’entre eux le plus grand
de taille me renifle tel un chien essayant de connaître son maître trop
longtemps absent.
Mabanckou (2011, p.31)
Cette extranéité identitaire se lit dans la présence de Mabanckou au Congo
sur invitation de la France, en tant qu'expert français et non parce que natif de
ce pays. Il bénéficie, à ce titre, des avantages que lui offre sa citoyenneté
française. Il le clame lui-même à son oncle venu lui rendre une visite de
courtoisie : « Je lui explique que l'Institut français m'a invité pour quelques
jours de conférences [...] je ne paye rien » (p. 167). Bien plus encore, l'identité de
Mabanckou déborde le cadre français pour s'étendre aux États-Unis. Koblavi, le
propriétaire du cinéma Rex qui, « autrefois, [...] garantissait le rêve [à
Mabanckou et aux enfants de son âge] » (p. 24), ne le désigne que sous le
pseudonyme de « l'Américain » : « L'Américain ! Je n'en crois pas mes yeux ! Tu
as pensé à venir voir le vieux Koblavi ! [...] Gilbert et madame, vous pouvez
aller filmer la salle pendant que je discute avec mon Américain... » (p. 198).
Mieux, Koblavi termine leur conversation par une conception de l'identité qui
semble bien traduire celle de l'auteur, voire des Africains actuels :
Akofena çn°004, Vol.1 171De l'intergénéricité et de l'interartialité dans Lumières de Pointe-Noire d'Alain Mabanckou
ou le roman N'zassa en question
C'est vrai que je suis d'origine ghanéenne par mes parents, mais je me suis
toujours senti monténégrin. Tu entends mon accent ? Il n'y a pas plus
monténégrin que moi dans cette ville ! Je n'ai jamais été victime d'une
quelconque exclusion de la part de la population. C'est ici que je vis, et c'est
ici qu'on m'enterrera.
Mabanckou (2011, p.202)
Ce sentiment d'appartenir à la fois à un ici et a un ailleurs qui se vit à
travers, le regard des autres se retrouve incidemment chez l'auteur. Celui-ci est,
à plusieurs reprises, choqué par les attitudes des gens qu'il rencontre pendant
son séjour. Ainsi en est-il de la réflexion qu'il fait en son for intérieur la nuit de
la conférence à l'Institut français quand Yaya Gaston pp. (113-114). Son grand
frère, parce qu'ayant démesurément consommé de la boisson alcoolisée, crée un
scandale et crie qu'ils sont du même père et de la même mère : « Pensait-il que
seul le sang rapprochait deux êtres et non ce qu'ils avaient vécu ensemble ?».
Mabanckou n'est donc plus exclusivement de ce monde dans lequel vivent ses
parents; il baigne désormais dans une identité à ressorts multiples. M’Bembe
(2006, p. 13) qualifie ce genre de reconstruction identitaire centrée sur une
sensibilité culturelle, historique et même esthétique de l’ici et de l’ailleurs par le
terme néologique d'afropolitanisme qu’il décrit comme : la conscience de cette
imbrication de l'ici et de l’ailleurs, la présence de l’ailleurs dans l'ici et vice-
versa, cette relativisation des racines et des appartenances primaires et cette
manière d'embrasser, en toute connaissance de cause, l'étranger et le lointain,
cette capacité à reconnaître sa face dans le visage de l'étranger et de valoriser les
traces du lointain dans le proche, de domestiquer l’in-familier, de travailler avec
ce qui a tout l'air des contraires. Pour la Camerounaise Miano (2014),
Mabanckou serait certainement afropéen, terme par lequel elle qualifie certaines
personnes d'ascendance subsaharienne ou caribéenne, mais de culture
européenne, des individus qui, selon elle, mangent certes des plantains frits,
mais dont les particularismes ne sont pas tellement différents de ceux qu'on
peut trouver dans les régions de France. Mabanckou demeure, dans tous les
cas, porteur d'une identité cosmopolite du fait que son humanité demeure
partagée entre le Congo, son pays natal, la France, son pays d'adoption, et les
Etats-Unis où il vit et travaille. Il n'est ni européen, ni africain, il est beaucoup
plus créole. À l’image des Africains du continent et de ceux de la diaspora
partagés entre afropolitanisme et afropeanisme, il se présente désormais comme
un citoyen du monde, un citoyen façonné dans un monde cosmopolitique.
Conclusion
L'une des originalités des œuvres littéraires africaines réside aujourd'hui
dans la pratique intertextuelle. Cette technique scripturale qui se joue à divers
niveaux permet aux écrivains en général, et aux romanciers en particulier, de
donner libre cours à une inspiration débordante perceptible par le détour de la
déconstruction générique et de l'entrée par effraction des arts dans le champ
littéraire africain. À ce jeu, Lumières de Pointe-Noire d'Alain Mabanckou se
présente comme un des parangons de ce nouveau roman africain qui se
172 Septembre 2021 ç pp. 163-174Kouakou Paul DABLE
construit en déconstruisant les cloisons anciennement étanches entre les genres
classiques écrits ou oraux que sont le roman, le théâtre, la poésie, la légende, le
proverbe, le mythe, etc. et des pratiques discursives modernes comme la
dépêche journalistique, les hymnes et les paroles de mélodies. Bien plus encore,
cette œuvre romanesque fait interagir en son sein différents arts tels que la
peinture, la musique, la sculpture, la bande-dessinée, la photographie, le
cinéma.
Par cette pratique littéraire de la polyphonie générique et artiale, elle entre
pleinement dans l'écriture n’zassa, une écriture qui apparaît finalement comme
une véritable poétique de l'identité. L'éclectisme textuel qui fait de cette œuvre
littéraire un roman n’zassa résumé, de fait, l'identité plurielle de Mabanckou, et
par ricochet, celle des Africains actuels du continent et de la diaspora, une
identité composite qui s'en source à la fois dans la culture africaine et les
multiples apports cognitifs reçus du commerce des autres cultures et races.
Mabanckou manifeste dès lors, à l'image de tous les Africains engagés
aujourd'hui dans cette culture de la mobilité caractérisée par des migrations
constitutives des diasporas, des échanges commerciaux de tous genres, une
identité, sinon afropolitaine, du moins afropéenne, et donc assurément
cosmopolite.
Références bibliographiques
Ade, A. J. M. (2000). Les Naufragés de L’intelligence, Abidjan CEDA
Assi, D.V. (2003). Africultures n°56 p68.
Bakhtine, M. (1987). Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard.
Beck, U. (2001). La société du risque sur la voie d’une autre modernité, édition
Flammarion, Librairie Eyrolles.
Durand, G. (1971). Les structures anthropologiques de L’imaginaire, Paris,
Bordas.
Guiyoba, F. (2012). Littérature médiagénique, Paris, L’harmattan.
Harvey, F. & Alain, R. G. (2011). Roman composite. Intergénéricité et
intermédialité, Paris, Editions L’harmattan, coll. « Critiques littéraires ».
Mabanckou, A. (2011). Lumières de Pointe-noire, Paris, Seuil.
Mariniello, S. (2003). Présentation des cinéma et intermédialité,
Cinemas, cinéma et intermedialité (10)2.3, 7.
Mbembe, A. (2006). De la postcolonie essai sur L’imagination politique dans
l’Afrique contemporaine, Paris Karthala.
Méchoulan, E. (2003). Intermédialités : le temps des illusions perdues , dans
Intertextualités 1, 22.
Miano, L. (2014). Histoire d’une résistance sonore, Kindle édition.
Moser, W. (2000). Puissance baroque dans les nouveaux médias, dans Cinémas,
(10)2-3, 44-70.
Müller, J.E. (1996). intermedialität : formen modern kulturellerkommunikation,
münster : Nodus publikationen, 5.
Akofena çn°004, Vol.1 173De l'intergénéricité et de l'interartialité dans Lumières de Pointe-Noire d'Alain Mabanckou
ou le roman N'zassa en question
Müller, J.E. (2000). Intermédialité , une nouvelle approche interdisciplinaire :
perspectives théoriques et pratiques à l’exemple de la vision de la
télévision Cinemas, (10)2-3, 106.
Müller, J.E. (2006). Vers l’intermédialité ; histoire, positions et options d’un axe
de pertinence », Métamorphoses. L’identité des médias en question, 16,
Piegay, G.N. (1995). Introduction à l’intertextualité, Paris, Dunod.
174 Septembre 2021 ç pp. 163-174Vous pouvez aussi lire