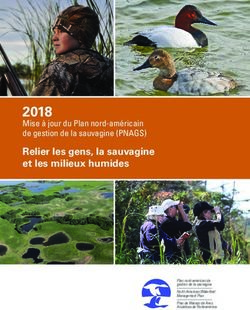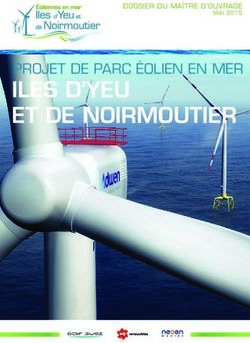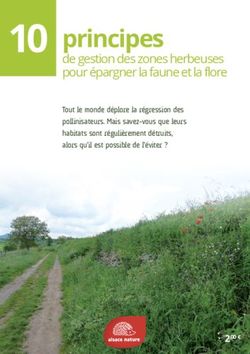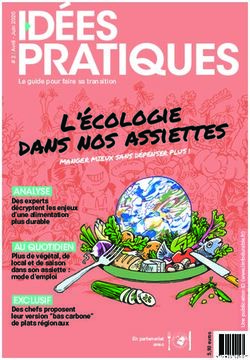Demande de régularisation d'autorisation d'exploiter une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement - NOVEMBRE 2017 ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Demande de régularisation
d’autorisation d’exploiter
une Installation Classée
pour la Protection de
l’Environnement
NOVEMBRE 2017
SAS Les Truites du “Ster-Goz”
Pisciculture de l’Élorn
Pont-Ar-Zall
29400 Lampaul-Guimiliau
Conseil
Accompagnement
Développement
SIRET : 800 038 606 000 11
CODE APE : 7490B Auteur(s) :
Johann PRODHOMME
1, rue du courtil
22380 Saint-Cast le Guildo
Etudes contributives :
Bureau d’études LA HAUT
Itavi – Service Aquaculture
Syndicat de la Truite d’Elevage de Bretagne
1SOMMAIRE
DEMANDE ............................................................................................................................... 6
INTRODUCTION ....................................................................................................................... 8
RÉSUME NON TECHNIQUE .................................................................................................... 11
1 – ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ............................... 11
2 – DESCRIPTION DE L’ACTIVITE ........................................................................................... 14
3 – IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ................................................................ 15
4 – MESURES ENVISAGEES POUR LIMITER OU SUPPRIMER LES IMPACTS DE L’INSTALLATION
SUR L’ENVIRONNEMENT ....................................................................................................... 17
5 – LA MODERNISATION ET LA MISE À NIVEAU DES INSTALLATIONS ................................. 19
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET DE L’INSTALLATION .................................................. 21
ÉTUDE D’IMPACT ................................................................................................................... 26
1 – ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ............................... 27
1.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET CADASTRALE DU SITE ........................................ 27
1.2 ÉTUDE DU MILIEU PHYSIQUE .................................................................................. 28
1.2.1 Contexte Géologique et pédologique ...................................................................................... 28
1.2.2 Contexte topographique et climatique ..................................................................................... 29
1.2.3 Contexte hydrogéologique ......................................................................................................... 32
1.2.4 Contexte hydrographique et hydrologique .............................................................................. 34
1.2.5 La qualité des eaux ....................................................................................................................... 40
1.3 ÉTUDE DU MILIEU NATUREL .................................................................................... 49
1.3.1 Présentation générale : le site Natura 2000 Rivière Élorn .......................................................... 49
1.3.2 Paysages et Habitats semi-naturels ............................................................................................. 50
1.3.3 Habitats d’intérêts communautaires........................................................................................... 51
1.3.4 Espèces d’intérêts communautaires ........................................................................................... 64
1.3.5 Espèces d’intérêt patrimonial ...................................................................................................... 69
1.3.6 Espèces disparues ......................................................................................................................... 64
1.3.7 Le peuplement piscicole .............................................................................................................. 64
1.4 ETUDE DU MILIEU HUMAIN..................................................................................... 68
1.4.1 Environnement humain ................................................................................................................. 68
1.4.2 Documents d’urbanisme .............................................................................................................. 70
1.4.3 Les réseaux ..................................................................................................................................... 71
1.4.4 Le Bruit ............................................................................................................................................. 72
1.4.5 Le patrimoine bâti ......................................................................................................................... 72
1.4.6 Les risques naturels ........................................................................................................................ 73
1.4.7 Les risques industriels...................................................................................................................... 75
1.4.8 Les sols susceptibles d’être pollués .............................................................................................. 76
1.4.9 Appellations d’Origine Contrôlée ............................................................................................... 77
2 - JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA DEMANDE DE REGULARISATION ET D’AUTORISATION
PARMI LES SOLUTIONS ENVISAGEES ................................................................................... 78
2.1 SOLUTIONS ENVISAGEES ............................................................................................. 78
2.1.1 Solution 1 ........................................................................................................................................ 78
2.1.2 Solution 2 ........................................................................................................................................ 78
2.1.3 Solution 3 ........................................................................................................................................ 78
2.2 SOLUTION RETENUE ..................................................................................................... 78
3 – DESCRIPTION DE L’INSTALLATION .................................................................................. 79
3.1 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE ....................................................................................... 79
3.1.1 Historique ........................................................................................................................................ 79
3.1.2 Activités soumises à la réglementation ICPE .............................................................................. 79
23.1.3 Phases d’exploitation et savoir-faire ........................................................................................... 80
3.2 DESCRIPTION DES INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION .......................................... 82
3.2.1 Prise d’eau dans l’Élorn ................................................................................................................. 84
3.2.2 Aménagement sur l’Élorn au niveau du site .............................................................................. 86
3.2.3 Les infrastructures et le matériel de production ........................................................................ 88
3.2.4 Aliments et nourrissage ................................................................................................................. 95
3.3 PLAN DE PRODUCTION DE LA PISCICULTURE ............................................................ 96
3.3.1 Historique de production .............................................................................................................. 96
3.3.2 Historique des paramètres de qualité d’eau ............................................................................. 96
3.3.3 Procédures de suivi en autocontrôle .......................................................................................... 97
3.3.4 Process du traitement des rejets d’élevage .............................................................................. 99
3.3.5 Simulation des flux générés par une activité de production de 400 tonnes annuelles ...... 100
3.4 GESTION SANITAIRE DE LA PISCICULTURE ................................................................ 102
3.4.1 Gestion du risque sanitaire lié au réseau hydrique naturel .................................................... 103
3.4.2 Gestion du risque d’inondation ................................................................................................. 103
3.4.3 Oiseaux piscivores et nuisibles ................................................................................................... 104
3.4.4 Gestion des mouvements de véhicules et personnes ............................................................ 104
3.4.5 Gestion sanitaire du cheptel ...................................................................................................... 105
3.5 NORME DE REJET ET COMPATIBILITE PAR RAPPORT AU SDAGE ET AU SAGE ........ 105
3.6 EFFECTIF DE LA PISCICULTURE .................................................................................. 107
3.7 HORAIRE DE FONCTIONNEMENT ............................................................................. 107
3.8 CAPACITÉ TECHNIQUE ET FINANCIÈRE .................................................................... 107
4 – IMPACT DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT ................................................ 109
4.1 IMPACTS SUR LES EAUX ............................................................................................. 109
4.1.1 Altération des eaux superficielles de l’Élorn ............................................................................. 109
4.1.2 Le bon état écologique des cours d’eau (objectif 2021) ...................................................... 110
4.1.3 Influence de la qualité de l’eau sur la physiologie du poisson .............................................. 113
4.1.4 Impact de l’élevage sur la qualité du milieu récepteur ......................................................... 114
4.1.5 Analyses par un laboratoire agréé ........................................................................................... 117
4.1.6 Analyse des boues issues de la décantation ........................................................................... 118
4.2 IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL ............................................................................... 118
4.2.1 Impact sur les paysages et les habitats semi-naturels ............................................................ 118
4.2.2 Impacts sur les habitats ............................................................................................................... 119
4.2.3 Impacts sur les espèces .............................................................................................................. 124
4.3 IMPACT SUR LE PATRIMOINE ..................................................................................... 128
4.4 IMPACT SUR L’URBANISME COMMUNAL ................................................................. 128
4.5 IMPACT SUR LA CIRCULATION ................................................................................. 128
4.6 IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR ............................................................................ 128
4.7 IMPACT PAR LE BRUIT ................................................................................................ 129
4.8 IMPACT PAR LES DECHETS ........................................................................................ 131
4.9 ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC DES PROJETS CONNUS .............................. 132
4.10 RÉCAPITULATIF DES IMPACTS ................................................................................. 133
4.10.1 Tableau récapitulatif des impacts .......................................................................................... 133
4.10.2 Analyse des méthodes utilisées ............................................................................................... 133
5 – IMPACT DU PROJET SUR LA SANTÉ ............................................................................... 137
5.1 INTRODUCTION ......................................................................................................... 137
5.2 MÉTHODE DE L’ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES .......................................... 137
5.3 CHAMP D’APPLICATION DE L’ETUDE....................................................................... 138
5.3.1 La zone d’étude .......................................................................................................................... 138
5.3.2 Les produits stockés ..................................................................................................................... 138
5.3.3 Les rejets pris en compte ............................................................................................................ 139
5.3.4 Les populations concernées ...................................................................................................... 140
5.3.5 Les voies d’expositions étudiées ................................................................................................ 140
5.3.6 Exposition chronique et exposition aiguë ................................................................................. 140
5.4 ÉTAT INITIAL DU SITE ET DES INSTALLATIONS .............................................................. 140
5.4.1 Description de l’installation ........................................................................................................ 141
5.4.2 Environnement ............................................................................................................................. 141
35.5 ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES .................................................................... 141
5.5.1 Identification des dangers et sélection des traceurs sanitaires de nature chimique ......... 141
5.5.2 Effets sur la santé des traceurs sanitaires de nature chimique retenus ................................ 142
5.5.3 Relation dose-réponse ................................................................................................................ 146
5.5.4 – Estimation des expositions ....................................................................................................... 147
5.5.5 – Caractérisation du risque ........................................................................................................ 147
5.6 CONCLUSION ............................................................................................................ 148
6 - RAISONS DU CHOIX DU PROJET................................................................................... 149
6.1 JUSTIFICATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE DU PROJET .......................................... 149
6.2 CRITÈRES D’ENVIRONNEMENT .................................................................................. 149
6.3 CRITÈRES RÉGLEMENTAIRES ...................................................................................... 150
7 - MESURES ENVISAGÉES POUR LIMITER OU SUPPRIMER LES IMPACTS DE L’INSTALLATION
SUR L’ENVIRONNEMENT ..................................................................................................... 152
7.1 MODE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX ................................................. 152
7.2 PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET DU PAYSAGE ................................................. 154
7.3 PROTECTION ET QUALITE DE L’AIR............................................................................ 154
7.4 BRUIT ........................................................................................................................... 154
7.5 GESTION DES DÉCHETS ............................................................................................. 155
7.6 PROTECTION DES BIENS ET DU PATRIMOINE ............................................................ 155
7.7 SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE ................................................................................... 155
7.8 ESTIMATION DU COUT DES MESURES COMPENSATOIRES....................................... 155
8 - REMISE EN ÉTAT DU SITE ................................................................................................. 157
8.1 ASPECTS RÈGLEMENTAIRES ...................................................................................... 157
8.2 PRINCIPES DE LA REMISE EN ÉTAT DU SITE ................................................................ 157
ÉTUDE DE DANGERS............................................................................................................ 158
1 - CONTENU ET MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE .................................................................. 159
1.1 INTRODUCTION ......................................................................................................... 159
1.2 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE .................................................................................... 159
2 – RÉSUME NON TECHNIQUE ............................................................................................ 161
2.1 IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS ...................................................... 161
2.2 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES ...................................................................... 161
2.3 ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES ............................................................................ 162
2.4 CONCLUSION ............................................................................................................ 162
3 – DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DES ENJEUX .......................... 163
3.1 DONNÉES ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ........................................................... 163
3.2 ENJEUX HUMAINS ...................................................................................................... 164
4 – DESCRIPTION DE L’INSTALLATION ................................................................................ 165
4.1 DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ ..................................................................................... 165
4.2 DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS ............................................................................. 165
4.3 DESCRIPTION DES PRODUITS UTILISÉS ....................................................................... 165
5 – IDENTIFICATION, CARACTÉRISATION ET RÉDUCTION DES POTENTIELS DE DANGER . 169
5.1 POTENTIELS DE DANGERS LIÉS A L’ACTIVITÉ ............................................................ 169
5.2 POTENTIELS DE DANGERS LIÉS AUX PRODUITS ......................................................... 170
5.2.1 – Identification des produits stockés et/ou mis en œuvre ...................................................... 170
5.2.2 – Incompatibilité de stockage entre produits chimiques ....................................................... 170
5.2.3 – Identifications des potentiels de dangers liés aux produits ................................................. 171
5.3 RÉDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS ............................................................. 171
5.3.1 – Inflammabilité / Explosivité ...................................................................................................... 171
5.3.2 – Toxicité ....................................................................................................................................... 172
45.3.3 – Pollution ...................................................................................................................................... 173
5.4 ESTIMATION DES CONSÉQUENCES DE LA LIBÉRATION DES POTENTIELS DE DANGERS
5.5 CARTOGRAPHIE DES POTENTIELS DE DANGERS ..................................................... 174
6 – RETOURS D’EXPÉRIENCE ............................................................................................... 175
6.1 ACCIDENTOLOGIE INTERNE ..................................................................................... 175
6.2 ACCIDENTOLOGIE EXTERNE .................................................................................... 175
7 – ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES ......................................................................... 180
7.1 MÉTHODOLOGIE ....................................................................................................... 180
7.1.1 Déroulement de l’APR ................................................................................................................ 180
7.1.2 Échelles de cotation ................................................................................................................... 181
7.2 ÉVALUATION DES RISQUES D’ORIGINE EXTERNE ..................................................... 183
7.2.1 Les intempéries ............................................................................................................................ 184
7.2.2 La foudre ...................................................................................................................................... 185
7.2.3 Risque inondation ........................................................................................................................ 186
7.2.4 Risque sismique ............................................................................................................................ 186
7.2.5 Risques liés aux installations voisines .......................................................................................... 186
7.2.6 Risques liés aux axes de communication ................................................................................. 187
7.3 ÉVALUATION DES RISQUES D’ORIGINE INTERNE...................................................... 187
8 - ANALYSE DÉTAILLÉE DES RISQUES ................................................................................ 191
9 - DÉMARCHE DE MAÎTRISE DES RISQUES D’ACCIDENTS POTENTIELS ............................ 192
10 - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ ............................................................................... 193
NOTICE HYGIÈNE ET SECURITÉ ........................................................................................... 194
INTRODUCTION ................................................................................................................... 195
1 – IDENTIFICATION DES SOURCES DE DANGERS ............................................................. 195
2 – GESTION DE LA PRÉVENTION ET DES SECOURS ........................................................... 196
2.1 – GESTION DE LA SÉCURITÉ ....................................................................................... 196
2.2 – ORGANISATION DES SECOURS .............................................................................. 196
2.3 – PROTECTION DES TRAVAILLEURS ........................................................................... 198
2.4 – MAÎTRISE DES RISQUES TRANSVERSAUX................................................................. 201
3 – ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL ................................ 201
3.1 - HYGIÈNE ................................................................................................................... 201
3.2 – RESTAURATION ........................................................................................................ 202
3.3 – POSTE DE DISTRIBUTION D’EAU .............................................................................. 202
3.4 – AMBIANCE THERMIQUE, ÉCLAIRAGE .................................................................... 202
3.5 – VENTILATION, QUALITÉ DE L’AIR ............................................................................ 202
3.6 – CONFORT AUDITIF .................................................................................................. 202
RÉFÉRENCES ........................................................................................................................ 203
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................ 204
GLOSSAIRE ...................................................................................................................... 204
CREDITS PHOTOS ............................................................................................................. 205
LISTE DES CARTES ............................................................................................................. 205
LISTE DES FIGURES ............................................................................................................ 205
LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................... 206
LISTE DES ILLUSTRATIONS ................................................................................................. 206
ANNEXES............................................................................................................................. 208
5DEMANDE
Loc-Éguiner / Lampaul-Guimiliau, le 30 Novembre 2017
Monsieur le Préfet du Finistère,
Nous vous présentons dans ce dossier la demande d’autorisation d’exploiter de la pisciculture
de l’Élorn au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement de la Police de l’Eau et de la Pêche. Le dossier décrit l’impact du site sur
l'environnement et expose les mesures compensatoires prises afin de supprimer ou de réduire les
nuisances engendrées.
Au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
issue du décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 à l’origine du livre V de la partie réglementaire du
code de l’environnement, l'activité concernée est reprise dans le tableau suivant :
Numéro de la Désignation de la rubrique Régime Rayon
rubrique d’affichage
2130-1 Piscicultures d’eau douce (à l’exclusion des étangs Soumis à autorisation - 3 km
empoissonnés, où l’élevage est extensif, sans Arrêté du 01/04/2008
nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel),
la capacité de production étant supérieure à 20 t/an Production maximale :
400 tonnes / an
4725-2 Oxygène dont la quantité stockée sur site est supérieure Soumis à déclaration - -
ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t Arrêté du 10/03/1997
(CAS 7782-44-7) modifié par l’arrêté du
11/05/2015
Stockage maximal :
79,25 tonnes
6Cette pisciculture est située sur la rivière Élorn, à cheval sur la commune de Loc-Éguiner et la
commune de Lampaul-Guimiliau. Elle produit essentiellement des truites Arc-en-ciel d’environ 3 kilos afin
d’honorer les besoins exprès provenant principalement des entreprises agroalimentaires de fumage de
poisson locales en manque de matière première.
La pisciculture de l’Élorn est l’outil de production principal dans le dispositif
d’approvisionnement de la Coopérative « Les Aquaculteurs Bretons », reconnue comme la première
Organisation de Producteur en France et qui regroupe 28 sites piscicoles dans les départements du
Finistère, des Côtes d’Armor et de Seine Maritime. Ses apports sont essentiels pour maintenir les ventes
durant les périodes de carence consécutive à la saisonnalité de notre production.
En effet, l’emplacement de la pisciculture est particulièrement propice à la production de la
truite, grâce notamment au soutien des débits d’étiage, opéré par le syndicat en charge de la gestion
du barrage du Drennec, lui-même situé à l’amont de la rivière.
Afin de pérenniser l’exploitation, dans le respect des objectifs environnementaux actuels, en tenant
compte de sa capacité de production, et au regard des besoins d’une filière organisée et constructive,
je sollicite une demande d’autorisation d’exploiter pour une production annuelle de 400 Tonnes
maximum.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma plus haute considération.
Hervé Ladurée
7INTRODUCTION
L’élevage des poissons en eau douce ne date pas d’hier. Avant Jésus-Christ, les Chinois, les Égyptiens
et les Romains maîtrisaient l’élevage des poissons d’étang. C’est au Moyen-âge que des moines
français ont intégré les principes de base des techniques d’élevage. Mais c’est surtout à la fin du
19ème siècle que la salmoniculture a véritablement pris son essor notamment dans les Vosges grâce à
deux pêcheurs Rémy et Géhin qui mirent au point la reproduction artificielle des truites. Puis, le 20ème
siècle a connu le développement de la pisciculture française. En 1910, il existe déjà 111 petits
établissements piscicoles situés pour la plupart à l’emplacement d’anciens moulins.
La pisciculture de l’Élorn existe depuis 1957 et a été entièrement reconstruite en 1973 par Mr René
PICART qui l’a transmise à son fils Ronan en 1993. La SAS « Les Truites du Ster-Goz » a repris l’exploitation
en 1994 et en est aujourd’hui locataire. Le présent dossier vise à régulariser l’autorisation d’exploiter
dans le cadre de la législation portant sur les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) sous la rubrique n°2130-1 (piscicultures d’eau douce) et 4725-2 (stockage
d’oxygène). L’élevage concerne la production de salmonidés (truites arc-en-ciel), sachant qu’il est
demandé de compléter l’autorisation initialement délivrée par l’arrêté n°2009/194 du 9 décembre 2009
à un niveau de 400 T de production annuelle, en tenant compte de l’arrêté type du 1er avril 2008.
Cette démarche devrait permettre d'assurer la pérennité économique de cette exploitation en
confortant les 2 emplois de salariés, et en créant un poste supplémentaire à mi-temps. Il est essentiel de
noter que ce site de production est le premier contributeur dans la planification des fournitures envers
la Coopérative « Les Aquaculteurs Bretons » reconnu première OP Française. (Organisation de
Producteur.) Cela conforte le développement de la transformation en aval, au sein de l’entreprise
« Bretagne Truite » qui emploie 35 personnes sur son site de Plouigneau, et cela permet aussi de soutenir
la croissance des usines de fumaisons, telles que Guyader à Châteauneuf-du-Faou, Moulin de La
Marche à Châteaulin ou encore Marine-Harvest à Landivisiau. Ces entreprises, qui représentent des
centaines d’emplois, rencontrent toutes d’extrêmes difficultés d’approvisionnements et de “sourcing“.
Elles se tournent avec convoitise vers nos productions locales qui sont malheureusement insuffisantes
pour permette le maintien et le développement de leurs activités.
Il est notable d’indiquer aussi que la société « Les truites du Ster-Goz » participe à la mobilisation de la
profession au sein du Comité Interprofessionnel des produits d’Aquaculture. (CIPA)
Ce comité a été créé le 16 décembre 1997, et reconnu officiellement le 11 juillet 1998 par les Pouvoirs
Publics. Il réunit, au sein d’une même interprofession, les acteurs de la salmoniculture d’eau douce et
de l’aquaculture marine et nouvelle. Il est composé d’un collège de producteurs, d’un collège de
fabricants d’aliment et enfin d’un collège de transformateurs. Le rôle du CIPA est, entre autres,
d’engager les actions permettant d’anticiper les évolutions de la filière en s’engageant sur des
8réformes de progrès en matière d’environnement, d’installations, d’aquaculture durable, de sécurité
alimentaire et d’alimentation.
Comme il le sera démontré dans ce dossier, la pisciculture de l’Élorn s’est, elle, engagée depuis
plusieurs années dans une démarche d’amélioration continue de ses équipements afin d’optimiser son
activité, face aux exigences environnementales. Cela s’est matérialisé par des investissements
conséquents, et se concrétise encore aujourd’hui, par des propositions innovantes, et l’adaptation en
« temps réel » de la technique piscicole en fonction des conditions environnementales.
Cette démarche a permis à la pisciculture de l’Élorn d’être retenue comme « site prioritaire » du « plan
de progrès pisciculture » dont la méthodologie a été validée par le cabinet ministériel en Janvier 2013,
en collaboration avec l’Institut Technique des filières avicoles, cunicoles et piscicoles (ITAVI). Ainsi,
certaines des propositions avancées dans ce dossier ont d’ores et déjà retenu l’attention pour une
généralisation à d’autres sites piscicoles.
Par ailleurs, une attention particulière est portée sur la qualité de l’aliment. La fabrication des aliments
pour poissons est d’ailleurs inscrite dans un cadre réglementaire européen et français très exigeant, qui
est l’un des plus sûrs au monde. L’alimentation des poissons d’élevage est strictement encadrée et fait
l’objet de nombreuses avancées. Ainsi, cette alimentation, qui incorpore des farines et des huiles de
poissons pour les espèces omnivores à dominante carnivore, permet de valoriser des espèces non
consommées par l’homme et dont les pêcheries sont gérées par quota dans le but de ne pas appauvrir
la ressource.
D’autre part, les poissons d’élevage sont d’excellents transformateurs de ces farines de poissons dont le
rendement est ainsi optimisé. Néanmoins et dans le souci d’assurer la durabilité de l’élevage des
poissons, plusieurs programmes de recherche sont en cours (INRA, IFREMER, Universités) pour remplacer
partiellement ces farines et ces huiles de poissons par des matières premières végétales tout en
maintenant les qualités nutritionnelles et organoleptiques des poissons d’aquaculture. Ces recherches
ont déjà permis d’obtenir des résultats exploitables, à la fois dans la substitution des farines et dans celle
des huiles de poissons. La société « Les Truites du Ster Goz » participe activement et conjointement avec
l’INRA via le programme VEGEAQUA, à restreindre l’utilisation des protéines d’origine marine, et réduire
ainsi l’empreinte écologique de l’activité sur les stocks naturels. Le but affiché est de substituer autant
que possible ces matières premières d’origine marine au profit des matières premières d’origine
végétale. La société « Les Truites du Ster-Goz » est l’un des acteurs majeurs dans la participation au
développement de ces recherches. C’est ainsi que nous constatons désormais un rapport de moins de
1 kg de truite produite pour 1 kg de poisson fourrage péché (exemple de résultat obtenu en prenant la
production de truite portion alimentée avec un aliment contenant au maximum 20% de matière
première d’origine marine, et en retenant un indice de transformation de 0.78). De plus, nous n’avons
pas atteint les limites de ce progrès, et nous envisageons de nombreuses pistes permettant
raisonnablement de penser que le futur est encore plus prometteur. À ce titre, des études sont menées
pour substituer encore davantage les matières premières actuelles d’origine marine par de nouvelles
sources : les protéines d’insectes ou encore d’origine planctonique. Les essais semblent concluants. De
nouvelles entreprises sont créées dans le monde pour se lancer dans ces nouvelles technologies de
productions pleines de promesses, d’espoir et d’avenir. L’Économie circulaire reflète son importance
9dans les processus d’élevage moderne de truite. Rien ne se perd. La transformation de truite engendre
un grand nombre de déchets de filetage ou d’éviscération qui sont intégralement retraités en nouvelle
source de protéine pour des aliments d’animaux familiers (« Pet food »).
C’est donc sans ambages que la pisciculture s’inscrit dorénavant dans une logique, certes perfectible,
d’efficience environnementale au profit de la nature et de sa biodiversité.
La présente demande s’intègre autant dans la volonté de régularisation administrative, que dans une
démarche d’amélioration de l’exploitation piscicole, au bénéfice réciproque de l’activité et de
l’environnement.
10RÉSUME NON TECHNIQUE
Le présent dossier constitue la demande d’autorisation présentée par la SAS « Les Truites du Ster
Goz » en vue de la régularisation et de l’extension de son autorisation d'exploiter pour son établissement
salmonicole : la pisciculture de l’Élorn. L’activité est spécialisée essentiellement dans l’élevage de la
truite arc-en-ciel (hors alevinage). La demande d’autorisation est présentée au titre de la
réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
1 – ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
Milieu physique
La pisciculture de l’Élorn est située au lieu-dit « Pont-Ar-Zall », à cheval sur les communes de Loc-Éguiner
et Lampaul-Guimiliau, dans le département du Finistère (29). Le site est directement accessible en
bordure de la route départementale D30 qui relie Landivisiau à Sizun.
La géologie du site se caractérise par un socle composé de schistes et micaschistes, recouverts
d’altérites d’origine sédimentaire. Le sol est brun, sain et profond. Ces caractéristiques sont communes
à l’ensemble de la vallée de l’Élorn et du Finistère en général qui peut néanmoins présenter un socle
dont la composante granitique est beaucoup plus présente.
Le site est situé à une altitude de 59m NGF, à proximité des Monts d’Arrée. Ce secteur est soumis à une
pluviométrie importante, mais sous l’influence océanique, le climat y est doux avec une très faible
amplitude de température.
Sur le plan hydrogéologique, les schistes briovériens de l’Élorn qui offrent une certaine capacité de
stockage de l’eau favorisent la prépondérance des écoulements par la nappe. En période de
pluviométrie importante où les écoulements de surface deviennent prépondérants, ils sont à l’origine
des augmentations de débits des cours d’eau et donc des crues.
11Au droit de la pisciculture, le bassin versant drainé représente une surface d’environ 116 km2. Le débit
moyen interannuel (module) retenu est de 2600 L/s et le débit réservé s’établit donc à 260 L/s. On
notera que le débit de l’Élorn est conditionné par la gestion des eaux du barrage du Drennec situé en
amont, à proximité de la source du cours d’eau. Le débit d’étiage est donc soutenu en été par
l’approvisionnement en eau du barrage, mais le débit est affecté le reste de l’année par les besoins de
reconstituer les réserves du barrage. Par ailleurs, le débit entrant et la qualité de l’eau sont conditionnés
par des installations situées en amont du site piscicole (captage de l’usine de Goasmoal pour la
production d’eau potable, 3 piscicultures dont une expérimentale), sans compter les activités
limitrophes de la rivière pouvant affecter le bassin versant amont (notamment les activités agricoles).
On notera que la pisciculture n’est intégrée dans aucun périmètre de protection vis-à-vis d’un captage
pour la production d’eau potable, et n’est concernée par aucun plan de prévention des risques
inondation (PPRI), ce qui n’exclut cependant pas certains évènements de crues importantes.
Au titre de l’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a
reconduit les objectifs d’atteinte du bon état écologique à l’échéance 2021. Les masses d’eau où se
situe le site sont jugées, en bon état écologique pour les eaux souterraines, et en état moyen pour les
eaux superficielles. Les mesures réalisées au niveau du site indiquent que la qualité des eaux de l’Élorn
est de très bonne qualité sur le plan physico-chimique tant en amont qu’en aval, avec une nuance sur
le plan biologique (mesures IBGN) qualifiant l’amont de bonne qualité et l’aval de très bonne qualité.
L’Élorn est ainsi classée par arrêté du 10 Juillet 2012 dans la liste 1 (rivières à préserver) de la
classification des cours d’eau.
Enfin, on notera que l’Élorn est une rivière dite de première catégorie (peuplement piscicole dominé
par les salmonidés).
Milieu naturel
La pisciculture de l’Élorn est située au sein de la zone Natura 2000 Rivière Élorn (n°FR5300024).
L’ensemble de la zone Natura 2000 comprend 28 habitats d’intérêt communautaire, 4 sont des habitats
prioritaires, et 13 espèces d’intérêt communautaire dont 6 ont un enjeu fort.
Le paysage est donc modelé par les habitats spécifiquement présents sur le site, à savoir :
- Les rivières
- Les hêtraies –chênaies
- Les boisements des bords de rivière, marécageux, ou tourbeux
- Les tourbières
- Les végétations des rochers
En-dehors des espèces citées dans la directive « Habitats, Faune, Flore », la rivière Élorn abrite des
espèces d’intérêt patrimonial, à l’échelle régionale ou nationale. Concernant le peuplement piscicole,
on retrouvera des espèces communes aux rivières de première catégorie : truite Fario, truite de mer,
saumon atlantique, alose, anguille.
De par sa situation enclavée en fond de vallée et la densité des boisements qui l’entourent, la
pisciculture de l’Élorn est parfaitement intégrée au paysage et ne fait l’objet d’aucun vis-à-vis extérieur.
12Milieu humain
L’ensemble du site de la pisciculture est situé à cheval sur les territoires respectifs des communes de
Lampaul-Guimiliau à l’est, et Loc-Éguiner à l’ouest.
La commune de Lampaul-Guimiliau s’étend sur une superficie de 1748 hectares, pour une population
de 2067 habitants (données 2013) soit une densité de population de 117 habitants/km2. La population
reste relativement jeune mais le solde migratoire est redevenu négatif ces dernières années. L’activité
économique de Lampaul-Guimiliau est essentiellement liée aux activités de commerce, transports et
services. L’activité touristique est peu développée. Concernant l’occupation du sol, la surface agricole
utilisée par les exploitations représente environ 48% du territoire communal mais l’effectif des
exploitations agricoles a largement diminué au cours des 25 dernières années. Le secteur économique
est extrêmement impacté par les difficultés rencontrées par les entreprises agro-alimentaires (plusieurs
centaines d’emplois ont été détruits suite à la fermeture d’usines agro-alimentaires).
Lampaul-Guimiliau est longée à l’ouest par la rivière Élorn, limite naturelle mais aussi administrative avec
la commune de Loc-Éguiner.
La population de Loc-Éguiner compte 361 habitants en 2013 pour une densité de 30 habitants/km2
(superficie totale de 11,9 km2). L’activité économique de la commune est essentiellement agricole. La
surface agricole représente environ 70% du territoire communal pour 16 exploitations (nombre
également en net déclin).
Sur le plan urbanistique, la commune de Lampaul-Guimiliau dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU)
alors que la commune de Loc-Éguiner dispose d’une carte communale. Les deux communes
dépendent, sur le plan de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, du Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) du Léon.
Concernant les infrastructures routières, le secteur est dominé par le réseau secondaire (routes
départementales RD30 et RD69).
Le service de distribution de l’eau potable à Lampaul-Guimiliau est assuré par la commune elle-même
selon un mode de gestion d’affermage alors que celui de Loc-Éguiner est géré par le Syndicat du
Plateau de Ploudiry.
L'assainissement de l'eau à Lampaul-Guimiliau est assuré de manière collective (station d’épuration du
Blaise) et de manière individuelle dans les secteurs non-desservis alors que l’assainissement est
uniquement individuel sur le territoire de Loc-Éguiner.
Concernant le patrimoine bâti, et selon le Service Régional de l'Archéologie et la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Bretagne, il n’existe aucun site archéologique actuellement connu sur l’aire
d’étude. Le site, relativement isolé n’est par ailleurs pas compris dans un périmètre de protection au
titre des bâtiments de France. On trouve néanmoins sur les 2 communes des édifices religieux de
qualité, églises, séminaire, enclos paroissiaux, chapelles… dont certains éléments sont classés aux
Monuments Historiques. La région possédait par ailleurs de nombreux moulins et on en retrouve encore
en parfait état de conservation ou restaurés.
13Concernant le paramètre « Bruit », il n’y a pas de mesures réalisées in situ mais l’inexistence
d’habitations tierces situées à moins de 100m de la pisciculture réduit sinon annule toute nuisance
sonore. Par ailleurs, le secteur d’étude n’est intégré dans aucun plan de prévention du bruit dans
l'environnement (PPBE). Concernant la qualité de l’air, il n’est pas fait état d’affectation de la qualité
de l’air sur le site d’étude.
Enfin, aucun risque naturel (inondation, foudre, sismicité) ou industriel n’est recensé sur le site en-dehors
d’une origine accidentelle.
2 – DESCRIPTION DE L’ACTIVITE
C’est en 1957 qu’une première pisciculture fut construite sur ce site, au lieu-dit Pont-Ar-Zall. Elle a été
une des premières piscicultures créées en Bretagne, exploitée en ce temps par la société de
pisciculture de l’Élorn. En Avril 1973 Monsieur René Picart et son épouse en ont fait l’acquisition afin de la
reconstruire entièrement. Le dernier arrêté valide de la pisciculture de l’Élorn a été obtenu en 1991 pour
une production annuelle de 250 tonnes (Arrêté N° 91/2133 du 21 novembre 1991). Monsieur Ronan
Picart succédera à son père en 1993, et Le 10 Octobre 1994, la SAS « Les Truites du Ster-Goz », dont je
suis le directeur, en a repris l’exploitation. Un récépissé de changement d'exploitant date du 18
septembre 1997. L’immobilier de la pisciculture est détenu par une société holding qui la loue à la SAS
« Les Truites du Ster-Goz ». La société productrice a été créée en 2014 et exploite actuellement trois
piscicultures. Deux sont situées dans le Sud du Finistère, une sur la commune de Scaër, une autre sur la
commune de Bannalec. La pisciculture de l’Élorn qui fait l’objet de la demande se situe dans le Nord-
Finistère, à cheval sur les communes de Lampaul-Guimiliau et de Loc-Éguiner, au lieu-dit de Pont-Ar-Zall.
Le développement s’est poursuivi en 1996. Ainsi, accompagné de deux associés, la Société « Les truites
du Ster-Goz » a créé une entreprise de transformation dont le nom commercial est « Bretagne Truite » et
située à Quimper jusqu’en 2004. Aujourd’hui, basée à Plouigneau (29610), Bretagne Truite est le premier
opérateur de truite fraîche en France. Elle constitue l’outil industriel de la Coopérative « Les
Aquaculteurs Bretons », reconnue comme la première Organisation de Producteur en France et qui
regroupe 28 sites piscicoles dans les départements du Finistère, des Côtes d’Armor et de Seine Maritime.
Le groupement peut compter également sur 2 ateliers de transformation dont l’un est situé en Bretagne
et l’autre en Normandie. Cette coopérative centralise 70% de la production bretonne.
L’activité concerne un élevage de salmonidés, essentiellement des grosses truites Arc-en-ciel
supérieures à 2 kg de l’espèce Oncorhynchus mykiss. Le tonnage annuel de production envisagé est
de 400 tonnes de truites par an.
L’exploitation n’assure pas la fonction d’écloserie et ne conserve donc pas de reproducteurs. Les
poissons arrivent sur le site au stade de truitelle et la pisciculture de l'Élorn en assure le grossissement.
D’autre part, il n’y a aucune transformation sur le site. Le travail consiste à élever le poisson en prenant
toutes les précautions qui s’imposent. Les opérations sont variées et exigent une attention particulière
pour les tâches du nourrissage qu’il faut savoir ajuster en fonction des conditions du moment. À
certaines périodes, le pisciculteur devra prendre en considération une baisse d’oxygène ou une
brusque remontée de pH. Cela le conduira à devoir disposer des aérateurs de surfaces dans les bassins
pour redresser les taux d’oxygène et aussi pour calmer le poisson qui pourrait s’agiter. Il devra à tout
14Vous pouvez aussi lire