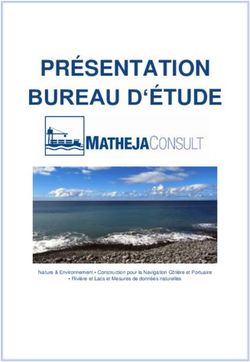DES ACTEURS DE L'EAU PANORAMA - Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
2
PROPOS INTRODUCTIFS
Les lois successives concernant l’eau, la biodiversité, les collectivités induisent des
changements fréquents dans la gouvernance de l’eau. La gouvernance peut être définie
comme un processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux, d’institutions
pour réaliser des buts débattus et définis collectivement. Dans le cas de la thématique
de l’eau et de la gestion de la ressource, la gouvernance est également associée à celle
du développement durable partant du constat que pour atteindre ce développement,
il faut s’assurer une gouvernance efficace.
Récemment, les lois MAPTAM (modernisation de l’action publique territoriale et d’affir-
mation des métropoles) du 27 janvier 2014 et NOTRe (Nouvelle organisation territoriale
de la République) du 07 août 2015 ont à nouveau redistribué les compétences des
collectivités territoriales notamment en matière d’eau. C’est ainsi qu’est née la GEMAPI
(gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations), compétence confiée
aux intercommunalités au 1er janvier 2018, dont les actions visées sont l’aménagement
des bassins versants, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et
plans d’eau, la défense contre les inondations et contre la mer, la protection et la
restauration des zones humides.
Dans le même temps, les Agences de l’Eau ont travaillé à l’écriture de leur 11ième programme
d’actions pour la période 2019-2024 et proposé la SOCLE (stratégie d’organisation des
compétences locales de l’eau) inscrite dans l’arrêté du 20 janvier 2016, modifiant l’ar-
rêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et
de gestion des eaux. Elle favorise la cohérence hydrographique, le renforcement des
SOMMAIRE
solidarités financières et territoriales et la gestion durable des équipements structurants
du territoire, et s’inscrit dans la perspective de la mise en place de la GEMAPI.
La biodiversité n’est pas en reste avec la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la DES ACTEURS À DIFFÉRENTES
nature et des paysages du 08 août 2016 qui créée l’Agence Française pour la Biodiversité ÉCHELLES DU TERRITOIRE… 3 ����������������
le 1er janvier 2017 en regroupant l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux aqua-
… échelle administrative ����������������������������������������������������� 3
tiques), l’Établissement public des parcs nationaux, l’Agence des aires marines protégées
… échelle de bassin versant ������������������������������������������ 4
et le groupement d’intérêt public ATEN. Au 1er janvier 2020 est prévue la création de l’OFB
Et le citoyen dans tout ça ? ��������������������������������������������� 5
(Office français de la biodiversité), regroupement de l’AFB et de l’ONCFS (Office national
de la chasse et de la faune sauvage). Les directions régionales de l’AFB conservent les
missions de police, de contrôle et d’appui technique aux services de l’Etat.
DES OUTILS DE PLANIFICATION
ET DE PROGRAMMATION 6 �����������������������������
À cette organisation peuvent s’ajouter la création d’ARB (agences régionales pour la
biodiversité) dont la mise en place est initiée par les Régions et dont la création est ÉCLAIRAGE RÉGIONAL
encouragée par la loi pour la reconquête de la biodiversité. Ce sont des démarches NOUVELLE-AQUITAINE ��������������������������������������� 8
collectives qui ont un rôle à jouer dans les SRB (stratégies régionales de la biodiversité).
Une stratégie régionale de l’eau ���������������������������� 8
L’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine a réalisé ce document dans Des actions départementales ����������������������������������� 8
le cadre du volet eau de son programme d’actions 2018, financé par la Région Nou- Une logique de bassin �������������������������������������������������������������� 8
velle-Aquitaine, avec le soutien des Agences de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne, La mise en oeuvre de la GEMAPI ������������������������� 10
des Départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, et de l’Union européenne (fonds Des spécificités de territoire ������������������������������������� 10
FEDER). Des organismes
La Nouvelle-Aquitaine fourmille d’acteurs travaillant de près ou de loin sur la théma- sociaux-professionnels ������������������������������������������������������ 14
tique de l’eau. Après une présentation générale des acteurs impliqués aux différentes La recherche ������������������������������������������������������������������������������������������� 15
échelles de territoire et un point sur les outils de planification et de programmation, ce
document dresse un panorama des acteurs de l’eau présents en région pour mieux
comprendre le qui fait quoi, sur quelle thématique et dans quel territoire, et les actions
menées. Il n’a pas un caractère exhaustif et fait état des informations connues par l’ARB
NA. L’organisation locale des territoires n’étant pas totalement finalisée ou figée, l’idée
est d’avoir un document actualisable.3
DES ACTEURS
À DIFFÉRENTES ÉCHELLES
DU TERRITOIRE
… échelle administrative
EUROPE tions des sciences de la Terre pour gérer
les ressources et les risques du sol et du
L’union européenne a deux grandes mis- sous-sol. INSTANCE DE
sions dans le domaine de l’eau : Institut national de recherche CONCERTATION
fixer un cadre général pour la gestion en sciences et technologies pour
et la protection de l’eau dans chaque l’environnement et l’agriculture
Etat, par l’intermédiaire de textes régle- (IRSTEA) - conduit une recherche envi- LE COMITÉ NATIONAL DE L’EAU
mentaires proposés par la Commission ronnementale concentrée sur l’eau, les Organisme placé auprès du
européenne, puis co-adoptés par le écotechnologies et l’aménagement des ministre chargé de l’environ-
Conseil de l’Union européenne et le Par- territoires. nement, il constitue l’instance
lement Européen ; Institut français de recherche pour nationale de consultation sur
donner l’obligation d’atteindre le bon l’exploitation de la mer (Ifremer) - la politique de l’eau. Il émet un
état des eaux et des milieux aquatiques contribue à la connaissance des océans avis sur :
(Directive Cadre sur l’Eau). et de leurs ressources, à la surveillance du les circonscriptions géogra-
milieu marin et du littoral et au dévelop- phiques des bassins,
FRANCE pement durable des activités maritimes. les projets d’aménagement
et de répartition au niveau
À l’échelle nationale, l’Etat français fixe RÉGION national,
les objectifs et met en oeuvre la poli- les projets de décrets
tique publique de l’eau dont il assure la Sous l’autorité du Préfet de Région qui (protection des peuplements
coordination administrative. Le ministère anime et coordonne la politique de l’Etat, piscicoles),
de la Transition écologique et solidaire les services déconcentrés interviennent les projets de SDAGE, la stra-
coordonne l’action des autres ministères à l’échelle régionale pour décliner loca- tégie nationale du risque
(santé, agriculture, industrie …) dans lement les actions à mettre en oeuvre : inondations, les orientations
ce domaine. Il s’appuie sur différents Direction régionale de l’environ- stratégiques de l’AFB …
établissements publics spécialisés et nement, de l’aménagement et du le prix de l’eau facturé aux
organismes de recherche : logement (DREAL) - assure la mise en usagers,
Agence française pour la biodiversité oeuvre, l’animation et la coordination la qualité des services
(AFB) - collecte des données et produit de la politique de l’eau ; contrôle les ins- publics de distribution d’eau
des connaissances sur l’état des milieux tallations classées pour la protection de et d’assainissement.
aquatiques, des eaux souterraines et l’environnement.
Il regroupe entre autres des
des eaux marines ; mène des actions de Direction Régionale de l’Alimenta- représentants :
restauration des milieux ; assure la coor- tion, de l’Agriculture et de la Forêt des collectivités
dination technique nationale du système (DRAAF) - met en oeuvre des actions territoriales :
d’information sur l’eau (SIE)… en faveur de la préservation des milieux Régions, Départements,
Voies Navigables de France (VNF) - aquatiques : directive nitrates, conditions Communes,
gère, exploite et développe les voies de production des végétaux, utilisation de l’Etat et de ses établisse-
navigables (canaux, fleuves, écluses, …). des pesticides.
ments publics,
Conservatoire du Littoral - acquiert Agence régionale de santé (ARS) - des usagers,
des parcelles du littoral menacées par organise le contrôle sanitaire des eaux des personnalités qualifiées.
l’urbanisation ou dégradées pour en faire destinées à la consommation humaine.
des sites restaurés, aménagés, accueil- L’implication des Régions est plus récente
lants dans le respect des équilibres mais s’intensifie avec la nécessité d’in- ont été modifiées avec la loi NOTRe qui
naturels. tégrer la politique de l’eau dans les confère notamment aux Régions un rôle
Bureau de Recherches Géologiques politiques publiques transversales. De important dans le pilotage de la politique
et Minières (BRGM) - établissement plus, les compétences environnemen- de la biodiversité avec l’élaboration des
public de référence dans les applica- tales des différents échelons territoriaux schémas régionaux d’aménagement,4
DES ACTEURS À DIFFÉRENTES ÉCHELLES DU TERRITOIRE
de développement durable et d’égalité le domaine de l’eau, des milieux aqua- En outre, la loi du 27 janvier 2014 de
des territoires (SRADDET) qui intègrent tiques, de la biodiversité et de la sécurité modernisation de l’action publique ter-
des enjeux de continuités écologiques. Il publique vis à vis des risques. ritoriale et d’affirmation des métropoles
doit également être compatible avec les La loi NOTRe, qui applique le principe (MAPTAM) rend obligatoire la compé-
SDAGE, les plans de gestion des risques de spécialisation des départements et tence Gestion des Milieux Aquatiques et
inondations, et prendre en compte une des régions, fixe les compétences obli- Prévention des Inondations (GEMAPI)
gestion équilibrée de la ressource en eau. gatoires des Départements telles que pour les communes, avec transfert aux
E.P.C.I. à fiscalité propre lorsqu’ils existent.
l’action sociale, culturelle et sportive,
DÉPARTEMENT Cette compétence peut également être
l’éducation, l’aménagement. Certains
déléguée à un syndicat mixte regroupant
interviennent dans le domaine de l’en-
Sous l’autorité du Préfet de Dépar- plusieurs E.P.C.I. Il peut être labellisé EPAGE
vironnement (eau, déchets, protection
tement, les MISEN/DISEN (Mission ou (Etablissement Public d’Aménagement et
des espaces naturels…). de Gestion des Eaux) ou EPTB (Etablisse-
Délégation InterServices de l’Eau et de
la Nature) animent et coordonnent la ment Public Territorial de Bassin). Cette
politique de l’eau et de la nature de l’Etat
COMMUNES & réforme répond aux impératifs des textes
entre les différents services départemen- GROUPEMENT DE européens : Directive Cadre sur l’Eau et
COMMUNES directive Inondations, visant à atteindre
taux sous ses aspects réglementaires
une gestion équilibrée de la ressource
et techniques. Elles sont également en
Historiquement, différentes compé- en eau.
charge du plan d’action opérationnel ter-
tences étaient attribuées aux communes Enfin, la loi Ferrand du 3 août 2018 confie
ritorialisé (PAOT), outil de suivi de la mise
la compétence de la gestion des eaux
en oeuvre du programme de mesures notamment le service public de l’eau
pluviales urbaines aux communautés
du SDAGE. potable et l’assainissement des eaux
urbaines et aux communautés d’agglo-
L’organisation des services de l’Etat à usées urbaines.
mération (obligatoire à partir de 2020).
l’échelon départemental repose sur des La loi NOTRE a créé l’obligation pour les
Elle est facultative pour les communautés
directions départementales interminis- communes de confier à des intercom- de communes.
térielles parmi lesquelles la Direction munalités (E.P.C.I.*) à fiscalité propre
Départementale des Territoires (ou Direc- la gestion de l’eau potable et de l’as-
tion des Territoires et de la mer (DDTM) sainissement au plus tard en 2020 (des
si le département possède une façade
maritime). De nombreuses missions sont
dérogations sont cependant possibles
sous certaines conditions, permettant le … échelle de
portées par la DDT dont certaines dans report jusqu’à 2026).
bassin versant
AGENCE DE L’EAU
Etablissements publics du ministère
chargé du développement durable, les
6 agences de l’eau, instituées par la loi sur
l’eau de 1964, ont pour missions de contri-
buer à réduire les pollutions de toutes
origines et à protéger les ressources en
eau et les milieux aquatiques.
Elles mettent en oeuvre les objectifs et
les dispositions des schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) et leur déclinaison locale (SAGE),
en favorisant une gestion équilibrée et
économe de la ressource en eau et des
milieux aquatiques, l’alimentation en
eau potable, la régulation des crues et
Bassin d’Arcachon (33)
le développement durable des activités
économiques.
* un E.P.C.I. (établissement public de coopération intercommunale) peut être à fiscalité propre (une métropole, une communauté urbaine,
d’agglomération ou de communes) ou sans fiscalité propre (un syndicat intercommunal).5
DES ACTEURS À DIFFÉRENTES ÉCHELLES DU TERRITOIRE
INSTANCE DE
CONCERTATION Produit des données sur l’eau SYNDICAT
et assure leur diffusion ;
Met en oeuvre la gestion intégrée Syndicat de rivière ? Syndicat de
LE COMITÉ DE BASSIN de la ressource. bassin versant ? Syndicat d’aménage-
Sous l’autorité du préfet coor- ment de cours d’eau ? Peu importe la
donnateur de bassin, cette dénomination, l’objectif de ces syndicats
assemblée regroupe différents est le même : travailler collectivement à
acteurs publics ou privés (collec- la gestion d’un cours d’eau en pensant et
tivités territoriales, Etat, usagers en agissant sur l’ensemble de son bassin
et personnes compétentes, versant. Dirigé par un conseil syndical
milieux socioprofessionnels) composé d’élus, il planifie et met en
qui agissent dans le domaine de oeuvre la gestion des cours d’eau afin
l’eau. Il débat et définit de façon d’améliorer la qualité des milieux aqua-
concertée les grands axes de la tiques, de préserver les ressources en
eau, et de réduire le risque d’inondations,
politique de gestion de la res-
tout cela dans un esprit de service public
source en eau et de protection
et pour l’intérêt général.
des milieux naturels aquatiques.
Il élabore le SDAGE, émet un avis
sur les grands aménagements et
oriente les politiques d’interven-
tions de l’agence de l’eau.
Et le citoyen
LA COMMISSION
dans tout ça ?
TERRITORIALE OU Le citoyen est au coeur de la gestion
GÉOGRAPHIQUE de l’eau. Son droit à l’information dans le
Instance d’échanges et de domaine de l’environnement en général
débats, elle organise la concer- est reconnu dans différents textes de loi
tation plus près du terrain entre (Convention d’Aarhus, Charte de l’envi-
comité de bassin et acteurs de Marais Poitevin (79)
ronnement, …). Une véritable implication
l’eau. Elle regroupe le Préfet des citoyens dans les processus décision-
coordonnateur de bassin, des nels en matière de gestion de la ressource
membres du Comité de bassin, en eau doit être mise en place sur les ter-
ÉTABLISSEMENT ritoires. Cette participation du public peut
des personnalités qualifiées, et PUBLIC TERRITORIAL se décliner selon différentes modalités.
les présidents des CLE et ETPB.
DE BASSIN
LA COMMISSION LOCALE Reconnus officiellement en 2003 comme
DE L’EAU (CLE) acteurs de la politique de l’eau à l’échelle
En charge d’élaborer, réviser et des bassins et sous-bassins, les EPTB
mettre en oeuvre les SAGE, elle visent à faciliter la prévention des inon-
regroupe 3 collèges : collectivi- dations et la gestion équilibrée de la
tés territoriales, Etat, et usagers. ressource en eau ainsi que la préserva-
tion et la gestion des zones humides et
de contribuer à l’élaboration et au suivi
des SAGE. Ils n’ont pas vocation à mener
toutes les actions dans le domaine de
Pour cela, une agence de l’eau : l’eau, mais traduisent une volonté des
Calcule, établit, perçoit les collectivités d’agir à l’échelle du bassin
redevances (principe pollueur payeur) ; et de mutualiser des moyens pour mener
Suscite et soutient financièrement les actions nécessaires à cet objectif.
et techniquement les travaux Selon les enjeux et les problématiques
d’amélioration des milieux aquatiques prioritaires du bassin, de l’organisation
et de réduction des pollutions ; des collectivités et des acteurs, l’EPTB
Assiste les comités de bassin mène des actions très différentes d’un L’Anglin à Angles sur l’Anglin (86)
dans l’élaboration des SDAGE ; territoire à l’autre.6
DES OUTILS DE PLANIFICATION
ET DE PROGRAMMATION
SDAGE SAGE QUELQUES OUTILS
COMPLÉMENTAIRES
En France métropolitaine, depuis la loi sur Instrument essentiel pour la mise en
l’eau de 1992, les orientations pour la ges- oeuvre de la Directive Cadre sur l’Eau,
Le plan de gestion du risque inonda-
tion de l’eau sont dictées, à l’échelle des les Schémas d’Aménagement et de Ges-
tion (PGRI) permet de planifier la prise en
6 grands bassins français, par un SDAGE, tion des Eaux (SAGE) déclinent à l’échelle compte et la gestion du risque inondation
mis en place par le comité de bassin et des sous-bassins, les priorités du SDAGE. sur le même territoire que le SDAGE et
accordé par un arrêté du préfet coordon- Le SAGE est un outil de planification et selon un même cycle de révisions. Il est
nateur de bassin. Il s’agit d’un document d’orientation qui fixe des objectifs géné- la déclinaison de la stratégie nationale
d’orientation à portée juridique qui raux d’utilisation, de mise en valeur, de au niveau local sur chaque Territoires à
protection quantitative et Risques importants d’Inondation (TRI)
qualitative de la ressource par une stratégie de gestion des risques
en eau. Il doit être com- d’inondation, laquelle se traduit de
patible avec les SDAGE et manière opérationnelle dans des plans
s’impose aux administra- d’action tels que les PAPI (programmes
tions et aux tiers. d’actions de prévention des inondations),
La Nouvelle-Aquitaine et des projets PSR (plan submersions
est couverte à 78,6% par rapides), et au niveau règlementaire dans
28 SAGE (en totalité ou les PPR (plans de prévention des risques).
pour partie).
Le plan d’action pour le milieu marin
(PAMM) vise le bon état écologique des
PLANS, eaux marines et est élaboré à l’échelle
CONTRATS, de la sous-région marine, située en aval
PROGRAMMES d’un ou plusieurs bassins. Le plan d’ac-
tion doit intégrer plusieurs éléments : une
De nombreux outils per- évaluation initiale de l’état de la sous-ré-
mettent de planifier et gion marine, une définition du bon état
de mener à bien locale- écologique de la sous-région, la fixation
ment des actions visant d’objectifs environnementaux, un pro-
à répondre aux objectifs gramme de surveillance, un programme
Source : Les agences de l’eau, 2013
des outils de planification de mesures. Il doit être élaboré sur la base
que sont les SAGE et les d’une large concertation avec les acteurs
SDAGE. Ils fixent des objec- maritimes et littoraux.
s’impose aux décisions de l’Etat, des tifs de qualité des eaux, de valorisation du Le plan national santé environnement
collectivités, établissements publics ou milieu aquatique et de gestion équilibrée (PNSE) vise à répondre aux interroga-
autres usagers. Les grandes orientations des ressources en eau. En voici quelques tions des Français sur les conséquences
sont définies pour la durée du SDAGE exemples qui concernent en particulier sanitaires à court et moyen terme de
(6 ans), et ce de manière concertée avec les bassins Loire-Bretagne et Adour- l’exposition à certaines pollutions de
les acteurs de l’eau, dans le respect des Garonne : leur environnement. L’objectif étant de
principes de la D.C.E. et de la loi sur l’eau. Contrat territorial ; réduire autant que possible et de façon
Les derniers SDAGE adoptés en France Contrat territorial de gestion quanti- la plus efficace les impacts des facteurs
couvrent les années 2016 à 2021. A noter tative ; environnementaux sur la santé afin de
que les documents d’urbanismes tels que Contrat territorial milieux aquatiques ; permettre à chacun de vivre dans un
les Schémas de Cohérence Territoriale Plan Pluriannuel de Gestion ; environnement favorable à la santé. Il est
(SCOT), Plans Locaux d’Urbanisme (PLU Plan de Gestion des Etiages ; décliné au niveau régional en PRSE (Plan
ou PLUi) … doivent intégrer les enjeux Contrat de bassin ; Régional Santé Environnement).
environnementaux, dont la prise en Contrat de restauration et Le décret du 16 février 1994, dit « décret
compte de la gestion l’eau, en cohérence d’entretien ; amphihalin », a décentralisé la gestion
avec les documents du SDAGE. Contrat de rivière. des poissons migrateurs au niveau de
La Nouvelle-Aquitaine est concer- Certains de ces outils évoluent dans le chaque bassin fluvial, et les premières
née par 2 SDAGE : Loire-Bretagne et cadre des 11ième programmes des Agences associations « migrateurs » se sont déve-
Adour-Garonne. de l’Eau (2019 - 2024). loppées. Sous ce décret ont été mis en7
DES OUTILS DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION
place les PLAGEPOMI (Plans de gestion ÉTAT D’AVANCEMENT DES SAGE EN NOUVELLE-AQUITAINE
des poissons migrateurs), confiés aux
COGEPOMI (Comité de gestion des pois-
AU 20/03/2019
sons migrateurs).
Réalisation cartographique : Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine, mars 2019
Sources : © MTES/OIEau/AFB (GEST’EAU), 20/03/2019.8
ÉCLAIRAGE RÉGIONAL
NOUVELLE-AQUITAINE
Une stratégie national (SISPEA), afin de répondre à un
maximum d‘échelons.
2 L’Établissement Public Loire (créé en
1986 et reconnu EPTB en 2006) contribue à
régionale GIRONDE : la mission expérimen- la cohérence des actions menées sur l’en-
tale Aménag’eau du Département vise semble du bassin de la Loire (117 800 km²).
Ses actions principales : gestion des
de l’eau à développer des interactions entre
les univers de l’eau et de l’urbanisme.
Projet transversal porté par une équipe
ressources en eau des ouvrages de Naus-
sac et Villerest, prévention et réduction
La Région Nouvelle Aquitaine porte aux compétences multi-thématiques, du risque inondation, aménagement
une stratégie régionale de l’eau qui vise il apporte depuis 2013 une assistance et gestion des eaux, stimulation de la
la protection, la restauration, la mise technique en interne aux directions du recherche, du développement et de
en valeur de la ressource en eau et des Département qui s’occupent de l’aména- l’innovation, valorisation du patrimoine.
milieux associés ainsi qu’à la promotion gement du territoire (routes, collèges...), 3 L’EPTB de la Sèvre Nantaise (créé en
d’un usage maîtrisé, optimisé et équilibre et en externe auprès des collectivités, 1985 et reconnu EPTB en 2013) fédère les
dans le respect des écosystèmes. L’élabo- animateurs SAGE, animateurs SCoT... acteurs du bassin (2 350 km²), intervient
ration de la Stratégie Régionale de l’Eau VIENNE : le Département et l’Etat sur les cours d’eau, améliore la qualité
repose sur une démarche préalable de co-pilotent un Schéma Départemental de la rivière, lutte contre les pollutions,
concertation lancée auprès d’un large de l’Eau en concertation avec l’ensemble entretient et restaure les milieux aqua-
spectre d’acteurs de l’eau (chercheurs, des acteurs du territoire et usagers de tiques, prévient les inondations, valorise
collectivités, socioprofessionnels, ges- l’eau (2018-2027). Cette démarche parte- le patrimoine, porte le SAGE …
tionnaires d’espaces, agences de l’eau…). nariale traite l’ensemble du cycle de l’eau, 4 L’EPTB de la Charente (créé en 1977
en identifiant 5 thématiques prioritaires : et reconnu EPTB en 2007) promeut la
l’eau potable, les milieux aquatiques, l’as- gestion de l’eau à l’échelle du bassin de
sainissement, les usages et les politiques la Charente (10 550 km²) en réalisant les
Des actions publiques de l’eau. études et les travaux permettant l’amélio-
ration du régime hydraulique tant en crue
départemen- qu’en étiage, le maintien ou la reconquête
de la qualité des eaux et des milieux
tales Une logique aquatique, la valorisation touristique du
fleuve et de ses affluents.
Les 12 Départements de Nouvelle-Aqui- de bassin 5 L’EPTB de la Dordogne – EPIDOR
(créé en 1991 et reconnu EPTB en 2006)
taine réalisent des actions en faveur de
Le territoire de Nouvelle-Aquitaine est a pour objectif principal de formuler des
la préservation des ressources en eau.
presque intégralement couvert par des stratégies appropriées aux problèmes
Les thématiques portées et l’avancée des
structures de bassin de taille importante du bassin versant de la Dordogne
actions peuvent cependant varier d’un
comme les Etablissements Publics Ter- (24 000 km²). Ses grandes missions
territoire à l’autre dont voici quelques
ritoriaux de Bassin ou les institutions recouvrent la stratégie et l’administration
exemples :
interdépartementales. Petit tour d’hori- générale, la qualité des eaux, la quantité
CREUSE : la gestion des milieux aqua- zon de ces structures essentielles pour d’eau et dynamique fluviale, les poissons
tiques est un axe important dans les la gestion de l’eau dont certaines ont été migrateurs et milieux naturels, la gestion
actions du Département traduit notam- créées il y a près de 40 ans. écologique des cours d’eau, l’observa-
ment par la mise en place d’un Schéma toire de bassin et la gestion intégrée.
1 L’EPTB de la Vienne (créé en 2007 et
départemental de gestion des milieux 6 Le Syndicat Mixte pour le Déve-
reconnu EPTB en 2008) oeuvre en faveur
aquatiques (2017-2021) , d’un SIG dédié à loppement Durable de l’Estuaire de la
d’une gestion équilibrée de la ressource
la thématique et d’un recueil des réalisa- en eau du bassin de la Vienne (21 160 km²). Gironde (créé en 2001 et reconnu ETPB
tions de gestion des milieux aquatiques. Ses actions principales : mise en oeuvre en 2007) réalise ses missions sur le péri-
DEUX-SÈVRES : le Département a et l’animation du SAGE Vienne, accom- mètre du SAGE de l’Estuaire de la gironde
engagé fin 2015 la mise en place d’un pagnement des structures porteuses (3 600 km²) : gestion de l’eau et des milieux
Observatoire de l’Assainissement collec- de contrats territoriaux, mise en place aquatiques, promotion et développe-
tif qui vise à répondre à des besoins en d’actions thématiques (étangs, plantes ment de l’estuaire, et préservation des
interne, mais aussi à ceux des collectivités exotiques envahissantes, zones humides, zones humides. C’est aussi la structure
locales. Il s’articule avec les démarches en inondations, communication …), gestion porteuse du SAGE et du PAPI d’intention
cours aux niveaux départemental, régional, d’un l’Observatoire de l’eau. de l’Estuaire.9
ÉCLAIRAGE RÉGIONALNOUVELLE-AQUITAINE
D’autres structures, non reconnues
comme EPTB, mais néanmoins aussi
importantes de par leurs actions et la
taille du territoire qu’elles couvrent, sont
présentes :
• L’Institution Interdépartementale
du bassin de la Sèvre Niortaise -
IIBSN ;
• Le Syndicat Mixte d’Etudes et
d’Aménagement de la Garonne -
SMEAG ;
• Le Syndicat Mixte de la vallée de
Thouet - SMVT ;
• L’Etablissement Public du Marais
poitevin - EPMP ;
• Le Syndicat Mixte d’Accompagne-
ment du SAGE Seudre - SMASS ;
• Le Syndicat mixte du bassin versant
des lacs du Born.
À une échelle inférieure, de nombreux
syndicats de rivières existent en Nou-
velle-Aquitaine et représentent une
échelle d’action de bassin propre à traiter
à la bonne échelle les enjeux relatifs aux
cours d’eau, aux milieux aquatiques et
humides, et aux phénomènes concer-
nant le ruissellement des eaux de surface.
La mise
en œuvre
de la GEMAPI
Le changement de gouvernance dans
7 Le syndicat mixte du bassin du Lot la ressource en eau, la lutte contre les l’exercice des compétences des col-
(anciennement Entente interdéparte- inondations, la qualité des eaux super- lectivités territoriales a été introduit afin
mentale de 1980 à 2017 et reconnu EPTB ficielles, la protection et la gestion des de structurer la maîtrise d’ouvrage sur
en 2011), exerce différentes missions dans le territoire en matière de gestion des
milieux aquatiques et plus généralement
milieux aquatiques et de prévention des
les domaines de la gestion quantitative à la mise en place d’une gestion intégrée
inondations.
et qualitative de l’eau, de la préservation de l’eau. Elle porte l’observatoire de l’eau
Au 1er janvier 2018, la région Nouvelle-Aqui-
des inondations et de la promotion tou- de l’Adour. taine compte 153 établissements publics
ristique sur l’ensemble du bassin du Lot 9 Le Syndicat mixte d’étude et de de coopération intercommunale
(11 500 km²). Sa spécificité est l’aména- gestion de la ressource en eau du (E.P.C.I.) à fiscalité propre.
gement et le développement de la vallée département de la Gironde - SMEGREG
du Lot, en matière d’hydraulique et dans L’avancement de la mise en place de la
(créé en 1998 et reconnu EPTB en 2015) GEMAPI est très hétérogène en région
les domaines économique, touristique et a pour objet de contribuer à la gestion avec plusieurs cas relevés :
environnemental. équilibrée et durable de la ressource en la prise de compétence sur le territoire
8 L’Institution Adour (créé en 1978 eau, afin de préserver et de valoriser les par la collectivité en levant ou non la taxe
et reconnu EPTB en 2007) est chef de nappes profondes de Gironde. Il assure dès 2018 ou reportée en 2019 ;
file et maître d’ouvrage sur le bassin de une mission d’expertise et d’information, la délégation de la compétence à un ou
l’Adour (16 800 km²) travaillant ainsi sur et anime les travaux liés à la mise en plusieurs syndicats existants (exemples :
différentes problématiques telles que oeuvre, au suivi et à la révision du SAGE. Vals de Saintonge, Bocage Bressuirais…) ;10
ÉCLAIRAGE RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE
la création de nouveaux syndicats
qui auront en charge la compétence
(exemples : syndicat mixte Charente aval,
syndicat mixte GEMAPI du bassin versant
de la Sèvre Niortaise…).
À noter que différentes études de pré-
figuration ont été réalisées sur certains
territoires pour déterminer la solution
la plus adaptée (exemples : bassin du
Thouet, communauté d’agglomération
de la Rochelle…).
Des
spécificités AcclimaTerra - Comité Scientifique Charente 2050, Garonne 2050,
de territoire Régional sur le Changement Clima-
tique : AcclimaTerra réunit 21 scientifiques
Dordogne 2050 : ce sont 3 démarches
prospectives engagées sur le territoire
provenant des milieux académiques de Adour-Garonne visant à évaluer les
LE PROGRAMME Nouvelle-Aquitaine. Ce groupe d’experts impacts du changement climatique sur
RE-SOURCES scientifiques permanent, indépendant, l’eau et les milieux aquatiques de 3 bas-
La démarche Re-Sources est née en Poi- capable d’apporter aux acteurs du terri- sins : la Charente, la Garonne et l’Adour.
tou-Charentes, dans les années 2000, du toire les connaissances nécessaires à leur L’objectif est de construire un diagnostic
constat d’une dégradation de la qualité stratégie d’adaptation au changement prospectif commun en identifiant les
des ressources en eau potable. Multi-ac- climatique, a produit en 2018 le rapport grands enjeux de chaque bassin, élabo-
teurs, elle vise à sécuriser la production « Anticiper les changements climatiques rer des scénarios et ressortir des pistes
d’une eau potable de qualité. Elle induit en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les d’adaptation envisageables.
des changements de pratiques agricoles territoires. ».
et des évolutions de systèmes de produc- Etude HMUC : Hydrologie, Milieux,
tion dans le but de prévenir la pollution Oracle - Observatoire Régional Usages, Climat : il s’agit d’une nouvelle
des eaux captées. Encadrée par une sur l’Agriculture et le Changement approche demandée par le SDAGE
convention régionale pour la période cLimatique en Nouvelle Aquitaine : Loire-Bretagne dans le cadre des SAGE
2015-2020, elle se décline à l’échelle locale l’observatoire démontre par les faits la afin d’anticiper les effets du changement
des bassins d’alimentation de captage réalité du changement climatique et la climatique sur les secteurs déficitaires
et se caractérise par une dynamique de diversité de ses incidences agricoles en et d’adapter les objectifs de gestion
réseau et un ancrage territorial. région ; il quantifie les évolutions clima- quantitative pour atteindre l’équilibre.
tiques et agricoles en cours, et constitue La démarche est précisée dans la dis-
En Nouvelle-Aquitaine, 81 champs cap-
tant prioritaires inscrits dans les SDAGE le référentiel de ce qui peut être attribué position 7A-2 du SDAGE. Actuellement,
afin de reconquérir la qualité de l’eau des- au changement climatique. Ces travaux la réflexion est engagée sur la Sèvre
tinée à l’alimentation en eau potable sont ont donné lieu en 2018 à un état des lieux Niortaise, le Thouet, le Clain et la Vienne.
ciblés par la démarche Re-Sources. Cela sur le changement climatique et ses inci-
nécessitera des partenariats forts entre dences agricoles. LES MIGRATEURS
les acteurs de l’eau, l’engagement des Ecobiose : créé en 2017 à l’initia- Les grands bassins fluviaux de
collectivités productrices d’eau potables tive de la Région Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine sont marqués par la
concernées à animer ses démarches, la au regard des enjeux sociétaux que présence régulière de poissons migra-
mise en oeuvre de programmes d’actions représente l’érosion de la Biodiversité, teurs. Néanmoins la plupart de ces
cohérents et des objectifs de résultats. le comité scientifique interdisciplinaire espèces sont caractérisées par un état de
ECOBIOSE a pour mission de réaliser un conservation préoccupant selon l’UICN
LE CHANGEMENT état des lieux des connaissances scien- nécessitant des actions de préservation
CLIMATIQUE tifiques sur les interrelations entre état et de restauration des populations de
En Nouvelle-Aquitaine, différents comi- de la biodiversité, fonctionnement des poissons migrateurs. En région, 4 grands
tés, programmes, études, travaux visant écosystèmes et provision de services opérateurs oeuvrent en ce sens :
à étudier le changement climatique sont économiques et socio-culturels sur le LOGRAMI : association créée en 1989
conduits parmi lesquels : territoire néo-aquitain. qui oeuvre sur le bassin de la Loire.11
ÉCLAIRAGE RÉGIONALNOUVELLE-AQUITAINE
MIGADO : association créée en 1989 qui Observatoire des Plantes Exotiques Le Forum des Marais Atlantiques qui
oeuvre sur le bassin Gironde-Garonne- Envahissantes du Limousin : animé par vise l’accroissement et la diffusion des
Dordogne-Charente-Seudre, dernier trois organismes départementaux (CPIE connaissances sur les zones humides,
bassin hydrographique à accueillir les des Pays Creusois, CPIE de la Corrèze, l’appui méthodologique et technique
8 espèces historiquement présentes. FDGDON de la Haute Vienne). aux porteurs de projets, et l’animation du
Cellule Migrateurs Charente-Seudre : OAFS : Intégré au sein du Réseau des réseau et de la communauté que consti-
issue d’une dynamique pluri-acteurs Observatoires Territoriaux de la Bio- tuent les acteurs publics et privés de ces
initiée en 2007 reposant sur une cellule territoires. Reconnu « Pôle-relais zones
diversité, l’Observatoire Aquitain de la
d’animation CREAA-EPTB Charente- humides de l’Atlantique, de la Manche
Faune Sauvage est un dispositif dédié à
MIGADO. Ses actions visent la connaissance et de la Mer du Nord », il contribue à la
la coordination et à la valorisation des
de l’état des populations, la restauration mise en oeuvre de la politique nationale
informations faunistiques en Aquitaine.
de la continuité écologique et la commu- sur les zones humides.
Une partie de ses activités s’intéresse à la
nication afin de sensibiliser et d’intégrer faune exotique pour laquelle un portail a Le Conservatoire des Espaces Natu-
l’ensemble des acteurs dans la sauvegarde rels qui intervient dans l’acquisition, la
été développé.
des poissons grands migrateurs. protection et l’ouverture au public des
Life CROAA : d’une durée de six ans, ce espaces naturels situés à l’intérieur
MIGRADOUR : association créée en
projet se donne pour objectif d’améliorer des terres dont les zones humides
1994 qui oeuvre sur les bassins de l’Adour,
l’état de conservation des populations notamment.
de la Nivelle et des cours d’eau côtiers
des Landes et des Pyrénées Atlantiques. locales d’Amphibiens affaiblies par la
Autres : les syndicats de rivière, les
présence d’espèces exotiques envahis-
D’autres structures traitent également de fédérations de pêche, les fédérations de
santes, comme la Grenouille taureau (en chasse … conduisent également de nom-
cette thématique dans leurs actions, c’est
Dordogne et en Gironde) et le Xénope breuses actions visant à la préservation et
par exemple le cas pour :
lisse (en Deux-Sèvres et en Vienne). au maintien des zones humides.
• L’EPTB Vienne pour lequel des actions
sont menées en faveur des poissons
migrateurs notamment l’animation de LES ZONES HUMIDES LES ÉTANGS
comités migrateurs sur la Vienne et la Marais, tourbières, prairies Composante majeure du pay-
Gartempe. humides, vasières, prés salés, mangro- sage notamment en Limousin, les étangs
• Les fédérations de pêche de Haute- ves... entre terre et eau, les zones humides appartiennent à la culture locale et repré-
Vienne, Creuse et Corrèze, la maison de présentent de multiples facettes tant par sentent une forte activité économique
l’eau et de la pêche de la Corrèze et l’AFB leur composition que par les fonctions (commerce du poisson, location des
qui ont conduit un travail permettant la qu’elles remplissent. Différentes struc- étangs à des fins piscicoles, halieutiques
création d’un atlas piscicole du Limou- tures oeuvrent en Nouvelle-Aquitaine ou cynégétique, abreuvage du bétail …).
sin traitant en partie de l’évolution des pour la préservation de ces milieux à la De nombreux syndicats existent en vue
migrateurs amphihalins dans le temps biodiversité remarquable, comme par de valoriser et de gérer ce patrimoine :
sur ce territoire. exemple : syndicat des étangs Corréziens, syndicat
LES ESPÈCES
EXOTIQUES
ENVAHISSANTES
De nombreuses espèces exotiques enva-
hissantes (faune et flore) sont inféodées
aux milieux aquatiques et concernent la
Nouvelle-Aquitaine. Réelles nuisances sur
le fonctionnement des hydrosystèmes
tant pour la biodiversité que pour les
usages, différentes actions visent à limiter
les impacts de ces espèces telles que :
ORENVA : L’Observatoire Régional
des Plantes exotiques Envahissantes
des écosystèmes Aquatiques (ORENVA)
de Poitou-Charentes un outil partagé de
compréhension et de suivi des phéno-
mènes invasifs, reposant sur un réseau
d’acteurs et des procédures d’échanges La jussie - Marais du Nord - Rochefort (17)
entre eux.12
ÉCLAIRAGE RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE
des étangs Creusois, syndicat des étangs et à la prévention
de la Haute-Vienne, association de pro- des risques côtiers.
motion du poisson du Limousin, Union Il accompagne les
régionale pour la Valorisation des Etangs stratégies de déve-
du Limousin, fédération des syndicats loppement durable
et associations des étangs du Limousin, de manière à
Syndicat de Valorisation et de Promotion prendre en compte
des étangs du Poitou-Charentes Vendée… l’évolution morpho-
logique du littoral et
LE LITTORAL les richesses de son
Le littoral Sud Atlantique consti- patrimoine naturel
tue plus de 970 km de côtes (du nord de
tout en s’adaptant
la Charente Maritime au sud du Pays
a u c h a n ge m e n t
Basque français). La région dispose ainsi
d’un patrimoine à forte valeur ajoutée climatique.
pour l’économie et l’attractivité de son 0 20 40km
territoire, et compte 2 Parcs Naturels LES PARCS
Marins (Bassin d’Arcachon et Estuaire NATURELS
de la Gironde et de la mer des Pertuis). UN IMPORTANT
Le GIP Littoral mène des réflexions
REGIONAUX RÉSEAU ASSOCIATIF
Les parcs naturels régionaux ont pour
stratégiques sur les problématiques lit-
vocation d’asseoir un développement ET D’ÉDUCATION
torales de Nouvelle-Aquitaine et anime
des politiques publiques dédiées à la ges- économique et social du territoire, tout À L’ENVIRONNEMENT
en préservant et valorisant le patrimoine De nombreux acteurs de la formation,
tion des espaces littoraux. C’est aussi un
naturel, culturel et paysager. L’eau fait de la sensibilisation des habitants et
lieu de production d’études à caractère
partie intégrante de ces espaces néces- des usagers et de la communication
prospectif et un outil de concertation,
sitant la mise en oeuvre de nombreuses interviennent dans le domaine de l’eau,
de mise en cohérence des projets,
actions visant à préserver et mettre en ainsi que différentes associations de
d’échanges d’expériences et de diffusion
protection de la nature et des milieux
de bonnes pratiques entre ses membres avant ces ressources essentielles.
aquatiques.
et partenaires. Le PNR Millevaches
Le PNR Périgord-Limousin CPIE : les Centres Permanents d’Initia-
L’Observatoire de la Côte Aquitaine
Le PNR Marais Poitevin tives pour l’Environnement coopèrent et
a pour rôle de mettre au service des
Le PNR Landes de Gascogne agissent au quotidien avec les habitants et
acteurs du littoral un outil scientifique et
l’ensemble des acteurs en territoire pour
technique d’aide à la décision, à la gestion Le PNR Médoc
co-construire des actions de dévelop-
pement durable. L’Union Régionale des
CPIE Nouvelle-Aquitaine regroupe 13 CPIE
travaillant sur différents projets : « Un
Dragon ! Dans mon jardin ? », la gestion
intégrée des eaux pluviales, accompa-
gner la GEMAPI … À noter que le CPIE Val
de Gartempe anime depuis une vingtaine
d’années un réseau de Techniciens
Médiateurs de Rivières.
IFREE : l’Institut Formation Recherche
Education à l’Environnement est une
association tournée vers les enjeux de
sensibilisation et mobilisation citoyenne
environnementale, au service des ter-
ritoires et de ses habitants. Parmi les
actions menées sur la thématique de
l’eau : la parution de la brochure « Favo-
riser le dialogue territorial sur l’eau », une
concertation sur la mise en place d’une
Fouras (17)
instance participative citoyenne accolée
à la CLE du SAGE Clain…13
ÉCLAIRAGE RÉGIONALNOUVELLE-AQUITAINE
GRAINE : le Groupe Régional d’Ani- monde soutenable, prenant en compte L’AGRICULTURE
mation et d’Initiation à la Nature et à les besoins des générations à venir, et la Première région agricole de
l’Environnement est une initiative des nécessité d’un fonctionnement pérenne France, la Nouvelle-Aquitaine nécessite
acteurs de l’éducation à l’environnement des écosystèmes. par conséquent une gestion fine de l’eau
pour une mise en réseau et la coordina- aussi bien en termes de quantité que de
tion de leurs actions au niveau régional. En qualité. Différentes structures et organi-
Nouvelle-Aquitaine 2 structures existent
Des
sations mènent des actions en ce sens :
proposant de nombreuses animations,
outils et formations : exposition « Les pes-
ticides c’est pas automatique ! », dossier
thématique « L’Éducation à l’Environ-
organismes
nement et l’Eau en Nouvelle-Aquitaine,
répertoire des Acteurs et Outils de sociaux-
l’EEDD… SEVE Relais Ecole et Nature du
Limousin est le pendant des GRAINE Poi- professionnels
tou-Charentes et Aquitaine, et a pour but
de rassembler les différents acteurs inté- Acteurs majeurs du développe-
ressés par la promotion d’une éducation ment économique, les organismes
à un environnement et à une humanité sociaux-professionnels sont des usa-
durable et qui agissent en Limousin. gers de l’eau mais aussi des soutiens
techniques et humains important aux
Les Petits Débrouillards contribuent à
organismes publics.
former des citoyens actifs, à développer
l’esprit critique, et à élargir les capacités
d’initiatives de chacun. 13 antennes/comi-
tés locaux existent en Nouvelle-Aquitaine
permettant une action locale. Le CESER (Conseil économique,
L’Association Régionale des Fédé- social et environnemental
rations de Pêche et de Protection régional) est une assemblée
du Milieu Aquatique de Nouvelle consultative de la Région com-
Aquitaine, formée des 12 Fédérations posée d’acteurs économiques
Départementales (FDAAPPMA), mène
et sociaux représentatifs
de nombreuses actions parmi lesquelles La Chambre d’agriculture Nou-
la protection du milieu aquatique et la de la société civile. Il exa-
velle-Aquitaine regroupe l’ensemble
sensibilisation des citoyens aux enjeux mine son budget à toutes des acteurs du monde agricole, rural
des milieux aquatiques, du bon état des ses étapes et les différents et forestier : exploitants, propriétaires,
cours d’eau et de la préservation de la documents de planification salariés, groupements professionnels…
biodiversité. en amont de leur adoption et Elle participe à différents programmes
La maison de l’eau et de la pêche de répond aux demandes d’avis notamment le plan Ecophyto et Oracle.
Corrèze est une association qui mène La Fédération Régionale d’Agriculture
et d’études du Président du
des actions visant à sensibiliser les jeunes, Biologique Nouvelle-Aquitaine ras-
développer l’activité pêche ainsi qu’à pro- Conseil régional. Différents
semble des agriculteurs, des producteurs
mouvoir la connaissance et la mettre à avis ont été émis par le CESER bio, des opérateurs privés, des institu-
disposition. Elle a notamment participé Nouvelle-Aquitaine sur la tionnels économiques et sociaux. Elle agit
à la réalisation d’un atlas des poissons thématique de l’eau. Il a pour le développement d’une agriculture
Limousin avec les fédérations de pêche notamment été sollicité par et d’une alimentation d’intérêt général, la
et l’Agence Française pour la Biodiversité. création de valeurs économiques, envi-
les autorités en charge de
France Nature Environnement Nou- ronnementales et sociales.
la coordination des bassins
velle-Aquitaine regroupe différentes Le Réseau InPACT Nouvelle-Aqui-
associations (Limousin Nature Envi- Adour-Garonne et Loire- taine est né de la volonté d’associations
ronnement, Poitou-Charentes Nature, Bretagne pour la relecture de de développement agricole et rural de se
SEPANSO) qui portent des objectifs plusieurs documents en cours rassembler pour aller vers une agriculture
communs de protection de la nature et de révision et soumis à consul- citoyenne et territoriale. Les 8 associa-
de l’environnement. La confédération tation (SDAGE, PGRI…). tions du réseau ont leurs propres champs
intègre les dimensions culturelle, sociale, d’action et partagent un plan d’action
économique dans la perspective d’un commun.Vous pouvez aussi lire