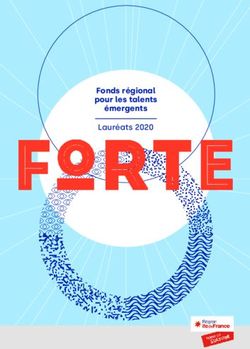DISCOURS DE M. LE PROFESSEUR JEAN HAMBURGER
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
DISCOURS
DE M. LE PROFESSEUR JEAN HAMBURGER
de l'Académie française [1985]
Membre de l'Académie des Sciences
et de l'Académie de Médecine
LE DOCTEUR WILLIAM HARVEY
ET LA DÉCOUVERTE DE LA CIRCULATION DU SANG
Le titre de ma conférence n'est pas tout à fait juste et je vous
demande de me le pardonner. Je vous parlerai certes de la circulation du
sang, mais je vous parlerai surtout de celui qui fit cette découverte, le
médecin anglais William Harvey. Depuis quelques années, les aventures,
les expériences, les écrits de William Harvey m'ont fasciné. A mesure que
je tentais de reconstituer les maillons de cette existence lointaine, le person-
nage me devenait plus familier et plus captivant. J'accumulais les docu-
ments capables de l'éclairer, dans les bibliothèques et les archives d'Angle-
terre, de France et d'autres contrées que Harvey visita. Je pénétrais peu à
peu les pensées, les passions, la logique de cet homme étonnant. Je compre-
nais combien les questions que se posait ce médecin du XVIIe siècle étaient
des questions actuelles. Le jour vint où je me sentis si proche de lui que,
non seulement je voulus en faire le héros d'un livre, mais que j'eus l'audace
de prendre la plume à sa place, d'écrire le livre à la première personne et
d'en faire un journal imaginaire que j'intitulai «Le journal d'Harvey». Ce
sont quelques souvenirs de cette aventure d'identification que j'aimerais
partager avec vous cet après-midi.
William Harvey naquit le 1er avril 1578, à Folkestone, port mar-
chand très actif à cette époque. Son père, Thomas Harvey, était un riche
commerçant, importateur d'objets du Moyen-Orient et citoyen influent de
la ville, dont il fut maire à plusieurs reprises. William était l'aîné d'une
famille de neuf enfants, dont sept garçons. Tous les frères de William Har-
vey embrassèrent la carrière paternelle de marchands, importateurs d'épi-
ces et de soieries, membres de la Compagnie du Levant et de la Compagnie
des Indes Orientales, sauf son frère John qui devint valet de pied du roi
James 1er. William, lui, fut attiré, dès ses études au Caius Collège de Cam-
bridge, par la médecine et par la philosophie. A l'âge de 22 ans, comme
beaucoup des plus brillants jeunes Anglais de cette époque, il partit termi-
ner ses études en Italie, dans une ville dont l'Université avait une réputation
extraordinaire, la ville de Padoue dans la République de Venise.Quand William arrive à Padoue, au début de Tannée 1600, il décou-
vre un monde nouveau, qui aura sur lui une influence décisive. Padoue lui
apparaît comme une ville éblouissante, encore qu'assez sale. Il découvre les
venelles étroites, les palais colorés, les arcades grouillantes, les sept coupo-
les du Saint et, finalement, le grandiose édifice de l'Université, pierres jau-
nes tranchant sur le bleu violent du ciel, un bleu de ciel comme il n'en avait
jamais vu en Angleterre. Le porche ressemblait à la porte d'un temple,
encadré de colonnes et surmonté d'un lion ailé en bas-relief. Entrant dans
la cour carrée, fermée d'un double étage de portiques et de balustrades, il
admire une architecture très belle, à la fois classique et foisonnante : tout le
contraire de la grise austérité des pierres dans laquelle il vivait, au vieux
Collège Caius de Cambridge.
Et bientôt il devait découvrir, dans ces murs et dans ces rues de
Padoue, une fascinante ébullition de l'esprit. Venus du monde entier, de
France, de Suède, d'Allemagne, de Pologne, les élèves formaient avec les
Italiens un monde en raccourci, brûlant d'échanger des idées sur tous les
thèmes qui éveillent la curiosité des hommes. Les Professeurs étaient pres-
que tous illustres. Harvey suivait l'enseignement du Droit, en même temps
que celui de la Médecine et de l'Anatomie; il lui arrivait même de se glisser
dans l'amphithéâtre comble où Galilée discourait sur la Mécanique et sur
l'Astronomie. Partout l'argument était neuf et libre, la tradition soumise à
la critique, la sollicitation provocante pour une réflexion personnelle.
Au-dehors, les rencontres se poursuivaient. Les librairies, les phar-
macies, les bibliothèques, les cabarets même étaient, chaque jour, emplis
d'hommes de tous âges qui discutaient sur la beauté et la laideur, sur le
monde, sur les femmes, sur les secrets de l'art de vivre. Dans cette Italie qui
pourchassait partout l'hérésie, Padoue était une île de tolérance; les mises
en question du passé y étaient accueillies dans la jubilation, on s'en empa-
rait, on les agitait, on les fêtait, on se réjouissait de vivre dans le lieu où
naissaient les idées qui, demain, changeraient la face du monde. Padoue,
cité pensante de la République de Venise, était l'endroit le plus civilisé de
toute l'Europe, la matrice la plus féconde pour une science nouvelle.
Il faut dire qu'au temps d'Harvey, la médecine européenne était sous
la coupe sévère d'une fidélité totale aux traditions antiques. Depuis au
moins six siècles, l'enseignement est sous l'emprise des normes imposées
par l'Eglise et, en médecine, les normes sont l'obédience aveugle à la pensée
d'Aristote et de Galien. Galien a séduit l'Eglise parce que, dans son Traité
de Physiologie, il a fait acte de foi en un Dieu unique, créateur du corps et
de l'âme et dispensateur de la santé et de la maladie; c'est que le grand
voyageur qu'était Galien s'était frotté à la tradition monothéiste juive etaux premières communautés chrétiennes, en plein essor dans son royaume
natal de Pergame, pointe avancée de l'expansion romaine en Orient. Aris-
tote, lui, conquit les faveurs de l'Eglise un peu plus tard, au temps des croi-
sades : les Croisés ramènent dans leurs bagages la traduction arabe de pres-
que toutes ses œuvres, des Espagnols traduisent ces textes en latin et ils se
répandent en Occident comme une traînée de poudre; des théologiens tels
que Saint Thomas d'Aquin déclarent que la philosophie d'Aristote s'intè-
gre parfaitement dans la pensée chrétienne. L'Eglise adopte Aristote, elle
l'impose. Désormais les seules références acceptables en médecine seront
Aristote et Galien.
L'histoire de la méthode d'enseignement qui définit cette période et
qu'on nomme scolastique mérite qu'on s'y arrête un instant, car elle est le
modèle d'un phénomène de société dont on a vu, depuis lors, d'autres
exemples : le passage, dans un moule uniforme, du raisonnement de mil-
liers d'hommes sous l'invisible pression de pensée de quelques-uns. A cette
époque, les manuscrits sont rares et très coûteux, les étudiants ont pour
seul moyen de s'instruire l'enrôlement dans une Université. La scolastique
n'est pas un système philosophique, c'est un système d'enseignement; le
maître prend un texte d'Aristote, de Galien ou encore de la Bible, et sa lec-
ture est le commentaire de ce texte. Le discours antique est donc la réfé-
rence unique, incontestable, auréolée d'un respect hiératique. Certes
l'analyse de texte peut se montrer critique, mais partout elle demeure sous
la surveillance de la hiérarchie catholique. Tout manquement à la saine tra-
dition est risque d'hérésie et les temps ne sont pas cléments pour les héréti-
ques. Des dizaines de générations d'étudiants vont se voir enseigner une
médecine momifiée, sous l'influence occulte de pressions extérieures invisi-
bles. C'était le temps où, à l'Université de Paris, aucune thèse n'était
acceptée si elle contredisait Aristote ou Galien. On a vu depuis de grands
mouvements idéologiques interdire de même, sous d'autres cieux, que le
raisonnement de chaque individu demeure tout à fait libre. Pour la démar-
che scientifique, c'est un peu ce que Thomas Kuhn a nommé les paradi-
gmes, c'est-à-dire la pression de pensée invisible que la tradition officielle
du moment exerce sur les chercheurs. Après la découverte de la circulation
du sang, un des confrères de Harvey lui écrira : «Veux-tu faire entendre
que tu sais ce qu'Aristote ignorait ? Aristote a tout observé et personne ne
doit oser venir après lui». C'était signé James Primrose, médecin londo-
nien qui devait devenir, comme je le raconterai dans un instant, un des
adversaires les plus farouches de Harvey.
Car la vie d'Harvey va être une double bataille : la bataille pour faire
reconnaître ses découvertes contre des ennemis acharnés à défendre la tra-dition; et la bataille contre les ennemis de son Roi, dans une aventure poli-
tique à laquelle il va être intimement mêlé.
Pour ce qui est de la circulation du sang, les Anciens s'étaient trom-
pés et bien trompés. Ils croyaient que le sang pouvait subir quelques dépla-
cements, particulièrement vers les membres, mais ils imaginaient ce dépla-
cement sans retour, comme si le sang ayant irrigué les extrémités s'éva-
nouissait tout à fait ou avait tout au plus quelques mouvements de va et
vient. Pour eux, la fonction du cœur était de réchauffer ce sang et nulle-
ment de le faire avancer. Ils n'avaient même pas observé le cœur avec soin,
car s'ils savaient que le cœur a deux ventricules, ils répétaient à l'envi qu'un
large orifice faisait communiquer le ventricule droit et le ventricule gauche,
alors que, comme l'écrira Harvey, «Par le ciel, aucune ouverture n'existe»,
chez l'homme normal. Quelques hommes, peut-être dès l'Egypte ancienne,
et assurément plus près de nous l'Espagnol Michel Servet, avaient bien
vaguement pressenti que le sang circulait, mais personne ne les prenait au
sérieux. Michel Servet avait même été brûlé en place de Genève pour
l'ensemble de ses idées hérétiques. Pour nous qui savons que le sang circule
et que le cœur est le moteur de cette circulation, cet aveuglement ancien
nous semble incroyable. Mais au XVIIe siècle, je l'ai dit, la parole antique
était dogme universellement admis et enseigné, de même qu'on ne doutait
pas que la terre fût immobile au centre du monde et que le soleil tournait
autour de la terre. Galilée, après Copernic, allait au péril de sa vie soutenir
que la terre tourne. Harvey allait découvrir comment le sang circule et se
battre une vie durant pour en convaincre une opinion sceptique et hostile.
C'est à Padoue, à l'âge de 23 ou 24 ans, que Harvey conçut ses pre-
miers doutes sur les idées traditionnellement acceptées. Il avait comme maî-
tre d'anatomie le célèbre Fabrice d'Acquapendente, qui avait découvert
que les veines sont tapissées, à leur intérieur, de valves qui semblent
s'opposer comme autant de soupapes au cheminement du sang vers les
extrémités et favoriser au contraire la remontée du sang vers le cœur. Mais
le respect de la tradition antique était si puissant qu'au lieu de se demander
si l'on ne s'était pas trompé sur la direction du sang dans les veines, Fabrice
s'ingéniait à trouver par quel subtil miracle le sang pouvait progresser dans
un sens apparemment interdit par ces valves. Dans le climat de liberté de
l'esprit, de mise en question des idées reçues, qui règne à Padoue, le jeune
William Harvey n'hésite pas à concevoir l'hypothèse à ce moment révolu-
tionnaire d'un aller et retour du sang à partir du cœur, un aller vers les
extrémités par la voie des artères, un retour par la voie des veines. Il con-
firme son hypothèse par l'expérience très simple d'un garrot. Quand on
enserre le bras par un lien modérément serré, on voit les veines gonfler au-dessous du lien parce que le sang s'accumule en amont de l'obstacle que
l'on a créé sur son chemin de retour. Serre-t-on le garrot plus fort, on
arrête aussi le courant d'aller dans les artères, le pouls artériel disparaît au-
dessous de l'obstacle et la main exsangue devient blanche et froide.
Dès cette époque, l'étudiant de Padoue entrevoit que c'est seulement
le début de sa recherche sur la circulation sanguine. Et, peu à peu, de retour
à Londres, il démontrera par l'observation et l'expérience sur les animaux
les plus divers que le trajet du sang est celui d'un tour complet; le sang qui
remonte des extrémités vers le ventricule droit du cœur est envoyé ensuite
par celui-ci vers les poumons; de là il revient vers le ventricule gauche du
cœur, lequel le renverra par les artères vers les autres organes et les extrémi-
tés. De ce cheminement circulaire, le cœur est le moteur, les mouvements
du cœur ne sont nullement passifs comme on le croyait, ils sont actifs, le
cœur est un muscle puissant qui chasse le sang en se contractant. Harvey le
vérifie sur le cœur d'anguille, le cœur de poissons, le cœur d'oiseaux, le
cœur de mammifères et même un jour sur un cœur d'homme par l'observa-
tion extraordinaire du jeune vicomte de Montgomery qui avait eu les côtes
brisées par accident, et qui vivait avec une sorte de trou béant dans la poi-
trine, avec, au fond du trou, juste derrière la peau, le cœur qu'on pouvait
presque prendre entre les doigts.
Entre temps, William Harvey était devenu médecin du roi James 1er
et, grâce à la protection de ce dernier, médecin chef de l'Hôpital Saint-
Barthélémy de Londres. L'hôpital avait alors une mission bien différente
de celle que nous connaissons aujourd'hui. Selon la charte de l'Hôpital
Saint-Barthélémy, on n'y recevait pas seulement les malades pauvres, mais
aussi tout homme et toute femme sans ressources et sans logement. Une
dizaine d'officiers-bedeaux étaient chargés de parcourir les rues de Londres
et de ramener tous les vagabonds qui erraient sans feu ni lieu et ne pou-
vaient justifier de moyens d'existence. En outre, parmi les malades, il était
interdit d'accepter les incurables, les lits étaient réservés à ceux que Harvey
déclarait guérissables. Tous les lundis matins, vers sept heures, notre héros
pénétrait dans le grand hall de l'hôpital, où les sœurs-matrones avaient
déjà commencé le premier tri des postulants. La troupe des miséreux, vieil-
lards solitaires et gueux sans domicile était déjà séparée des malades,
gémissant, boîtant, béquillant, affaissés sur des tabourets ou étendus sur
des civières. Assis derrière une table, Harvey voyait d'abord les malades
déjà logés dans l'hôpital, afin de décider qui pouvait être renvoyé et de
combien de places on disposait pour les arrivants. Puis Harvey voyait ceux-
ci, un à un, et la tâche lui était pénible de décider qui était incurable, et
n'avait par conséquent pas droit à l'hospitalisation, et qui devait êtreaccepté. Et, pour ces derniers, il rédigeait une prescription, dont l'apothi-
caire se saisissait aussitôt. Certaines de ces prescriptions sont parvenues
jusqu'à nous et elles sont surprenantes. Il y avait bien sûr les clystères, les
purgations et les saignées, mais aussi des médications extrêmement compli-
quées, qui contenaient un nombre extraordinaire de produits, allant de
l'œil d'écrevisse ou de l'extrait de vipère aux plantes les plus rares. L'élec-
tuaire thériaque de Galien ne comptait pas moins de 60 ingrédients et la
pharmacopée anglaise du temps de Harvey avait encore compliqué la for-
mule.
J'ai retrouvé le compte rendu de certaines consultations de Harvey à
l'hôpital. Ainsi le cas d'une femme nommée Ellin French. C'était une
femme d'environ 65 ans, servante bien connue pour ses habitudes dépra-
vées, voleuse, alcoolique et proférant à tout propos blasphèmes et jurons -
tellement réputée pour ses vices qu'on chantait dans les rues de Londres la
triste ballade d'Ellin French. Ellin puait à se boucher le nez et c'est même
son odeur qui avait poussé les voisins à se plaindre et à la faire envoyer à
Saint-Barthélémy. A l'hôpital, Harvey reconnut la cause de cette puan-
teur : la malheureuse avait une gangrène des deux jambes et, aux mains,
sept doigts sur dix étaient également gangrenés. Le chirurgien de l'hôpital,
John Woodall, rustre fort habile et expérimenté, mais aussi caractère diffi-
cile que Harvey avait de la peine à mater, déclara que la cause de la gan-
grène était évidente : c'était la punition décidée par Dieu pour les crimes
d'Ellin. Dieu fut clément, puisqu'il permit à Woodall de réussir l'amputa-
tion des parties gangrenées, la patiente se rétablit tant bien que mal, et on
continua dans les rues de Londres à chanter des complaintes sur les mal-
heurs d'Ellin French.
Mais Harvey avait des malades d'un autre rang. J'ai retrouvé, par
exemple, l'histoire de Sir William Smith, qui montre que dès cette époque
lointaine la décision thérapeutique pouvait poser au médecin les problèmes
de conscience les plus difficiles. Sir William était un vieil homme qui avait
depuis de longues années une grosse pierre dans la vessie. Il souffrait mille
morts, la douleur le transperçait de part en part dans le bas ventre et, la
nuit, d'incessantes envies d'uriner le contraignaient à se lever à dix reprises,
pour n'émettre que quelques gouttes d'urines rougeâtres. On pouvait le
débarrasser de la pierre par l'opération de la taille, qui était alors une entre-
prise assez terrifiante et hasardeuse : les pauvres patients était ligotés sur le
plan incliné d'une table, tenus fermement par quatre solides gaillards, et
sans anesthésie, le chirurgien fouillait du scalpel la plaie qu'il avait créée
entre anus et scrotum pour tenter de trouver et ramener la pierre. C'était la
technique qu'on appelait du «grand appareil», quelques malades s'en trou-vaient guéris, mais beaucoup mouraient d'infection ou autres complica-
tions post-opératoires. Sir William était un homme si fatigué que Harvey
doutait fort qu'il pût sortir vivant de l'opération. D'un autre côté, ses dou-
leurs étaient devenues intolérables et sa vie presque impossible à supporter.
Harvey hésita longtemps, finit par accepter qu'on tentât l'intervention, et
le malade mourut. J'ai pu reconstituer toute l'histoire parce que la famille
de Sir William intenta ensuite un procès à notre héros et que les minutes du
procès ont été conservées. Et aujourd'hui encore, aujourd'hui bien plus
que du temps d'Harvey à cause des moyens thérapeutiques puissants, sal-
vateurs, mais non sans risque, les dilemmes de la décision médicale sont
ceux que ressentait Harvey. On dit bien que c'est au patient dûment éclairé,
et non au médecin, de faire lui-même le choix entre les avantages et les ris-
ques de chaque décision possible, mais l'expérience montre que la respon-
sabilité du médecin reste considérable et que, bien souvent, il a le sentiment
d'une grande solitude devant les problèmes moraux chaque jours plus
ardus qui lui sont posés. Et aujourd'hui comme hier, le procès n'est pas
rare en cas d'échec, avec une fréquente incompréhension des avocats et des
magistrats. Je sais bien que le problème du choix envahit tous les métiers,
mais il n'y en a guère où se trouve si directement en jeu la vie ou la mort
d'un homme.
Harvey fut aussi le médecin des Rois. Il soignait le roi James, assista
à son agonie et pratiqua son autopsie qui révéla deux reins détruits par des
calculs. Harvey devint ensuite le médecin de son fils et successeur, Charles
1er, à l'ombre duquel il vivra la plus grande partie de son existence. Entre
Charles et Harvey se tisseront des liens presque affectueux, qui auront
grande influence sur la vie du médecin. Ainsi quand Harvey voit le jeune
vicomte qui avait le cœur sous la peau, il l'amène incontinent à la cour
pour que le Roi puisse tâter lui-même le muscle cardiaque et vérifier que
lui, Harvey, a raison de tenir le cœur pour un muscle contractile dont cha-
que battement lance du sang dans les artères et leur imprime les battements
du pouls. Ainsi encore, Harvey accompagnera le Roi dans ses parties de
chasse, il en profitera pour disséquer les daims et les biches du parc royal,
mêlant chaque jour Charles 1er à ses observations physiologiques et discu-
tant avec lui des résultats. En raison même de cette intimité, Harvey va être
mêlé de près aux malheurs du Roi, luttant contre les ambitions de Crom-
well et la révolution d'Angleterre. Il vécut cette révolution jour après jour,
en subit les contrecoups, fut tenu pour suspect par les antiroyalistes,
menacé dans son activité médicale, exilé même de Londres pendant de
longs mois.
Les angoisses de William Harvey pour son Roi remontent à 1642. LeParlement de Londres avait voté contre le monarque une «grande remon-
trance» et levé une armée pour lutter contre l'armée du Roi. Au retour d'un
voyage en Ecosse, où il avait accompagné Charles 1er, Harvey assiste à la
première bataille entre les deux armées, la bataille de Edge-Hill. L'issue du
combat fut indécise. Mais Harvey, qui avait été chargé pendant la bataille
de garder les deux enfants du Roi, voit à quelques mètres de lui un soldat
décapité par un boulet de canon et il ne peut se retenir de crier l'horreur et
le caractère dérisoire des guerres que se font les hommes. Plus tard, quand
visitant l'Europe, il verra la misère des peuples et les épidémies de peste, il
aura aussi les réflexions que peut encore et toujours se faire un médecin du
XXe siècle : les hommes ont une sorte de maladie collective, qui les empê-
che de vivre sagement, de réserver leurs forces pour lutter contre les mal-
heurs du monde et de profiter pleinement et pacifiquement des bienfaits
qu'ils pourraient tirer de la terre où ils vivent.
Cependant la lutte entre le Roi et le Parlement ne fait que s'aggraver.
En 1643, Charles est contraint de quitter Londres et de s'installer à Oxford,
où il fait nommer Harvey recteur du Collège Merton. Là, Harvey vivra
heureux pendant trois années, travaillant dans son laboratoire avec un
jeune élève qu'il aime, le Docteur Charles Scarborough. Mais le 27 avril
1646, le Roi, déguisé en valet de son fidèle gentilhomme Ashburnham,
barbe et accroche-cœurs tondus, est forcé de s'enfuir nuitamment
d'Oxford, que menace l'armée du Parlement. Harvey est destitué et rentre
à Londres. Le Roi se réfugie en Ecosse, où Harvey va le voir et assiste au
chantage des Ecossais qui exigent du Roi qu'il abandonne l'Eglise d'Angle-
terre et ses Evêques pour adhérer à la doctrine presbytérienne et, sur le
refus du Roi, décident de vendre celui-ci au Parlement de Londres pour la
somme de 400 000 livres.
Alors, Harvey va passer par des alternatives d'espoir et d'inquiétude.
Le Roi est d'abord hébergé au luxueux manoir d'Holmby et l'espoir renait
parce que le Parlement se chamaille avec son armée et que celle-ci pour
avoir le dessus fait enlever le Roi et veut le placer dans son camp. L'idée
est, en réalité, de Cromwell qui, après avoir longtemps hésité à prendre le
parti du Parlement ou celui de l'Armée, décide finalement que son ambi-
tion sera mieux servie par celle-ci et veut aussi mettre le Roi dans le même
camp. Mais Charles 1er, maladroit politique, aveuglé par le désir perma-
nent d'être le souverain de tous les Anglais, parlementaires compris, et non
celui d'un des partis en lutte, hésite, se dérobe, finit par refuser, s'enfuit du
somptueux palais d'Hampton Court où l'Armée l'a installé, se réfugie à
l'Ile de Wight, est à nouveau enlevé pour être mis dans la terrible citadelle
du château de Hurst, puis à nouveau placé dans sa résidence préférée, lechâteau de Windsor avec tous les égards possibles. Mais il a définitivement
lassé les velléités favorables de Cromwell. Celui-ci fait épurer le Parlement
de tous les Députés suspects de rester favorables à Charles, ceux qui restent
organisent le procès du Roi, un simulacre de procès dira Harvey. Le procès
commence le 20 janvier 1649 et, le 30 janvier, le Roi est décapité. C'est
ensuite une chasse aux sorcières contre tous les monarchistes et Harvey est
banni de Londres, contraint de se réfugier hors de la capitale, dans la mai-
son de campagne d'un de ses frères, où il pleure son Roi, craint pour sa
propre liberté et a tout le temps pour méditer sur les attaques d'une autre
espèce dont est victime son œuvre scientifique.
Car, si clair, si démonstratif, si convaincant que soit son livre sur les
mouvements du cœur et du sang chez les animaux, paru à Franckfort en
1628, il n'en avait pas moins soulevé une tempête d'objections et de sarcas-
mes.
L'attaque avait été menée de front par un Anglais et un Français,
puis par des Italiens et des Allemands. L'Anglais était ce James Primrose,
dont j'ai déjà parlé, homme opposé par principe à toute idée nouvelle et
éprouvant chaque fois le besoin pressant de réfuter par écrit toute décou-
verte médicale qui modifiait la tradition. Dès l'année qui suit la parution
du livre d'Harvey, Primrose rédige en 14 jours un libelle d'une extrême vio-
lence, niant, point par point, tout ce que Harvey avait mis vingt ans à
démontrer. Ce détracteur anglais avait fait, je dois le dire, ses études en
France, successivement à Bordeaux, Montpellier et Paris, où il avait été
l'élève d'un personnage étonnant, médecin de Henri IV puis de Louis XIII,
Jean Riolan.
On prête à Jean Riolan un mot célèbre, dont je ne sais s'il est authen-
tique : «Il n'y a aucune raison d'accepter que le sang circule, envers et con-
tre toute tradition, pour le seul caprice d'un médecin anglais». Ce qui est
certain, c'est qu'il attaque Harvey dans ses livres avec une frénésie qui n'a
d'égale que l'hypocrite flatterie qui accompagne l'éreintement. Tout en
qualifiant Harvey d'illustrissime anatomiste et en le couvrant de compli-
ments fielleux, Riolan juge ses travaux proprement ridicules et lui oppose
une série d'affirmations aussi péremptoires que dénuées de sens. Il juge
plus raisonnable - le mot est joli - de supposer que le sang se déplace de lui-
même. Le cœur ne sert qu'à apporter au sang de la chaleur et une provision
d'esprit, tandis que de son côté le sang, qualifié de douce liqueur et de nec-
tar vivifiant, sert à empêcher le cœur de se dessécher. D'ailleurs, écrit-il,
seul le cœur des hommes solides est dur, celui des femmes est mou, et si,
par folle imagination, on supposait que le cœur projette une ou deux gout-tes de sang à chacun de ses battements, cela ferait tant de gouttes qu'elles
auraient bien du mal à se loger quelque part. Dans deux lettres célèbres
parues en 1649, Tannée de la mort du Roi, Harvey lui répondra qu'il suffit
de regarder le cœur qui bat pour voir que ce ne sont pas des gouttes, mais
un jet impérieux de sang que le cœur expulse à chacun de ses battements.
Au travers des pamphlets de Riolan démolissant l'œuvre de Harvey,
on devine qu'il s'agit d'un de ces hommes enfermés dans une doctrine et
dans un personnage, et persuadés que ce qui entame leur doctrine les
entame eux-mêmes et risque de mettre en doute leur infaillibilité. Et puis,
dans les discours de tous les détracteurs de Harvey, on devine un sentiment
éternel, assurément aussi vivace aujourd'hui qu'hier, la jalousie, l'envie, la
manie du dénigrement d'autrui. Voilà qui n'existe pas seulement parmi les
médecins et les scientifiques. J'ai cru sentir que Harvey partageait une con-
viction que je crois importante : l'envie et le dénigrement n'apportent
qu'amertume à celui qui en est envahi, alors que la confiance, l'estime,
l'admiration pour les accomplissements des hommes dont le génie apporte
à l'humanité un supplément de savoir ou un supplément d'âme sont des
sentiments vivifiants et qui sont sources de joies. Voilà bien ce que nos
enfants devraient mieux apprendre à connaître à l'école.
Le mérite d'Harvey et de quelques-uns de ses contemporains fut de
montrer que le respect aveugle des Anciens ou le droit de tirer de sa seule
imagination l'interprétation des choses de la nature, sans se croire aucune-
ment obligé d'en vérifier l'exactitude par l'observation et l'expérience, sont
néfastes. C'était la pénible naissance, au XVIIe siècle, de l'esprit scientifi-
que. J'ai fait prononcer à Harvey un mot que, j'en suis sûr, il aurait pu
prononcer s'il ne Ta pas fait : «Accepter de changer d'opinion, reconnaître
son erreur, sont des victoires et non des défaites». Tout le germe du progrès
scientifique a résidé dans cette conviction.
En même temps que cette lutte pour faire reconnaître la justesse de
ses découvertes, Harvey aura à lutter contre une autre forme d'obscuran-
tisme, contre une espèce fort abondante en son temps, mais qui n'a sans
doute pas disparu aujourd'hui autant que Harvey le souhaitait, je veux
parler des sorcières et des charlatans.
La sorcellerie était florissante dans cette première moitié du XVIIe
siècle. Harvey fut mêlé à plusieurs histoires de sorcières, qui ont un goût de
diableries aussi fort que certains films de Polanski. Le roi James 1er avait
écrit et publié là-dessus un livre intitulé «Démonologie en forme de dialo-
gue», que j'ai pu lire à la Bibliothèque Mazarine. On y voit qu'il fautapporter beaucoup de rigueur pour reconnaître une sorcière, afin de ne pas
brûler par erreur quelqu'un qui ne serait pas vraiment habité par le diable.
Il faut, par exemple, lui raser le crâne, pour découvrir ces callosités privées
de sensibilité qui, chacun le sait, sont tout à fait caractéristiques d'une vraie
sorcière. Il faut aussi la plonger dans un bassin pour voir si elle flotte, car,
nul ne l'ignore, les habités du démon sont toujours plus légers que les
autres. Harvey ne partageait pas cette croyance aux sorcières, mais s'inté-
ressait beaucoup à ce qui pouvait se cacher derrière les prétendus phénomè-
nes de sorcellerie. Un jour il apprend que, dans la région de Newmarket où
il passe avec la suite du Roi, se trouve une femme que chacun tient pour
une sorcière. Il décide d'aller la visiter, se rend à cheval dans la maison iso-
lée où elle vit sur le bord de la lande. Elle est seule et accueille Harvey avec
méfiance. Il se présente comme un confrère en sorcellerie, désireux
d'échanger avec elle quelques propos sur leur condition commune. Comme
toute sorcière de bon aloi possède son démon familier qui lui sert de truche-
ment dans ses relations avec le diable, il lui demande où se trouve le sien et
lui dit qu'il désire beaucoup le connaître. La fille va chercher un peu de lait,
le verse dans une écuelle, l'approche d'un coffre placé dans un coin de la
salle et clappe de la langue, imitant le cri du crapaud. Aussitôt, de dessous
le coffre, sort un gros crapaud. Harvey témoigne de son contentement,
s'approche du coffre pour retirer assez vite l'écuelle et déclare qu'il sou-
haite fêter l'événement en payant quelques verres de bière. Il donne un shil-
ling à la fille pour qu'elle aille en chercher à un demi-mile de là. A peine la
fille est-elle sortie que Harvey va vers le coffre, approche l'assiette de lait et
imite de son mieux le son du coassement. Aussitôt la petite bête réapparaît,
il la saisit dans la main, elle lui paraît le crapaud le plus ordinaire. Il veut
néanmoins en avoir le cœur net, prend dans sa poche un scalpel qu'il avait
toujours sur lui dans ses expéditions, ouvre le corps du démon et ne trouve
pas la moindre originalité à ce crapaud-là. Il pense que la fille a dû le
ramasser dans la lande, Ta apprivoisé et s'est persuadée qu'il est le messa-
ger que Satan lui destinait. A cette minute la fille revient avec la bière, aper-
çoit ce qu'il a fait et entre dans une colère épouvantable. Elle lui lance la
bouteille de bière à la figure, le roue de coups, veut lui arracher les yeux, lui
égratigne le visage, et il a bien de la chance de sortir vivant de l'aventure.
En vain offre-t-il de l'argent, en tentant d'expliquer à la fille son illusion.
Finalement il change de discours, déclare qu'il est le médecin du Roi,
chargé par lui de découvrir si elle est sorcière, pour la jeter aussitôt en pri-
son, ou si au contraire elle est innocente. Il parvient alors à s'échapper de
ses griffes et sort sous une pluie d'injures.
Plus tard, commis comme expert par le Roi dans plusieurs procès de
sorcières, Harvey parvint à sauver la vie de quelques pauvres femmes quedes voisins malveillants accusaient de sorcellerie et qui, sans lui, n'auraient
pas échappé à la mort.
Les charlatans que Harvey rencontra sont plus étranges encore. Très
souvent ce ne sont pas des charlatans à part entière : ils ont une face de leur
caractère tout à fait raisonnable et une autre face qui est celle d'un illu-
miné. Ainsi Sir Kenelm Digby, qui écrit un Traité sur le Corps et sur l'Ame
où il défend avec pertinence la découverte d'Harvey contre ses détracteurs,
mais qui prétend aussi guérir les malades à distance avec une «poudre de
sympathie» faite de vitriol. Ainsi encore Robert Fludd, qui appartient à la
secte des Rose-Croix, traite avec sérieux et dévouement sa clientèle londo-
nienne, construit de merveilleux automates, mais invente aussi un onguent
secret qu'il nomme l'onguent des armes : quand un homme est blessé, on
enduit de son onguent, non pas la plaie, mais l'arme qui l'a provoquée;
l'onguent fait naître une sorte de remords dans l'arme, laquelle envoie aus-
sitôt à travers l'espace des ondes qui vont guérir la plaie.
Toutes ces histoires, et beaucoup d'autres que j'ai consignées dans le
Journal d'Harvey, montrent bien que la crédulité est le propre de l'homme.
C'est une propriété de notre esprit profondément ancrée et toutes les rai-
sons du monde ne peuvent la tenir en respect que chez un nombre restreint
d'êtres humains. Nous voyons bien aujourd'hui que cette étrange propriété
prospère avec autant de vigueur qu'au siècle de Harvey, le progrès des con-
naissances scientifiques n'y a rien fait; en ce domaine comme en tant
d'autres, j ' a i senti que l'expérience vécue par Harvey était une expérience
éternelle, aussi instructive sur ce qui se passe aujourd'hui que sur ce qui
s'est passé hier.
Mais dans cette Europe du XVIIe siècle, baignant dans ce singulier
mélange de crédulité, de magie d'enfermement dans des traditions aveu-
gles, quelques hommes construisent les fondements du raisonnement criti-
que, de l'esprit scientifique et des méthodes de pensée qui seront les nôtres.
Harvey est de ceux-là. Et comme Harvey voyage beaucoup à travers
l'Europe, il va entrer en contact avec toute une série de personnages qui
s'efforcent de dégager le siècle de sa gangue d'obscurantisme. Parmi eux se
trouvent Descartes, Mersenne, Gassendi, Francis Bacon dont Harvey est le
médecin, Thomas Hobbes dont Harvey est l'ami. Il y a quelque chose
d'émouvant à voir ainsi naître cette intelligence européenne au travers
d'échanges entre hommes de pays différents, qui ne cessent de s'écrire, de
s'envoyer leurs ouvrages et de se rencontrer.
J'ai d'ailleurs été étonné de voir des hommes comme Harvey voyager
sans cesse, alors que les moyens de transport de ce temps apparaissent, ànos yeux, d'une désespérante lenteur. Harvey s'émerveille parce qu'il n'a
mis que douze jours pour se rendre de Londres à Paris. Et pourtant nous le
voyons visiter la France, la Hollande, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la
Bohême. Il traverse l'Europe en proie à la guerre de trente ans, visite des
régions dévastées par la peste, voit la souffrance du peuple à Coblence et à
Naples, est à Paris quand Richelieu lutte contre Marie de Médecis, assiste à
des batailles et des conflits et prononce des paroles qui pourraient être
d'aujourd'hui sur la folie des hommes qui usent leurs forces à se battre
entre eux au lieu de les unir contre leurs malheurs.
Harvey rencontre aussi les peintres, les sculpteurs, les céramistes, les
collectionneurs d'art, les écrivains et les dramaturges de son temps. Il va
voir Shakespeare dans son théâtre et connaît Ben Jonson, l'auteur de Vol-
pone, que les Anglais tenaient alors pour supérieur à Shakespeare. Chaque
fois qu'un peintre était invité à la cour d'Angleterre pour faire le portrait
de quelques gentilshommes, Harvey voulait avoir, lui aussi, son portrait.
On a retrouvé la trace de quatorze portraits de lui par les peintres les plus
divers. J'ai pu reconstituer les séances de pose de notre héros dans l'atelier
de Van Dyck, que le roi Charles avait installé luxueusement à Londres. Les
séances de pose duraient exactement une heure, jamais davantage; quel-
ques musiciens, dans un coin, avaient la tâche de distraire le modèle; bien-
tôt une horloge avertissait que le temps était achevé; Van Dyck faisait une
révérence profonde, fixait le jour de la prochaine séance et passait à la per-
sonne suivante. Entre deux séances, on devait faire envoyer ses habits par
un valet. Van Dyck ébauchait seulement le dessin, choisissait la posture, les
proportions et l'arrangement du portrait, s'attachait au détail des traits du
visage, puis faisait peindre les habits par ses élèves; il les chargeait aussi de
peindre les mains, pour lesquelles il entretenait à demeure quelques modè-
les à gage. Enfin, il donnait lui-même la touche dernière et c'est là que son
génie éclatait. Harvey raconte que son portrait était à la fois ressemblant et
pourtant, dit-il, plus beau que le modèle, car Harvey, petit de taille et les
traits moins réguliers que ceux de ses frères, n'aimait pas son visage, bien
qu'il aimât à l'évidence le faire reproduire par de grands peintres.
En définitive, ce qui domine chez Harvey, c'est un intense désir
d'observer, de comprendre et d'entreprendre. Malgré toutes les difficultés
qu'il rencontre, il est constamment habité par une certaine passion de la
vie. Il n'a pas seulement consacré ses recherches au cœur et à la circulation,
il a aussi écrit un volumineux ouvrage sur la génération des animaux. Il
regarde, heure par heure, comment un œuf donne naissance à un poulet. Il
voit, dès le troisième jour d'incubation, se former et battre dans l'œuf le
cœur de l'embryon. Sur le dessin de la page de garde de son livre, il inscritla formule fameuse «tout être vivant naît d'un œuf». Il voit dans la genèse
d'un être vivant le plus grand des miracles et il en garde les yeux éblouis.
Certes, à d'autres moments, il n'échappe pas au découragement et au
désespoir, au point de songer à deux reprises au suicide. Mais très vite le
reprend l'amour de la vie, un amour passionné pour l'aventure humaine.
Et ce mélange d'angoisse et de bonheur, qui est le propre de chacun
de nous, il me semble que Harvey nous en donne la clé. L'angoisse, il l'atté-
nue en oubliant de trop chercher le sens de la vie, mais il trouve le bonheur
en n'oubliant pas de chercher à donner un sens à sa vie.
Je vous le disais en commençant, cet homme d'il y a trois siècles m'a
paru très proche de nous. Il faut, m'écrivait un lecteur, que vous ayez beau-
coup aimé Harvey pour avoir écrit ce livre. Et c'est vrai que j'ai plus d'une
fois, en les découvrant, partagé ses joies et ses peines, un peu comme ce
romancier du siècle dernier disait avoir dans la bouche un goût d'arsenic
quand son héroïne s'empoisonnait. C'est vrai que j'ai été heureux quand,
enfin, des voix s'élevèrent un peu partout dans le monde pour défendre
Harvey contre ses détracteurs. Peu à peu la vérité triomphait. La France,
qui avait été si hostile à la découverte de Harvey, se racheta par de célèbres
écrits, qui n'étaient pas seulement le fait de médecins. Molière se moqua
des ennemis de Harvey, en ridiculisant dans Le malade imaginaire le jeune
et imbécile Thomas Diafoirus, qui fait hommage à sa belle de sa thèse con-
tre les «circulateurs». Boileau publie son «Arrêt burlesque» ou le Ministère
public met en accusation la dénommée Raison, pour avoir reconnu au
cœur la fonction de voiturer le sang et la Cour décide de faire désormais
«défense au sang d'être vagabond, errer et circuler dans le corps». La Fon-
taine reprend la défense de Harvey dans un poème qui lui avait été com-
mandé sur le quinquina par la Duchesse de Bouillon et qui n'est d'ailleurs
pas la plus brillante de ses œuvres. Le jeune Louis XIV lui-même, pour
faire échec à l'aveuglement de la Faculté, ouvre une chaire indépendante
d'anatomie dans les Jardins du Roi (aujourd'hui le Muséum d'histoire
naturelle) et la confie à Dionis, médecin de 32 ans qui défendra la décou-
verte de la circulation du sang et le vrai rôle du cœur. C'est vrai enfin que
j'ai été heureux quand, enfin unanimement reconnu comme le plus grand
médecin d'Angleterre, Harvey assista au Collège royal des Médecins de
Londres à l'inauguration de sa propre statue, avec sur le socle ces mots :
En témoignage éternel de reconnaissance
du Collège des Médecins
pour les travaux de William Harvey
sur les mouvements du sang et l'origine des animauxVous pouvez aussi lire