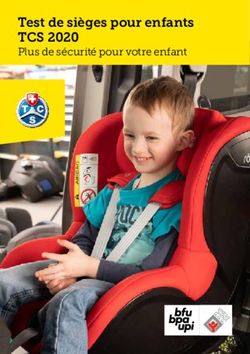Les moteurs du développement de la métropole Nantes Saint-Nazaire - Par Laurent DAVEZIES
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
__________________________________________________________________________
Les moteurs du développement de la métropole
Nantes Saint-Nazaire
__________________________________________________________________________
Par Laurent DAVEZIESStratégie métropolitaine
L’analyse par Laurent Davezies des moteurs du développement
économique de la métropole Nantes Saint-Nazaire
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Syndicat Mixte du SCOT, la SAMOA conduit
une réflexion sur la stratégie de la métropole Nantes Saint-Nazaire en privilégiant une démarche de
projets qui doit concourir à la constitution d’une culture partagée sur les enjeux métropolitains. Dans le
champ du développement économique, la SAMOA a décidé de faire appel à l’économiste Laurent
Davezies, Professeur à l’Université Paris Val de Marne, en poste à l’institut d’urbanisme de Paris et
expert reconnu auprès d’institutions nationales et internationales.
Auteur de diagnostics territoriaux pour des collectivités territoriales françaises, ses travaux de
recherche portent essentiellement sur les politiques régionales, les politiques urbaines et de
développement économique local ainsi que les politiques financières publiques. Fin connaisseur des
territoires français, c’est également un observateur avisé des réalités locales de notre territoire, pour
avoir mené, en février 2004, une étude sur les moteurs de la CARENE intitulée « Le développement
de la CARENE dans son environnement».
Il revient ici, à notre demande, pour dresser une analyse des moteurs du développement économique
de la métropole Nantes Saint-Nazaire. Une métropole qui, comme nous le verrons, ne peut se limiter
à ses seules limites institutionnelles et que nous nous sommes, dès lors, efforcés d’exprimer le plus
conformément possible à la réalité vécue de ce territoire.
L’expertise qui procède d’une nouvelle approche de l’économie territoriale de Nantes Saint-Nazaire
permet là aussi de resituer le rôle et la particularité de chaque sous ensemble, mais autorise avant
tout à comprendre le fonctionnement général de cette réalité métropolitaine et à saisir la pertinence de
raisonner à une échelle élargie. Un regard comparatif sur les autres aires métropolitaines françaises
permet par ailleurs d’éclairer la singularité de son développement.
Cette expertise a fait l’objet d’une restitution au cours d’un atelier (23 février 2005) auprès d’élus et de
techniciens du SCOT et sera soumis au débat lors de la conférence métropolitaine du 10 juin 2005.
La diffusion de ces données nous paraît être un enjeu pour les acteurs de ce territoire. La SAMOA se
propose dans ce document d’en faciliter la lecture par une synthèse des analyses de Laurent
Davezies (I) avant la restitution de son étude (II) et l’explication du découpage retenu pour le territoire
d’étude. La SAMOA met également à disposition du lecteur intéressé le dossier complet de l’expertise
avec données chiffrées, cartes, graphiques à l’appui.
1__________________________________________________________________________ I Synthèse SAMOA des analyses de Laurent DAVEZIES __________________________________________________________________________
Laurent Davezies : agir pour maintenir la dynamique
Laurent Davezies fonde son analyse du développement local sur les revenus dont dispose un
territoire. Il nous éclaire sur la diversité des « moteurs économiques » de la métropole Nantes Saint-
Nazaire et la nécessité d’une action publique forte pour préserver les sources de ce développement
atypique.
2-1 Le périmètre d’étude de la métropole Nantes Saint-Nazaire (carte page 3)
Le territoire d’étude pour l’intervention de Laurent Davezies a été composé de la façon suivante :
A la base, les aires urbaines de Nantes et de Saint-Nazaire, celles d’Ancenis et de Clisson ainsi
que les communes multipolarisées s’y rattachant. Cet ensemble constitue pour l’INSEE
l’ensemble urbain Nantes Saint-Nazaire.
Ont été rajouté les territoires suivants :
- Les pôles d’emploi de Pornic et Saint-Brévin ainsi que les communes de l’espace rural
interstitiel entre ces pôles et l’aire urbaine de Nantes (le pays de Retz)
- Le pôle d’emploi de Blain, constitué de la seule commune de Blain.
Population (99) : 1 024 075
Nombre d’emplois (99) : 408 447
Cet espace informel n’a d’autre vocation que de représenter une base d’étude, plus proche de la
réalité économique que le découpage institutionnel. Mais il est aussi discutable, en tout cas dans ses
marges, sans que cela ne remette en cause les grandes données économiques qui s’y rattachent.
z Sources statistiques de Laurent Davezies
INSEE
UNEDIC
DGI
CNAF
Ministère du Tourisme
Annexe 1 : Le découpage du territoire (à la fin de ce document)
Annexe 2 : les données statistiques de Laurent Davezies « les moteurs du développement de la
métropole Nantes Saint-Nazaire », éléments du rapport, janvier 2005 (communiqué sur
demande).
2Les territoires vécus de l’INSEE - Datar
Périmètre d’étude de la métropole Nantes – St Nazaire
32-2 L’équilibre des revenus de la MNSN explique sa dynamique
z Chiffres à l’appui, Laurent Davezies s’écarte résolument des analyses traditionnelles :
. Le développement d’un territoire local n’est pas seulement lié à l’efficacité de ses
entreprises engagées dans la compétition économique mondiale. L’évolution de son produit
intérieur brut, le rapport entre le PIB et le nombre d’habitants ne suffisent pas à éclairer sa
situation économique. Pourquoi, sinon, l’Ile-de-France, qui est l’un des territoires les plus
productifs au monde, connaît-elle les difficultés que l’on sait ?
. La cohésion sociale d’un territoire est un facteur de développement économique, autant
que la présence d’infrastructures ou d’ « emplois métropolitains supérieurs ». Elle n’est pas
un effet mais une condition de la croissance économique locale. La cohésion donne à un
territoire la « solidité » dont a besoin l’économie pour s’y développer.
Les métropoles qui créent de la richesse au détriment de leur cohésion sociale et spatiale
s’affaiblissent : le revenu y progresse moins vite que la valeur ajoutée, le cadre de vie s’y
dégrade et une part croissante de leurs actifs les quittent. Les villes fragmentées, déchirées,
ont de moins bonnes perspectives de développement.
. Ce constat ne contredit pas l’analyse selon laquelle la création de richesse est un
préalable à sa redistribution, mais il oblige à lui donner une perspective renouvelée, plus
large : la richesse d’un territoire local n’est pas ce que produisent ses entreprises mais les
revenus qu’il attire et leur transformation plus ou moins grande en activités domestiques.
La base économique d’un territoire, constituée par ces revenus, est exposée à la
concurrence avec les autres territoires. Le secteur domestique est moins directement
soumis à cette concurrence.
. Traduction de cette analyse ci-dessous à travers le cas de la métropole Nantes Saint-
Nazaire, étudié par Laurent Davezies.
Æ Les revenus captés forment la « base économique ». Ils ont quatre sources :
. La production de biens et services vendus à l’extérieur, dite aussi base productive privée :
Sur la métropole Nantes Saint-Nazaire, la base productive est formée des revenus de
100 000 salariés, dirigeants d’entreprises, 7 000 agriculteurs et pêcheurs vivant et
travaillant sur ce territoire. Elle s’élève à 2,4 milliards d’euros de revenus. Soit une base
productive représentant 25 % du total des revenus formant la base économique
locale.
Trois territoires différents : la zone de Saint-Nazaire dont les spécialisations industrielles
constituent un puissant moteur pour l’ensemble de la MNSN et dont l’emploi continue à
se développer (+ 1 600 salariés entre 1993 et 2001) ; le cœur de l’aire urbaine de Nantes
qui se spécialise dans les activités à haute valeur ajoutée et dont l’emploi croit
rapidement (+ 6000) ; le reste de la MNSN qui, à l’exception des zones résidentielles
littorales, se partage un spectre d’activités industrielles (à noter, dans ces territoires
industriels périphériques , la croissance forte des dirigeants d’entreprises de plus de 10
salariés)
. Les salaires publics, dite base publique :
Sur la métropole Nantes Saint-Nazaire, la base publique fait rentrer 1,8 milliards d’euros
de revenus, issus des revenus de 96 000 salariés du secteur public. Soit une base
4publique représentant 19 % du total des revenus formant la base économique
locale.
Les deux tiers des emplois publics sont localisés sur l’unité urbaine de Nantes.
Pas de sur-représentation par rapport aux autres emplois comparé à la moyenne
nationale.
. Les revenus de personnes résidant mais ne travaillant pas sur le territoire local, dite base
résidentielle (ou présentielle, liée à la présence).
Sur la métropole Nantes Saint-Nazaire, la base résidentielle fait rentrer 4,1 milliards
d’euros de revenus, issus des revenus de 26 000 actifs travaillant en dehors de ce
territoire (0,5 milliard d’euros), 171 000 retraités (2,3 milliards d’euros), et des dépenses
des touristes (1,3 milliard d’euros). Soit une base résidentielle représentant 42 % de la
base économique locale.
La balance de la MNSN est négative avec les zones voisines de l’Ouest. Elle leur fournit
des emplois et des revenus à plus d’actifs résidant sur ces zones qu’elles ne le font pour
les siens. Mais elle est positive avec l’Ile-de-France (effet TGV)
Spécialisation sur l’accueil résidentiel des cadres : 10 % des cadres vivant dans la MNSN
n’y travaillent pas : 3 400 cadres vivant hors de la MNSN viennent y travailler, 5 100
cadres vivent dans la MNSN et travaillent ailleurs. Soit un solde positif de 1 700 cadres
dont le revenu est dépensé sur place alors qu’ils n’y travaillent pas (qui représentent
aussi un potentiel d’emplois de haut niveau à capter ou développer sur place).
Les retraités pèsent moins lourd parmi les titulaires de revenu qu’en moyenne en
province (indice 100, MNSN 89), mais leur nombre progresse plus vite (23 % contre
16%) : « entre 1990 et 1999, quand la MNSN enregistre un gain de 49 000 actifs
occupés, elle enregistre 32 000 retraités supplémentaires ! ». De ces 32 000, 12 000 sont
imputables aux retraités venus de l’extérieur de la MNSN. 37% de ces retraités venus de
l’extérieur habitaient en Ile-de-France neuf ans plus tôt.
L’emploi des secteurs touristiques progresse plus vite que la moyenne de la province (39
% contre 33%), soit 2 700 créations nettes d’emplois entre 1993 et 2001.
Forte spécialisation des territoires littoraux dans le tourisme et la présence de retraités
. Les revenus issus des prestations sociales : c’est la base sociale
Sur la métropole Nantes Saint-Nazaire, cette base sociale fait rentrer 1,2 milliards
d’euros de revenus. Soit une base sociale représentant 14 % de la base économique
locale.
Æ La base économique d’un territoire génère une activité domestique indispensable à sa
cohésion sociale:
. Les biens et services produits et vendus localement pour répondre à la demande des
habitants (boulangers, femmes de ménage, médecins, agents immobiliers, garagistes, etc.).
Sur la métropole Nantes Saint-Nazaire, l’activité domestique représente
la moitié des 410 000 emplois.
5. L’activité domestique est déterminante pour la cohésion sociale locale : ces emplois sont
« largement abrités de la concurrence mondiale, peuvent maintenir une activité non
technologique, à faible gain de productivité, donc plus ouverts aux actifs locaux les moins
qualifiés ». Contrairement au secteur productif privé et à ses « emplois métropolitains
supérieurs » l’activité domestique influe fortement sur le taux d’emploi et le taux de pauvreté
d’un territoire local.
z La dynamique de Nantes Saint-Nazaire
« L’avantage comparatif économique de la MNSN tient globalement à une capacité
d’attraction liée à sa diversification fonctionnelle (productivo-résidentielle), elle-même
génératrice d’une cohésion sociale et territoriale qui joue à son tour le rôle d’un turbo dans
l’activité de ce territoire ».
Æ La démographie
. Deuxième croissance des métropoles millionnaires derrière Toulouse entre 1990 et
1999. Idem pour le solde migratoire.
Æ L’équilibre des bases économiques
. La base résidentielle apporte autant que la base productive privée et la base publique
réunie.
. Parmi les métropoles millionnaires françaises, la MNSN est la seule à avoir trois
sources de revenus, productif, public, résidentiel fonctionnant de manière conjointe :
« Trois moteurs poussent mieux que deux. La dynamique de la MNSN comparée aux
autres villes millionnaires est, en dépit de son profil plus modeste, remarquable, et en
accélération ».
« Aucune des composantes du développement territorial ne l’emporte parce qu’elles y
sont toutes présentes… et s’épaulent mutuellement ».
« Le modèle qui apparaît, à l’examen, le plus dynamique, par comparaison entre les
territoires français est celui de l’équilibre, associant créations de richesses par la
production et revenus résidentiels et publics. C’est ce que l’on trouve dans la MNSN ».
. « L’aire urbaine de Paris, celles de Lyon et de Toulouse, dépendent plutôt de bases
productives et publiques, celles d’Aix-Marseille et de Lille de bases publiques, celle de
Nice de base résidentielle. L’aire urbaine de Rennes, beaucoup plus petite, ne dispose
pas de base résidentielle significative ».
. Attention : cet équilibre tient à « l’intégration d’une aire urbaine publique (Nantes) et
d’une aire urbaine productivo-résidentielle (Saint-Nazaire) ». A bien y regarder, la MNSN
« est encore un agrégat faisant interagir des territoires de natures et de fonctions très
diverses et dont l’ensemble est assez différent de ce que l’on trouve aujourd’hui dans les
grandes métropoles françaises ».
Æ La très bonne transformation en emplois domestiques grâce à la forte « présentialité »
. Progression de 32 % entre 1993 et 2002 des emplois domestiques « purs », ne se
développant qu’en fonction de la demande locale des ménages. La plus forte progression
des métropoles millionnaires.
6. Les interactions positives entre des composantes territoriales très différentes se lit dans
le fait que la circulation monétaire y semble très élevée.
. Cette forte dynamique tient aussi au niveau élevé de « présentialité ». La « présence »
mesure la population réellement présente sur un territoire un jour donné, soit l’équation :
Population habitante – population habitante absente + population non habitante résidante
= population présente
La « présentialité » est le fruit des aménités que développe un territoire, de l’envie que
l’on a ou non d’y résider lorsque l’on a le choix.
. Cette « présentialité » a une conséquence directe sur la demande locale. Dans les
Yvelines, 70 % de la population est là le jour le moins présent et 103 % le jour le plus
présent. En Loire-Atlantique, l’écart est très faible : 97 % le jour le moins présent, 106 %
le jour le plus présent. Ceci garantit un niveau élevé et soutenu de consommation, donc
d’activités domestiques, tout au long de l’année sur le territoire.
Æ La croissance de l’emploi
. Emploi total :
Seconde position, derrière Toulouse, pour la croissance de la population active occupée
(1990-1999), loin devant les autres métropoles millionnaires : 13,6 % pour la MNSN, 14,6
% pour Toulouse, 4 % pour Lyon, 3 % pour Aix-Marseille, 4 % pour Lille-R-T, 2 % pour
Nice.
. Emploi salarié privé :
Seconde position, derrière Toulouse, pour la croissance des emplois salariés privés et la
croissance des emplois de cadres d’entreprise entre 1993 et 2002. Première place pour
la croissance des professions libérales.
« Toulouse et la MNSN ont en commun d’avoir connu une croissance régulière de leur
emploi salarié privé qui suggère un mécanisme structurel plus fort que les turbulences
conjoncturelles ainsi qu’une base économique moins élastique aux variations
conjoncturelles (revenus publics et résidentiels) ».
-
. Faible poids des cadres d’entreprise et professions intellectuelles supérieures dans ses
actifs occupés : Sixième position des métropoles millionnaires (13,4 % contre 17 % à
Lyon, 20 % à Toulouse), mais seconde position pour leur croissance (derrière Toulouse).
Æ Le revenu des ménages
. Situation modeste : quatrième rang des métropoles millionnaires : 8 089 euros / hab,
contre 8 540 à Toulouse, 8 976 à Lyon et 9 540 à Nice. Plus élevé qu’à Aix-Marseille et
Lille-R-T.
Impôt sur le revenu par foyer égal à la moyenne de province, ce qui est peu pour une
métropole millionnaire (MNSN 99, province 100, France 118, Ile-de-France 176).
Æ La cohésion territoriale
. Le modèle classique de la « polarisation-fracture » métropolitaine ne semble pas
s’appliquer, au contraire : toutes les composantes territoriales y gagnent ».
7. Les emplois des secteurs basiques productifs se sont développés dans presque toute la
MNSN, et plutôt plus rapidement hors des unités urbaines de Nantes et de Saint-Nazaire
(qui représentent toutefois 9 500 des 15 000 créations nettes d’emplois salariés privés
entre 1993 et 2001).
. Les 14 zones d’études de la MNSN ont eu, entre 1993 et 2002, une croissance de
l’emploi salarié privé supérieure (de 27% à 75%) à la moyenne de la Province (21%), à
celle de la France (18%) et a fortiori à celle de l’Ile-de-France (12%). Dans les 14 zones,
on constate la corrélation entre croissance des cadres et croissance des ouvriers-
employés qui singularise la MNSN.
. « L’unité urbaine de Saint-Nazaire, qui est la plus pénalisée en termes sociaux, est la
grande gagnante au jeu de la création nette d’emplois induits (activités domestiques),
avec une croissance de 37 % de ce type d’emplois entre 1993 et 2002 ! ».
. Tous les territoires internes de la MNSN enregistrent une croissance du revenu des
ménages, et ce ne sont pas les territoires les plus riches dont le revenu augmente le plus
vite : le revenu des ménages a augmenté moins vite dans l’unité urbaine de Nantes que
dans les 13 autres zones d’études. De ce fait, la croissance des emplois domestiques,
liés à la demande locale, se fait sur toute la MNSN.
Æ La cohésion sociale
. Le plus faible taux de population vivant en dessous du seuil de pauvreté, avec Lyon,
des métropoles millionnaires, et le plus fort taux de réduction de ce taux dans les années
de croissance 1996-2000 (11 % parmi les moins de 65 ans, - 7,9 %), contre 20 % à Aix-
Marseille, 17 % à Lille-R-T, 15,7 % à Nice, 12,7 % à Toulouse.
. La forte croissance des actifs cadres va de pair avec une forte croissance des actifs
ouvriers et employés, contrairement au « modèle » métropolitain habituel (Ile-de-France,
Lyon). La MNSN partage cette caractéristique avec Toulouse.
. « La MNSN a cette particularité de bénéficier à la fois de l’effet « richesse
métropolitaine » et de la diversité de la structure de sa base économique lui permettant
une réduction plus rapide du nombre de ses pauvres en période d’embellie macro-
économique ».
Æ L’intercommunalité favorable à cette cohésion
. La comparaison entre les inégalités de potentiel fiscal entre les 14 zones statistico-
géographiques et entre les 22 EPCI concernées par le territoire d’étude de la MNSN ne
révèle pas de divergence entre les deux, au contraire.
Ceci montre que l’organisation politique des intercommunalités a plus été dans le sens
des gains de cohésion que l’inverse, à la différence de ce qui est souvent observé dans
les aires urbaines à cause de « mariages endogamiques » de communes riches entre
elles.
Æ Une forme « non métropolitaine » de développement ?
« Sous pratiquement tous ses aspects économiques et sociaux, la MNSN apparaît
différente de ce qu’est aujourd’hui une métropole française ». Sa forte dynamique
n’entraîne pas de fragmentation sociale et territoriale, mais au contraire la solidarité
croissante de ses composantes, « son renforcement comme un ensemble socio-
économique »
8. Diffusion territoriale des emplois et des revenus au lieu de la concentration
caractéristique des métropoles.
. Croissance conjointe des emplois supérieurs et ouvriers-employés au lieu du
découplage habituellement constaté.
. Moindre taux de pauvreté que dans les métropoles millionnaires françaises.
. Modestie du revenu des ménages par rapport aux métropoles millionnaires françaises.
. Services supérieurs aux entreprises (conseil en gestion, publicité, etc.) moins présents
que dans la moyenne de province, avec une croissance également moindre : 3,6 % des
emplois en 2002 contre 4,1% à Toulouse, 4,3 % à Bordeaux, 5,1 % à Lyon. « La MNSN
apparaît à cet égard comme un territoire dont la base productive est plus technique que
tournée vers le business management ».
2-3 Les risques et les enjeux que souligne Laurent Davezies
« La question est maintenant de savoir si la MNSN a aujourd’hui mangé son pain blanc ou si les
résultats d’aujourd’hui prédisent ceux de demain…Sommes-nous face à une forme de développement
« pré-métropolitaine » ou « alter-métropolitaine » ? »
z Un risque : avoir mangé son pain blanc
Æ La diffusion territoriale des activités et la cohésion sociale moins mise à mal qu’ailleurs ne
seraient que les signes du retard de la « métropolisation » en cours de NSN. Le rythme de
développement étant bien de type métropolitain, la concentration des activités et la ségrégation
sociale ne seraient qu’une question de temps.
z Un enjeu : Maintenir un développement sur ces bases
Æ « Les acteurs locaux français ont souvent tendance à penser que la mondialisation de la
production les réduit au statut de « badaud » de l’évolution, voire de la fracture de leur territoire.
Les éléments réunis ici visent à monter qu’il n’en est rien ».
« Les moteurs actuels – et plus encore futurs – de la croissance locale résident dans la
préservation et la fabrication d’un environnement permettant à la fois d’attirer des facteurs de
production modernes (capital et travail), de retenir et de porter les projets productifs locaux,
mais aussi de préserver le véritable capital que constituent les équilibres sociaux et territoriaux
eux-mêmes dépendant de la diversité des spécialisations territoriales et de la qualité du cadre
de vie ».
Æ La chance d’avoir trois moteurs de développement économique est aussi une « injonction à
maintenir et à gérer cet équilibre (..) en inscrivant dans les politiques et les choix
d’aménagement les mesures permettant de limiter les risques de surchauffe (urbanisation,
coûts fonciers/immobiliers..), d’arbitrer dans les concurrences d’usage du sol entre
spécialisations territoriales, de développer des infrastructures permettant une meilleure
intégration/fluidité du modèle de développement de la MNSN, d’assurer un équilibre entre
fonctions productives et « reproductives » simples et élargies (culture, service public
d’éducation…), et de ménager la rente résidentielle, qui comme toutes les rentes se consomme
plus qu’elle ne se reproduit ».
9__________________________________________________________________________
II L’étude de Laurent DAVEZIES
__________________________________________________________________________Les moteurs du développement de la métropole Nantes – St Nazaire
Laurent davezies- Université Paris 12- Février 2005
L’étude commandée par la Samoa1 visait à identifier, localiser et évaluer les moteurs du
développement de l’ensemble de la Métropole Nantes-Saint Nazaire et à en mesurer les effets
sur son développement. Pour aller directement aux conclusions, il s’est agi de comprendre en
quoi son fonctionnement métropolitain –ou plutôt peut-être « alter-métropolitain »-, fondé sur
un équilibre entre différents moteurs, permettait d’expliquer l’étonnant succès économique et
social actuel de ce territoire en même temps que le partage de ce succès ente ses différentes
composantes. La présente note vise à synthétiser l’ensemble des analyses qui ont été menées.
Le lecteur voulant en savoir plus sur tout ou partie de ces analyses trouvera en annexe leur
présentation détaillée sous forme de fiches/diapos thématiques.
Le cadre d’analyse : la « théorie de la base économique »
En préambule, que le lecteur pressé pardonne l’auteur, il est nécessaire de dire deux mots du
contexte théorique de l’étude. Le cadre analytique de cette étude s’écarte en effet résolument
des analyses traditionnelles –et dominantes- du développement territorial qui postulent que les
qualités des systèmes productifs des territoires, dans un univers de compétition mondialisée,
suffisent à leur garantir un développement soutenu. Ces analyses, pourtant, échouent à
comprendre pourquoi les territoires les mieux adaptés à cette compétition connaissent
aujourd’hui de graves difficultés économiques et sociales (à commencer par l’Ile de France)
et négligent les cadres environnemental, social, en bref territorial, dont on peut voir qu’ils
constituent pourtant le premier facteur d’un développement productif durable. La notion de
« métropole » qui fait aujourd’hui l’objet d’une forme de fétichisme, est, on le sait, à la fois le
lieu des gains de compétitivité productive et de déstabilisation sociale et territoriale : le « tout
productif » exclut des parts croissantes de la population active la plus vulnérable, alimente la
pauvreté, génère la ségrégation socio-spatiale, mine la cohésion des territoires. La
« métropole » serait aujourd’hui le seul destin de la grande ville, hors le déclin, et cela à un
coût social qui serait inévitable. Le dilemme « métropolisation »-« cohésion » se poserait dans
les termes de la tragédie grecque !
La « cohésion » est généralement traitée comme une problématique sociale ou politique
n’ayant que peu à voir avec la « vraie économie ». Les économistes, du reste, laissent cette
question aux bons soins des sociologues et des géographes et ne l’intègrent pas dans leurs
modèles… Elle est cantonnée dans le registre des effets ou des retombées, voulus ou non
voulus, et peu ou pas dans celui des facteurs premiers de la croissance locale. Le vocabulaire
de la cohésion est chargé de connotations humanistes ou affectives (solidarité, équité, égalité,
redistribution,…), alors que si l’on revient à son sens premier, elle évoque d’abord la question
de la solidité du corps social (et c’est encore plus vrai du terme solidarité qui dérive
directement de solidus). Revenir à cette définition première place la cohésion non pas en aval
mais en amont des conditions de développement économique : elle constitue un véritable bien
1
Cette étude a été réalisée à la suite d’une première analyse menée à la demande de la CARENE (Davezies L.
(2004) « Le développement de la Carene dans son environnement ». Rapport à la Communauté
d’Agglomération de Saint-Nazaire. Œil-CRETEIL-Université Paris 12. Créteil. Polygraphié 45 pages + annexes)
10public et un facteur de développement autrement plus stratégique que la dotation en
infrastructures ou la présence d’ « EMS » (emplois métropolitains supérieurs).
Les territoires « métropolitains » qui se développent rapidement en termes de création de
richesses au détriment de la cohésion socio-spatiale apparaissent aujourd’hui affaiblis2 : leur
revenu progresse moins vite que leur valeur ajoutée, le cadre de vie s’y dégrade et finalement
une part croissante de leurs actifs les quittent comme en témoigne le solde migratoire négatif
des villes françaises les plus spécialisées dans la production. Dans un contexte, nouveau à
l’échelle séculaire, dans lequel la population active française va commencer à décroître en
nombre absolu (« Le choc de 2006 » de Michel Godet), la capacité des territoires à retenir et
capter les populations de jeunes actifs constituera le principal enjeu de leur développement
productif. Mais on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre : ce sont les villes les plus
attractives sur le plan résidentiel –et leur « cohésion » fait partie de ces facteurs d’attractivité-,
dotées, on le verra, des meilleurs « coefficients de présentialité», qui auront à l’avenir les
meilleures perspectives de développement productif. Les villes « solides » ont aujourd’hui de
meilleures perspectives économiques que les villes fragmentées, déchirées, duales ou éclatées
(pour reprendre les adjectifs accompagnant généralement l’analyse des métropoles).
La métropole Nantes-Saint Nazaire (MNSN) constitue d’ores et déjà une illustration de ce
nouveau modèle de développement territorial et particulièrement urbain qui est en train
d’émerger en France.
Par ailleurs, de la même façon que l’on a discuté ce que sont les nouveaux facteurs du
développement territorial, il convient d’avoir une définition de ce qu’est ce développement
territorial en tant que tel, et, pour les acteurs locaux, de se doter d’un objectif clair et cohérent
sur ce qu’ils entendent que soit le futur de leur territoire. La littérature académique ou
politico-administrative n’offre pourtant aucune définition explicite du contenu de ce qu’est le
développement local ou régional. Les facteurs du développement productif (la compétitivité
productive, le PIB par emploi ou habitant,…) ont fini par occuper l’ensemble du champ du
développement et sont généralement confondus avec ses effets attendus (l’amélioration
durable du bien-être de la population). Le développement comme processus fait l’objet d’une
abondante littérature (des fonctions de production des économistes aux analyses
sociologiques de la « gouvernance »), mais on ne trouve rien d’articulé sur le contenu du
développement. D’où le désarroi analytique et politique face à des situations locales associant
système productif brillant et crise sociale et démographique ou, à l’inverse, sous-
développement productif et bonne santé sociale…
Ce qui apparaît aujourd’hui comme la seule approche analytique rendant compte de la nature
et des facteurs du développement d’un territoire est l’ancienne « théorie de la base
économique », datant de plus d’un siècle et généralement oubliée (mais maintenue et
transmise par quelques auteurs comme Loeiz Laurent, l’ancien directeur de l’Insee Bretagne).
2
Davezies L. (2003) La diversité du développement local dans les villes françaises. Rapport à la DATAR. Œil-
CRETEIL-Université Paris 12. Créteil. Polygraphié 60 pages + annexes. (on trouvera dans le Premier Rapport de
l’Observatoire des Territoires, a paraître à la Documentation Française à l’été 2005, l’essentiel des analyses et
cartes développées dans ce rapport non publié).
11Dans cette approche, le développement d’un territoire repose sur deux facteurs : (i) sa
capacité à maximiser les flux de revenus –appelé « base économique »- en provenance du
reste du monde (y compris de la France) et (ii) l’intensité de la circulation monétaire interne
(i.e. la propension des ménages du territoire à consommer localement). Le développement, en
tant que résultat, est exprimé en termes d’emplois, de revenus et de croissance démographique
du territoire. Cette approche par les revenus permet de rendre compte de ce qu’est la réalité du
développement de la population locale et de ses enjeux3.
Le "secteur basique" est celui qui apporte toutes sortes de revenus captés hors de la ville.
L’autre secteur de la ville est le "secteur domestique" dont le développement est induit par la
base économique par des mécanismes multiplicateurs d'emploi et de revenu. Il s'agit de
secteurs d'activité produisant des biens et des services vendus localement (boulangers,
médecins, commerçants, aides ménagères…). Ces secteurs, et la population qu'ils font vivre,
dépendent de la demande locale et du revenu local eux-mêmes déterminés par la base et par la
propension à consommer localement de la population. Il y a donc deux secteurs économiques
locaux : l’un exposé à la concurrence avec les autres territoires et le reste du monde, l’autre
protégé de la concurrence et qui permet aux actifs les plus vulnérables d’être employés, inclus
dans la société locale, par le biais d’activité à faible productivité et à ajustement structurel
lent. L’excellence et la vulnérabilité peuvent ainsi cohabiter d’autant plus positivement (et par
des mécanismes de solidarité d’abord marchands) que les flux de revenus basiques et leur
propension à stimuler les dépenses locales sont élevées.
La métropole Nantes Saint Nazaire, singulière par la structure moyenne de ses bases.
Le territoire de la MNSN regroupe un million d’habitants et permet de hisser ce territoire dans
le cercle restreint des villes millionnaires de la province française (aires urbaines de Lyon,
Aix-Marseille, Lille, Toulouse et Nice). À l’examen, ce qui apparaît frappant est le fait que,
dans ce club, –y compris si on y ajoute l’aire urbaine de Paris- la MNSN est celle dont les
bases du développement économique sont les plus équilibrées. Les revenus qui viennent
irriguer son économie proviennent à la fois (i) de la contrepartie des ventes de biens et
services produits dans la MNSN et vendus à l’extérieur (base productive privée), (ii) des
salaires publics (base publique), (iii) ainsi que des revenus apportés par des agents qui ne
travaillent pas dans la MNSN (base résidentielle) : retraités, touristes et actifs y vivant et
travaillant hors de la MNSN).
L’aire urbaine de Paris, comme celles de Lyon et de Toulouse, dépend plutôt de bases
productives et publiques, celles de Marseille-Aix et de Lille de bases publiques, celle de Nice
de bases résidentielles. La MNSN est la seule, dans ce club, à disposer, à la fois, des trois
moteurs (un peu à la façon de ce que l’on retrouve dans quelques rares territoires comme
l’aire urbaine d’Annecy). L’aire urbaine de Rennes, beaucoup plus petite, ne dispose pas non
plus de bases résidentielles significatives. La MNSN est un territoire qui n’est pas industriel
mais qui a de l’industrie, qui n’est pas résidentiel mais qui a des atouts résidentiels, qui n’est
3
Pour des développements conceptuels et méthodologiques, voir : Davezies L. (2004) "Temps de la production
et temps de la consommation: les nouveaux aménageurs du territoire?" n° 295 Futuribles. Mars 2004. Davezies
Laurent (2000) "Revenu et territoires" in Le développement local, Rapport du Conseil d'Analyse Economique
n°31 ,Paris. La Documentation Française. 15 pages
12pas public mais qui a de l’emploi public… elle est donc mue par trois moteurs, ce qui
constitue une chance –la MNSN « en a sous le pied »-, on le verra, en même temps qu’une
injonction à maintenir et gérer cet équilibre en opérant plus qu’ailleurs des arbitrages dans
leurs concurrences dans l’usage du sol.
Tableau 1 : Estimation des revenus basiques de la métropole Nantes-Saint Nazaire- 1999
Note : les montants sont exprimés en francs, pour des évaluations datant d’avant le passage à l’Euro
Source : Calculs de l’auteur d’après Dgi, Insee, Unedic, Cnaf,…
Tableau 2 : La structure des bases économiques des grandes villes françaises comparée à
celles des aires urbaines de Nantes et Saint-Nazaire
13Une des leçons d’un exercice d’évaluation des bases économiques territoriales réside dans le
fait que la part des revenus basiques directement issus d’une activité productive marchande
locale est partout largement inférieure à ce que constituent la somme des revenus publics
(salaires publics) et des revenus résidentiels (retraites, touristes et salaires d’actifs employés
ailleurs). Le « tout-productif », ne garantit donc pas une maximisation du revenu basique (tout
en ayant, on l’a dit, une forte propension à exclure les actifs peu ou pas qualifiés). Le « tout-
résidentiel » a ses limites également : il se traduit par la consommation d’une rente
résidentielle non-renouvelable et qui peut atteindre assez rapidement ses limites, quand le
résidentiel n’est pas utilisé comme levier du développement productif, comme on l’observe
actuellement par exemple sur la Côte d’Azur. Le modèle qui apparaît, à l’examen4, le plus
dynamique, par comparaison entre les territoires français est celui de l’équilibre, associant
créations de richesses par la production et revenus résidentiels et publics. C’est ce que l’on
trouve par exemple à Annecy. Mais aussi dans la MNSN.
La MNSN en tête du peloton des villes millionnaires
Trois moteurs poussent mieux que deux ou un : la dynamique de la MNSN comparée aux
autres villes millionnaires est, en dépit de son profil plus modeste, remarquable (et en
accélération par rapport aux années 1980). Elle opère, dans la roue de Toulouse, un
échappée : seconde pour la croissance de la population (1990-99), pour le solde migratoire (la
MNSN accélère alors que les championnes des années 1980, Nice et Toulouse, ralentissent),
pour la croissance de la population active (et première pour celle des actifs masculins), pour
celle de l’emploi total et de l’emploi salarié privé –et l’écart se creuse largement entre
Toulouse et la MNSN et les autres villes millionnaires-, pour celle de l’emploi des cadres
d’entreprise, première pour la croissance des professions libérales et pour celle des chefs
d’entreprise de plus de 10 salariés…
Pour autant, la MNSN présente un profil plus modeste que les autres grandes villes, avec un
revenu moyen par habitant qui reste inférieur à celui des autres métropoles de Province, à
4
Davezies (2003), déjà cité
14l’exception de Aix-Marseille et Lille. De même, la MNSN a, des cinq métropoles, le plus
faible taux de cadres dans ses actifs occupés. Ce retard, en dépit d’une très forte croissance de
leur nombre, est très marqué : 13,5% dans la MNSN contre 20% à Toulouse ou 17% à Aix-
Marseille.
Métropole peu « métropolisée » (avec ce que la métropolisation comporte de fractures), la
MNSN est encore un agrégat faisant interagir des territoires de natures et de fonctions très
diverses et dont l’ensemble est assez différent de ce que l’on trouve aujourd’hui dans le
« modèle » des grandes métropoles françaises. Modeste, on l’a dit notamment pour le revenu,
mais avec moins de pauvres que les autres : elle est, des métropoles millionnaires françaises,
celle dans laquelle la part de la population en dessous du seuil de pauvreté est la plus faible et
une de celles dans lesquelles cette population s’est le plus réduite dans les années de
prospérité 1996-2000. Cette « modestie » associée à une faible présence de populations
pauvres signe le caractère « pré-métropolitain » de la MNSN et reflète, on le verra, la
diversité des moteurs de son développement qui, plus qu’ailleurs, offre des opportunités de
développement personnels à un large spectre d’actifs y compris peu ou pas qualifiés (à
l’inverse, parmi d’autres exemples, de l’Ile de France dans laquelle les succès productifs
passent par une exclusion croissante d’actifs vulnérables que la faiblesse des bases
présentielles francilienne ne permet pas de réintégrer dans l’activité… d’où les contre-
performances sociales spectaculaires de la région parisienne).
L’équilibre des bases de la MNSN : une co-production de ses différents territoires…
Comment ces différents moteurs se combinent-ils entre les territoires de la MNSN ? On peut
d’abord donner quelques ordres de grandeur pour l’ensemble de son territoire: (i) la base
productive permet de faire rentrer de l’ordre de 16 milliards de francs (en 2000), grâce au
travail de 100 000 salariés et chefs d’entreprises et 7000 agriculteurs/pêcheurs. (ii) La base
publique amène de l’ordre de 12 milliards de francs sous forme de rémunération des 96 000
salariés publics. (iii) La base présentielle apporte autant que les deux premières réunies : de
l’ordre de 27 milliards de francs par le truchement des 171 000 retraités, des 25 000 actifs de
la MNSN qui travaillent ailleurs, des touristes présents dans les 60 000 résidences
secondaires et des 25 000 hébergements marchands.
On peut estimer que la moitié des 410 000 emplois de la MNSN sont consacrés à des activités
tournées vers la demande locale des ménages. Ce sont ces emplois qui dépendent de la
demande locale (la propension à consommer localement) et qui, largement abrités de la
concurrence mondiale, peuvent maintenir une activité souvent « low-tech », à faible gains de
productivité et donc largement ouverte aux actifs locaux les moins qualifiés. Soulignons
encore que l’emploi de la MNSN (comme du reste en gros dans la France entière) se partage
en un quart exposé à la concurrence des marchés (et évoluant en fonction de la position
compétitive du territoire), un quart public (qui évolue avec le peuplement) et une moitié
produisant des biens et des services vendus localement (et qui évolue avec la demande, i.e. la
présence des populations, leur revenu et leur propension à consommer localement).
Dotée de bases diverses et équilibrées, la MNSN est le fait de territoires eux-mêmes
diversifiés et complémentaires :
15- La base productive se partage entre trois types de territoires : (i) la zone de Saint
Nazaire, d’abord, dont les spécialisations industrielles (notamment navales et
aéronautiques) constituent un puissant moteur pour l’ensemble de la MNSN. Les
emplois continuent à s’y développer en dépit des inquiétudes récurrentes sur l’avenir
du secteur naval (+ 1600 salariés entre 1993 et 2001). Y travaillent près de 3 000 actifs
résidants dans l’aire urbaine de Nantes et ce sont au total près de 16 000 actifs de la
MNSN qui rentrent quotidiennement dans l’unité urbaine de St Nazaire pour y
travailler ; (ii) le cœur de l’aire urbaine de Nantes, qui se spécialise dans les activités à
haute valeur ajoutée (conseil en systèmes informatiques, réalisation de logiciels,
ingénierie,…) dont l’emploi croît très rapidement (au total près de 6 000 créations
nettes d’emploi entre 1993 et 2001). Ce sont près de 46 000 actifs de la MNSN qui
vont travailler dans l’unité urbaine de Nantes… De façon générale, avec une forte
concentration nantaise des services supérieurs aux entreprises, l’unité urbaine de
Nantes constitue le pôle de services supérieurs de l’ensemble de la zone (et au delà) ;
(iii) le reste de la MNSN, à l’exception des zones résidentielles littorales, qui se
partagent un spectre d’activités industrielles (agro-alimentaire, matières plastiques,
…). Ces activités progressent globalement et pour la plupart, en termes d’emplois,
même si certaines enregistrent actuellement des difficultés (textiles, équipements
automobiles, papiers cartons,…). C’est dans ces territoires industrieux, non littoraux et
« périphériques » des deux grandes aires urbaines que se situe la croissance –on l’a vu,
plus rapide que dans les autres métropoles millionnaires- des chefs d’entreprises de
plus de 10 salariés. La zone littorale de la Turbale, peu industrielle, parvient à
maintenir son emploi dans le domaine de la pêche.
Tableau 3 : La base productive privée en 2001. Nombre et indice de spécialisation de
l’emploi salarié privé des zones d’étude de la MNSN.
HORS
AU POLE
in UU in UU St EMPLOI
Nantes Nazaire ESPACE
in AU in AU St Nantais- Nantais- in AU Nantais- RURAL
MNSN Nantes Nazaire Sud Nord Ancenis Est (Sud)
industries agro alimentaires 9 095 66 53 236 151 40 365 263
industries textiles-maroquinerie-chaussures 2 062 34 71 424 640 13 0 0
industries bois papiers cartons 3 230 69 49 372 8 284 150 49
edition 733 117 75 200 18 43 27 151
imprimerie 2 091 114 36 161 178 72 175 18
raffinage de pétrole 975 46 435 0 0 0 0 0
petrole-chimie-pharmacie 2 345 81 240 115 12 170 0 2
industrie du caoutchouc 1 128 146 2 29 9 0 0 0
transformation des matières plastiques 2 600 75 88 59 289 118 420 316
industries verre-ceramique-beton-pierre 1 251 97 47 67 194 63 114 215
travail des metaux-fonderie-chaudronnerie 8 728 72 130 124 120 248 125 95
fabrication appareils-machines 17 493 95 67 120 171 365 90 28
construction navale 6 468 3 586 0 25 0 0 12
construction aéronautique et spatiale 5 029 63 369 0 0 0 0 0
fabrication de meubles 1 076 61 54 613 379 11 137 39
industries diverses 1 943 118 19 31 92 12 0 5
informatique-recherche 8 394 145 18 113 20 8 8 3
jurid-compta-gestion-pub 9 895 126 71 41 45 45 67 54
archi-ingénierie-contrôle techn. 6 124 124 80 62 44 30 34 32
Total emploi concerné (indice de présence) 100 85 135 130 116 138 105 68
Total emploi concerné (nbre d'emplois 2001) 80 765 42 823 17 884 4 147 3 578 2 821 2 143 1 039
16HORS
MULTIPO hors UU AU POLE
LARISÉE St MULTIPO EMPLOI MULTIPO
ARRDT Nazaire LARISÉE ESPACE LARISÉE
in AU St in AU St HORS AU RURAL UU de la RURAL ARRDT
Clisson Nazaire Nazaire ENCLAVE Turbale (Nord) Cholet
industries agro alimentaires 43 573 308 730 110 129 64
industries textiles-maroquinerie-chaussures 1051 190 0 314 12 608 0
industries bois papiers cartons 1153 40 13 33 54 246 0
edition 64 0 0 0 68 0 0
imprimerie 23 105 74 13 0 49 56
raffinage de pétrole 0 0 0 0 0 0 0
petrole-chimie-pharmacie 5 15 0 0 0 0 0
industrie du caoutchouc 387 0 0 0 0 0 0
transformation des matières plastiques 320 0 25 0 0 0 0
industries verre-ceramique-beton-pierre 0 27 261 1174 0 0 93
travail des metaux-fonderie-chaudronnerie 82 102 500 385 9 188 31
fabrication appareils-machines 59 195 69 161 19 4 20
construction navale 0 0 1 0 128 0 0
construction aéronautique et spatiale 0 0 0 13 0 0 0
fabrication de meubles 219 64 341 86 0 0 0
industries diverses 957 4 8 48 26 0 421
informatique-recherche 23 20 0 2 6 0 0
jurid-compta-gestion-pub 38 48 36 48 0 16 75
archi-ingénierie-contrôle techn. 34 52 52 2 29 71 25
Total emploi concerné (indice de présence) 147 135 120 190 34 68 30
Total emploi concerné (nbre d'emplois 2001) 2 015 1 582 1 187 1 160 110 214 62
Source : calcul d’après Unedic
- La base publique fondée sur le quart de l’emploi total de la MNSN est concentrée
dans l’unité urbaine de Nantes (dans laquelle 30% de l’emploi est public). La forte
croissance démographique de la MNSN explique les performances de création nette
d’emplois des secteurs éducation/sanitaire/social : avec 31,3% (contre 18,4% en
France), soit 11 000 emplois entre 1990 et 1999. La croissance des employés de la
fonction publique est moyenne (15,6% contre 15,5% en France), avec 6 700 créations
nettes, et celle des cadres publics et professions intellectuelles supérieure, également
moyenne (24,5% , comme pour la France) avec 4 500 créations nettes. Ces emplois,
fortement centrés sur Nantes bénéficient à de nombreux secteurs de la MNSN dans
lesquels résident ces actifs. De façon générale, cependant et en dépit de leur forte
croissance, les emplois publics ne sont pas surreprésentés (par rapport aux autres
emplois) dans la MNSN par rapport à la moyenne nationale.
- La base résidentielle est constituée des pensions de retraites (près de 16 milliards de
francs), les dépenses des touristes (8,5 milliards de francs) et les revenus d’actifs
résidants dans la MNSN et travaillant ailleurs (près de 3 milliards de francs).
(i) La part la plus importante de la base résidentielle est constituée des
revenus des 171 000 retraités qui vivent dans la MNSN. Ils constituent de
plus, là comme ailleurs en France, le gros de l’augmentation des titulaires
de revenu de ces dernières années : dans le même temps où la MNSN voit
ses actifs occupés croître de 49 000 unités entre 1990 et 1999, elle
enregistre près de 32 000 retraités supplémentaires ! Nombre d’entre eux
proviennent de l’extérieur de la MNSN. On peut calculer que l’apport de
17Vous pouvez aussi lire