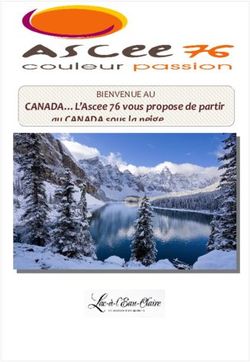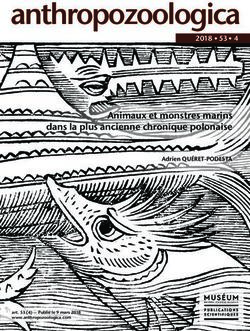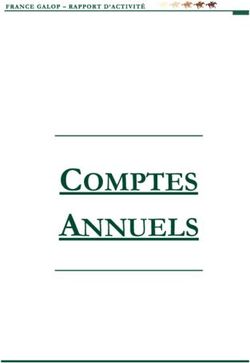Du désir à la tombe. Littérature et analité chez Guy Hocquenghem et Leo Bersani - Brill
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Du désir à la tombe. Littérature et analité chez
Guy Hocquenghem et Leo Bersani
Lorenzo Bernini
Le VIH, une machine à explorer le temps
Plutôt que d’explorer la façon dont le VIH a influencé la production littéraire,
dans cet article j’analyserai la façon dont l’histoire de l’épidémie du sida a
influencé la production théorique sur la subjectivité gaye et la façon dont cette
production théorique a interprété certains auteurs de la littérature française
qu’on peut considérer comme des classiques de l’homosexualité. Que le VIH ne
soit pas seulement un virus, mais un dispositif de subjectivation politique, ce
n’est pas une nouveauté ; ce que je voudrais souligner c’est que ce dispositif est
une machine à explorer le temps qui, dans son évolution, a modifié au fur et à
mesure le passé de l’expérience gaye aussi bien que son présent et son avenir.
En ce qui concerne l’histoire de la littérature française, par exemple, le VIH n’a
pas simplement influencé la production d’un nouveau genre narratif gay, mais
il a aussi agi sur la sensibilité du lecteur gay et donc sur le sens qu’il a donné à
des romans du passé.
Loin d’avoir des ambitions d’exhaustivité, je ne prendrai en considération
que deux lecteurs exceptionnels : Guy Hocquenghem, militant du mouvement
de libération homosexuelle français, et Leo Bersani, professeur de littérature
française à Berkeley, aux États-Unis. Tous font jouer, dans leurs théorisations,
un rôle de premier plan à Marcel Proust, André Gide et Jean Genet – mais
les moments où ils écrivent déterminent des lectures très différentes. Je me
propose donc de confronter la manière dont Hocquenghem a appréhendé les
trois auteurs avant l’apparition de l’épidémie du sida, et l’interprétation que
Bersani en a donnée pendant la crise, pour interroger le sens de la journée
d’étude « La littérature du sida » qui a été à l’origine de cet article. Si le VIH
est un dispositif à explorer le temps qui a re-sémantisé la littérature homo-
sexuelle précédant son surgissement, que se passe-t-il quand on bouleverse le
sens de rotation de ses engrenages ? Quelles conséquences dans la perception
d’être gay entraîne la relecture, à l’âge des trithérapies, de la littérature surgie
au moment de la crise du sida ?
© koninklijke brill nv, leiden, ���6 | doi ��.��63/9789004325975_010 Lorenzo Bernini - 9789004325975
Downloaded from Brill.com12/05/2021 03:41:32PM
via free accessDu Désir À La Tombe 103
Archéologie d’avant la crise ou de l’anus assassin
Guy Hocquenghem est bien sûr l’un des auteurs de référence de la littérature
française du sida, pour les intenses romans autobiographiques où il raconte sa
maladie, comme Ève1 et L’Amphithéâtre des morts2. Mais Le Désir homosexuel,
son principal essai théorique, date de 1972, lorsque, âgé de vingt-cinq ans, il est
un des animateurs du FHAR (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire3) et
ne connaît rien du destin qui l’attend, lui ainsi que beaucoup de jeunes gays
de sa génération. Il s’agit d’un traité très riche, répondant à l’homophobie que
les mouvements gauchistes partagent avec le Parti Communiste4 et réagissant
à la diffusion dans la gauche française d’une idéologie psychanalytique qui, la
plupart du temps, plutôt que de contrarier les préjugés contre l’homosexualité
risque de les renforcer. Au lieu de soutenir une réforme de la psychanalyse et
un renouvellement de la gauche, Hocquenghem se sert de la schizo-analyse
proposée par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans L’Anti-Œdipe5 pour affirmer
l’incompatibilité du désir homosexuel en tant que désir anal avec tout projet
politique, même révolutionnaire. Il rappelle que pour Freud6 la phase anale
précède la formation de l’individu civilisé en mesure de distinguer entre public
et privé, signifiant et signifié, moyen et fin, représentant et représenté. L’anus
devient ainsi pour Hocquenghem le site d’un désir qui rend le sujet incapable
de reconnaître toute hiérarchie et de sacrifier le présent pour l’avenir de la civi-
lisation humaine : en refusant le rôle du père au sommet du triangle œdipien,
1 Guy Hocquenghem, Ève, Paris, Albin Michel, 1987.
2 Guy Hocquenghem, L’Amphithéâtre des morts. Mémoires anticipées, Paris, Gallimard, 1994.
3 Les relations entre Hocquenghem et les autres membres du FHAR n’ont jamais été faciles ;
dès 1972 il prend ses distances avec eux : Guy Hocquenghem, « Aux pédérastes incompréhen-
sibles », Partisans, 66-67, 1972, repris dans Id., La Dérive homosexuelle, Paris, J.-P. Delarge, 1977,
p. 38-57. Voir aussi Id., L’Après-mai des faunes, Paris, Grasset, 1974.
4 « Il y a toujours quelque chose qui ne va pas entre le désir et la révolution, et qui se traduit
par l’éternelle lamentation qui va de ceux qui voudraient, mais ne peuvent pas, à ceux qui
pourraient mais ne veulent pas : du gauchisme au parti communiste par exemple. Il faut se
décider à renoncer aux rêves de réconciliation entre les détenteurs officiels de la révolution
et l’expression du désir » (Guy Hocquenghem, Le Désir homosexuel, Paris, Fayard, 2000 [Paris,
Éditions Universitaires, 1972], p. 157).
5 Gilles Deleuze, Félix Guattari, L’Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie 1, Paris, Minuit, 1972.
6 Sigmund Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, Leipzig, Wien, Deuticke, 1905 ; trad. fr.
Trois essais sur la théorie de la sexualité, Paris, Presses Universitaires de France, 2010.
Lorenzo Bernini - 9789004325975
Downloaded from Brill.com12/05/2021 03:41:32PM
via free access104 Bernini
l’homosexuel témoigne de la possibilité d’un mode d’existence imprévu7 qui
correspond à « l’assassinat des moi civilisés8 ».
Mais il s’agit justement d’une possibilité : pour Hocquenghem être homo-
sexuel ne représente pas en soi un défi à la société œdipienne. D’un certain
point de vue l’homosexualité est au contraire pour lui une catégorie « psycho-
policière », fabriquée dans la seconde moitié du XIXe siècle par le « monde
normal9 » afin de contrôler et réprimer les désirs déviants10 ; par conséquent,
les homosexuels peuvent facilement être soit les victimes soit les complices
du système qui les opprime. Hocquenghem ne prétend donc pas parler au
nom de tous les homosexuels ; il parle comme militant du mouvement de libé-
ration homosexuelle, et c’est en tant que militant qu’il perçoit l’exigence de
prendre ses distances avec les œuvres de Proust, Gide et Genet, qui sont pour
lui trois exemples du sentiment de culpabilité produit chez les homosexuels
des générations précédentes par la « paranoïa » de la civilisation œdipienne.
Dans Sodome et Gomorrhe et dans Contre Sainte-Beuve, le jeune auteur trouve
en effet des personnages homosexuels incapables d’amitié envers leurs sem-
blables, qui vivent cachés, suspendus entre la simulation et la dissimulation.
Dans le roman de Proust – observe-t-il – « toute relation entre l’homosexuel
et son entourage est prise dans la problématique de l’aveu11 », et la « race mau-
dite » existe en tant que tenue ensemble par la « complicité qu’entretiennent
entre eux [des] anormaux12 ». Il retrouve d’ailleurs la même faute et la même
honte d’être homosexuel chez Gide et Genet, mais chez eux il trouve aussi des
7 « Quand Deleuze et Guattari expliquent qu’à côté de la disjonction homme-femme, abou-
tissement à chaque instant de la filiation, l’homosexualité mâle, loin d’être un produit du
complexe d’Œdipe, constitue un mode de rapport social différent, ils montrent qu’à côté
du mythe freudien qui fait tout dériver de la filiation il y a un autre rapport social possible,
inacceptable pour notre société, horizontal et non plus vertical » (G. Hocquenghem,
Le Désir homosexuel, op. cit., p. 116).
8 « La grande peur de l’homosexualité s’exprime par la peur que s’arrête la succession des
générations qui fondent la civilisation. Le désir homosexuel n’est pas plus du côté de la
mort que du côté de la vie, il est bien l’assassin des moi civilisés » (Ibid., p. 182).
9 Ibid., p. 26.
10 Quatre ans avant La Volonté de savoir (Paris, Gallimard, 1976), Hocquenghem anticipe la
thèse qui rendra célèbre Michel Foucault et selon laquelle l’homosexualité, en tant que
catégorie médicale, est une invention moderne. Par conséquent, il conclut : « à la fois
l’homosexualité n’existe pas et elle existe : c’est son mode même d’existence qui remet
en question la certitude de l’existence » (G. Hocquenghem, Le Désir homosexuel, op. cit.,
p. 29).
11 Ibid., p. 86.
12 Ibid., p. 84.
Lorenzo Bernini - 9789004325975
Downloaded from Brill.com12/05/2021 03:41:32PM
via free accessDu Désir À La Tombe 105
tentatives, opposées, de racheter ces sentiments. Dans L’Immoraliste, Gide
sublime son homosexualité en direction d’un surmoi qui la désexualise13, tan-
dis que dans Corydon il tente de justifier l’homosexualité humaine par une
comparaison avec les autres espèces animales14. Au contraire, dans Notre-
Dame-des-Fleurs et Le Miracle de la rose, Genet tente de rédimer l’homosexualité
à travers un scandaleux sacrifice, en établissant un lien « entre le sublime et
l’atroce », en célébrant le « don absolu15 » de la passivité anale, et en témoi-
gnant enfin du « rapport de désir inversé » que la civilisation œdipienne établit
entre masochisme homosexuel et « système judiciaire et policier16 ».
Pour Hocquenghem tout ça n’a rien à voir avec ce qu’il appelle le désir
homosexuel, qui s’exprime dans la « lutte homosexuelle » comme désir inno-
cent, sans culpabilité, qui par conséquent ne cherche pas la rédemption. Son
livre est le manifeste d’une génération de jeunes gays qui veulent représenter
une coupure révolutionnaire, ou mieux anarchique, qui interrompt la conti-
nuité historique de l’expérience de l’homosexualité. Pour la première fois
ils veulent prendre la parole publiquement et collectivement pour dire sans
honte qu’ils veulent jouir de leurs corps, à partir de leurs anus, dès mainte-
nant – sans accepter de compromis avec la morale bourgeoise ou prolétaire,
sans attendre ni la reconnaissance de l’État libéral ni l’avènement de l’État
communiste. Bientôt, tout cet enthousiasme politique ne sera plus possible.
En l’espace d’une dizaine d’années cette génération affrontera en effet la catas-
trophe du sida et l’effondrement de tous ses espoirs de changement.
La pulsion-sida ou du rectum suicidaire
Hocquenghem meurt du sida en 1988. L’année précédente, Leo Bersani publie
son célèbre article sur l’épidémie en cours « Le rectum est-il une tombe17 ? », où,
significativement, il ne tient aucun compte de la réflexion d’Hocquenghem sur
l’analité, tout comme il ne prendra pas en considération sa lecture de Proust,
13 Ibid., p. 94.
14 « Et quand Gide dans Corydon tente de construire une homosexualité fondée biologique-
ment sur la comparaison avec les autres espèces, il ne fait qu’obéir au piège insensé où
l’enferme la nécessité de fonder en nature les formes du désir » (Ibid., p. 42).
15 Ibid., p. 77.
16 Ibid., p. 40.
17 Leo Bersani, « Is the Rectum a Grave ? », dans Crimp, Douglas (edited by), AIDS : Cultural
Analysis/Cultural Activism, October, 43, 1987, p. 197-222 ; trad. fr. « Le Rectum est-il une
tombe ? » dans Id., Sexthétique, Paris, Epel, 2011, p. 15-62.
Lorenzo Bernini - 9789004325975
Downloaded from Brill.com12/05/2021 03:41:32PM
via free access106 Bernini
Gide et Genet dans l’essai Homos18 qui date de 1996. Comme Hocquenghem,
Bersani se sert de la psychanalyse pour ses théorisations politiques et ses lec-
tures littéraires : mais le premier se référait, dans les œuvres de Freud, surtout
aux Trois essais sur la théorie sexuelle, où apparaît la notion de pulsion sexuelle,
tandis que le second mentionne aussi Au-delà du principe de plaisir19 et
Le Malaise dans la culture20, où Freud introduit la notion de pulsion de mort21.
Le point de départ de « Le rectum est-il une tombe ? » est l’homophobie
des moyens d’information et des institutions américaines au temps de
l’administration Reagan, qui, au lieu de s’associer au deuil de la popula-
tion gaye décimée par l’épidémie du sida et de la secourir, semblent vouloir
l’abandonner à son destin comme si elle l’avait mérité par sa dépravation22.
Bersani commente cette réaction en soutenant que le VIH n’a que rendu lit-
térale la menace de mort que le sexe homosexuel, entendu comme sexe anal,
représente depuis toujours dans l’imaginaire hétérosexuel. Ce qu’il propose aux
gays, au lieu de promouvoir leur image dans l’opinion publique et d’affirmer la
légitimité de leurs amours afin d’être inclus dans la société, c’est d’embrasser
« une représentation homophobe de l’homosexualité23 » et de profiter de ce
qu’ils représentent aux yeux des hétérosexuels pour contester radicalement
leur sexophobie. Le masochisme homosexuel qui était pour Hocquenghem un
résultat de la répression sexuelle de la civilisation œdipienne devient alors une
valeur à revendiquer. Si ce qui dérange le plus dans le sexe homosexuel mascu-
lin est la dégradation d’un homme s’abandonnant à la passivité et au présumé
masochisme féminin, l’objectif de Bersani n’est pas de dissocier l’homosexua-
lité du masochisme : il soutient au contraire que la jouissance sexuelle même
18 Leo Bersani, Homos, Cambridge, Harvard University Press, 1996 ; trad. fr. Homos. Repenser
l’identité, Paris, Odile Jacob, 1998.
19 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, Leipzig, Wien, Zürich, Internationaler
Psychoanalytischer Verlag, 1920 ; trad. fr. Au-delà du principe de plaisir, Paris, Presses
Universitaires de France, 2013.
20 Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur, Leipzig, Wien, Zürich, Internationaler
Psychoanalytischer Verlag, 1929 ; trad. fr. Le Malaise dans la culture, Paris, Flammarion,
2010.
21 Sur ce thème, Bersani se réfère aussi aux réflexions de Jean Laplanche, Vie et mort en
psychanalyse, Paris, Flammarion, 1970.
22 L’essai de Bersani était au départ une critique de « l’excellent livre » de Simon Watney,
Policing Desire. Pornography, AIDS, and the Media (Minneapolis, University of Minnesota
Press, 1987), dont le sujet était « la façon dont un problème de santé publique a été
traité comme une menace sexuelle sans précédent » (L. Bersani. « Le Rectum est-il une
tombe ? », op. cit., p. 20).
23 Ibid., p. 40.
Lorenzo Bernini - 9789004325975
Downloaded from Brill.com12/05/2021 03:41:32PM
via free accessDu Désir À La Tombe 107
est « une tautologie pour le masochisme24 », une force qui humilie et avilit la
subjectivité, qui lui fait perdre la maîtrise sur soi-même en la soustrayant à
toutes les disciplines nécessaires pour vivre en société. Comme le rectum est la
tombe d’une certaine forme de subjectivité virile, machiste et par conséquent
homophobe, les mouvements gays ne devraient pas chercher de le racheter :
ils devraient plutôt le célébrer comme le site d’implantation d’une pulsion qui
est en même temps pulsion sexuelle et pulsion suicidaire de la subjectivité25.
À partir de « Le rectum est-il une tombe ? » et dans toute sa production ulté-
rieure, Bersani rappelle que ce n’est pas dans les relations de couple, mais dans
les bains gays, dans les darkrooms des boîtes homosexuelles, dans les clubs
pour sadomasochistes leather et pour barebackers26 que le sexe révèle toute
sa force de séduction et de destruction, sa capacité de faire exploser l’intégrité
du moi sous la pression de la pulsion de mort. Dans ces expériences, ce que
la société hétérosexuelle veut cacher devient évident, à savoir que « la baise
n’a rien à voir avec le fait d’être ensemble, ou l’amour », et que « l’inestimable
valeur du sexe » est son être « anti-communitaire, anti-égalitaire, anti-éducatif,
anti-amoureux27 ».
Chez Bersani il n’y a donc plus rien du sentiment de révolte joyeuse et opti-
miste qu’exprimait Hocquenghem : le potentiel de destruction du désir homo-
sexuel s’adresse contre le sujet homosexuel même. Pour Hocquenghem l’anus
était l’arme pour attenter à la société hétérosexuelle et assassiner les moi civi-
lisés ; pour Bersani le rectum est la tombe où l’homosexuel s’enterre, soi-même
ainsi que tous ses espoirs d’une communauté différente. Quand il écrit, aux
États-Unis la confiance en la possibilité d’un changement radical est désor-
mais évanouie et la réaction violente de l’opinion publique à l’épidémie du
sida rappelle aux gays l’incapacité des discours politiquement corrects à pro-
mouvoir leur intégration définitive dans la société. En renonçant aux projets
24 « Freud continue de revenir à une ligne de pensée dans laquelle l’opposition entre plaisir
et douleur devient non pertinente, et où le sexuel émerge comme jouissance d’une dis-
solution des limites, comme une souffrance extatique dans laquelle l’organisme humain
plonge momentanément quand il est “pressé” au-delà d’un certain seuil d’endurance. La
sexualité, au moins dans la façon dont elle se constitue, équivaudrait à une tautologie
pour le masochisme » (Ibid., p. 53).
25 Cf. Ibid., p. 43-44 : « Mais pourquoi “suicidaire” ? [. . .] Être pénétré, c’est abdiquer le
pouvoir ».
26 À la subculture bareback Bersani consacre le chapitre « Shame on You » du livre : Leo
Bersani, Adam Phillips, Intimacies, Chicago, London, University of Chicago Press, 2008,
p. 32-57, où il commente l’essai de Tim Dean, Unlimited Intimacy. Reflections on the
Subculture of Barebacking, Chicago, London, The University of Chicago Press, 2009.
27 L. Bersani, « Le Rectum est-il une tombe ? », op. cit., p. 50.
Lorenzo Bernini - 9789004325975
Downloaded from Brill.com12/05/2021 03:41:32PM
via free access108 Bernini
révolutionnaires et en affirmant le « droit » des pédés à la jouissance anale,
pour Hocquenghem la lutte des mouvements de libération gaye et lesbienne
représentait une expérience inédite, une nouveauté absolue, une manière
imprévue d’être homosexuels qui introduisait dès maintenant une façon dif-
férente d’être humains. Pour Bersani, au contraire, le sida devient le signe
de la négativité du sexuel que les homosexuels incarnent depuis toujours en
dépit de toutes leurs tentatives d’émancipation et de libération, et qui rend
donc possible pour les gays du présent d’engager un dialogue avec les invertis
et les pédérastes des générations précédentes. Ce que Bersani cherche dans
les romans de Gide, Proust et Genet c’est donc exactement ce qui dérangeait
le plus Hocquenghem : des exemples de gays hors-la-loi28 qui, par leur nar-
cissisme, leur masochisme, leur honte et leur mépris pour eux-mêmes se
soustraient à toute intégration sociale. Dans Homos la timide sexualité pédé-
rastique de Michel, le protagoniste oisif de L’Immoraliste de Gide qui se perd
dans la contemplation des corps de jeunes Arabes sur la plage, témoigne par
exemple d’une expansion narcissique du désir qui dissout le moi et échappe
à tout rapport social et donc à l’emprise de toute discipline sur le sujet29.
D’autre part, l’attraction éprouvée par les invertis proustiens pour la virilité
des hommes hétérosexuels, à quoi s’ajoute leur répugnance pour leurs sem-
blables et pour eux-mêmes, représente un défi à l’idée même de société : en
tant qu’expériences de l’homosexualité précédant l’idée même de mouvement
et de communauté gays, elles suggèrent la possibilité de repenser radicalement
la valeur de toute communauté humaine30. Mais pour Bersani c’est surtout
28 « Le hors-la-loi gay » est le titre du quatrième et dernier chapitre d’Homos.
29 « Il recherche leurs corps dans son propre corps ; ils deviennent une sorte de moi idéal
sensualisé qui le ramène à la santé par la voie de leur séduction ». « Il est incontestable
qu’un des aspects les moins attrayants de sa défense présumée de l’homosexualité dans
Corydon est qu’elle exclut ce que la majorité d’entre nous reconnaissons comme le désir
homosexuel . . . ». « La sexualité hyperraffinée de Gide est encore plus menaçante pour
l’idéologie culturelle dominante. Car non seulement elle joue dangereusement avec les
termes d’un rapport sexuel possible (actif et passif, dominant et dominé), mais elle éli-
mine du “sexuel” la nécessité d’un rapport quel qu’il soit » (L. Bersani, Homos, op. cit., p. 143
et 145).
30 « Passer de la drague des invertis à une identité gaye qui soit politiquement viable est une
étape que Proust ne franchit pas, encore que, faisant ainsi écho de façon inattendue à
Gide, il esquisse au moins dans les grandes lignes une communauté qui serait fondée sur
un désir indifférent à l’inviolabilité sacro-sainte de la personne. Chez Proust, la personne
disparaît dans son désir, recherchant inlassablement un supplément de même dans les
sujets en partielle dissolution avec lesquels elle se fond dans une commune homoïté »
(Ibid., p. 173).
Lorenzo Bernini - 9789004325975
Downloaded from Brill.com12/05/2021 03:41:32PM
via free accessDu Désir À La Tombe 109
Genet, dans Pompes Funèbres, qui représente les tendances antisociales dont
l’homosexualité est porteuse : loin d’être la condition d’une minorité opprimée
qui exige d’être incluse dans les normes qui définissent l’humain, pour Genet
l’homosexualité devient, comme le crime, une occasion pour trahir le genre
humain et pour renier sa propre humanité. Pour Bersani, cette « intolérable
logique morale » rend Genet le moins « gay-affirmative » et par conséquent le
plus audacieux des écrivains homosexuels : puisqu’il ne se soucie pas de faire
accepter le sexe entre hommes à un public hétérosexuel, il en fait un portrait
sans censures, en mettant en évidence les aspects les plus désagréables et
répulsifs de ses dimensions corporelles et symboliques31.
Quel présent pour le sujet gay ?
Avant l’explosion de l’épidémie du sida, Hocquenghem a essayé de congédier
Gide, Proust et Genet comme des auteurs qui n’ont rien à dire sur la libéra-
tion sexuelle. Pendant la crise, Bersani lui répond avec une grande précision.
Plutôt qu’une absence, le fait que le nom du jeune auteur du Désir homosexuel
n’apparaisse pas dans « Le rectum est-il une tombe ? » et dans Homos marque
donc la présence d’un convive de pierre. Paradoxalement le virus qui a déter-
miné la plus radicale des ruptures dans l’autoreprésentation des gays, permet
à Bersani de renouer un dialogue avec les trois grands chantres français de
la négativité homosexuelle qu’Hocquenghem avait reniés. Dans ses essais, la
machine à explorer le temps qu’est le VIH fonctionne donc comme une dan-
gereuse machine-médium qui, quand elle ne tue pas le vivants, les met en
communication avec les morts – ou mieux encore il fonctionne comme une
machine de l’apocalypse qui ressuscite les morts et provoque le collapsus des
temps, en rétablissant une continuité dans l’expérience homosexuelle de géné-
rations différentes.
Tout cela suscite des interrogations sur notre actualité, qui est le temps où,
dans les pays riches du monde, les malades du sida ont obtenu leur droit à
l’anonymat, tandis que dans beaucoup d’autres pays ils portent encore bien
évidents sur leurs corps les signes infamants de leur proximité avec la mort32.
31 « Telle est, à mon sens, l’intolérable logique morale de l’érotisme de Genet. Presque toutes
ses œuvres se présentent, avec tout l’excès et la flamboyance qui les caractérisent, comme
une inlassable célébration de l’homosexualité, et pourtant il est l’écrivain gay le moins
gay-positif que je connaisse » (Ibid., p. 185).
32 Un présent de l’expérience gaye n’existe naturellement pas, parce que le présent est
toujours un temps à décliner au pluriel. Dans notre présent, par exemple, la sodomie
Lorenzo Bernini - 9789004325975
Downloaded from Brill.com12/05/2021 03:41:32PM
via free access110 Bernini
Depuis la diffusion des trithérapies, aux États-Unis et en Europe les mouve-
ments gays ont utilisé la visibilité acquise pendant les années de la crise pour
rejeter l’association des homosexuels avec la maladie, et pour revendiquer les
potentialités vitales de leurs relations. L’image qu’ils ont donnée des gays et des
lesbiennes est celle de gens respectables qui n’aspirent qu’à être des citoyens
comme il faut de l’État libéral, à donner leur contribution au bien-être de la
nation et à la perpétuation de son existence dans l’avenir. Les gays et les les-
biennes – on l’entend dire souvent – produisent de la richesse comme les autres
et, comme les autres, ils paient leurs taxes ; ils exigent alors les mêmes droits
que les autres : pouvoir se marier comme les autres, pouvoir (plus ou moins)
se reproduire comme les autres, pouvoir même servir dans l’armée comme
les autres. La valeur politique d’une journée d’étude sur la littérature du sida
est alors justement de mettre en question qui sont « les autres » auxquels les
gays aspirent à ressembler dans leur anxiété de reconnaissance sociale, quelles
expériences de l’homosexualité sont-ils disponibles à accueillir comme parties
de leur identité, de quelles exclusions sont-ils prêts à devenir les complices
pour obtenir leur inclusion. Dans les années soixante-dix c’était pour la radi-
calité de sa lutte anti-hétéronormative qu’Hocquenghem prenait ses distances
avec Proust, Gide et Genet. Aujourd’hui c’est une forme de conformisme homo-
normatif qui risque de se démarquer d’Hocquenghem et des autres auteurs
gays de la littérature du sida ; ils nous rappellent un passé très proche, mais où
le fossé séparant les gens LGBT des bonnes mamans, des bons pères de famille,
des bons soldats et des bons citoyens bien-pensants hétérosexuels semblait
impossible à combler. Réduire, voire abolir, cette fracture est une aspiration
bien légitime, mais ce n’est pas la seule possible. De façons différentes, Gide,
Proust, Genet, Hocquenghem ou Bersani démontrent que le désir homosexuel
n’a pas toujours coïncidé avec un désir d’intégration, et qu’il y a eu des gays
qui non seulement ont habité la région de la négativité sociale, mais qui ont
et les actes sexuels contre nature sont encore hors la loi dans soixante-dix-huit pays du
monde, et dans sept pays (Mauritanie, Soudan, Iran, Yémen, Arabie Saoudite, Émirats
Arabes Unis, auxquels s’ajoutent certains des États de la République fédérale du Nigéria
et certains territoires de la Somalie), les pratiques homosexuelles sont punies de mort.
Au contraire, il y a quatre-vingt-quatorze États qui défendent les droits des gens LGBT
et qui ont adopté des lois anti-discriminatoires, mais, même dans ces cas, les personnes
homosexuelles vivent dans des temporalités différentes, déterminées souvent, mais non
pas exclusivement, par les différences de classe et de race. De toute façon, si on regarde
les États-Unis et l’Europe, ce qui caractérise le plus la politique homosexuelle du présent
est sans doute la demande et l’affirmation du droit au mariage et à la parentalité des gays
et des lesbiennes.
Lorenzo Bernini - 9789004325975
Downloaded from Brill.com12/05/2021 03:41:32PM
via free accessDu Désir À La Tombe 111
eu le scandaleux culot de la raconter, et même de la célébrer33 – anus assas-
sins, r ectums suicidaires . . . Les faire resurgir à côte des auteurs de la littérature
du sida nous met face à une alternative : les considérer comme des témoins
d’un âge qui ne nous concerne plus ou comme des voix prophétiques qui nous
parlent encore.
33 L’exemple le plus significatif des récentes célébrations de la négativité homosexuelle est
ce que l’on appelle la « théorie queer antisociale », dont le livre-manifeste est No Future.
Queer Theories and The Death Drive (Durham, London, Duke University Press, 2004) de
Lee Edelman – dont le premier chapitre, « Le Futur est un truc de gosse », a été traduit en
français dans le recueil d’essais Id., L’Impossible homosexuel. Huit essais de théorie queer
(Paris, Epel, 2013, p. 285-324). Tandis qu’aux États-Unis et en Europe la majorité des mou-
vements gays et lesbiens sont engagés dans la revendication des droits au mariage et à la
parentalité, Edelman met en valeur la menace que l’homosexualité représente pour la
civilisation hétérosexuelle fondée sur la famille et il engage une polémique contre « le fa-
scisme du visage de l’enfant », c’est-à-dire contre la rhétorique selon laquelle la valeur
d’un être humain résulte de la contribution qu’il est en mesure de donner à l’avenir de
la collectivité – une rhétorique qui a toujours été utilisée contre les minorités sexuelles,
mais qui imprègne maintenant aussi les mouvements gays et lesbiens mainstream, qui
risquent ainsi de devenir les complices d’exclusions nouvelles. Les deux auteurs auxquels
Edelman rend hommage comme fondateurs de la théorie queer antisociale sont juste-
ment Guy Hocquenghem et Leo Bersani. Il s’agit d’une association qui a bien sûr des rai-
sons, raisons que je pense avoir mises en question dans cette contribution.
Lorenzo Bernini - 9789004325975
Downloaded from Brill.com12/05/2021 03:41:32PM
via free accessVous pouvez aussi lire