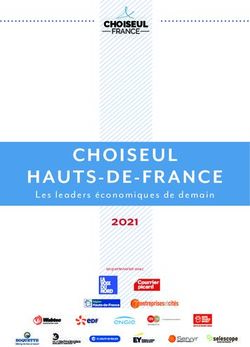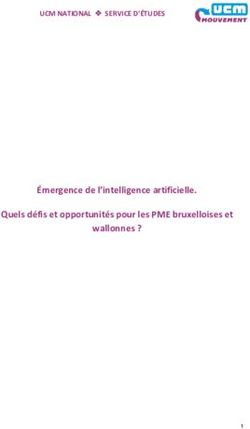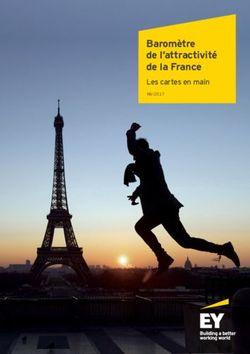Etude qualitative relative au parcours usagers des personnes handicapées portant sur l'insertion professionnelle - Modernisation de l'action ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Etude qualitative relative au parcours usagers des
personnes handicapées portant sur l’insertion
professionnelle.
Principaux résultats – Mars 2018
Contact BVA :
Agnès BALLE – Directrice des études institutionnelles
Isabelle GULPHE - LACHAUD- Directrice conseil – Etudes
qualitatives
Ambre MOUSSUT – Chargée d’études qualitatives SéniorContexte, objectifs et P.3
méthodologie
Synthèse des résultats P.8
Le parcours d’insertion P.9
professionnelle des personnes en
situation de handicap
Volet « Entreprises » - Identification P.54
des freins et leviers à l’embauche
de personnes en situation de
handicap
Conclusions P.65
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Contexte, objectifs et méthodologie
Le Premier ministre Edouard Philippe a confié à Adrien Taquet, député, et Jean- François Serres, membre du Conseil économique, social et environnemental, une mission sur le handicap, priorité du quinquennat. Ils seront spécifiquement chargés de proposer à Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics et Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées, des mesures de simplification administrative au bénéfice des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Cette mission, annoncée lors du Comité Interministériel du Handicap qui s’est tenu le 20 septembre dernier, s’inscrit pleinement dans l’esprit de la politique de transformation de l’action publique portée par le Gouvernement pour renforcer le lien de confiance entre l’administration et les citoyens. Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018
L’étude a pour objectifs, sur la base de l’expérience et des attentes des
personnes en situation de handicap et de leurs aidants, de :
• Simplifier les formalités administratives et diminuer les complexités
normatives, c’est-à-dire les conditions posées pour l’accès aux droits et dispositifs
publics.
• Favoriser un accompagnement adapté, notamment pour l’accès à différents
domaines de la vie quotidienne.
• Faciliter l’accompagnement des personnes, notamment les modalités selon
lesquelles les nombreux intervenants se coordonnent dans les territoires.
• Au final, favoriser une société dite « inclusive », c’est-à-dire qui s’adapte aux
différences de la personne (et non l’inverse), allant au-devant de ses besoins afin de
lui donner toutes les chances de réussite dans la vie.
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Plus précisément cette étude devra permettre de : • Cerner les parcours d’accès à l’emploi en tenant compte des différents statuts possibles (en recherche d’emploi, stagiaires, salariés (dont apprentis), usagers d’un ESAT) en identifiant les potentiels moments de ruptures, notamment lors des changements de statut et les difficultés/freins/complexités rencontrés qu’ils soient d’ordre physique (inadaptation de l’environnement, etc.), psychologique (autocensure ou inadaptation des interlocuteurs), juridique (absence ou inadéquation de la norme), de processus (lourdeur, complexité ou inadaptation du processus au handicap, etc.), institutionnel (absence ou mauvaise coordination entre acteurs, etc.) ou liéés à l’accès à un dispositif ou à une aide spécifique ; • Cerner les difficultés/freins/complexités rencontrés par les entreprises (adaptées ou non) qu’ils soient d’ordre physique (inadaptation de l’environnement, etc.), psychologique (autocensure ou inadaptation des interlocuteurs), juridique (absence ou inadéquation de la norme), de processus (lourdeur, complexité ou inadaptation du processus au handicap, etc.), institutionnel (absence ou mauvaise coordination entre acteurs, etc.) ou liéés à l’accès à un dispositif ou à une aide spécifique ; • Identifier pour ces différents parcours les bonnes pratiques en matière d’inclusion des personnes handicapées sur l’ensemble de leur parcours ; • Recueillir des pistes de solutions permettant une société inclusive. Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018
35 entretiens individuels d’une durée de
1h30 dont :
• 11 entretiens réalisés par téléphone
• 24 entretiens réalisés en face à face
27 entretiens auprès de
8 entretiens auprès
personnes en situation de
d’entreprises
handicap physique ou
(tous réalisés par téléphone)
mental.
• 6 entretiens auprès de personnes • 2 entretiens auprès d’entreprises
en CFA adaptées
• 18 entretiens auprès de personnes • 1 entretien auprès d’une entreprise
en recherche d’emploi / en ne respectant pas la
emploi règlementation en matière d’emploi
• 3 entretiens auprès d’usagers de personnes en situation de handicap
d’ESAT • 3 entretiens auprès d’entreprises
ordinaires respectant la législation
• 2 entretiens auprès d’ESAT
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Synthèse des résultats
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018
Compte tenu de la diversité des cibles interrogées, 3
grands types de parcours ont été identifiés :
1)Le parcours pour accéder à un ESAT
2)Le parcours pour accéder à l’apprentissage
3)Le parcours pour accéder à l’emploi
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018
3 grands facteurs impactent le déroulé des parcours d’insertion
professionnelle des personnes rencontrées
LE CARACTÈRE LA VISIBILITÉ DU
LA
NATIF OU HANDICAP : UN
PERSONNALITÉ
ACQUIS DU HANDICAP VISIBLE
/ la
HANDICAP OU INVISIBLE
DÉTERMINATIO
N DE LA
PERSONNE
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Le caractère natif ou acquis du handicap
• Un accompagnement (parents, AVS, médecins,
professeurs…) et une connaissance des démarches et
acteurs en matière de handicap plus importants quand le
handicap est de naissance ou se développe/est
diagnostiqué au plus jeune âge.
Des parcours plus fluides et plus courts : des
démarches et décisions majoritairement prises par
un tiers…
• …À l’inverse pour les personnes dont le handicap se
développe à un âge plus avancé, une acculturation aux
démarches et acteurs du handicap est nécessaire et
l’accompagnement apporté est plus limité.
• De plus, l’impact psychologique de connaitre un avant le
handicap et un maintenant s’avère souvent très violent
Des parcours moins fluides et plus long : un univers
du handicap (des démarches, des acteurs, mais
aussi de son corps) à découvrir et à comprendre.
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018La visibilité du handicap : un handicap visible
ou invisible
• Un handicap qui lorsqu’il est invisible (maladie traitée comme
la schizophrénie par exemple ou un mal de dos intense) a
tendance à être caché notamment à l’employeur pour ne pas
être discriminé.
Des parcours qui comportent souvent plus de situations
« d’échec » : une personne en situation de handicap qui
finit par abandonner (souffre trop au travail) ou par se
faire licencier (un manque de productivité qui n’est pas
compris par l’employeur).
• Un handicap qui lorsqu’il est visible ne peut donc pas être
caché. Une transparence sur sa situation qui implique de
trouver un employeur qui veut et peut (et sait) prendre en
charge une personne en situation de handicap
Des parcours pour lesquels le retour à l’emploi est
beaucoup plus long et difficile.
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018La personnalité de la personne et notamment la
force de sa motivation
• Il apparait effectivement que ce sont les personnes les plus
motivées et donc les plus « fortes » psychologiquement qui
connaissent les parcours les plus aboutis.
Des parcours souvent plus longs mais aussi souvent plus
« heureux » : les personnes les plus motivées étant
souvent les plus impliquées, elles vont faire plus de « De toute façon, je vais vous dire, je
recherches pour trouver les acteurs / combines qui peuvent n’y crois plus, c'est le système qui le
veut : les employeurs ne veulent pas
les aider, et avoir moins tendance à renoncer ou à accepter de handicapés. » (Frédéric, 45 ans, en
un emploi/ une formation qui ne leur convient pas… attente de formation, Pôle Emploi)
• À l’inverse les personnes les moins motivées et/ou les moins « J’ai envie de me remercier,
« fortes » psychologiquement vont connaître des parcours plus vraiment, parce que si je n’avais pas
eu la ténacité et la pugnacité de
inachevés rebondir, clairement, je ne serais pas
en emploi aujourd’hui. Ça n’a dépendu
que de moi, je sais écrire un CV, j’ai
Des parcours souvent plus courts mais aussi plus assez de ressources et de réseau, je
« malheureux » : les personnes les moins motivées étant sais rédiger une lettre, j’ai eu un
coaching en emploi dans une
souvent plus « défaitistes » elles vont avoir tendance à association privée que Pôle Emploi ne
baisser « plus vite » les bras et/ou à accepter des postes / fait pas. Si je n’avais pas mobilisé les
bonnes ressources, je n’aurais pas eu
formations qui leur conviennent peu… d’emploi. » (Marion, 35 ans, en CDD)
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Le parcours jusqu’à l’ESAT Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018
Les 3 usagers d’ESAT rencontrés dans le cadre de cette étude souffraient chacun d’un handicap mental. Ce parcours
est donc à lire à l’aune de cette information.
Etape 1 : Une scolarité en IMPro et une
découverte négative du milieu ordinaire
Souffrant d’un handicap mental depuis leur plus jeune âge, les
personnes rencontrées ne pouvaient pas suivre une scolarité
dans le milieu ordinaire, elles ont donc été placées par leurs
parents en milieu protégé et plus particulièrement IMPro
(Institut médico-professionnel).
• Un institut au sein duquel elles ont pu bénéficier d’un
apprentissage professionnel tout en étant suivies, formées
et accompagnées par un / des éducateur(s) spécialisé(s).
• Et un institut dans le cadre duquel elles ont pu « mettre
un premier pied » dans le milieu ordinaire en y
réalisant quelques stages (faire la plonge dans un
restaurant par exemple, ou encore être ouvrier sur un
chantier…).
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Etape 1 : Une scolarité en IMPro et une
découverte négative du milieu ordinaire « Je n’ai pas aimé le travail en milieu
ordinaire, on est livré à soi-même (…)
moi j’étais en restauration et on a
profité de moi au niveau des horaires
(…) je faisais la cuisine et le service
Toutefois ces stages dans le milieu ordinaire ont souvent été mal (…) On me faisait des vacheries (…) les
autres salariés ils se moquaient de moi
vécus par les jeunes personnes rencontrées. (…) je n’ai rien dit, j’ai tout gardé pour
moi parce que j’avais honte et puis ils
n’auraient pas compris. » (Flavien, 26
• En effet les entreprises d’accueil semblaient ne pas avoir ans, Usager ESAT)
été informées et formées en amont au handicap de la
personne, si bien que la méconnaissance et/ou la découverte « C’est sûr qu’ils n’avaient pas
fortuite du handicap a été génératrice de moqueries ou de paroles l’habitude de recevoir des gens comme
moi, ce n’était pas du tout adapté (…)
décourageantes particulièrement dures et blessantes pour les ils n’ont rien fait pour essayer de
jeunes stagiaires. s’adapter à mon handicap, du coup je
n’osais pas leur demander de répéter
• De plus les missions et rythmes de travail n’avaient pas été quand je n’entendais pas. » (Flavien,
26 ans, Usager ESAT)
adaptés à la spécificité des jeunes stagiaires (journées de
travail qui commencent très tôt ou terminent très tard, cadences
de travail très / trop soutenues, nécessité de faire des calculs ou « C’était un con mon chef, il me disait
de lire alors que le jeune ne sait pas) et étaient en inadéquation que comme je n’arrivais pas à lire les
fiches de recette je n’étais pas fait pour
avec leurs besoins la cuisine et que je n’y arriverai pas. Je
suis parti. » (Corentin, 26 ans, Usager
ESAT)
Des premières expériences du milieu ordinaire qui se sont
révélées négatives. Un effet repoussoir de ce milieu et la
volonté (dans un premier temps) de rester dans le milieu
protégé.
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Nom de l’étape 2 : l’orientation vers l’ESAT
• Soit parce qu’ils sont arrivés à un âge où ils ne peuvent plus rester en
IMPro (20 ans) soit parce qu’ils ont envie de travailler (dans le milieu
protégé), les personnes rencontrées se sont / ont été orientées vers
les ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail).
• Les personnes rencontrées ont connu les ESAT de différentes façons…
o soit sur les conseils d’un ami lui aussi en ESAT,
o soit sur ceux de l’éducateur de l’IMPro
« L’assistante sociale de Suresnes elle m’a
o soit sur ceux d’une association d’insertion professionnelle aidé pour la MDPH, les vœux et tout ça,
je ne me souviens vraiment plus très bien
de ce qu’il y avait (…) j’avais fait des
• …mais toutes ont été aidées et prises en charge par leur vœux et j’avais mis l’ESAT de XXX en 1er
conseiller / l’assistante sociale de l’IMPro pour réaliser les choix je sais car y avait plein de cuisine,
après je ne sais plus trop ce qui s’est
démarches nécessaires à l’inscription en ESAT (visiblement un passé mais il y a eu un peu d’attente (…)
dossier de candidature à se procurer auprès de la MDPH). 2 semaines je crois pour avoir une place
dans l’ESAT (…) j’ai reçu un courrier pour
savoir que j’étais pris. » (Corentin, 26 ans,
• A ce titre ces personnes ne se souviennent pas de la nature des Usager ESAT)
démarches à réaliser (si ce n’est formuler des vœux quant aux ESAT
choisis) mais elles estiment avoir peu attendu (2 semaines environ)
entre le moment où elles ont postulé et le moment où elles ont eu le
premier rendez-vous en ESAT.
Une orientation très naturelle vers l’ESAT
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Nom de l’étape 3 : la découverte de l’ESAT
• Une fois la réponse de l’ESAT obtenue, les personnes rencontrées témoignent toutes du
même processus d’intégration en ESAT.
o Une rencontre avec le directeur de l’ESAT pour permettre au jeune d’expliquer ses envies et
motivations, le jeune étant accompagné de son éducateur de l’IMPro.
o Une semaine d’intégration lors de laquelle le jeune peut expérimenter différentes activités
professionnelles (cuisine, blanchisserie, service…) et se faire au fonctionnement de l’ESAT
o L’orientation à la fin de la semaine selon les désirs du jeune et de ses capacités vers un métier
particulier
• Un mode de fonctionnement particulièrement valorisé dans la mesure où il permet au jeune de
« toucher à tout » avant d’affirmer son goût (et ses compétences) pour un métier en particulier. Des jeunes
dont les envies sont écoutées…
• …Toutefois des activités proposées au sein de l’ESAT dont la simplicité peut être déroutante parce
que jugée ennuyantes et dévalorisantes par ceux ayant les capacités (intellectuelles ou manuelles) de faire
plus….
• … et une découverte de l’ESAT et plus particulièrement des différents handicaps de ses usagers qui n’est
pas toujours évidente pour ces jeunes.
o En effet au sein de l’ESAT ils côtoient au quotidien et pour la première fois des personnes avec des
handicaps très différents du leur (handicaps physiques par exemple) mais aussi beaucoup plus lourds
(trisomie).
o Un décalage difficilement vécu (peut donner le sentiment d’avoir « régressé ») et qui fait qu’un jeune a
quitté son premier ESAT pour finalement être orienté dans un ESAT où toutes les personnes ont un
handicap mental.
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Nom de l’étape 4 : l’ESAT, entre milieu
protégé et milieu ordinaire
• Au sein de l’ESAT les jeunes sont en contact avec le milieu
ordinaire tout en restant dans le milieu protégé :
o Que ce soit par la présence de personnes du milieu
ordinaire au sein de l’ESAT : par exemple une cantine au
sein de l’ESAT où des travailleurs ou sans- abris viennent se
restaurer,
o Ou que ce soit par la mise en place de détachements (des
stages de plusieurs semaines) pendant lesquels plusieurs
jeunes de l’ESAT sont envoyés dans une entreprise pour
exercer un emploi.
• Un pied dans le milieu ordinaire et protégé fortement
valorisé par les jeunes dans la mesure où il permet de ne pas les
déconnecter du monde professionnel ordinaire (ne sont pas dans
une bulle) et de leur en apprendre les codes…
• … tout en leur assurant un cadre de travail confortable : des
entreprises informées et formées au handicap des jeunes qu’elles
reçoivent,
Confidential & Proprietary –des rythmes
Copyright BVA Group de travail adaptés.
® 2018Nom de l’étape 4 : l’ESAT, entre
milieu protégé et milieu ordinaire
• Toutefois, pour les usagers plus âgés (et donc moins soutenus
financièrement), un travail en ESAT qui, lorsqu’il constitue la
seule source de revenus, est insuffisamment rémunérateur
pour leur permettre d’être autonomes financièrement.
• Un lien avec le milieu ordinaire et une volonté d’offrir la
possibilité aux jeunes de réintégrer un jour le milieu ordinaire s’ils
le souhaitent fortement pris en compte par les ESAT
o Sur proposition de la chargée d’insertion de l’ESAT, deux jeunes sont
en train de préparer une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
dans un domaine spécifique.
o Toutefois les passerelles pour réintégrer le milieu protégé ne sont pas
connues des usagers.
Un ESAT à l’écoute de la volonté des jeunes (rester en
milieu protégé ou intégrer le milieu ordinaire) et facilitateur
des démarches
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Plusieurs grands axes d’amélioration identifiés
« Les entreprises ordinaires
Un premier axe concerne LE MILIEU ORDINAIRE et plus devraient recruter plus de
personnes en situation de handicap
particulièrement l’attente d’une meilleure préparation du milieu pour qu’ils voient le handicap
ordinaire autrement, qu’ils connaissent les
handicapés, qu’ils ne se moquent
pas, qu’ils acceptent le handicap des
• Des entreprises qui doivent être formées à l’accueil et au travail autres. » (Flavien, 26 ans, Usager
ESAT)
avec des personnes en situation de handicap (comportements à
avoir, prérequis nécessaires…).
« Faudrait juste qu’ils nous
donnent plus d’infos sur comment
ça va se passer, dire qu’il y a des
personnes en difficultés, qu’on va
Un autre axe concerne les IMPRO avec 2 principales attentes rencontrer des personnes
beaucoup plus handicapées que
exprimées : nous… pour qu’on se représente
un peu mieux comment ça va
• Veiller à ce que les jeunes qu’ils suivent intègrent des entreprises être. » (Flavien, 26 ans, Usager
ESAT)
respectueuses de leur handicap
• Davantage informer et préparer les jeunes à l’univers de « Il faudrait des gens qui nous
orientent vers quoi on est
l’ESAT et notamment mieux leur expliquer ce que cela vraiment doués, vers des choses
implique (côtoyer au quotidien des personnes avec des handicaps qui nous correspondent quand on
a des capacités intellectuelles pour
divers). nous permettre de faire quelque
chose de plus valorisant. »
(Benoit, 40 ans, Usager ESAT)
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Un dernier axe concerne les ESAT avec plusieurs attentes exprimées
« J’aimerais avoir un travail dans le
• Diversifier les offres de formation selon le handicap : ne pas traiter et milieu ordinaire, quelque chose à
mon niveau, un travail normal pour
offrir les mêmes activités professionnelles à une personne avec un handicap/ une avoir de meilleurs revenus et une
meilleure vie. Mais pour le moment
maladie mentale qui peut être maîtrisée / calmée (la schizophrénie par exemple) je ne sais pas encore comment ça
et dont les effets sont donc minimes et une personne avec un handicap peut se passer, ce qu’il faut faire,
qui peut m’aider. » (Benoit, 40 ans,
psychologique et/ou physique très lourd dont les effets sont importants et Usager ESAT)
permanents afin de permettre à tous les types de handicap de s’épanouir.
« Il faudrait des gens qui nous
• Davantage rémunérer les usagers d’ESAT pour leur permettre de prétendre à orientent vers quoi on est vraiment
doués, vers des choses qui nous
un logement privé (notamment dans un contexte de crise du logement social) correspondent quand on a des
capacités intellectuelles pour nous
• Sensibiliser davantage les personnes en situation de handicap à la vie en permettre de faire quelque chose de
plus valorisant. » (Benoit, 40 ans,
ESAT et particulièrement aux types de pensionnaires et handicaps auxquels elles Usager ESAT)
vont être confrontées en arrivant en ESAT
• Mettre à disposition des usagers de l’information sur les différents moyens
de réintégrer le milieu ordinaire : processus, acteurs à solliciter etc.
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Les bonnes pratiques qui émergent de ce parcours sont celles des
acteurs que sont l’ESAT et l’IMPro
L’ESAT
• La présence de personnels encadrant qui écoutent, boostent et orientent les usagers au quotidien
• L’écoute des envies des jeunes : un ESAT qui dans son fonctionnement incite ses usagers à montrer leur
motivation et qui les « récompense » en leur attribuant la spécialité métier qu’ils souhaitent
• La jonction avec le milieu ordinaire : la possibilité offerte aux usagers qui en manifestent l’envie/ la
capacité d’aller en milieu ordinaire tout en restant protégé par une chargée d’insertion
• Une spécialisation des ESAT par type de handicap qui permet de s’adapter à la diversité des types de
handicap
• Un rythme professionnel au sein des ESAT adapté : des journées de travail plus courtes et moins intenses
(la possibilité pour l’usager de prendre une pause quand il est fatigué)
• Un personnel d’ESAT formé au handicap: des encadrants qui connaissent les différents handicaps et qui s’y
adaptent. Des usagers qui alors se sentent à l’aise, n’ont pas besoin de cacher leur handicap / limites
physiques.
• La présence d’une assistante sociale qui aide les usagers de l’ESAT à réaliser leurs démarches administratives.
L’IMPro
• Une bonne coordination avec les ESAT – des IMPro qui savent orienter vers les ESAT
• La présence d’éducateurs qui aident les personnes qui veulent aller en ESAT à réaliser les démarches pour y
parvenir.
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018CFA Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018
Etape 1 : Une scolarité en CLIS / ULIS : entre milieu protégé et
milieu ordinaire
• Compte tenu de leur handicap, les jeunes rencontrés ont été très tôt placés en milieu
protégé soit en CLIS (Classe pour L’Inclusion Scolaire) soit en ULIS (Unités Locales
pour L’Inclusion Scolaire). Des établissements qui ont l’avantage de :
o Rassembler peu d’élèves et des élèves de tout niveau (même si certains cours sont
communs avec le milieu ordinaire selon les niveaux).
o Offrir un encadrement spécifique avec la présence d’AVS.
o Être insérés au sein d’un milieu plus ordinaire, ce qui est une façon de :
Les protéger, sans les déconnecter totalement,
Leur offrir un enseignement et des structures adaptées.
• De plus ces structures leur permettent de se familiariser avec le monde de l’entreprise
puisque les élèves réalisent des stages en classe de 3ème …
• …Toutefois des stages dont l’orientation apparait souvent « contrainte » :
o Soit par les souhaits / connaissances des parents,
o Soit par l’offre disponible à proximité du lieu de vie (des personnes dont le handicap ne
leur permet pas de partir loin/longtemps du domicile familial),
o Soit par la méconnaissance de l’existant : une tendance à intégrer la première
entreprise qui dit oui.
Une étape pour laquelle le CIO apparaît absent puisqu’il n’a jamais été identifié.
Des difficultés rencontrées dès la 3ème qui, en l’absence d’aide et d’aiguillage,
vont s’amplifier par la suite
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Etape 2 : L’orientation (contrainte) vers
l’apprentissage
• À la fin de la classe de 3ème, ces jeunes doivent choisir une
orientation. Un choix difficile dans la mesure où bien que très
suivis dans le milieu protégé ils rencontrent des difficultés scolaires
importantes, qui contraignent leur orientation professionnelle (une
option de poursuivre en lycée généraliste souvent difficile à
envisager).
• Il apparaît très rapidement que seule la voie de l’apprentissage
est possible
- L’absence du CIO ne permet pas de connaître d’autres
alternatives,
- Les parents estiment que leurs enfants doivent travailler
dans des univers « simples » et qu’ils connaissent (par un
ami ou par des connaissances),
- L’équipe enseignante tend à présenter l’apprentissage
comme (la seule) alternative au parcours généraliste.
À l’aune des premiers stages réalisés, l’impression que
l’apprentissage est un choix par défaut, souvent déterminé par
plusieurs éléments (la territorialité, l’offre, les parents)
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Etape 3 : La découverte des CFAS et de Cap Emploi
Le choix de l’apprentissage étant fait, les jeunes sont Les CFAS : c’est quoi ?
orientés par leurs professeurs vers les portes ouvertes du
CFAS (Centre de Formation des Apprentis Spécialisé) de - Les CFAS sont des structures
la région récentes (et donc encore peu
connues), organisées autour
d’un centre dans la capitale
• Les CFAS ont l’avantage par rapport aux CFA ordinaires régionale et avec des antennes
d’être des structures au plus proche des jeunes en situation sur toute la région. Ces
de handicap avec notamment des tuteurs dédiés (éducateur antennes sont liées au CFAS
scolaire spécialisé), impliqués et connaisseurs du handicap régional mais sont relativement
sur les plans pédagogique et éducatif, et assurant un suivi indépendantes et peuvent
également être reliées (ou non)
constant des jeunes. à un CFA ordinaire.
• Une découverte de cette structure lors de la journée portes - Les antennes des CFAS sont
ouvertes rassurante aussi bien pour les parents que pour les très marquées par leur «
élèves eux-mêmes. spécialité » (liée à
l’environnement : rural, bassin
d’emploi), ce qui implique que
C’est souvent d’ailleurs lors de cette journée portes les jeunes sont un peu obligés
ouvertes que le jeune et ses parents font la connaissance de choisir leur apprentissage
d’un autre acteur : Cap Emploi par rapport à l’ « offre »
disponible sur place.
• Cap Emploi se présente alors comme un acteur facilitateur « C'était bien, parce
du parcours du jeune : va pouvoir l’aider à trouver un qu’à la porte ouverte, j’ai
pu savoir ce que faisait
maître d’apprentissage mais également va lui conseiller vraiment le CFAS. »
(Vincent, 17 ans,
de faire une demande de RQTH. apprentissage, CFAS)
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Etape 4 : la demande de RQTH
Sur les conseils de Cap Emploi et avec l’aide d’un éducateur du
CFAS ou de Cap Emploi et de ses parents, le jeune fait sa
demande de RQTH auprès de la MDPH.
• La demande de RQTH est majoritairement gérée par « C'est long, il faut aller voir le
médecin pour qu’il remplisse, on
l’éducateur du CFAS ou de Cap Emploi (qui maitrise totalement ne sait pas quand ça va être
les démarches administratives en matière de RQTH) et qui met en accepté. » (Romuald, 18 ans,
apprenti, CFAS)
relation le jeune, les parents et le médecin.
• De fait cette étape du parcours a laissé peu de traces mémorielles
aux jeunes rencontrés. « C'est le monsieur de Cap Emploi
qui a fait la demande de RQTH
auprès de la MDPH pour moi. »
• Pour l’éducateur ou les parents (quand ils étaient présents lors de (Romuald, 18 ans, apprenti,
l’entretien) c’est une étape qu’ils décrivent comme longue du fait CFAS)
des contraintes de la MDPH, mais relativement aisée.
• En effet aucun élément dans la constitution du dossier RQTH n’est
identifié comme bloquant mais c'est le temps élargi de la demande
et de la réponse qui allonge considérablement le processus
(demande au médecin traitant, pas de date de clôture de dossier)…
Un processus qui apparait d’autant plus long et
fastidieux aux parents du jeune que ce dernier est
reconnu handicapé depuis longtemps.
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Etape 5 : la recherche d’un maître
d’apprentissage
La recherche d’un maître d’apprentissage s’avère être
une étape périlleuse
En effet, les quelques rapports entre Cap Emploi et le futur apprenti
sont souvent déceptifs, avec un acteur Cap Emploi qui : « J’ai quand même cherché 6 ou 7 mois
avant de trouver. Cap Emploi m’avait
proposé un chevrier, mais tout le monde
- Quantitativement, propose peu de pistes / d’opportunités : un sait qu’il ne fait ça que pour l’argent, j’y
suis allée, c'était dégoûtant, jamais je ne
acteur qui connaitrait peu d’entreprises qui prennent en serais allée là-bas. C'est une grosse
apprentissage des jeunes en situation de handicap (un constat qui chèvrerie qui ne fonctionne qu’aux
subventions, ils ne cherchent que la
traduit aussi l’état du marché de l’apprentissage dans la région), rentabilité. » (Jeannette, 18 ans,
apprentie, CFAS)
- Qualitativement, propose des pistes qui ne sont pas jugées
adaptées :
- Au regard du handicap du jeune
- Au regard de ses envies et ambitions
- Au regard de l’éloignement géographique avec le domicile
familial
- Au regard du profil du maître d’apprentissage
- Quand une piste proposée est acceptée, Cap Emploi n’accompagne
pas l’employeur dans la gestion du handicap du jeune.
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Etape 5 : la recherche d’un maître
d’apprentissage
Du côté du CFAS, malgré leur volontarisme, les éducateurs scolaires
spécialisés peinent eux aussi à trouver les ressources aidantes : ils ne
connaissent pas tous les rouages de l’entreprise et n’ont pas le carnet
d’adresses d’acteurs plus performants. Quand ils trouvent un maître
d’apprentissage, c’est davantage en activant leur réseau personnel. « Je ne sais pas trop ce que
pense mon employeur du
handicap, mais il connaît la prof
Dès lors, quand aucune proposition de Cap Emploi ne correspond, ce de français du CFA, c'est comme
sont les parents du jeune qui, grâce à leur réseau, trouvent un ça que j’ai été prise. Il me pose
beaucoup de questions sur le
maître d’apprentissage à leur enfant, parfois dans un secteur qui n’est handicap et à mon tuteur
pas celui voulu par le jeune. aussi. » (Jeannette, 18 ans,
apprentie, CFAS)
Dans les différents cas rencontrés, il apparaît que le maître
d’apprentissage trouvé est soit :
• Appâté par l’aubaine financière que représente l’embauche d’un
apprenti en situation de handicap,
• Totalement impréparé à l’accueil d’un jeune en situation de
handicap : d’autant que le handicap, quand il n’est pas visible,
n’a pas forcément été déclaré par le jeune et/ou ses parents.
Une étape de recherche du maître
d’apprentissage qui constitue la plus difficile du
parcours
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Étape 6 :
l’apprentissage
Lors de la réalisation de l’apprentissage, la découverte du handicap
par les employeurs qui n’en sont pas informés / formés va générer
quelques frustrations
En effet, il apparaît que soit le maître d’apprentissage ne comprend pas les
limites de son apprenti, soit il réalise qu’il doit adapter / aménager son lieu
de travail au handicap de l’apprenti. Dans les 2 cas L’apprenti se sent
dévalorisé.
La question prend alors davantage d’ampleur à 2 niveaux :
• Quand il s’agit de mettre en place une compensation financière, des dossiers
Agefiph jugés complexes et chronophages par les chefs d’entreprise. D’autant
que les chefs d’entreprise ne sont pas aidés pour ce faire (sauf si l’éducateur du
CFAS est présent).
• Quand les difficultés de l’apprenti sont telles qu’il a besoin de faire une 3ème année
d’apprentissage : il apparait des « effets de seuil » avec des jeunes plus âgés donc
plus onéreux, des maîtres d’apprentissage qui se sentent pris en étau ou qui refusent
de reconduire l’apprentissage (des apprentissages avortés, ce qui augure mal pour la
suite professionnelle du jeune en question)
Un vrai déficit de lien entre les maîtres d’apprentissage et les
apprentis sur la question du handicap
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Plusieurs grands axes d’amélioration identifiés
Concernant les parcours scolaires
• Des parcours scolaires qui ne doivent pas être déterminés par différentes contraintes (le bassin
d’emploi, les craintes ou le métier des parents, la facilité apparente de l’apprentissage…) ou alors
la nécessité que cette voie soit revalorisée.
• Des structures aidantes (dans le cadre de l’apprentissage) qui doivent être davantage
mises en avant tout au long du parcours scolaires : CIO, mais également CFAS.
Concernant l’accès à l’apprentissage
• Des acteurs du binôme emploi/handicap qui doivent intervenir de manière
systématique et accompagnante (pour les parents, les entreprises, les jeunes, les structures
scolaires ordinaires ou spécialisées) : un acteur Cap Emploi qui doit intervenir davantage (et
mieux) dans la recherche d’un maitre d’apprentissage.
• Favoriser la rencontre entre les jeunes et les maîtres d’apprentissage (potentiels ou
anciens) : convier les entreprises aux journées portes ouvertes des CFAS, organiser des
rencontres.
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Plusieurs grands axes d’amélioration identifiés
Concernant les relations entre le maître d’apprentissage et son apprenti
• Faire davantage de pédagogie auprès des maîtres d’apprentissage sur les bénéfices mais aussi sur
les contraintes liées à l’embauche d’une personne en situation de handicap.
• Davantage contrôler et encadrer les contrats d’apprentissage :
• Du côté des chefs d’entreprise, pour évincer ceux qui seraient tentés par la seule aubaine
financière que représente l’embauche d’un apprenti en situation de handicap),
• Du côté des apprentis, pour s’assurer qu’ils ont bien informé l’employeur de leur situation.
• Accompagner les 2 parties dans leur adaptation mutuelle : travail des éducateurs scolaires
spécialisés et de Cap Emploi
Concernant les acteurs impliqués dans le parcours
• Réaliser un travail de sensibilisation et de coordination des différents acteurs qui interviennent dans
ce parcours : réunions / plaquettes d’information pour les entrepreneurs, prises de parole d’acteurs
impliqués à différents niveaux, qu’ils soient au cœur du handicap (MDPH), de l’emploi (Pôle Emploi, CCI),
des 2 (Cap Emploi), de l’apprentissage (Région, CFA, CFAS), du milieu scolaire (CIO, directeurs
d’établissements scolaires ordinaires et spécialisés type CLISS/ULIS), du financement (AGEFIPH)… ou
même tout simplement auprès des parents.
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Plusieurs bonnes pratiques identifiées dans ce parcours
Une journée portes ouvertes au CFAS qui permet au jeune et à ses parents
« Aux portes ouvertes, la directrice
de découvrir plus en profondeur le CFAS et qui permet également d’introduire du CFAS m’a dit qu’il fallait que je
un acteur important : Cap Emploi contacte Cap Emploi pour constituer
mon dossier et par exemple aussi
pour ce qui concerne une aide pour
l’aménagement par rapport à mon
Une sensibilisation d’un des maitres d’apprentissage à la question du handicap. » (Vincent, 17 ans,
handicap par la CCI ; une formation qui dans le cas du jeune rencontré est apprentissage, CFAS)
arrivée tardivement puisqu’il était depuis plusieurs mois dans l’entreprise mais
une pratique qui semble incontournable, et qui est à développer en amont « J’avais besoin d’un
aménagement, parce qu’en fait,
en boulangerie, pour savoir s’il y
a de la buée, c'est un petit son, et
L’intervention de l’éducateur du CFAS pour aider le maitre moi je ne peux pas l’entendre,
d’apprentissage d’un jeune apprenti à mettre en place l’équipement alors il a fallu que j’en parle au
maître de stage et qu’on mette en
nécessaire au bon déroulé de l’apprentissage (démarches place un financement, mais ils ne
administratives et organisation) savaient pas trop comment faire.
C'est ma tutrice qui m’a aidé. »
(Vincent, 17 ans, apprentissage,
Plus concrètement un jeune avec un handicap auditif a intégré un CFAS)
apprentissage en boulangerie qui nécessitait des aptitudes sonores
(entendre un bip signalant un trop plein de buée dans le four) que le
patron n’avait pas évaluées.
La mise en place d’un Aménagement de Conditions Particulières (un
bouton qui permet de se passer du signal sonore) était nécessaire. Un
aménagement qui a été suscité par l’éducatrice scolaire spécialisée, qui
a aidé le patron à constituer le dossier (particulièrement compliqué).
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Pôle Emploi Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018
Préambule : le début du handicap et la fin d’un métier
• La très grande majorité des personnes rencontrées étaient avant tout malades (sclérose en plaque, greffé du rein,
dépression, lobectomie pulmonaire, hyperlaxie musculaire, diabète…) et/ou souffraient d’un handicap invisible (mal
de dos, douleurs…).
• Un handicap qui s’est déclaré à un âge avancé, et qui les a contraint à renoncer au métier qu’elles
occupaient jusque-là (un métier que beaucoup d’entre elles aimaient).
• Un départ professionnel qui a souvent été « violent » car non désiré : licenciement, accident du travail non
reconnu, recours aux Prud’hommes, pression voire harcèlement de l’employeur pour conduire à la démission.
• Ces personnes sont donc / ont été dans une situation de très grande fragilité psychologique. Une fragilité
nourrie par :
o Le handicap lui-même, les douleurs au quotidien, et pour certains l’incertitude de l’évolution de la maladie,
o Une situation de marginalisation voire d’isolement social (beaucoup étant célibataires),
o Une situation de précarisation économique (des revenus très faibles, un retour chez les parents),
o Le sentiment amer que sa vie a pris un cours, ou un tournant qui ne devait pas être le sien : la difficulté
d’accepter l’injustice de la situation, de faire le deuil de sa vie d’avant (et en particulier de sa vie
professionnelle)
o La difficulté de réinventer sa vie en tenant compte de :
Ses limites, qui sont parfois difficiles à accepter, et à mesurer
Ses envies, qui sont très difficiles à déterminer quand on se sent diminué et fragilisé psychologiquement
Des limites que la « société » leur impose : la nécessité de se battre pour imposer ses volontés, ses
choix, ses capacités, quand les institutions ont tendance à contraindre ces ambitions.
Dès lors parmi toutes les difficultés rencontrées par ces personnes « nouvellement »
handicapées, c’est avant tout la difficulté de la réinsertion professionnelle qui apparait la
plus problématique puisque c’est par le travail qu’elles étaient insérées dans la société.
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Étape 1 : La demande de RQTH
L’ensemble des personnes rencontrées se sont vues conseiller par
leur médecin du travail / médecin généraliste ou agent de Pôle
Emploi / Cap Emploi de faire une demande d’obtention de RQTH.
« Je n’ai pas vraiment eu de
Une demande qui, dans la majorité des cas, s’est avérée difficile : problème pour le remplir, moi je
• Un remplissage relativement aisé, sur le plan strictement administratif … sais ce que je veux faire, mon
médecin lui il remplit ça toute la
journée. Il y a juste plein de
• …mais qui s’avère beaucoup plus complexe pour ce qui concerne le trucs à fournir, c'est un peu
remplissage de la rubrique « projet de vie ». Une difficulté pointée du long. » (Samir, 32 ans, en
doigt à plus d’un titre : emploi, Pôle Emploi)
o Des personnes qui ne sont pas très à l’aise avec l’écrit (aucune
aide de la MDPH)
o Une dimension de projection qui, notamment pour les handicaps
acquis, signifie psychologiquement la nécessité d’accepter une
situation que l’on voudrait pourtant tempérer ou ignorer
o Une nécessité de se projeter dans un métier / des
formations, alors même que les restrictions médicales ne
sont pas explicites : beaucoup ne sachant par exemple pas le
poids maximum qu’ils pouvaient porter…
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Étape 1 : La demande de RQTH
• De plus une temporalité d’obtention de la RQTH qui « Je n’ai pas vraiment eu de
apparait floue : un dossier dont le remplissage est long et problème pour le remplir, moi je
sais ce que je veux faire, mon
dont le résultat est lui aussi très éloigné. médecin lui il remplit ça toute la
journée. Il y a juste plein de
trucs à fournir, c'est un peu
long. » (Samir, 32 ans, en
• Des points de crispation accentués par l’opacité perçue de emploi, Pôle Emploi)
la MDPH, avec particulièrement des personnes qui
regrettent de :
o Ne pas pouvoir suivre le traitement de leur dossier,
o Ne pas avoir d’explications sur les décisions prises : des
décisions qui sont imposées et jamais justifiées,
o Ne pas réussir à parler ou voir quelqu’un (rapidement)
de la MDPH.
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Étape 1 : La demande de RQTH
Une fois la RQTH obtenue, les personnes interrogées mettent en
avant la méconnaissance de l’utilité de cette RQTH « Entre temps, mon conjoint, qui est
médecin, m’a incitée à demander une
RQTH. Mon généraliste a appuyé ma
• En effet il apparait souvent que (sauf lorsque cela leur a été expliqué demande, il a souligné l’idée d’un poste
par un conseiller Pôle Emploi, un médecin…) les droits « ouverts » aménagé. Et en plus je suis en ALD et à
par la RQTH ne sont pas connus ; des personnes en situation de 100%, ça n’a donc pas posé de
handicap qui en ont fait la demande sans en connaître la finalité et qui problème particulier. » (Flavie, 46 ans,
en formation, Pôle Emploi)
s’interrogent donc sur à quoi elle sert ? Est-ce pour soi ? pour les
employeurs ?...
« J’ai galéré, il y avait plein de choses à
• … dès lors ces personnes s’interrogent sur l’intérêt de la mettre en fournir, et surtout je ne savais pas à
avant auprès des employeurs et, si oui, pour quelles raisons ? Est-ce quoi ça allait me servir. » (Géraldine,
que des emplois sont réservés ? Les employeurs bénéficient-ils d’aides 28 ans, en attente de formation, Pôle
ou de facilités qui pourraient les inciter à les recruter ? Finalement ne Emploi)
serait-ce pas contre-productif de « s’afficher » handicapé ?
Au final, le sentiment que la RQTH pourrait être davantage un
frein à l’emploi plutôt qu’un facilitateur
Un manque d’information sur les droits ouverts par la RQTH
problématique et contraignant dans le déroulé des parcours
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Etape 2 : s’interroger sur son orientation
professionnelle
Avant même la recherche d’emploi, c’est l’étape d’orientation
professionnelle qui semble la plus difficile
En effet, pour la grande majorité des personnes rencontrées, « trouver sa
voie » est une difficulté majeure.
Des personnes qui peinent à :
- se projeter dans un nouveau métier : les personnes rencontrées doutent d’elles, de leurs
capacités à apprendre un nouveau métier, ou de reprendre des études.
- trouver un métier qui soit compatible avec les contraintes du handicap, ses envies, ses
compétences et ses aspirations.
- trouver la bonne formation et le financement de cette formation.
À cela s’ajoute un manque d’information sur leurs droits, sur les acteurs
pouvant les aider et sur les formations disponibles.
• En effet, sauf si l’individu est en contact avec une structure qui le prend en charge (centre de
rééducation, association), l’information ne vient jamais à lui, c’est à lui d’aller la chercher avec tout
ce que cela peut avoir d’inégalitaire car ce sont les individus les plus formés, et les plus pugnaces qui
ont in fine les bonnes informations (et qui s’en sortent le mieux).
Un flou sur sa situation et sur les aides à solliciter. Une tendance naturelle à se
tourner alors vers Pôle Emploi.
Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2018Etape 3 : la rencontre avec Pôle Emploi
Pôle Emploi est le premier acteur sollicité par les personnes rencontrées…
mais c’est un acteur qui va rapidement montrer ses limites
• En effet si les personnes rencontrées valorisent la présence dans leur Pôle Emploi
d’un agent dédié aux personnes en situation de handicap (des agents dédiés jugés à
l’écoute et empathiques)… « Je fais mes lettres de
motivation tout seul, même
• … elles pointent du doigt de nombreux dysfonctionnements chez cet acteur : si on a eu des ateliers. Mais
franchement, à part la fois où
1) Outre cet agent dédié, les autres agents de Pôle Emploi sont beaucoup moins un chef d’entreprise est venu
sensibilisés et formés au handicap. nous parler de travail, ce
n’est pas très intéressant. Les
2) Les formations de base (apprendre à rédiger son CV, une lettre de motivation etc.) professionnels, ils disent des
proposées sont souvent jugées davantage « occupationnelles » qu’utiles dans la mesure où choses concrètes, alors que
elles ne donnent pas accès directement à un emploi les autres rigolos de
Une logique « occupationnelle » que la plupart des personnes rencontrées jugent d’habitude, ils ne savent pas
intentionnelles : étant en formation ces personnes n’apparaissent plus dans les de quoi ils parlent. » (Gaétan,
statistiques du chômage 36 ans, au chômage, Pôle
Emploi)
3) Le discours et les propositions en matière d’emploi sont souvent limitées et
« limitantes »
Les agents mettraient d’abord en avant la nécessité d’avoir un projet professionnel sans proposer
des emplois envisageables compte tenu de leur parcours précédent, de leurs compétences et des
restrictions imposées par le handicap…
….or c’est précisément pour avoir ces informations et parce qu’elles n’ont pas d’idées de ce
qu’elles pourraient faire que les personnes en situation de handicap se sont tournées vers Pôle
Emploi…
Toutefois la crainte de la précarité et la peur de ne jamais réussir à se reconvertir ont poussé
certaines personnes à accepter à contre-cœur les formations et/ou emplois proposés.
Un acteur Pôle Emploi décrit comme très vite dépassé par la question du handicap et
quiGroup
Confidential & Proprietary – Copyright BVA renvoie
® 2018parfois vers Cap Emploi.Vous pouvez aussi lire