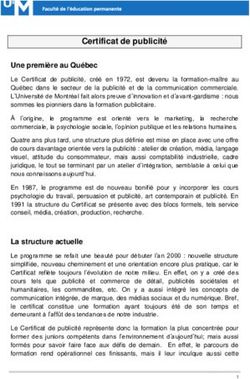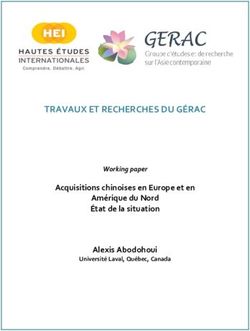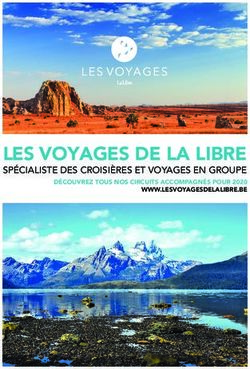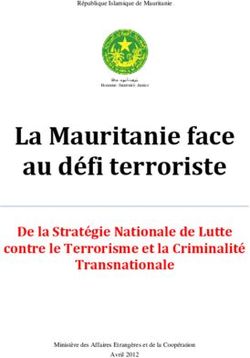L'image des migrants véhiculée par les médias Portefeuille de lecture - 15 juin 2018 - 12h00-14h30 Avec Daniel Bonvoisin, Média-Animation - CAI Namur
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
15 juin 2018 – 12h00-14h30
L'image des migrants véhiculée
par les médias
Avec Daniel Bonvoisin, Média-Animation
Portefeuille de lectureL’intervenant :
Daniel Bonvoisin, ancien journaliste en relations internationales et rédacteur en chef d’une revue
consacrée aux relations Nord/Sud, travaille depuis 2006 à Média Animation. Il y est responsable de
l’équipe d’éducation permanente. Détenteur d’un master en relations internationales, il est également
formateur d’enseignants et professeur invité à la haute école de communication IHECS pour les
matières relatives aux enjeux des nouveaux médias et aux usages contemporains du jeu. Ses domaines
privilégiés sont les dimensions politiques de la culture populaire à travers la fiction (en particulier le
cinéma et les jeux), les enjeux des nouveaux médias, les représentations de l’actualité internationale
et les questions interculturelles. Il intervient régulièrement sur ces questions lors d’ateliers, de
formations ou en contribuant à des recherches et des publications.
Sommaire des articles :
1. « Invasion de migrants » : un millier de plaintes contre Sudpresse,
http://www.levif.be/actualite/belgique/invasion-de-migrants-un-millier-de-plaintes-contre-
sudpresse/article-normal-476579.html
Cet article met en évidence que l’influence des termes utilisés, surtout dans des gros titres, peut
renforcer les préjugés de manière forte.
2. « Ange blond : les médias et les stéréotypes sur les Roms », Daniel Bonvoisin,
https://media-animation.be/Ange-blond-les-medias-et-les-stereotypes-sur-les-Roms.html
Cet article dénonce et analyse comment d’une rumeur médiatique, au départ d’une couleur de
cheveu, traitée différemment par quelques pays européens, on passe à un drame humain.
3. « Médias et migrations dans l’espace euro-méditerranéen », Tristan Mattelart, Médias et
migrations dans l’espace euro-méditerranéen, Revue européenne des migrations
internationales [En ligne], vol. 32 - n°3 et 4 | 2016, mis en ligne le 01 décembre 2016, consulté
le 28 mai 2018. URL : http://journals.openedition.org/remi/7891
Fruit d’une recherche collective, cette analyse expose le rôle des médias en amont et en aval de la
migration.
4. « Revoir les mythes médiatiques à propos des réfugiés et des migrants »,
https://fr.unesco.org/news/revoir-mythes-mediatiques-propos-refugies-migrants-0
L’unesco démonte ici 7 mythes créés par de la désinformation de la part des médias.
5. « Copiées d’un pays à l’autre, comment les intox fabriquent des stéréotypes racistes sur les
migrants », http://observers.france24.com/fr/20171229-intox-stereotypes-racistes-
migrants-internationalLa rédaction des Observateurs de France 24 a recensé et classé des fausses informations ou images manipulées. Elle livre ici ses conclusions. 6. « La couverture médiatique de la crise migratoire en Europe : un discours confus et polarisé », http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius- adjunts/anuari/med.2017/french/IEMed_MedYearbook2017fr_couverture_mediatique_crise _migratoire_matar.pdf L’objectif de cet article est d’examiner les tendances générales qui se dégagent des nombreuses études et interprétations publiées sur cette question. / ! \ l'article n'est pas présent dans ce dossier mais bien en ligne et en téléchargement en annexe
"Invasion de migrants": un millier de plaintes contre Sudpresse Le Vif http://www.levif.be/actualite/belgique/invasion-de-migrants-un-millier-de-plaintes-contre- sudpresse/article-normal-476579.html Source: Belga Le Conseil de déontologie journalistique a reçu à ce jour un millier de plaintes visant une 'Une' du groupe Sudpresse, portant le titre "Invasion de migrants: la Côte belge menacée! ", datant du 24 février. Ces plaintes proviennent quasi exclusivement de particuliers. On trouve toutefois parmi les plaignants huit centres régionaux d'intégration en Wallonie. Le journal parodique Nordpresse a, pour sa part, déposé plainte à la police pour incitation à la haine et au racisme. "Dans un climat largement alimenté par des fantasmes et des allégations souvent mensongères sur les faits et gestes des populations étrangères, qu'elles soient primo-arrivantes ou non d'ailleurs, Sudpresse entretient voire intensifie la peur irrationnelle actuelle", dénoncent les huit centres d'intégration, dans un communiqué commun. "Sudpresse en agissant de la sorte crée un amalgame qui laisse à penser que tous les demandeurs d'asile, voire tous les étrangers sont des dangers potentiels et des envahisseurs", déplorent-ils. Les centres régionaux expliquent qu'ils sont en charge du soutien de l'intégration des populations étrangères notamment via le parcours d'intégration mais aussi de la lutte contre la discrimination via des actions de sensibilisation de la société d'accueil. Le journal parodique Nordpresse indique sur son site Internet, PV à l'appui, avoir déposé plainte à la police fin février pour incitation à la haine et au racisme et incite ses lecteurs à l'imiter. "Les plaintes au conseil de déontologie n'ont pour sanction qu'une publication sans la moindre peine. Ce n'est plus qu'une question de déontologie mais bien un crime condamnable au pénal", se justifie-t-il. La secrétaire générale de l'Association des journalistes professionnels (AJP), Martine Simonis, a demandé quant à elle, après la diffusion de la 'Une' litigieuse, au ministre francophone des Médias Jean-Claude Marcourt, de vérifier si Sudpresse remplissait les conditions d'octroi des aides à la presse. Elle rappelait que le respect de la déontologie était l'un des critères d'octroi de ces aides. Du côté de Sudpresse, on estime qu'une réflexion est nécessaire en interne et avec le CDJ sur le rôle d'un journal populaire, qui ne doit pas basculer dans le populisme tout en conservant sa particularité. La direction du groupe tient toutefois à placer ces plaintes dans leur contexte. Ainsi, 90% des plaintes sont liées à celle de Nordpresse, affirme-t-elle, regrettant que le CDJ omet cette précision et sort ainsi de son rôle, selon elle. Sudpresse a lui-même déposé plainte au CDJ et au pénal contre Nordpresse, avec qui les relations sont tendues depuis la diffusion de cette 'Une' à propos des migrants et du père d'un des auteurs des attentats de Paris qui tient un commerce à Liège.
Au sujet du titre sur les migrants, la direction reconnaît qu'il était "peut-être maladroit", tout en ajoutant que ce sera aux juristes de trancher. Elle convient qu'il faut se montrer prudent dans le choix des titres "en période délicate sur le plan social". Quant à l'AJP, Sudpresse souligne que les rapports avec l'organisation professionnelle sont difficiles sur le plan syndical et que celle-ci n'est donc pas objective dans ce dossier. Le délai moyen du traitement d'une plainte au Conseil de déontologie journalistique est de cinq mois.
Ange blond : les médias et les stéréotypes sur les
Roms
https://media-animation.be/Ange-blond-les-medias-et-les-stereotypes-sur-les-Roms.html
En octobre 2013, le visage d’une fillette fait la
une des médias européens. Elle s’appelle Maria,
elle a des cheveux blonds et vit au sein d’un
campement de Roms. Que fait-elle parmi eux ?
Sans doute a-t-elle été enlevée. Sans retenue, une
grande partie de la presse européenne souscrit à
cette hypothèse et aux préjugés qui la fondent.
Cette européanisation pourrait indiquer que les
Roms jouissent du triste privilège d’être pareillement considéré à travers tout le continent où ils
vivent depuis des siècles. Cependant, si le stéréotype semble généralisé, au diapason d’un
discours politique qui s’est singulièrement durci à l’encontre de ces minorités ces dernières
années, son usage varie d’un pays à l’autre, comme le montre la comparaison de la presse
anglaise, française et irlandaise lors de l’affaire de « l’Ange blond ».
Le 16 octobre 2013, lors d’une opération dans un campement rom, des policiers grecs « repèrent »
une fillette aux cheveux blonds et aux yeux clairs. S’inquiétant de sa dissemblance physique d’avec
ceux qui revendiquent être ses parents, ils la soustraient à son foyer et la confient à des services
sociaux. Pensant avoir mis la main sur une enfant enlevée, les autorités diffusent des
communiqués de presse et des photos de la fillette dans l’espoir de l’identifier [1] . L’évènement
anime d’abord la presse grecque, puis est répercuté par les agences de presse (AFP, AP,
Reuters…) et finit par susciter l’intérêt d’une grande partie des médias européens, et même au-
delà. Le 19 octobre, la photo de la jeune Maria, désormais connue comme « l’Ange blond », est
visible partout
La séquence médiatique dure une dizaine de jours et suscite une série d’évènements à l’ampleur
étonnante. Le 21 octobre, la police irlandaise signale aux services sociaux (HSE, Health Service
Executive) la présence de deux enfants blonds dans deux familles roms différentes. A leur tour, les
enfants sont séparés de leur foyer afin de procéder à des tests génétiques et d’établir leur
identité [2] . En Serbie, ce sont des skinheads qui tentent de soustraire un garçon blond aux Roms
auprès desquels ils l’ont vu [3] . A Chypre, un jeune homme aux cheveux clairs, préalablement
signalé par des internautes sur base de vidéos amateurs, se présente à la police et déclare qu’ilpense être Ben Needham, un bébé britannique disparu en Grèce en 1991, blond lui aussi [4] . Toutes ces affaires se concluent de la même manière : les enfants sont Roms, ils n’ont pas été enlevés. Quant à la petite Maria, elle aurait été confiée bébé par sa mère, une Rom bulgare, à ses parents adoptifs grecs, une explication que ces derniers soutenaient à la police depuis le premier jour [5] . Les soupçons d’enlèvement d’enfants largement partagés par la police grecque et les médias sont démentis, l’intérêt médiatique s’éteint. Désormais placée dans un foyer et séparée de ses deux familles (adoptive et biologique), Maria disparait de l’actualité début novembre, retournant à un anonymat peut-être définitif. Une rumeur continentale L’affaire de « l’Ange blond » prend source dans une rumeur : des enfants non-Roms, ce que démontreraient leur couleur de cheveux et d’yeux, auraient été enlevés par des Roms, éventuellement dans le cadre d’un vaste trafic. Le fait remarquable dans cette rumeur n’est pas tant son contenu [6] que l’ampleur exceptionnelle du traitement médiatique qui lui a été accordée pour un fait divers impliquant les minorités roms. En plus de reproduire massivement les dépêches de presse consacrées à l’affaire, les médias européens, et tout particulièrement la presse écrite, lui ont consacré de nombreuses informations « maison » [7] . A ce titre, l’affaire de « l’Ange blond » constitue un moment privilégié et particulièrement dense pour observer les discours médiatiques tenus au sujet de ces minorités. Si les médias ont largement reproduit les clichés populaires associés à ces populations, et tout particulièrement le mythe des voleurs d’enfants, certains journaux ont préféré mettre l’accent sur les préjugés dont elles sont victimes et dénoncer la dimension raciste ou à tout le moins raciale, tant des faits policiers que de la séquence médiatique elle-même [8] . Au-delà de cette répartition des articles entre ceux qui stigmatisent les Roms et ceux qui prennent leur défense, l’affaire dévoile deux visages du traitement de l’information, à première vue paradoxaux. D’une part, il est remarquable qu’un fait divers, voire une anecdote sociale, ait réussi à susciter l’intérêt presque unanime des médias du continent. Une rapide revue de presse révèle sans peine que le traitement opéré par la plupart des titres de presse est à la fois relativement simpliste, beaucoup se contentent de reproduire ou de réécrire les dépêches des agences, et repose sur une narration prémâchée par les clichés sur les Roms : une petite fille blonde a été enlevée par des Roms d’Europe de l’Est dont c’est un commerce habituel. Cette convergence médiatique autour d’un discours relativement uniforme est en soi indicatrice d’une généralisation d’une certaine image des Roms, devenus des personnages repoussoirs à l’échelle européenne.
Les Roms, un thème politique européen Cette généralisation ne peut être envisagée indépendamment d’un discours politique qui s’est lui- même généralisé et qu’on retrouve dans la bouche d’un grand nombre de décideurs européens. Depuis plusieurs années, les minorités Roms sont les sujets de mesures particulières et contraignantes, visant notamment leurs campements ou leur rapatriement dans les pays dont ils proviennent s’ils ne sont pas natifs du territoire national, essentiellement d’Europe centrale et orientale : Bulgarie, Kosovo, Roumanie,… Dans les années 2000, l’Allemagne, la France et l’Italie se distinguent particulièrement par des mesures de ce type [9] . C’est sans doute en 2010 que les tensions s’exacerbent à l’occasion des expulsions massives pratiquées par le gouvernement de Sarkozy qui illustraient crument les discriminations que subissent les Roms [10] . Le nœud de la situation réside dans l’adhésion des pays d’Europe centrale et orientale à l’UE qui a « transformé » les Roms issus de ces pays, jusqu’alors migrants, souvent clandestins, en citoyens à part entière de l’UE sensés pouvoir jouir de la libre-circulation des personnes qui est au principe de l’Union [11] . Ces tensions se sont encore exacerbées en 2013 avec la perspective de la fin prévue pour 2014 des restrictions qui pèsent sur le Roumanie et la Bulgarie quant à leur intégration inconditionnelle à l’espace Schengen. Si l’argument premier des méfiances à leur égard a trait à la capacité de ces Etats à contrôler leurs frontières et donc les flux migratoires extra- européens, la circulation des Roms de ces pays est prétexte aux inquiétudes exprimées publiquement comme l’illustre un article caricatural du Daily Mail selon lequel, la moitié d’un village roumain, peuplé de Roms, attendait le 1er janvier 2014 pour déménager en Grande-Bretagne [12] . Cette perspective migratoire sur les Roms correspond aux nombreux discours politiques tenus à leur égard, dès lors qu’il s’agit de soutenir des politiques de contrôle ou de justifier des mesures, et elle se conjugue volontiers aux préjugés qui ont cours au sujet de cette minorité. A travers l’Europe, les discours qui parlent explicitement des Roms ou qui les évoquent se démultiplient. Si l’extrême-droite est coutumière du thème, à l’image des interventions de Jean-Marie Le Pen qui fantasment sur le déferlement de 12 millions de Roms ou des déclarations violentes du journaliste hongrois Ferenc Szaniszlo qui compare les Roms à des animaux (ce qui ne l’empêche pas d’être récompensé pour son travail par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán [13] ), les dirigeants européens l’exploitent avec de moins de moins de retenue. En novembre 2013, dans une tribune, David Cameron déclare son opposition à la libre circulation des travailleurs Bulgares et Roumains au nom des inquiétudes que cela suscite : « I know many people are deeply concerned about the impact that could have on our country. I share those concerns. », et plus loin : « if people are not here to work - if they are begging or sleeping rough - they will be removed [14] . » Pour Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur et s’exprimant le 24 septembre 2013 au sujet de démantèlements : « Ces populations [les Roms] ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres, et qui sont évidemment en confrontation, il faut tenir compte de cela, cela veut bien dire que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie [15] ». Malgré la différence des contextes (l’un s’exprime sur l’ouverture des frontières, l’autre sur des
opérations de police), ces deux discours partagent le même cliché sur l’incompatibilité des modes de vie entre les Roms et la société « d’accueil » qui semble acquis au sens commun. Les politiques ne sont pas les seuls à reproduire la caricature des Roms, à l’occasion de l’affaire de « l’Ange blond », les médias ont abondamment répercuté une intervention d’Interpol qui accréditait ouvertement la thèse d’une culture du trafic d’enfant propre aux Roms : « this problem, of children going missing and falling into gypsy hands, is a problem throughout the continent [16] . » Confortés par cette ambiance sans nuance, la presse européenne s’est largement fait l’écho de la rumeur de la fillette blonde « tombée dans les mains des tsiganes » et semble avoir ainsi parlé d’une même voix. Les particularismes locaux du traitement médiatique Un examen plus attentif des différents angles par lesquels l’histoire de Maria a été traitée montre que si les stéréotypes sur les Roms sont identiques d’un pays à l’autre, ils ne sont pas mobilisés pour les mêmes raisons. Le contexte national joue un rôle important sur l’orientation des aspects par lesquels l’histoire prend du sens comme l’illustre la comparaison entre la Grande-Bretagne, la France et l’Irlande. Les tabloïds britanniques Le rôle des tabloïds britannique dans la notoriété qu’a connu l’affaire a été important. Pendant une semaine, les plus gros tirages que sont The Sun, The Daily Mail, The Daily Mirror ou The Daily Telegraph ont chacun publié des dizaines d’articles en insistant, tabloïd oblige, sur les photos de Maria et consacrant le drame que sa blondeur devait incarner. Bien que la minorité rom reste faible en comparaison des 60 millions de Britanniques [17] , elle est régulièrement évoquée dans les médias et généralement négativement [18] . En 2013, l’imminence de l’entrée complète de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’espace Schengen a inspiré de nombreux articles et discours politiques aux accents parfois ouvertement xénophobes [19] . Les journaux britanniques ont largement présenté l’affaire de « l’Ange blond » sous l’angle de l’enlèvement d’enfant, adhérant à la rumeur selon laquelle Maria serait une enfant volée. Mais cette perspective n’est pas uniquement alimentée par le mythe du Gitan voleur d’enfants. Elle s’inscrit surtout dans la lignée des nombreux dossiers d’enfants disparus qui entretiennent régulièrement l’attention médiatique britannique, à l’instar de la disparition de la petite Maddie MacCann survenue au Portugal en 2007 et qui a constitué (et constitue encore) un ressort de l’audience, et donc un élément commercial des médias britanniques et tout particulièrement des tabloïds [20] . Rapidement, les médias ont entretenu l’hypothèse que Maria pourrait être une de ces enfants disparus. La presse britannique a aussi beaucoup évoqué la disparition en Grèce du petit Ben Needham en 1991 [21] . Ce cas prendra une tournure singulière puisque le 27 octobre 2013, suite à la diffusion d’images prises de lui, un jeune Rom aux cheveux clairs se présente à la police chypriote en soupçonnant être lui-même le petit Ben, ce qui s’avérera inexact. Dominé par l’angle
de l’enlèvement d’enfant et la mauvaise réputation des Roms d’Europe de l’est, les quotidiens britanniques n’ont pas laissé beaucoup de place à une réflexion critique. Ils ont souvent préféré, comme The Sun, laisser ses « envoyés spéciaux » décrire avec répulsion les conditions de vie dont a été « sauvée » Maria : « Unkempt children played in the street waving sticks at strangers. Old motorbikes and car parts littered the neighbourhood, while stray dogs rummaged through piles of rubbish [22] . », entretenant ainsi l’image de clochards nuisibles qui convient bien aux postures politiques hostiles aux ressortissants des pays de l’est. Ce n’est qu’auprès des médias à moindre tirage, comme The Guardian, qu’on peut trouver des analyses critiques de l’emballement médiatique et une dénonciation des narrations stéréotypées qui ont entretenu l’évènement : « An angel kidnapped by Gypsies ? In the absence of all the facts, age-old libels are being replayed [23] », titre le quotidien de gauche. La presse française La « question rom » est un thème récurrent de l’actualité française. Outre les expulsions massives et les démantèlements de camps pratiqués par les gouvernements de Sarkozy puis par celui de Hollande, des faits divers impliquant des Roms font régulièrement les choux gras de la presse populaire et inspirent des déclarations outrancières de politiciens locaux. En juillet 2013, un élu UDI (centre) se distinguait par une ironie nauséabonde : « Hitler n’en n’a peut-être pas tué assez [24] », largement reprise dans les médias (et conduisant à son expulsion du parti). Le même mois, sur un mode à peine moins extrémiste, le député UMP Christian Estrosi vantait ses méthodes pour « mater » les Roms en situation irrégulière [25] . L’ambiance hostile culmine sans doute avec le lynchage d’un jeune homme en juin 2014 [26] . Mais c’est en octobre 2013 que l’attention médiatique sur cette minorité est à son comble lorsque les titres sont occupés par l’expulsion vers le Kosovo de la famille de la jeune Leonarda, arrêtée lors d’une sortie scolaire [27] . C’est dans ce contexte que surviennent les informations au sujet de « l’Ange blond » qui s’offrent donc à des médias déjà polarisés entre ceux qui semblent souscrire à la perspective du gouvernement sur un « problème rom » et ceux qui privilégient un traitement antiraciste et critique. Ainsi, le Figaro, conservateur, n’hésite pas à reproduire la parole d’élus grecs qui parlent des camps roms en des termes que ne renieraient pas certains maires de France : « Ces ghettos font peur. Ils concentrent trop de monde, un policier ne peut s’y aventurer seul. C’est dangereux. Il faut les disperser. Sinon, ils continueront à voler, à écouler de la drogue ou à enlever des enfants [28] ». En revanche, Le Monde et Libération, après avoir publié les dépêches initiales, préféreront insister sur les préjugés racistes qui animent l’affaire : « Eh bien oui, les Roms peuvent être blonds [29] ! » titre le premier, « Qui sont les voleurs d’enfants [30] ? » s’interroge le second, retournant l’accusation contre les services sociaux.
La presse irlandaise A priori, rien ne semblait devoir faire de l’Irlande un lieu où l’affaire de « l’Ange blond » rebondirait, provoquant un brusque changement dans la manière dont les médias de l’île ont couvert l’affaire. Dans les premiers jours, les quotidiens suivent leurs confrères européens et couvrent l’histoire de la petite Maria sans questionner la pertinence des communiqués de presse et de police sur la thèse de l’enlèvement. En Irlande, les Roms constituent une petite minorité : ils seraient 37 500 pour une population totale de près de 4,2 millions d’habitants [31] . Démographique, cette discrétion est aussi médiatique. Contrairement à la Grande-Bretagne, la minorité rom n’apparait que très occasionnellement dans l’actualité et les faits divers [32] . Mais si la thématique rom n’exerce pas d’influence particulière sur la sensibilité médiatique de l’Irlande, il en va autrement des questions liées à la maltraitance des enfants et aux actes des services sociaux dans ce domaine. Les années 1990 et 2000 ont été marquées par de régulières révélations en matière de maltraitance d’enfants dans des institutions publiques, souvent encadrées par des religieux catholiques [33] . En 2009, le rapport d’une commission spéciale du Parlement irlandais détaille ces affaires et suscite l’émotion pour l’étendue des abus qui y sont révélés ou confirmés [34] . Ce contexte singulier explique sans doute les réactions suscitées par l’affaire de « l’Ange blond » dans les médias irlandais lorsqu’inspirés par l’histoire de Maria, la police et les services sociaux retirent deux enfants roms et blonds à leur famille respective pour vérifier leur identité. La situation est paradoxale : c’est la couverture médiatique de l’affaire grecque qui contribue à la propagation de la rumeur et du fantasme des Roms voleurs d’enfants, mais lorsque la police y souscrit, l’approche médiatique change du tout au tout. Dès le 22 octobre, les quotidiens, comme l’Irish Times et The Independent, consacreront jusqu’à la fin du mois des dizaines d’articles à l’affaire qui dénoncent ouvertement les préjugés dont sont victimes les Roms et les abus des services sociaux accusés d’avoir fait du profilage racial. Ainsi, si le 19 octobre The Irish Times reproduit une dépêche intitulée « Interpol search for parents of girl found in Roma camp [35] », une semaine plus tard, il dénonce les préjugés : « Roma incidents highlight attitudes to the marginalised [36] ». Les articles de ce genre se démultiplient rapidement et dramatisent non plus l’enlèvement supposé d’un enfant mais le drame familial d’une séparation : « Our son woke up crying, says dad of boy taken by gardai [37] [la police irlandaise] » et le dérapage des services publics : « Authorities red-faced after ’rush to judgment’ [38] ». Echaudés par l’épisode grotesque irlandais, les quotidiens relisent l’affaire grecque et y soulignent les mêmes travers : « ‘Maria’ case reveals Greek bureaucracy close to collapse [39] ». La représentation des Roms comme moteur du récit médiatique La clé de voûte du battage médiatique consacré aux enfants blonds en octobre 2013 est le stéréotype du Rom. D’une part, il est largement activé, par les polices grecques ou irlandaises et par les médias, pour donner du sens à ce qui semble une anomalie capillaire. A priori, avoir des cheveux blonds ne constitue pas une raison pour écrire des histoires, à moins, de toute évidence, d’être rom. L’enthousiasme médiatique pour Maria révèle donc d’abord l’arrière-fond racial, au sens
de l’apparence physique, qui structure l’imaginaire sur les Roms (qui, en effet, sont les autres d’un ange blond sinon de sombres démons ?). Dans un même temps, cette anomalie est exorcisée par un autre cliché, tout aussi raciste, qui consiste à l’expliquer par l’évidence qui veut que les Roms enlèvent les enfants des non-Roms. Ce double stigmate n’a pas convaincu tous les commentateurs. Beaucoup de médias ont donné la parole à des institutions, comme le Conseil de l’Europe, ou des associations engagées aux côtés de ces minorités pour qu’elles dénoncent cette stigmatisation. Toutefois, ce faisant, c’est toujours le cliché qui est au cœur de la narration bien qu’il s’agisse de le déconstruire. Finalement, les Roms n’ont pas médiatiquement existé sous un autre regard que celui conditionné par un discours politique et médiatique européen largement soupçonneux à leur égard. Lorsque l’affaire de « l’Ange blond » survient, soit, comme en Grande-Bretagne et en France, elle alimente une présence médiatique déjà nourrie par l’idée qu’il y ait un « problème », soit elle éclaire une minorité jusqu’alors transparente, comme c’était plus ou moins le cas en Irlande. Mais c’est également en Irlande que ce ressort narratif du cliché versus la déconstruction du cliché a trouvé ses limites. En effet, pour dramatiser l’histoire des deux enfants séparés de leurs familles par la police irlandaise, il fallait non plus puiser dans l’imaginaire de l’enlèvement d’enfant et de la marginalité des Roms, mais solliciter les valeurs familiales. Le scandale relevait d’abord d’une atteinte à l’intégrité des familles et à la quiétude des enfants. Soudain, les Roms n’étaient plus seulement affligés par la stéréotypie mais accédaient au rang de citoyens « normaux » et de parents. Comme le titrait The Irish Independent : « Every parent’s worst nightmare suddenly springs to horrifying life [40] ». L’affaire de « l’Ange blond » ne restera sans doute pas un évènement mémorable et il est peu probable que les médias se soucient à l’avenir de ce que deviendra Maria. L’épisode reste cependant remarquable parce qu’il dévoile à quel point l’imaginaire sur une minorité combiné à un climat politique spécifique envers elle est susceptible d’animer le travail des médias. Certes, l’hypothèse du trafic d’enfants était du vent, mais il a soufflé fort. Au risque, dont peu de médias se sont souciés, d’agiter un peu plus les fantasmes qui recouvrent les minorités les plus marginalisées d’Europe. Daniel Bonvoisin Média Animation, Novembre 2014 [1] VANTIGHEM, Vincent, « Tout comprendre sur l’affaire de « l’Ange blond », 22 octobre 2013, Site Web de 20 minutes, http://www.20minutes.fr/societe/1240101-20131022-grece-tout-comprendre-laffaire-lange-blond (17 avril 2014) [2] SPENCER, Ben, Now blonde girl found at a Roma home in Ireland : Blue-eyed child of seven is led away by police and social workers, The Daily Mail, 21 octobre 2013, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2470998/Blonde-Angel-Maria- Mystery-child-bought-850.html [3] « Serbie : « "l’ange blond" de Novi Sad était bien rom », trad. ALIGRUDIC, Persa, Le Courrier des Balkans, 23 octobre 2013, balkans.courriers.info/article23470.html
[4] OWENS, Nick, THORNTON, Lucy, Is this Ben Needham ? Picture of Roma man suspected of being British tot missing for 22 years, The Daily Mirror, 27 octobre 2013, http://www.mirror.co.uk/news/world-news/ben-needham-picture-roma- man-2643982 [5] REBILLAT, Clémentine, « Le mystère de "l’Ange Blond" résolu », 26 octobre 2013, Site web de Paris Match, http://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/Le-mystere-de-l-ange-blond-resolu-534556 [6] Dont deux aspects, l’enlèvement et l’orientation raciste, rappellent celle d’Orléans analysée par une équipe dirigée par Edgard Morin MORIN, Edgar, La rumeur d’Orléans, Paris, Seuil, 1969, 256 p. [7] La presse non européenne a également été prolixe sur le sujet comme en témoigne cet article du New York Times : BILEFSKY, Dan, « Roma, Feared as Kidnappers, See Their Own Children at Risk », The New York Times, 25 octobre 2013, www.nytimes.com/2013/10/26/world/europe/for-the-roma-fears-of-kidnapping-in-europe-only-mirror-their- own.html?_r=0 [8] Comme l’illustre cet article d’une anthropologue paru à Libération et qui entre parfait dans le concept de « l’anti-mythe de dissuasion » proposé par Edgard Morin comme discours « constitué par la conjonction des plaintes en justice, des interventions de personnalités, d’associations, d’autorités, des articles parus dans la presse » (MORIN, Edgar, ibidem. P. 68). : CONDEMI, Silvana, Ange blond et noirs démons, Libération, 3 novembre 2013, www.liberation.fr/monde/2013/11/03/ange-blond-et-noirs-demons_944264 [9] CAHN, Claude, « Racial Preference, Racial Exclusion : Administrative Efforts to Enforce the Separation of Rom and Non-Roma in Europe Through Migration Controls », European Journal of Migration and Law, no.5, 2004, pp 479-490 [10] SIGONA, Nando, op. cit. [11] Ibid, p.214 [12] « Comment le Daily Mail invente une information sur l’invasion des Roumains », Presseeurop.eu, 12 novembre 2013, www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/4311861-comment-le-daily-mail-invente-une-information-sur-l-invasion-des- roumains [13] . «A Nice, Jean-Marie Le Pen dérape sur les Roms », AFP via Libération, 4 juillet 2013, www.liberation.fr/societe/2013/07/04/a-nice-jean-marie-le-pen-derape-sur-les-roms_916116. ; THEDREL, Arielle, « Hongrie : Viktor Orban met l’extrême droite à l’honneur », Le Figaro, 18 mars 2013, www.lefigaro.fr/international/2013/03/18/01003-20130318ARTFIG00412-hongrie-viktor-orban-met-l-extreme-droite-a-l- honneur.php [14] CAMERON, David, « Free movement within Europe needs to be less free », Financial Times, 27 novembre 2013 [15] BEAUDOUX, Clara, « Selon Manuel Valls, une minorité de roms veulent s’intégrer », France Info, 24 septembre 2013, www.franceinfo.fr/politique/actu/article/selon-manuel-valls-une-minorite-de-roms-veulent-s-integrer-285659 [16] PETTIFOR, Tom, « Kate and Gerry’s "great hope" : Mystery blonde girl found living with gypsies gives boost to Madeleine McCann’s parents », The Daily Mirror, 18 octobre 2013, http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/madeleine- mccann-kate-gerrys-great-2467765 [17] Une étude parue dans les médias britanniques en novembre 2013 estime à près de 200 000 migrants le nombre de Roms récemment arrivés de l’Est de l’Europe : KEELEY, Amie, « UK has one of largest Roma populations in Western Europe with 200,000 living here », The Daily Mail, 31 octobre 2013, www.dailymail.co.uk/news/article-2480751/UK- largest-Roma-populations-Western-Europe-200-000-living-here.html
[18] Comme dans cet exemple : BIRD, Steve, « The Roma gipsy beggars of Park Lane : 30 Romanians camp out with soiled duvets and cardboard boxes in exclusive London street », The Daily Mail, 24 mai 2013, www.dailymail.co.uk/news/article-2330542/The-Roma-gipsy-beggars-Park-Lane-30-Romanians-camp-soiled-duvets- cardboard-boxes-exclusive-London-street.html [19] Comme l’illustre cette polémique entre porte-paroles partisans : LYONS, James, « "Ugly and stupid" : Lib Dem chief Tim Farron’s blast at Tories over attacks on immigration », The Daily Mirror, 1er janvier 2014, www.mirror.co.uk/news/uk- news/ugly-stupid-lib-dem-chief-2976662 [20] MOREAS, Georges, « La disparition de la petite Maddie tourne au mélo », Blog de Georges Moréas, Le Monde.fr, 17 octobre 2013, moreas.blog.lemonde.fr/2013/10/17/la-disparition-de-la-petite-maddie-tourne-au-melo [21] MURPHY, Simon, « Was missing Ben Needham at the same gypsy camp as ’Maria’ ? Police probe claims that abducted British boy was seen at site where blonde girl, four, was found », The Daily Mail, 20 octobre 2013, www.dailymail.co.uk/news/article-2468431/Police-probe-claims-Ben-Needham-spotted-gypsy-camp-Maria.html [22] PARRY, Ryan, « Faked », The Sun, 24 October 2013, http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/5219850/pictures-of-missing-girl-maria-room-staged-to-protect-gypsy- community.html [23] DOUGHTY, Louise, « An angel kidnapped by Gypsies ? In the absence of all the facts, age-old libels are being replayed », The Guardian, 22 octobre 2013, www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/22/angel-kidnapped-by- gypsies-libel-replayed [24] MEDIONI, David, « Roms / Hitler : le dérapage du maire UDI était enregistré », @rrêt sur images, 22 juillet 2013, www.arretsurimages.net/breves/2013-07-22/Roms-Hitler-le-derapage-du-maire-UDI-etait-enregistre-id15914 [25] « Estrosi dit "mater" les Roms », Le Figaro, 7 juillet 2013, www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/07/07/97001- 20130707FILWWW00060-estrosi-dit-mater-les-roms.php [26] MOUILLARD, Sylvain, TOURANCHEAU, Patricia, LE DEVIN, Willy, « Darius, jeune Rom lynché à Pierrefitte », 17 juin 2014, Libération, www.liberation.fr/societe/2014/06/17/darius-jeune-rom-lynche-a-pierrefitte_1043854 [27] L’article dédié à l’affaire sur Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Leonarda [28] KEFALAS, Alexia , « "L’ange blond" déclenche un débat sur les Roms en Grèce », Le Figaro, 25 octobre 2013, www.lefigaro.fr/international/2013/10/22/01003-20131022ARTFIG00606-l-ange-blond-declenche-un-debat-sur-les-roms- en-grece.php [29] SALLES, Alain, « Eh bien oui, les Roms peuvent être blonds ! », 31 octobre 2013, Le Monde, http://www.lemonde.fr/cgi- bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1248624&xtmc=eh_bien_oui_les_ro ms_peuvent_etre_blonds&xtcr=1 [30] BORDIGONI, Marc, PIASERE, Leonardo, « Qui sont les voleurs d’enfants ? », 3 novembre 2013, Libération, http://www.liberation.fr/monde/2013/11/03/qui-sont-les-voleurs-d-enfants_944259 [31] « Statistiques, Roms et Gens du voyage », op. cit. [32] Comme par exemple en novembre 2012 lorsqu’une mendiante rom est la première à subir une nouvelle législation en matière de mendicité, CUSAK Jim, « Roma gypsy first to be convicted for begging », The Irish Independent, 30 novembre 2012, www.independent.ie/irish-news/courts/roma-gypsy-first-to-be-convicted-for-begging-26737314.html, où lorsque
deux « clans » sont au cœur d’une affaire de mœurs, « Two richest Roma clans at centre of child rape », The Irish Independent, 25 novembre 2012, www.independent.ie/irish-news/two-richest-roma-clans-at-centre-of-child-rape- 26321843.html [33] Le cas des couvents des Sœurs Magdalène constitue le volet le plus célèbre de ces affaires, GORDON, Mary, « How Ireland Hid Its Own Dirty Laundry », The New York Times, www.nytimes.com/2003/08/03/movies/how-ireland-hid-its-own- dirty-laundry.html?pagewanted=all&src=pm [34] Commission to Inquire into Child Abuse, 2009, http://www.childabusecommission.com [35] REUTERS, « Interpol search for parents of girl found in Roma camp », 19 octobre 2013, The Irish Times, http://www.irishtimes.com/news/world/europe/interpol-search-for-parents-of-girl-found-in-roma-camp-1.1566962 [36] O’BRIEN, Breda, « Roma incidents highlight attitudes to the marginalised », 26 octobre 2013, The Irish Times, http://www.irishtimes.com/news/social-affairs/incidents-involving-roma-children-highlight-our-attitude-to-the- dispossessed-1.1573680 [37] HOGAN, Louise, « Our son woke up crying, says dad of boy taken by gardai », 25 octobre 2013, Irish Independent, http://www.independent.ie/irish-news/our-son-woke-up-crying-says-dad-of-boy-taken-by-gardai-29699019.html [38] « Authorities red-faced after ’rush to judgment’ », 24 octobre 2013, Irish Independent, http://www.independent.ie/opinion/editorial/authorities-redfaced-after-rush-to-judgment-29696191.html [39] SMITH, Helena, « ‘Maria’ case reveals Greek bureaucracy close to collapse », 26 octobre 2013, The Irish Times, http://www.irishtimes.com/news/world/europe/maria-case-reveals-greek-bureaucracy-close-to-collapse-1.1573895 [40] DONOHOE, Miriam, « Every parent’s worst nightmare suddenly springs to horrifying life », Irish Independent, 23 octobre 2013, http://www.independent.ie/opinion/columnists/miriam-donohoe/every-parents-worst-nightmare-suddenly- springs-to-horrifying-life-29688066
Mattelart Tristan
Médias et migrations dans l’espace euro-
méditerranéen
Revue européenne des migrations internationales [En ligne], vol. 32
- n°3 et 4 | 2016, mis en ligne le 01 décembre 2016, consulté le 28
mai 2018.
URL : http://journals.openedition.org/remi/7891
Cet ouvrage est le fruit d’un projet de recherche collectif sur « Médias et migrations dans l’espace
euro-méditerranéen » (Mediamigraterra) financé par l’ANR de 2009 à 2012. Il entend analyser le rôle
des médias en amont et en aval de la migration, c’est-à-dire comprendre la façon dont ceux-ci
impactent la dynamique migratoire avant le départ, autant que la dynamique d’intégration lors de
l’installation. Remarquable de par sa densité et la richesse de ses contenus, l’ouvrage de près de
600 pages, composé de seize chapitres, est organisé autour de cinq grands axes qui ont également
servi de fil conducteur au programme de recherche : le rôle joué par les médias, dans les pays du
Maghreb, dans le désir de partir ; les dispositifs médiatiques mis en place par les États du Maghreb à
destination de leurs émigrés ; la mise en place, ou pas, de politiques d’insertion médiatique des
populations issues de l’immigration dans les pays d’accueil en Europe du Sud (France, Espagne, Italie) ;
les usages des médias et des technologies dans les foyers issus de l’immigration maghrébine en France.
• 1 À ce sujet, voir le film du réalisateur kurde d’Irak Hiner Saleem (1998) Vive la mariée et la
libér (...)
2La première partie interroge le lien entre médias et émigration. Il se garde toutefois de défendre une
vision fonctionnaliste qui postulerait l’idée selon laquelle les médias font l’immigration – en présentant
notamment les pays européens comme un Eldorado et en attisant les désirs de consommation – et qui
négligerait les facteurs sociaux, économiques et politiques dont on connaît bien le poids. Ainsi, le texte
de Ratiba Hadj-Moussa s’intéresse à la façon dont l’usage des télévisions par satellite contribue depuis
les années 1990 à une transformation de l’espace public, rendant possible l’expression de critiques à
l’égard des gouvernements. D’autre part, elle montre que les images occidentales ne sont plus les
seules à séduire au Maghreb, notamment parmi les jeunes générations, et que le discours identitaire
sur l’« arabité-islamité » des chaînes panarabes vient contrebalancer les représentations de
l’immigration, des musulmans et de l’Islam parfois distordues et simplistes véhiculées par les médias
occidentaux. Le texte de Tarik Sabry porte sur les liens existants entre les usages d’Internet,
notamment des réseaux sociaux, et les projets migratoires des jeunes Marocains. Dans ses travaux
précédents des années 2000, l’auteur avait pris à bras-le-corps la question de la relation entre les
programmes télévisuels des grandes chaînes occidentales et le désir des Marocains « d’émigrer vers
l’Ouest ». Toutefois, loin de se cantonner à l’émigration physique, il évoquait surtout l’importance de
« l’émigration mentale » et « symbolique ». Dans la même veine, il interroge d’une part dans cet article
les effets des usages des médias sur les stratégies de mise en œuvre du projet migratoire : récolte et
échange d’informations pratiques, mais aussi recherche d’une relation amicale ou amoureuse avec
une personne déjà installée en Europe, comme les jeunes générations précédentes le faisaient déjà à
travers la presse magazine dans les années 1980 ou les cassettes vidéo dans les années 19901. D’autre
part, Tarik Sabry traite également d’un aspect plus méconnu et moins attendu : celui des usages des
réseaux sociaux, en particulier de Facebook, non pas pour communiquer avec l’Occident, mais avecd’autres Marocains à l’intérieur du Maroc. Dans le prolongement de ces réflexions, on pourrait
s’interroger sur les possibles effets produits et/ou induits par les relations parfois tendues entre Beurs
et Blédards, comme l’a démontré Claire Schiff dans des enquêtes portant sur l’analyse de contenu de
forums de discussion en ligne dédiés à la communauté maghrébine en France (Schiff, 2015).
3La deuxième partie de l’ouvrage s’inscrit volontairement en porte à faux avec la vision d’Appadurai
selon laquelle le monde contemporain serait composé de flux et de circulations, au détriment des
organisations stables qui s’en trouveraient de ce fait fragilisées. Les quatre textes qui la composent
montrent au contraire la force des États du Maghreb, qui utilisent depuis longtemps les médias comme
moyen de gestion des migrations, dans une perspective de maintien des liens communautaires, à la
fois en diffusant leur version du récit national et en incitant les émigrés à réinvestir une partie de leurs
revenus dans l’économie nationale. Yvan Gastaut montre, avec l’œil de l’historien, la façon dont l’État
algérien s’est servi depuis l’indépendance de tous les moyens disponibles pour communiquer avec ses
ressortissants à l’étranger, et ce bien avant la popularisation des télévisions satellitaires et d’Internet,
avec un journal comme L’Algérien en Europe. Il souligne toutefois les difficultés auxquelles est
confronté l’État algérien, dès lors que l’immigration de travail se transforme en immigration de
peuplement à partir des années 1980. Dans le prolongement, Mohamed-Ali Adraoui analyse la manière
dont Alger se sert de la télévision par satellite, d’abord grâce à Canal Algérie, pour communiquer avec
ses émigrés dans les années 1990, à un moment où, parallèlement, chaînes occidentales, surtout
françaises, et chaînes arabophones entrent également en concurrence dans le paysage satellitaire au
Maghreb. Dans une offre de plus en plus diversifiée, il s’agit aussi de combattre l’apparition des chaînes
berbérophones. Là aussi, d’intéressants parallèles pourraient être soumis à la discussion avec la
situation turque et le développement de la chaîne satellitaire TRT-International qui entendait,
également dans les années 1990, à la fois maintenir les liens politiques et économiques avec les
populations turcophones à l’étranger, mais aussi alimenter l’imaginaire national contre l’émergence
médiatique d’identités concurrentielles au premier rang desquelles l’identité kurde, elle-même
traversée par différents courants politiques et religieux (Rigoni, 2001 ; de Tapia et al., 1997). Mais c’est
sur le Maroc que porte l’article suivant, rédigé par Abdelfettah Benchenna, l’un des États d’émigration
ayant certainement mis le plus de moyens institutionnels dans le maintien de ses liens, voire de son
contrôle, à l’égard de ses ressortissants et de leurs descendants à l’étranger qui, tous, sont considérés
comme des « sujets du roi ». Comme Canal Algérie, Al Maghribiya, destinée aux émigrés d’Amérique
du Nord, est fortement dépendante du pouvoir politique marocain et même longtemps condamnée à
rediffuser une sélection de programmes émanant des deux chaînes généralistes Al Aoula et 2M.
Aujourd’hui toutefois, le gouvernement marocain réfléchit à la façon dont il pourrait se servir de cet
outil pour augmenter son influence dans le paysage audiovisuel international sans que cela ne lui coûte
trop cher en termes de liberté. L’article suivant se focalise pour sa part sur les chaînes panarabes reçues
en Europe, la façon dont elles représentent les émigrés d’origine arabe et traitent des questions
relatives à l’immigration. Naomi Sakr montre tout d’abord qu’à l’inverse des chaînes satellitaires
étroitement contrôlées par les États maghrébins, les chaînes panarabes ne s’intéressent pas
prioritairement aux publics d’origine arabe. En revanche, lorsqu’elles s’intéressent aux émigrés arabes,
et c’est notamment le cas d’Al Jazeera et d’Al Jazeera Children, ceux-ci sont dépeints tour à tour
comme des figures de la réussite – ce qui contrebalance avec l’image véhiculée par les médias
occidentaux – et comme des citoyens rendus amers par la situation économique, mais aussi par les
contraintes politiques qui leur sont imposées par les gouvernements des pays du Maghreb – ce qui
contraste fortement avec le positionnement des médias maghrébins.
• 2 L’article de Navarro et al. (2011) portait déjà sur cette dimension entre les mêmes trois pays.
4La troisième partie de l’ouvrage porte la focale sur la rive nord de la Méditerranée en s’intéressant à
la façon dont les médias du sud de l’Europe traitent des questions migratoires. Les auteurs montrent
l’impact des différentes politiques d’intégration sur la façon dont les médias parlent de l’immigration
et s’adressent aux immigrés. En filigrane, on perçoit, pour chacun des États, les liaisons entre lesVous pouvez aussi lire