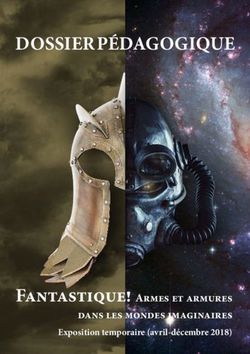LA RÉCEPTION DE L'ENCYCLIQUE FIDEI DONUM DANS LE DIOCÈSE DE LIÈGE - fidei donum dans le diocèse de
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
LA RÉCEPTION DE L’ENCYCLIQUE
FIDEI DONUM DANS LE DIOCÈSE DE
LIÈGE
Marcel Villers UCL 15 novembre 2021
INTRODUCTION
Saisissant l’occasion du 65ème anniversaire de l’encyclique Fidei donum (Pâques
1957), l’APLM, « aide aux prêtres liégeois en mission », association créée en 1963
pour soutenir les prêtres du diocèse partis à l’étranger, a mis en route un projet qui se
veut à la fois un acte de mémoire et un geste d’espérance. C’est toute une page de
l’histoire du diocèse que nous voulons conserver. Un livre, un film et un évènement
diocésain en seront l’aboutissement. Deux prêtres, Marcel Villers et François-Xavier
Jacques, eux-mêmes anciens Fidei donum, se sont attelés à la tâche, assurés de la
collaboration des membres de l’association (APLM).
Acte de mémoire car nous voulons faire connaître la personnalité et l’action des 89
prêtres diocésains liégeois qui ont répondu à l’appel missionnaire amplifié par
l’encyclique Fidei donum. L’Afrique et l’Amérique latine sont les deux destinations
majeures, ce qui s’explique par le contexte de l’époque et la situation de l’Église. Nous
avons cherché à retracer l’essentiel de la biographie de ces prêtres, partis entre le
début des années 1950 et aujourd’hui ; une vingtaine sont encore en vie dont 7 sur
place.
Nous avons heureusement bénéficié de plusieurs sources de documentation dont la
principale est constituée par les archives de l’association d’aide aux prêtres liégeois
en mission (APLM). En novembre 1963, une quinzaine de prêtres liégeois restés au
pays se constituent en comité et font appel à leurs confrères pour collaborer à l’œuvre
missionnaire des prêtres partis en leur apportant une aide matérielle, l’APLM est née.
L’objectif est de fournir un appui financier équivalent au traitement d’un vicaire en
Belgique. En quelque 50 ans, ont été aidés 81 prêtres, les autres étant partis et
revenus avant la création de l’APLM. Cet appoint financier (plus de 3 millions €) a
suscité une correspondance dans les deux sens dont l’ensemble constitue les
précieuses archives (1963-2021) de l’association diocésaine.
En plus des archives (1953-1961) du Fonds Kerkhofs de l’évêché, celles de deux
autres associations ont été largement utilisées, surtout pour retracer l’histoire de
l’engagement du diocèse au Rwanda ; ce sont les archives des « Amis du collège du
Christ-Roi de Nyanza » (1963-2008) et de la « Commission diocésaine Liège-
Rwanda » (1994-2012).
Deux parties dans notre exposé des résultats de notre travail :
1. l’encyclique Fidei donum et son impact sur la politique missionnaire du diocèse
de Liège ;
2. les répercussions sur le clergé et les flux des départs dans le temps et l’espace.
1L’encyclique Fidei donum et son impact sur la
politique missionnaire du diocèse de Liège
C’est le 21 avril 1957 que Pie XII publie l’encyclique Fidei donum qui encourage une
solidarité effective entre Églises et promeut notamment le partage des prêtres
diocésains en faveur surtout de l’Afrique. Cinq ans auparavant, le 21 novembre 1952
à Banneux, Liège adopte le Vicariat apostolique de Nyundo qui vient d’être créé au
Rwanda, sous tutelle de la Belgique, et confié au premier évêque indigène de l’Afrique
belge, Mgr Bigirumwami (1904-1986). Mgr Kerkhofs promet au jeune pasteur de
Nyundo tout son soutien dont il explicite la signification par la responsabilité collégiale
de l’évangélisation et la solidarité entre Églises qui en découle : « La mission
d’évangéliser toute la terre persiste et elle incombe solidairement à tout l’épiscopat
catholique, et notamment aux Évêques et aux fidèles des diocèses qui depuis des
siècles bénéficient des trésors de la foi et de la vie chrétienne. Ils ne peuvent pas
garder jalousement pour eux seuls ce précieux patrimoine, mais ils doivent le
communiquer à leurs frères moins favorisés… »1 Il précédait ainsi les vues
développées par l’encyclique Fidei donum en 1957, mais déjà sous-jacentes à divers
textes comme à l’action de Pie XII.
Cette initiative liégeoise va susciter un vaste questionnement ecclésiologique et une
belle espérance, qui fera dire au grand missiologue, le jésuite P. Charles : « Si
l’initiative de Liège, première en ce genre, trouve des imitateurs, ce sera une date dans
l’histoire des missions. » La revue des Missionnaires d’Afrique, Grands Lacs, va
multiplier, dans les années suivantes, réflexions et appels à suivre l’exemple liégeois.
Liège n’en est pas à son coup d’essai. « C’est à Liège que sont fondées, en 1926, la
Société des prêtres auxiliaires des missions (SAM) afin de mettre des prêtres séculiers
européens au service des évêques en pays de mission et, en 1936, l’ALM (les
auxiliaires laïques et féminines des missions) parallèlement à la SAM. Ces actions
missionnaires ont été vivement encouragées par l’évêque Kerkhofs [1927-1961] qui,
en 1927, accepte de devenir supérieur majeur de la SAM.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, Mgr Kerkhofs ne tarde pas à enseigner
à ses diocésains les devoirs des pays riches à l’égard des pays en voie de
développement. Précédant d’un an l’invitation pontificale contenue dans l’encyclique
Fidei donum (1957), en dépit aussi d’un recrutement sacerdotal en baisse, il invite bien
volontiers ses prêtres diocésains à œuvrer apostoliquement dans les pays en
développement. »2
Deux perspectives sont dégagées de l’initiative liégeoise de parrainage de Nyundo.
D’abord, encourager le recours au clergé séculier ; « il s’agit de mettre à disposition
de certains Vicaires Apostoliques, et pour une durée déterminée, un groupe de
volontaires. Il ne s’agit pas de confier au clergé diocésain un territoire ecclésiastique
dont il aurait seul la charge. »3 On retrouvera la même perspective dans l’encyclique
Fidei donum.
1
Nyundo. Notre Trait d’Union, n°1, juillet 1953.
2
Paul GÉRIN, Les évêques de Liège dans le nouveau régime, du Concordat à nos jours. Troisième et dernière
partie in Trésors de Liège, Bulletin trimestriel, vol 36, septembre 2013, p. 2.
3
S.T., Impressions missionnaires d’un laïc, in Grands Lacs, n° 175, sept. 1954, Tribune libre, p. 38.
2D’autre part, le parrainage d’un diocèse de mission par un diocèse de chrétienté,
inauguré entre Liège et Nyundo, est considéré comme la formule idéale de
collaboration entre Églises, « elle a l’avantage d’être concrète, d’application immédiate
et remarquablement favorable au développement spirituel du diocèse parrain comme
du diocèse filleul. » Dans les faits, la formule restera exceptionnelle.
Il n’empêche que l’encyclique de Pie XII, particulièrement en faveur de l’Afrique et
proposant l’envoi de prêtres, a pu apparaître aux yeux de certains, notamment
liégeois, comme une confirmation et même une reprise de la politique missionnaire de
Liège, incarnée par Mgr Kerkhofs.
Liège et l’Afrique centrale
Après son ordination épiscopale le 1er juin 1952, Mgr Bigirumwami visite pendant six
mois la Belgique en quête de soutien, de ressources et de missionnaires, prêtres et
laïcs pour son jeune vicariat ; il ne repartira pas les mains vides car l’accueil fut
chaleureux. Gagneront Nyundo au cours du premier semestre 1953, deux prêtres de
Malines ; un samiste originaire de Verviers, l’abbé Jean Lacroix ; huit laïques
volontaires ; trois A.F.I. (auxiliaires féminines internationales) ; trois Frères des Écoles
chrétiennes. Suivra l’abbé Naveau en mai 1953, chargé par l’évêque de Liège de
mettre au point un programme concret d’aide au Vicariat de Nyundo.
« À Rome, le long pontificat de Pie XII (1939-1958) est sur le point de s'achever. Dans
les Églises dites « jeunes », une certaine impatience se manifeste. En 1956 paraît le
livre Des prêtres noirs s'interrogent, dans lequel le jeune clergé africain exprime le
désir de garder son identité noire à l'intérieur de la foi chrétienne. Le Vatican engage
une politique de nominations d'évêques locaux, en Afrique et en Asie. »4
L’encyclique marque la prise de conscience de cette nouvelle donne et fixe son
attention sur l’Afrique qui, écrit le pape, « s'ouvre à la vie du monde moderne et
traverse les années les plus graves peut-être de son destin millénaire. » Et d’énumérer
les risques qu’entraîne pareil bouleversement : les séductions et étroitesses d’un
nationalisme exacerbé ; le virus de division que répand le communisme athée ; le
succès croissant de l’Islam ; l’ébranlement culturel et religieux produit par la civilisation
technique et matérialiste. Cette situation peut entraîner la perte de l’Afrique noire pour
l’Église catholique. Le communisme athée, l’avancée de l’Islam parmi les masses
encore païennes, la concurrence des autres confessions chrétiennes peuvent y
conduire. « Demain cette terre, travaillée par d’autres ouvriers que ceux du Seigneur,
sera peut-être devenue imperméable à la vraie foi. »
Le clergé local comme les missionnaires ne sont pas en mesure de répondre
efficacement à cet état de choses. Et surtout, écrit le pape, « il ne suffit pas d’annoncer
l’Évangile : dans la conjoncture sociale et politique que traverse l’Afrique, il faut très
tôt former une élite chrétienne au sein d’un peuple encore néophyte. » Pour former
cette élite, il faut « développer sans retard les œuvres indispensables à l’expansion et
au rayonnement du catholicisme » : fonder des collèges, créer des organismes
d’action sociale, développer la presse et les médias catholiques, promouvoir l’Action
catholique, nourrir la foi et la culture des chrétiens.
4
Maurice CHEZA, La dynamique du don de la foi : Fidei donum, in Mission de l’Église, n° 154, janvier-mars 2007,
p. 29-34.
3Dans cette perspective s’inscrivait, dès 1955-56, l’action de Liège à Nyundo où furent
envoyés des prêtres pour enseigner au Petit Séminaire, puis à Nyanza où, à la
demande de Mgr Bigirumwami, Mgr Kerkhofs envoie le chanoine Ernotte pour
construire et diriger un collège d’enseignement général, le premier au Rwanda ; il
ouvre la première classe avec 42 élèves le 22 septembre 1956.
Liège et l’Amérique latine
L’encyclique Fidei donum s’attachait particulièrement à l’Afrique. Quatre ans plus tard,
en 1961, Jean XXIII demande le même type d’aide pour l’Amérique latine. « Pourtant,
dès le début des années 1950, Rome sollicitait les épiscopats européens pour aider
l’Amérique latine en proie « aux avancées communistes, protestantes et spirites »,
selon le vocabulaire utilisé par Pie XII, notamment dans la lettre apostolique au
cardinal Piazza du 29 juin 1955. L’argumentation de Pie XII est alors défensive et
entend protéger la citadelle catholique assiégée en Amérique latine ». 5 Des
organismes d’aide à l’Amérique latine sont créés dans un certain nombre de pays
d’Europe et d’Amérique du nord. « En Belgique, le Collège pour l’Amérique latine de
Louvain, séminaire interdiocésain et centre de formation spécifique à l’Amérique latine
est fondé en 1953 à la demande du cardinal Van Roey et sur l’impulsion du Saint-
Siège. Les premiers départs de prêtres s’organisent en 1955 à destination de la Bolivie
et du Brésil. »6
Dans la foulée de son prédécesseur, Mgr van Zuylen (1961-1986), retour du Concile,
en 1963, lance le 21 avril un appel aux prêtres de son diocèse pour des volontaires
Fidei donum.7 Cette longue lettre est à l’origine d’un bel élan missionnaire des prêtres
liégeois.
Mgr Van Zuylen fait d’abord une série de constats.
« En Amérique Latine et dans le centre de l’Afrique, c’est tout l’avenir de l’Église qui
est mis en cause par la pénurie des vocations sacerdotales.
L’Amérique du Sud connaît une expansion démographique extraordinaire. Tandis que
chez nous la proportion est d’un prêtre pour 500 habitants, en Amérique latine elle est
en moyenne d’un prêtre pour 5410 habitants. Quelle sera la situation en l’an 2000 si
l’on ne réussit pas à corriger le chiffre du pourcentage sacerdotal ? L’Amérique latine
est en grand danger de perdre son caractère chrétien et de devenir la proie du
communisme favorisé par l’inadaptation des structures sociales et la misère des
masses.
Quant à l’Afrique Centrale, et plus spécialement au Congo, Rwanda et Burundi, l’Église
y a réalisé dans les dernières années, des progrès gigantesques ; elle a grandi
rapidement, trop rapidement peut-être : il y manque des bras pour engranger les
moissons qui grandissent et qui, faute de moissonneurs, risquent de se perdre. »
Il évoque ensuite ses rencontres entre évêques lors du concile.
« Que de fois, au cours de la 1ère session du Concile, des Évêques d’Amérique latine
et d’Afrique m’ont abordé pour me demander de leur envoyer des prêtres du diocèse
de Liège. Ils invoquaient l’encyclique « Fidei Donum », dans laquelle S.S Pie XII avait
lancé un appel à l’aide sacerdotale en faveur des pays démunis de prêtres. Après notre
retour ici nous avons reçu de S.S. Jean XXIII une demande d’aide renforcée pour
5
Caroline SAPPIA, Prêtres Fidei donum belges au Brésil au tournant du Concile Vatican II. Pont entre deux
continents, in Cahiers Internationaux de Théologie Pratique, Série « Acte » n° 10, Louvain, 2016, p. 54-70.
6
SAPPIA, Idem.
7
Acta, n° 14, 1963, p. 117-121.
4l’Amérique latine et en même temps nous parvenait un appel de la hiérarchie du
Congo, Rwanda, Burundi, dont le texte vient d’être publié dans la presse. »
Enfin, il en tire les conséquences et fait appel au clergé liégeois.
« C’est ensemble que nous devons prendre ce problème en charge. Il faudra donc que
certains d’entre nous partent là-bas, comme nos 27 prêtres séculiers qui déjà en
Amérique latine et en Afrique témoignent du dynamisme missionnaire du diocèse. Ce
doivent être des volontaires, n’ayant pas encore atteint 20 années de sacerdoce et
disposés à partir pour une période d’au moins 3 ans au service d’un diocèse lointain.
Je demande à ceux qui sont prêts à ce service de bien vouloir se faire connaître à leur
Evêque qui jugera, d’après les situations, de la suite effective à donner à leur offre.
Leur départ d’ici n’ira pas sans nous mettre devant de sérieuses difficultés. Alors que
notre diocèse souffre depuis la fin de la guerre d’une crise persistante de vocations,
alors que les besoins augmentent chez nous et que le vieillissement relatif de notre
clergé s’accentue, l’envoi de prêtres diocésains à l’étranger posera des problèmes
graves. C’est indéniable. Mais ce n’est pas une raison suffisante pour fermer l’oreille
à l’appel angoissé de ceux qui ont proportionnellement 10 ou 20 fois moins de prêtres
que nous. »
Les répercussions sur le clergé liégeois et les
flux des départs dans le temps et l’espace
Lorsque le Pape Pie XII publie son encyclique à Pâques 1957, six prêtres diocésains
liégeois sont déjà à l’œuvre, depuis 1956, en Afrique (trois au Rwanda ; un au Congo
belge) et, depuis 1955, en Amérique latine (un en Argentine et un en Bolivie). Ceux
qui sont au Rwanda le sont dans le cadre de l’axe Liège-Nyundo, voulu par Mgr
Kerkhofs dès 1952 ; les deux en Amérique latine y arrivent l’année même de leur
ordination, ce qui laisse à penser qu’ils faisaient partie des premiers envoyés par le
Collège pour l’Amérique latine créé par les évêques belges à Louvain en 1953.
LA DISTRIBUTION DANS LE TEMPS DES PRÊTRES ENVOYÉS
Le nombre de prêtres envoyés par Liège va rester modeste (2 ou 3 par an) jusqu’en
1961. De 1961 à 1964, on est au sommet des départs sur la période envisagée (1955-
2010). Au cours de ces quatre années, 20 prêtres partent : 7 vers l’Afrique et 13 vers
l’Amérique latine ce qui constitue 33% du total des prêtres du diocèse de Liège partis
en mission sur la période envisagée (sans compter les Limbourgeois qui ont rejoint le
diocèse de Hasselt lors de sa création en 1967)8.
Comment expliquer cette abondance qui ne se renouvellera pas ?
Pour l’Afrique, on ne peut qu’y lire l’impact de l’encyclique Fidei donum qui porte une
attention particulière au continent africain ; le développement du collège du Christ-Roi
fondé par Liège au Rwanda est aussi un facteur décisif.
Pour l’Amérique latine, joue l’appel de Jean XXIII du 25 septembre 1961 pour l’envoi
de prêtres dans cette partie du monde.
8
89 prêtres Fidei donum sont répertoriés par l’APLM ; 8 d’entre eux n’ont pas été en lien avec APLM ; 14 ont
adhéré à Hasselt : le reste, à savoir 67, est le nombre que nous qualifions de « prêtres liégeois » et à partir duquel
nous avons établi les statistiques ici présentées. Voir en annexe les diverses classifications des prêtres Fidei donum.
5Surtout, cet élan missionnaire est une réponse à l’appel de Mgr van Zuylen du 5 avril
1963 ; ce n’est pas pour rien qu’on constate 11 départs en 1963-1964.
Les années suivantes, de 1965 à 1969, on compte 10 départs, 8 pour l’Amérique latine
et 2 pour l’Afrique centrale. La période faste s’achève : de 1956 à 1970, 46 prêtres
sont partis, soit 70% du total, en 14 ans. Les 30% restants vont s’étaler sur 40 ans.
Vient alors un premier « trou », c’est-à-dire, une absence de départs de 1971 à 1974.
Pourquoi ce « trou » ?
Entre l’achèvement du concile Vatican II, fin 1965, et la mort de Paul VI, en 1978, on
est en proie à ce que d’aucuns ont appelé la crise catholique 9 : déclin accéléré des
vocations sacerdotales et en conséquence vieillissement du clergé ; questionnement
exacerbé des prêtres sur leur identité ; pratique régulière en large baisse ; désarroi
des fidèles suite à la réforme de la liturgie ; crise des autorités révélée par mai 68 ;
mouvement d’émancipation féminine et libération des mœurs. Ce mouvement de crise
au sein de l’Église n’est que l’écho d’une mutation de la société européenne. Du côté
des pays du Sud, la mutation n’est pas moindre et un vent de libération ou
d’indépendance secoue les Églises. Ainsi, certains évêques assimilent l’envoi de
prêtres Fidei donum à du néocolonialisme spirituel. L’Europe n’est pas en reste et on
y pense que les Africains et les Sud-Américains devraient développer leurs propres
Églises indépendamment de l’Occident.
Malgré ces contestations, en Europe comme en Afrique ou Amérique latine, le
mouvement des Fidei donum connaît une légère reprise : 12 prêtres de 1974 à 1982.
Un deuxième « trou » est constaté entre 1983 et 2008 où seulement 5 prêtres sont
partis (3 pour l’Afrique et 2 pour l’Amérique latine), la plupart dans le cadre d’un projet
personnel approuvé par l’évêque. Les derniers sont deux, partis au Congo, l’un en
2009 sous l’influence des Pères Croisiers avec qui il collaborait dans le ministère
paroissial, et l’autre, envoyé en 2010, par le Prado dont il est membre.
Sur l’ensemble de la période (1955-2010), on remarque que les départs pour l’Afrique
se font à un ou deux et étalés sur la période tandis que pour l’Amérique latine, il y a
deux dates majeures : 1961 avec 5 départs et 1964-1965 avec 10 départs, ce qui
représente quasi la moitié de tous les départs (31) pour l’Amérique latine.
LA DISTRIBUTION DANS L’ESPACE DES PRÊTRES ENVOYÉS
Les pays de destination sont au nombre de 22 : 7 pays d’Afrique ; 11 d’Amérique
latine ; 2 du Moyen-Orient ; 2 d’Europe de l’Est. Le nombre de prêtres est de 33 pour
l’Afrique et de 31 pour l’Amérique latine.
Pour l’Afrique, le Rwanda est le premier pays de destination : 21 prêtres (soit 65% des
envoyés en Afrique) dont 17 pour le collège de Nyanza et 4 pour Nyundo ; tous
s’inscrivent dans le projet diocésain Liège-Nyundo et pour la période 1956-1982.
La seconde destination est le Congo avec 7 prêtres dont 5 dans le Katanga-Shaba,
dans le domaine de l’enseignement. Cela semble correspondre à un projet initié par
les évêques locaux avant l’indépendance du Congo et poursuivi bien après.
Les 5 autres pays : Côte d’Ivoire, Mali, Togo, Tchad, Cameroun reçoivent chacun un
prêtre, ce qui indique qu’on a affaire vraisemblablement à des projets individuels.
9
Denis PELLETIER, La crise catholique, Payot, 2005.
6Pour l’Amérique latine, on constate deux traits dominants dans le choix de la
destination en fonction du projet pastoral : être avec les plus pauvres et contribuer à
la formation des acteurs dans le cadre des séminaires, mouvements d’action
catholique et communautés de base. Cela n’ira pas sans un engagement politique et
social coûteux dans une Amérique latine marquée par les dictatures militaires comme
par la théologie de la libération.
La première destination des prêtres liégeois est le Chili avec neuf prêtres, soit à peu
près un tiers de l’ensemble de nos prêtres envoyés en Amérique latine. Ils sont quatre
à partir en 1961 pour des destinations diverses au sein des diocèses du Chili ; suivront
deux prêtres en 1964 et autant en 1965 ; le 9ème viendra en 1966. Le coup d’état du
général Pinochet, le 11 septembre 1973, mettra fin à bien des espoirs et se solda par
l’expulsion des prêtres étrangers (dont un de nos confrères) trop engagés dans la
mouvance du gouvernement socialiste d’Allende (1970-1973).
Le Guatemala reçoit six prêtres, dont deux limbourgeois, autour d’un projet nommé
« Jocotan », créé en 1961 et connu dans certaines paroisses du diocèse de Liège.
La Bolivie accueille quatre prêtres, plus trois confrères limbourgeois, tous basés dans
le diocèse de Potosi, la grande cité minière. Ils y sont dans le cadre d’un projet belge
soutenu par le COPAL et plusieurs associations du diocèse de Liège.
Le Brésil accueille cinq prêtres. Les quatre premiers, en 1975 et 1979, sont tous
affectés à l’enseignement au séminaire et à la pastorale des vocations, avec une
insertion dans le domaine paroissial ; trois d’entre eux sont affectés dans le diocèse
de Lins (État de Sao Paulo), ce qui permet de penser à une certaine continuité au
service d’un même diocèse. Deux prêtres limbourgeois les rejoindront.
Au Venezuela, quatre prêtres sont affectés en paroisse dans divers diocèses.
Suite à l’appel, en 1963, de Mgr van Zuylen, trois prêtres, deux liégeois et un
limbourgeois, partent pour Cuba prendre en charge une paroisse qui sera soumise aux
tracasseries et mêmes persécutions du régime castriste. Ils seront interdits de séjour
ou expulsés après trois ou quatre ans.
Les autres pays d’Amérique latine concernés par nos prêtres Fidei donum, Argentine,
Panama, Honduras, Pérou, Mexique accueillent chacun un prêtre.
Hors Afrique et Amérique latine, un prêtre liégeois est envoyé, souvent à sa demande
et en accord avec notre évêque, en Jordanie, au Liban, en Lettonie et en Hongrie.
ÂGE DU DÉPART ET DURÉE DU SÉJOUR DANS LE PAYS DE
DESTINATION
La moyenne d’âge du départ en Afrique est de 38,6 ans, ce qui peut s’expliquer par la
prédominance des prêtres partis au collège de Nyanza pour y être enseignants ce qui
suppose une formation plus longue et une expérience préalable en Belgique.
Pour l’Amérique latine, l’âge moyen du départ est de 33 ans, ce qui se comprend, en
grande partie, par le fait que la vocation missionnaire est, chez eux, souvent première
et conduit à une formation spécifique à Louvain au sein du Collège pour l’Amérique
latine. La moitié des prêtres liégeois envoyés en Amérique latine l’ont été par le
COPAL. Ceci explique le petit nombre d’années d’ordination au moment du départ :
11 des 31 prêtres partis en Amérique latine ont moins de 3 ans d’ordination.
L’âge moyen d’années d’ordination est de 7 pour les partants en Amérique latine alors
qu’elle est de 13 ans pour ceux partis en Afrique.
7En ce qui concerne la durée du séjour dans le pays de destination, on constate qu’elle
est de moins de 10 ans pour 66% des prêtres envoyés en Afrique et de plus de 40 ans
pour près de 40 % des prêtres partis en Amérique latine. La différence se comprend
dans la mesure où l’engagement missionnaire pour l’Amérique latine est précoce et
souvent sans rupture avec un ministère déjà exercé dans le diocèse de Liège ; on a
affaire à un choix missionnaire initial, souvent affermi et développé par une formation
spécifique au Collège pour l’Amérique latine. Il ne s’agit plus, comme l’encyclique Fidei
donum le recommandait, d’un envoi temporaire, mais d’un don total.
QUESTIONS POSÉES PAR LES PRÊTRES FIDEI DONUM
La première a trait à l’aide matérielle relative aux frais de voyage et aux moyens de
subsistance sur place. A Liège, la réponse a été rapide. Dès novembre 1963, se crée
une association de fait dans le but de solliciter les prêtres du diocèse en faveur de
leurs confrères partis dans le cadre Fidei donum. De cette initiative naîtra l’Aide aux
Prêtres Liégeois en Mission (APLM).
La seconde question est celle du statut de ces prêtres souvent tiraillés entre leur
évêque d’origine et celui du pays où ils exercent leur ministère. La diminution du clergé
en Europe pousse certains évêques à rappeler « leur » prêtre avant terme ; les conflits
entre le prêtre et l’évêque d’origine ou du diocèse de destination ne sont pas rares ;
les conditions de vie sur place sont aléatoires ; bref, ces différents problèmes vont
conduire à mettre au point un contrat entre les deux évêques concernés par le prêtre
Fidei donum.
La question de la préparation des prêtres Fidei donum au pays et à l’Église qui les
accueillent s’est posée très vite et a mené à douter de l’efficacité de la formule Fidei
donum. Pour ces prêtres généreux, le dépaysement inévitable est souvent vécu sans
une formation et une transition accompagnée, ce qui va rendre très difficile une
intégration dans le pays et une adaptation aux perspectives pastorales du diocèse
d’accueil. Le déficit de formation spécifique, la durée limitée de leur présence font
douter du bien-fondé de la formule.
Le retour du prêtre Fidei donum dans son diocèse d’origine va poser aussi question.
Comment lui assurer une réintégration heureuse ? On a pensé à lui proposer un temps
de repos et de soins, puis un recyclage afin de l’acclimater à la nouvelle situation
pastorale de son diocèse. Malgré tout, le retour au pays fut douloureux pour beaucoup
confrontés à l’écart entre l’Église jeune, en croissance, qu’ils venaient de quitter et
l’Église vieillissante, frileuse qu’ils retrouvent.
L’AVENIR DE LA FORMULE FIDEI DONUM
En 1963, alors qu’on est en plein questionnement sur l’avenir des missions, Dominique
Nothomb, Père Blanc d’Afrique au Rwanda à l’époque, évalue la formule Fidei donum.
Son analyse est intéressante pour nous aujourd’hui confrontés à l’arrivée de confrères
africains.
8« Il pointe quatre arguments favorables : c’est la mise en application de la collégialité
épiscopale ; la formule est utile quand il s’agit d’apostolat spécialisé ; le caractère
transitoire facilite la passation des pouvoirs au clergé local ; la société connaît de
nombreux échanges supranationaux.
Nothomb relève ensuite quatre arguments allant en sens contraire : préparation
insuffisante des Fidei donum ; insertion difficile puisqu’ils ne sont ni missionnaires, ni
membres du clergé local ; isolement psychologique dangereux ; chances d’intégration
affaiblies du fait du caractère provisoire de leur présence (langue, coutumes, etc.) »10
Une autre théologie de la mission s’est fait progressivement jour pour justifier la
formule Fidei donum. On ne parle plus alors d’envoyés ou de missionnaires, mais de
devenir des ponts entre l’Église de départ et celle du pays de destination, d’assurer un
va-et-vient, un échange entre deux Églises locales, manifestant ainsi la solidarité, la
communion entre Églises comme l’universalité de la mission.
Ainsi, l’archevêque de Dakar dès 1973, « voyait dans les Fidei donum l’opportunité
pour les Églises du Sud de s’enrichir et de bénéficier de l’expérience du catholicisme
occidental. Il affirmait qu’ils devaient être les ambassadeurs et les témoins des jeunes
Églises, une fois revenus dans leur diocèse d’origine. »11
Aujourd’hui, on va plus loin en affirmant qu’ils doivent enrichir les Églises d’Europe de
l’expérience et de la vitalité des Églises du Sud dans un échange réciproque et non à
sens unique. Serait-ce le don que l’Esprit nous offre par la présence des nombreux
prêtres, surtout africains, en activité dans notre pays ?
10
Maurice CHEZA, La dynamique du don de la foi : Fidei donum, in Mission de l’Église, n° 154, janvier-mars
2007, p. 29-34.
11
Olivier LANDRON, Les prêtres Fidei Donum : l’exemple français, in Histoire et Missions Chrétiennes, n°5,
mars 2008, p. 167.
9PRÊTRES LIEGEOIS FIDEI DONUM ET
AUTRES PARTIS EN MISSION
LISTES12
Prêtres soutenus par l’APLM
En italique les prêtres qui ont adhéré au diocèse de Hasselt lors de sa création en 1967
1. ADAM Pierre Congo, 1956-1968
2. BAILLY Jean Bolivie, 1956 – décédé dans le pays en 2018
3. BALTUS Joseph Chili, 1966-1973
4. BLEUS Jan Formation au Copal mais pas parti
5. BOUVY Paul Bolivie, 1962-1971, décédé dans le pays le
15/8/1986
6. BOUVY Philippe Rwanda, 1963-1966
7. BOVY Adelin Vénézuéla, 1965 – décédé en 1975 dans le pays
8. BOXUS Jean-Marie Guatemala, 1970 – mars 2018
9. BRUYERE Hugues Guatemala, 1961 ; Mexique, 1981-2000
10. CLAESSENS Guillaume Rwanda, 1959-1994
11. CROIMANS Jan Brésil, 1966
12. D’ANS Hugues Brésil, 1975 – y est toujours
13. DE BEER de LAER André Chili, 1964 – décédé dans le pays le 23/1/2020
14. DECKERS Pieter/ Pierre Rwanda, 1959 ;
Chili, 1961 – décédé dans le pays le 29/1/1968 ;
15. DEMOULIN Auguste Rwanda, 1963-1964
16. DESSART Joseph Bolivie, 1958-2002
17. DUMONT Georges Jordanie, 1951 – décédé dans le pays le 30/9/1998
18. EICHER Félix Argentine 1955,
Chili 1961 – décédé dans le pays le 20/12/2014
19. ERNOTTE Eugène Rwanda, 1956-1979
20. EVENS Gustave Bolivie, 1965-1990
21. FOCCROULLE Joseph Rwanda, 1958-1974 ; 1982-1983
22. FRAIPONT Joseph Rwanda, 1957-1980
23. FLOHIMONT Jean Rwanda, 1960-1969
24. FRANSSEN Paul Bolivie, 1965
25. FRANSOLET Claude Rwanda, 1973-1976
26. GEENEN Paul Rwanda, 1966-1979
27. GISLAIN Victor Chili, 1964-1985
28. GOOR Joseph Vénézuéla, 1968 – décédé dans le pays le
1/10/2017
29. GREGOIRE Christian Rwanda, 1980-1982 ; Tanzanie, 1991-1994
30. HEINEN Franz-Joseph Panama, 1978 – décédé dans le pays en 2008
31. HENDRICK Victor Congo, 1957-1975
12
Listes établies par François-Xavier JACQUES
1032. HONNAY Robert Côte d’Ivoire, 1994-1995
33. JACQUES François-Xavier Mali, 2003-2008 ; contacts réguliers depuis 2018
34. JAMINET Armand Chili, 1961 – années 1990
35. JERUMANIS André-Marie Lettonie, 1998-1999 ; Suisse 1999, y est toujours
36. JONGMANS Jacques Brésil, 1979-2020
37. KESENNE Paul Rwanda, incardiné Nyundo en 1957 –
tué dans le pays le 15 juillet 1994
38. KOELEN Paul Brésil, 1957
39. LAMBRECHT Xavier Rwanda, 1990-1992
40. LAMMENS Luc Bolivie, 1964
41. LANGOHR Guy Brésil, 1975
42. MAIRLOT André Chili, 1961-1970
43. MAIRLOT Joseph Chili, 1964 – décédé dans le pays le 28/8/2012
44. MALBROUCK Lambert Liban, 1991-1994
45. MARECHAL Gaston Rwanda, 1962-1982
46. MARTENS Matthieu Guatemala, 1959
47. MARTERNE André Chili, 1965-1973 ; 1977-1979
48. MERTES Aloys Cuba, 1964-1967
49. MEYERS Joseph Togo, 1982 ; Bénin, 1999 ;
Burkina Faso, y est toujours
50. MOORS Jan Congo, 1952
51. MULLER Louis Congo, 1968-1976
52. MUYSHONDT Orlando Honduras, 2007 – 2014
53. ORIS Eugène Zaïre, 1979-1986
54. PETIT Pierre Rwanda, 1964-1973
55. PIROTTON Jean-Claude Tchad, 1981-1987
56. PLEVOETS Mauritius Congo, 1962
57. REGAL Jan San Salvador, 1964
58. RENAUD Bruno Vénézuéla, 1967- y est toujours
59. RENYES Imre Hongrie, 1992 – décédé dans le pays le
30/8/2017
60. RIXEN Eugène, Mgr Brésil, 1980 – y est toujours
61. ROULLING Joseph Cameroun, 1968-1986
62. ROUSCHOP Jean Rwanda, 1963-1964
63. RUMMENS André Vénézuéla, 1959-1965 ; 1978,
Décède dans le pays le 7/11/2007
64. RUWET Léon Guatemala, 1964 – a quitté le sacerdoce,
tjrs vivant dans le pays
65. SCHEPPERS Léon Congo, 1969-1975
66. SCHIFFLERS Joseph Rwanda, 1956-1965
67. SCHMETZ Joseph (senior) Rwanda, incardiné Nyundo 1959 –
y est toujours
68. SCHMETS Joseph (Moresnet) RDC, 2009-2010
69. SCHOOFS François Congo, 1960,
70. SCHUURMANS Gisbert Rwanda, 1959-1960 ;
Guatemala, 1960
71. SERDONS Jozef Cuba, 1964
1172. SIMONS Pierre Rwanda, 1969 – décédé dans le pays le 2/8/2020
73. THIELS Karel Bolivie, 1957
74. TOSSENS Winand Cuba, 1964-1968 ;
Vénézuéla, 1968 – décédé dans le pays le 31/10/2005
75. TRUYENS Marc RDC (Congo) 2010 – y est toujours
76. VAN HAM Guy Amérique Latine, 1968
77. VILLERS Marcel Rwanda, 1976-1982
78. WAFFLARD Paul Brésil, 2000-2018
79. WERNER Robert Rwanda, 1961-1976
80. WOLLSEIFEN Claude Pérou, 1964 – décédé dans le pays le 8/12/ 2016
81. XHROUET Jean-Marie Guatemala, 1974 ; Mexique en 1981,
y décède le 21/4/1999
Prêtres partis et revenus avant la création de l’APLM
1. DANZE Louis Rwanda, Nyundo, 1956-1958
2. DEFOSSE Jean-Pascal Chili, 1940-1954
3. D’HAUWE Ferdinand Rwanda, 1960-1961
4. LEVARLET Paul Rwanda, 1960-1963
5. NAVEAU Léon Rwanda, 1953-1963
6. RAMSCHEIDT Peter Uruguay, 1958-1964 ; Guatemala, 1967-1968
Prêtres partis sans solliciter le soutien de l’APLM
1. ANCIA Alain Suisse, 1993-2014
2. PROMPER Werner Allemagne, 1964-1984
Prêtres ayant adhéré au diocèse de Hasselt lors de sa création en
1967
1. BLEUS Jan Pas parti
2. CROIMANS Jan Brésil – 1966
3. DECKERS Pieter/Pierre Rwanda 1959, Chili 1961, décédé là en 1968
4. FRANSSEN Paul Bolivie - 1965
5. KOELEN Paul Brésil – 1957
6. LAMMENS Luc Bolivie - 1964
7. MARTENS Matthieu Guatemala - 1959
8. MOORS Jan Congo - 1952
9. PLEVOETS Mauritius Congo - 1960
10. REGAL Jan San Salvador - 1964
11. SCHOOFS François Congo – 1960 ?
12. SCHUURMANS Gisbert Rwanda, 1959-1960 ; Guatemala, 1960
13. SERDONS Jozef Cuba - 1964
14. THIELS Karel Bolivie – 1957
12Prêtres liégeois toujours à l’étranger
1. D’ANS Hugues
2. JERUMANIS André-Marie
3. MEYERS Joseph
4. RENAUD Bruno
5. RIXEN Eugène (Evêque émérite de Goias au Brésil)
6. SCHMETZ Joseph, Senior (incardiné dans le diocèse de Nuyndo au Rwanda)
7. TRUYENS Marc
Prêtres liégeois revenus et toujours en vie
1. BOXUS Jean-Marie
2. FRANSOLET Claude
3. HONNAY Robert
4. JACQUES François-Xavier, au Mali une partie de l’année
5. JONGMANS Jacques
6. LAMBRECHT Xavier
7. MALBROUCK Lambert
8. MUYSHONDT Orlando
9. PETIT Pierre
10. SCHMETZ Joseph (Moresnet)
11. VILLERS Marcel
12. WAFFLARD Paul
13Vous pouvez aussi lire