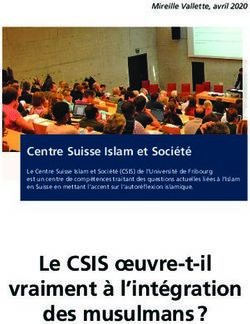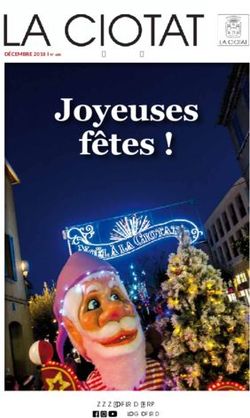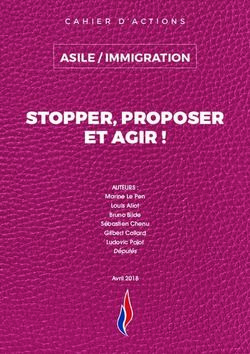La structuration financière comme enjeu de définition de l' " islamité " - Brill
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Studia Islamica 112 (2017) 264-293
brill.com/si
La structuration financière comme enjeu de
définition de l’ « islamité »
Pakistan, Golfe et Malaisie
Frédéric Coste
Docteur associé, CERI/Sciences Po
La finance islamique, phénomène initié dans le Golfe avec la création de la
Dubai Islamic Bank et de la Banque islamique de développement (BID) en
1975, entend proposer des transactions financières évitant essentiellement, à
la fois, l’intérêt (ribā) et les secteurs jugés illicites1. Pour garantir l’ « islamité »
des opérations financières à travers le monde, l’approche consiste à attester
celles-ci par un conseil de supervision religieuse dit “shariah board”2. Cette
méthode vise alors à accorder la primauté à la légalité sur toute autre consi-
dération. Si la finance islamique peut être vue par ses promoteurs comme
une fondation ex nihilo, son origine lointaine provient de la figure majeure de
1 La notion de ribā peut signifier « intérêt » ou « usure ». Pour la présente étude, le premier
terme est employé à dessein, sachant qu’il existe un consensus quant à cette acceptation
au sein de la finance islamique, ainsi que dans ce courant de l’islam politique indo-pakista-
nais. Le qualificatif d’« usure » a pu être critiqué comme étant l’émanation d’une perception
moderniste islamique. Pour ces débats, se référer notamment à Fazlur Rahman, ‘‘Ribā and
Interest”, Islamic Studies, Islamabad, Vol. 3, No. 1, Mar. 1964, pp. 1-43; Nizam Yaquby, “Tantawi’s
Riba fatwa Has No Legal Basis”, Islamic Banker, London, No. 86, Mar. 2003, pp. 6-7; Mahmoud
A. El-Gamal, “Interest and the Paradox of Contemporary Islamic Law and Finance”, Fordham
International Law Journal, Vol. 27, No. 1, Dec. 2003, pp. 108-149.
2 Cf. notamment Zulfiki Hassan, “Regulatory Framework of Shari’ah Governance System in
Malaysia, GCC Countries and the UK”, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, Vol. 3, No. 2, Mar.
2010, pp. 82-115 ; Samy Nathan Garas, Chris Pierce, “Sharia Supervision of Islamic Financial
Institutions”, Journal of Financial Regulations and Compliance, Vol. 18, No. 4, 2010, pp. 386-407.
© koninklijke brill nv, leiden, ���7 | doi 10.1163/19585705-12341363
Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free accessLa structuration financière 265
l’islam politique qu’est Sayyid Abul A’la Mawdudi (1903-1979)3, et de ses dis-
ciples tels que Khurshid Ahmad4 et Muhammad Nejatullah Sidiqqi5.
L’influence des « religions séculières », que sont le communisme et le
national-socialisme, visant à recréer de manière immanente un ordre politique
permanent, dans le mouvement perpétuel de la dialectique de la Modernité,
3 Pour des éléments biographiques se rapporter à Leonard Binder, Religion and Politics in
Pakistan, Berkeley, University of California Press, 1961 ; Charles J. Adams, “Mawdudi and the
Islamic State”, in John L. Esposito (Ed.), Voices of Resurgent Islam, New York, Oxford University
Press, 1983, pp. 99-133 ; Seyyed Vali Reza Nasr, The Vanguard of the Islamic Revolution: The
Jama’at-I Islami of Pakistan, London, I. B. Tauris, 1984 ; Seyyed Vali Reza Nasr, Mawdudi and
The Making of Islamic Revivalism, New York, Oxford University Press, 1996.
4 Un des plus grands contributeurs, par son militantisme soutenu, à la compréhension écono-
mique de l’islam est le fervent disciple de Mawdudi, Khurshid Ahmad né en 1932 à Dehli. Il
a connu ce dernier par l’entremise de son père, un homme d’affaires à la situation aisée, très
engagé dans différentes causes en faveur de l’ummah, et ami intime de l’idéologue islamique.
Celui-ci a notamment participé au financement de ses activités et a édité plusieurs pam-
phlets pour qu’ils connaissent une large distribution, et ce dès les années 20, lors du « mou-
vement Khilafat » où les Indiens ont soutenu ce qui restait de la suprématie musulmane
de leurs confrères ottomans. Quelques années plus tard, le fils continuera cet exercice de
publication et de diffusion au plus grand nombre, à travers la traduction en anglais de la plu-
part des textes de Mawdudi. Cf. le long entretien où Khurshid Ahmad se confie ouvertement
et livre un témoignage autobiographique important in Mehboob ul-Hassan, “Meeting with
History: A Conversation with Prof. Khurshid Ahmad, An Islamic Economist and Activist”,
Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, Vol. 4, No. 1-2, Mar. 2011, pp. 74-123 ; et John L. Esposito,
John O. Voll. Makers of Contemporary Islam. New York, Oxford. University Press, 2001,
chap. 2 “Khurshid Ahmad, Muslim Activist-Economist”; Ibrahim M. Abu-Rabi (Ed.), Islamic
Resurgence: Challenges, Directions & Future Perspectives. A Roundtable with Prof. Khurshid
Ahmad, Lahore, Institute of Policy Studies & World and Islam Studies Enterprise, 1995.
5 Muhammad Nejatullah Siddiqi est une autre personnalité à avoir un rôle crucial dans le
développement de la réflexion économique dans le cadre de l’islam. Né en 1931 en Inde, il a
d’abord fait des études coraniques pendant quatre années à l’âge de 19 ans à Azamgarh dans
le Nord Est du pays, avant de poursuivre à la célèbre Université musulmane d’Aligarh en
économie où il obtient son doctorat en 1966. En 1954, il fait ses premières armes dans la revue
Islamic Thought qu’il lance et dont il sera le rédacteur en chef. Il sera professeur d’études
islamiques de 1977 à 1983 à Aligarh et dirigera même un temps ce département, après y avoir
été vacataire dans sa discipline doctorale pendant plus d’une décennie. Surtout il devien-
dra professeur de sciences économiques à l’Université du Roi Abdulaziz de Jeddah de 1978 à
2000, dans cet établissement qui sera le pivot de l’Islamic economics dans le monde. Il a été
membre du Jamaat-e-islami Hind, la branche indienne du mouvement de Mawdudi. Il a, par
ailleurs, traduit de l’arabe à l’urdu le Livre de l’impôt foncier (Kitāb al-kharāj) d’Abu Yusuf et le
célèbre ouvrage la Justice sociale en islam (Al-’adālah al-ijtimā’iah fil Islam) du Frère musul-
man Sayyid Qutb, respectivement en 1966 et en 1963.
Studia Islamica 112 (2017) 264-293 Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free access266 Coste
est manifeste dans ses idées6. D’intenses débats ont lieu lors de la partition
de 1947, visant à définir la nature, religieuse ou séculière, d’un Etat destiné
aux musulmans indiens. Dans ce contexte, Mawdudi entend mettre en évi-
dence que l’islam, de par sa complétude, dispose aussi des préceptes socio-
économiques permettant de répondre aux besoins mondains. Et ce, au même
titre que les formes multiples de socialisme ou de communisme combattant le
capitalisme7. Ses écrits sont une réponse directe à ces constructions idéolo-
giques immanentes. Il les perçoit comme des concurrents majeurs du seul
ordre socio-politique total et parfait, selon lui, correspondant à « l’Âge d’or » du
modèle prophétique et des Quatre califes Bien-guidés (610-661)8. L’islam ne se
limite pas à rester une « religion », dont il se représente la signification comme
cantonnée à être une simple affaire privée de culte. Le souffle coranique qu’il
prétend raviver offre un cadre épousant tous les champs de la vie, au même titre
que ces cadres d’idées rivaux. Pour le réformiste islamique Khurshid Ahmad,
face au « défi posé par le totalitarisme » communiste, « le temps est venu
pour une nouvelle idéologie forte »9. Ce courant politico-religieux la nomme
« l’idéologie islamique ». Partant du postulat de la complétude de la révéla-
tion divine, Mawdudi et les partisans de son mouvement le Jamaat-i-islami,
6 Raymond Aron, « L’avenir des religions séculières », I et II, La France Libre, Vol VIII,
No. 45 et No. 46, Juil-août 1944 ; Marcel Gauchet, L’avènement de la démocratie : à l’épreuve
des totalitarismes, 1914-1974, t. 3, Paris, Gallimard, 2010. Dans l’article d’Aron, le terme possède
une simple dimension heuristique, alors qu’il deviendra central et pleinement développé à
travers l’œuvre de Gauchet.
7 Le présent article s’appuie sur l’étude des principales revues du Jamaat-i-islami, disponibles à
l’Islamic Foundation de Leicester, qui est le centre européen de ce courant politico-religieux,
que ce soit The Voice of Islam (1952-64), The Criterion (1966-78), Students’ Voice (1952-55), ou
celles partageant des affinités comme Islamic Thought, et Islamic Literature. Les écrits de
membres essentiels de ce mouvement comme Mawdudi, Khurshid Ahmad, Muhammad
Nejatullah Siddiqui, souvent publiés par cette institution ou son pendant à Islamabad du
nom d’Institute of Policy Studies, ont aussi fait l’objet d’une analyse approfondie.
8 Sayyid Abul A’la Mawdudi, “Nations Rise and Fall, Why?” (Bana’ o awr bigar), Speech delivered
at Dar-ul-Islam in East Punjab on 10 May 1947, trans. from Urdu, Lahore, Islamic Publications,
1976; Sayyid Abul A’la Mawdudi, “Islam Today” (Islam ‘asr-i hadir men), Lecture delivered
at the Islami Jamiat-e-Talaba in Karachi in Dec. 1963, trans. from Urdu, Criterion, Karachi,
Vol. 3, No. 2, Mar.-April 1968, pp. 13-36. Voir aussi sur cette notion Ira M. Lapidus, “The Golden
Age: The Political Concept of Islam”, Annals of the American Academy of Political and Social
Science, Vol. 524, Nov. 1992, pp. 13-25.
9 Khurshid Ahmad, “The Fallacy of Secularism”, Students’ Voice, Karachi, 19 Dec. 1953.
Studia Islamica 112 (2017) 264-293
Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free accessLa structuration financière 267
s’attèleront à exposer les préceptes offrant la possibilité de l’existence, de ce
qu’ils appellent « le système économique de l’islam »10.
Des différents aspects économiques de l’islam qui seront énumérés par les
partisans d’une telle perspective, deux d’entre eux se détacheront jusqu’à de-
venir les principaux piliers de cette construction intellectuelle : la prohibition
de l’intérêt (ribā) et la zakāt (aumône légale) en tant que redistribution sociale.
« Le système économique islamique est largement basé sur les principes ju-
meaux de la zakāt et de la prohibition de l’intérêt », arguera plus tard l’un de
ces économistes militants11. L’importance de ces éléments tient au fait qu’ils
10 Cette appellation est une constante dans de nombreux écrits sur plusieurs décennies en
Inde musulmane et au Pakistan depuis les années 40, cf. Anwar Iqbal Qureshi, Islam and
the Theory of Interest, Lahore, Shaikh Muhammad Ashraf, 1946; Shaikh Mahmud Ahmad,
Economics of Islam: A Comparative Study, Lahore, Shaikh Muhammad Ashraf, 1947;
Muhammad Hamidullah, “Islam and Communism: A Study in Comparative Thought”,
The Islamic Review, Woking, Vol. 38, No. 3, Mar. 1950, pp. 11-16; Maulana Aftab ud-Din
Ahmad, Islam and Communism, Lahore, Series of articles first published in The Light,
1951; Q. M. Fareed, “Towards a New Economic System in the Light of Islam”, The Voice of
Islam, Karachi, Vol. 1, No. 5, Feb. 1953, pp. 164-168; Muhammad Fazl-ur-Rahman Ansari,
“Editorial”, The Voice of Islam, Karachi, Vol. 3, No. 4, Jan. 1955, pp. 114-117; Muhammad Fazl-
ur-Rahman Ansari, “Islam versus Communism”, The Voice of Islam, Karachi, Vol. 3 No. 5,
Feb. 1955, pp. 150-152; Amir Hasan Siddiqi, “The Economic System of Islam”, The Voice of
Islam, Karachi, Vol. 5, No. 4, Jan. 1956, pp. 209-217; S. M. Yusuf, “The Economic Principles
of Islam”, The Voice of Islam, Karachi, Vol. 5, No. 2, Nov. 1956, pp. 504-512; Muhammad
Yakub Khan, “Is Islam a Preparation for Communism?”, The Islamic Review, Woking,
Vol. 45, No. 4, Apr. 1957, pp. 25-29; Khurshid Ahmad, “Our Economic Problem”, The Voice
of Islam, Karachi, Vol. 6, No. 2-3, Nov.-Dec. 1957, pp. 47-55; Khurshid Ahmad, Essays on
Pakistan Economy, Karachi, Maktab-e-faridi, 1958; Shaikh Mahmud Ahmad, “Economics
in the Social Structure of Islam”, The Voice of Islam, Karachi, Vol. 6, No. 12, Sept. 1958,
pp. 498-505; Muhammad Ihsanullah Khan, “Communism and Islam Contrasted”, The
Islamic Review, Woking, Vol. 48, No. 6, June 1960, pp. 9-19; Khurshid Ahmad, Socialism or
Islam, Trans. from Urdu, Dehli, Hindustan Publications, 1969; A. K. Brohi, “Socialism, Islam
and Pakistani Politics”, The Criterion, Karachi, Vol. 4, No. 2, Mar. 1969, pp. 59-67; Mahmud
Javed, “Capitalism and Socialism: Bitter Fruits of the Same Tree”, The Criterion, Karachi,
Vol. 4, No. 5, Sept. 1969, pp. 21-27; Anwar Ahmed Qadri, “The Shariah and Other Economic
Systems”, The Criterion, Karachi, Vol. 4, No. 5, Sept. 1969, pp. 39-60; Muhammad Imran,
“Islamic Social Justice: the Alternative to the Curse of Capitalism and Communism”, The
Criterion, Karachi, Vol. 5, No. 1, Jan. 1970, pp. 5-31; Mohammad Abdul Mannan, “Islam and
Other Isms: Ideologies of Capitalism, Communism, Socialism, Fascism, and Their Effect
on Man’s Behavior”, The Islamic Review, Woking, Vol. 59, No. 1, Jan. 1971, pp. 5-11.
11 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic Banking: Selected Papers, Leicester, The
Islamic Foundation, 1983, p. 36.
Studia Islamica 112 (2017) 264-293 Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free access268 Coste
les conçoivent comme les deux formes archétypales à même d’atteindre à la fois
le cœur de l’idéologie capitaliste et communiste12.
Toutefois, surgit à ce moment la difficulté de définir ce que seraient, en pra-
tique, des moyens islamiques. En effet, le fait de s’accorder sur le dessein de
mettre fin à l’intérêt dans le système économique dans son entier, ne répond
pas à la question des mécanismes à appliquer. Il en ressort un problème ma-
jeur : celui de la définition des instruments qui seraient dans la droite ligne des
commandements divins. Progressivement, la méthode du partage des pertes
et profits fondée sur la distribution de dividendes, au lieu du financement de
l’économie par l’endettement, sera privilégiée par ces économistes13. Au lieu
d’une relation asymétrique entre créancier et débiteur, où le remboursement
12 Ainsi, un des domaines les plus importants du fiqh par ailleurs, le droit des successions,
ne sera-t-il l’objet que de peu d’attention au regard de ces deux pivots. Noel J. Coulson,
Succession in the Muslim Family, Cambridge, Cambridge University Press, 1971 ; David
S. Powers, “The Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach”, Arab Law
Quarterly, Vol. 8, No. 1, 1993, pp. 13-29.
13 Sur les méthodes de partage des pertes et profits dans l’histoire et dans le droit isla-
mique, cf. Nicolas P. Aghnides, Mohammedan Theories of Finance: With an Introduction
to Mohammedan Law and a Bibliography, New York, Columbia University Press, 1916; Mir
Siadat Ali Khan, “The Mohammedan Laws Against Usury and How They Are Evaded”,
Journal of Comparative Legislation and International Law, Vol. 11, No. 4, 1929, pp. 233-244 ;
Abraham L. Udovitch, “At the Origins of the Western Commenda: Islam, Israel, Byzan
tium?”, Speculum, Vol. 37, No. 2, Apr. 1962, pp. 198-207 ; Shelomo Dov Goitein, “Bankers
Accounts from the Eleventh Century A.D.”, Journal of the Economic and Social History of
the Orient, Vol. 9, No. 1/2, Nov. 1966, pp. 28-66 ; Shelomo Dov Goitein, A Mediterranean
Society: The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the
Cairo Geniza, Berkeley, University of California Press, Vol. 1 & 2, Economic Foundations,
1967 ; Abraham L. Udovitch, “Labor Partnerships in Early Islamic Law”, Journal of the
Economic and Social History of the Orient, Vol. 10, No. 1, July 1967, pp. 64-80 ; Abraham L.
Udovitch, “Credit as a Means of Investment in Medieval Islamic Trade”, Journal of the
American Oriental Society, Vol. 87, No. 3, July-Sept. 1967, pp. 260-264 ; Claude Cahen,
“Partnership and Profit in Medieval Islam by Abraham L. Udovitch: Review”, Journal of the
Economic and Social History of the Orient, Vol. 14, No. 1, Apr. 1971, pp. 82-85 ; Abraham L.
Udovitch, “Reflections on the Institutions of Credits and Banking in the Medieval
Islamic Near East”, Studia Islamica, No. 41, 1975, pp. 5-21 ; John H. Pryor, “The Origins of
the Commenda Contract”, Speculum, Vol. 52, No. 1, Jan. 1977, pp. 5-37 ; Haim Gerber, “The
Muslim Law of Partnerships in Ottoman Court Records”, Studia Islamica, No. 53, 1981,
pp. 109-119 ; Ronald C. Jennings, “Loans and Credit in Early 17th Century Ottoman Judicial
Records: The Sharia Court of Anatolian Kayseri”, Journal of the Economic and Social
History of the Orient, Vol. 16, No. 2-3, Dec. 1973, pp. 168-216 ; Murat Çizakça, A Comparative
Evolution of Business Partnerships: The Islamic World and Europe with Special Reference to
the Ottoman Archives, Leiden, Brill, 1996 ; Phillip I. Ackerman-Lieberman, “Contractual
Studia Islamica 112 (2017) 264-293
Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free accessLa structuration financière 269
est indépendant de l’activité économique, ils comptent remplacer celle-ci par
la logique inverse. Les gains futurs doivent être directement tirés de l’exercice
réel de l’entreprise, et le risque partagé. Selon cette perspective, seul l’appor-
teur de capital est responsable des pertes, et non plus l’entrepreneur (sauf si ce
dernier est également financeur).
Dans l’objectif de mettre un terme à la prévalence de l’intérêt, il est envisa-
gé d’en finir avec la logique de dette, en recourant à son contraire : les fonds
propres (ou la notion évocatrice d’equity). En d’autres termes, la méthode
de partage de pertes et profits est censée incarner, à elle seule, l’ « esprit de
l’islam ». Or, cette position a priori n’est pas sans poser des difficultés, puisqu’elle
suppose à l’inverse que tous les instruments de dette sont non islamiques. Ces
militants en viendront à vouloir créer une « science économique islamique »
(“Islamic Economics”) à partir des années 1970 pour approfondir leur projet
initial14.
Le courant de la finance islamique sera une « vision du monde » concur-
rente de ce projet radical, d’un au-delà de l’intérêt par la suppression de la lo-
gique d’endettement. Elle s’y opposera sur de nombreux traits, que ce soit par
l’approche ou la finalité, au point d’en constituer une conception rivale. Alors
que le droit islamique ( fiqh) était jugé, soit comme essentiellement limité au
statut personnel et à l’héritage, sinon immuable et incapable d’adaptation aux
Partnerships in the Geniza and the Relationship between Islamic Law and Practice”,
Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 54, No. 5, 2011, pp. 646-676.
14 Le moment de naissance officiel de cette « science économique islamique » intervient
à l’initiative de Khurshid Ahmad, cf. l’ouvrage collectif qu’il a édité, Studies in Islamic
Economics: A Selection of Papers Presented to the First International Conference on Islamic
Economics, held at Mekkah under the auspices of King Abdulaziz University, Jeddah,
21-26 Feb. 1976, Leicester, The Islamic Foundation. Voir aussi pour l’origine de ce phé-
nomène Seyyed Vali Reza Nasr, “Islamic Economics: Novel Perspectives”, Middle Eastern
Studies, Vol. 25, No. 4, Oct. 1989, pp. 516-530; Thomas Philipp, “The Idea of Islamic
Economics”, Die Welt des Islams, Vol. 30, No. 1-4, 1990, pp. 117-139; Syed Farid Alatas, “The
Sacralization of the Social Sciences: a Critique of an Emerging Theme in Academic
Discourse”, Archives des sciences sociales des religions, No. 91, Juill.-Sept. 1995, pp. 89-111;
Rodney Wilson, “The Development of Islamic Economics: Theory and Practice”, in Suha
Taji-Farouki, Basheer M. Nafi (Eds.), Islamic Thought in the Twentieth Century, London, I.B.
Tauris, 2003, pp. 195-222; Timur Kuran, Islam and Mammon: The Economic Predicaments
of Islamism, Princeton, Princeton University Press, 2004; Mehboob ul-Hassan, “Islamic
Approach of Economics: Some Discourses on Khurshid Ahmad’s Vision of Socio-
Economic Order, Self-Reliance and Economic Development”, Kyoto Bulletin of Islamic
Area Studies, Vol. 3, No. 2, Mar. 2010, pp. 216-240; Nagaoka Shinsuke, “Critical Overview of
the History of Islamic Economics: Formation, Transformation, and New Horizons”, Asian
and African Area Studies, Vol. 11, No. 2, Mar. 2012, pp. 114-136.
Studia Islamica 112 (2017) 264-293 Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free access270 Coste
exigences modernes par la première vision du monde, il a fait l’objet d’un re-
nouveau en matière de transactions financières. Ce domaine du fiqh est de-
venu l’un des plus importants, si ce n’est le premier, en termes d’études ces
dernières années15. Il a pu répondre aux besoins multiples de montages fi-
nanciers complexes dans des économies grandissantes. Certaines innovations
tenteront d’adapter des types de contrats, existants depuis des siècles, en leur
attribuant un contenu inédit à l’instar des ṣukūk16.
Quand le mécanisme d’approbation de contrats devait être la raison même
de la légitimité de ce secteur financier du point de vue religieux, il devient en
fait le nœud principal du conflit entre deux visions du monde contraires. D’un
côté, la représentation idéologique, qui entend mettre un terme à un point
de vue littéraliste du droit, en lui opposant une approche vivante représentée
par le politique. De l’autre, un retour au fiqh comme garant de la norme reli-
gieuse dans une perspective nouvelle qu’est la finance islamique. La caution
de ceux qu’on nomme les “shariah scholars” avait pour finalité de mettre un
terme à tout débat éventuel. Or, la certification de produits financiers établie
par les « gardiens de l’islam », suite à l’étude des contrats, peut à l’inverse être
appréhendée comme un retour à une période « prérévolutionnaire », c’est-à-
dire avant ce moment de la Modernité qui a permis la compréhension du mes-
sage divin en tant que totalité. Le recours à des shariah scholars afin de valider
des produits financiers, faisant prévaloir ainsi la conformité au droit islamique,
loin d’être une garantie de consensus, ravive brusquement une confrontation
indépassable. Ainsi, « le système économique de l’islam » et la finance isla-
mique représenteront-elles deux visions du monde, de nature fondamentale-
ment incompatible. En outre, une autre vive tension apparaît à travers la licéité
du commerce de la dette en Malaisie, contredisant le fondement même de la
finance se voulant en conformité avec la shariah, telle que pratiquée dans le
Golfe.
15 Monzer Kahf, “Islamic Banks: The Rise of a New Power Alliance of Wealth and Shari’a
Scholarship”, in Clement M. Henry, Rodney Wilson (Eds.), The Politics of Islamic Finance,
Edinburgh, Edinburgh University Press, 2004, pp. 17-36, cf. p. 26. Le réinvestissement
récent du militantisme dans le fiqh a été analysé par J. N. D. Anderson, “Modern Trends
in Islam: Legal Reform and Modernisation in the Middle East”, The International and
Comparative Law Quarterly, Vol. 20, No. 1, Jan. 1971, pp. 1-21; Bernard Botiveau, Loi isla-
mique et droit dans les sociétés arabes, Paris, Karthala, 1993.
16 Le terme pourtant pluriel de « sukuk » est utilisé de manière indifférenciée, au singulier
et au pluriel, en finance islamique.
Studia Islamica 112 (2017) 264-293
Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free accessLa structuration financière 271
Le rapport au monde extériorisant du droit
« Les fuqahā’ », pense Fazlur Rahman, « traitent très sérieusement les com-
mandements et prohibitions coraniques ; toutefois, ils ont des difficultés à trai-
ter des exigences coraniques générales qui ont une base éthique, et la plupart
du temps ils ne le font pas »17. De ce fait, il peut s’agir d’une véritable pierre
d’achoppement, dans un système juridique se voulant explicitement éthico-lé-
gal. De surcroît, la distinction courante, entre forme et substance, en matière
contractuelle, peut revêtir une idée toute différente de la substance métaphy-
sique. La définition juridique classique, reprenant à son compte la distinction
aristotélicienne, peut être éloignée de substance comme liée à une vision plus
large qui la guiderait18. Elle est en fait réduite à la transaction et ne se rattache
aucunement à un idéal supérieur qu’elle devrait transposer. La substance
est simplement entendue comme symbolisant le contenu d’une transaction.
Même quand les juristes s’estiment compétents pour apprécier l’intention
dans des relations interpersonnelles, celle-ci se limite à l’acte lui-même, sans
chercher à le rapporter à un sens supérieur. Par exemple, en matière commer-
ciale, afin de valider ou non une transaction, le droit peut questionner si l’in-
tention d’une personne est de vouloir posséder un bien. Il peut aussi interroger
si ce bien est utilisé de façon fictive, pour contourner l’intérêt, afin de recevoir,
au final, une somme d’argent. Ainsi, à la différence de la sphère sociale comme
pour le mariage et le divorce, l’intention et la finalité du contrat priment-elles
sur la formalité, en raison du consentement présupposé libre des parties19.
17 Fazlur Rahman, “Law and Ethics in Islam”, in Richard G. Hovannisian (Ed.), Ethics in
Islam, Malibu, Undena Publications, 1985, pp. 3-15, cf. p. 6.
18 La substance est définie selon l’environnement contextuel relatif à chaque
contrat. Elle permet simplement d’identifier la substance échangée ou en cause
au cœur de celle-ci. Par exemple, un esclave (substance, essence) s’inflige une
invalidité lors d’une vente, or la livraison reste contractuellement valide, car
l’esclave représente la substance sans affecter la forme. Exemple tiré de Ya’akov
Meron, « Forme et substance en droit musulman », Islamic Law and Society,
Vol. 5, No. 1, 1998, pp. 22-34, cf. p. 25. Ce dernier relate dans son article unique-
ment l’essence sous une forme contractuelle.
19 Baber Johansen, “The Valorization of the Human Body in Muslim Sunni Law”, Princeton
Papers: Interdisciplinary Journal of Middle Eastern Studies, No. 4, 1996, pp. 75-117, Article
reproduced in Baber Johansen, Contingency in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in
the Muslim Fiqh, Leiden, Brill, 1999, pp. 71-112.
Studia Islamica 112 (2017) 264-293 Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free access272 Coste
Le fiqh, comme les autres systèmes légaux, a une emprise sur la régulation
de l’ensemble des affaires humaines20. Il peut déterminer la bonne conduite,
et contrôler sa mise en œuvre, qu’elle soit contractuelle ou non. Toutefois,
la cible du droit islamique, en matière de relations interpersonnelles, n’est
pas de nature à atteindre l’intériorité des hommes. Ce sont les actes visibles,
identifiables, en somme leur extériorité, qui relèvent du domaine de ce droit.
Le fiqh al-muʿāmalāt ne peut, et ne veut, sonder les esprits, bien qu’il se ré-
fère à l’éthique nécessaire à adopter. Il appréhende ce qui est perceptible, en
ne pouvant avoir aucun ascendant sur l’intériorité. Le développement légal re-
présente la circonscription par la raison des actes. L’homme doit les assumer
intégralement étant postulé qu’il en est pleinement responsable. Ainsi, « les
juristes distinguent clairement deux types de normes : les normes légales qui
concernent le forum externum, c’est-à-dire le jugement judiciaire sur des actes
et énonciations observables, et les normes éthiques qui concernent le forum
internum uniquement »21. Le droit islamique se veut un ensemble éthico-légal.
Et pourtant, il s’interdit d’interroger la réalité de la croyance chez un individu,
dans les relations interpersonnelles, car ce qui est en jeu représente la « ga-
rantie de la validité légale », et non la « véracité »22. L’éthique du fiqh repose
ailleurs, à savoir dans la validation ou la prohibition en amont de certains actes,
comme dans le cas d’une transaction fondée sur le ribā, quand d’autres sys-
tèmes légaux peuvent avoir pour seule limite a priori le droit naturel (ne pas
tuer, ne pas voler, etc.).
Lorsque les adeptes de l’ « idéologie islamique » s’en prennent ouvertement
aux gardiens du savoir religieux, lequel voit sa pleine réalisation formulée dans
le fiqh, ils entendent percer l’intériorité, le « forum internum » du Message.
Or, les prescriptions légales ne peuvent directement l’atteindre, comme l’ad-
mettent de manière explicite les objectifs que se pose le droit islamique. De
ce fait, si deux représentations du monde se sont développées en parallèle,
20 Cf. notamment Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford,
Clarendon Press, 1950 ; Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford, Oxford
Clarendon Press 1964 ; Jean-Paul Charnay, « Pluralisme normatif et ambiguïté dans le
Fiqh », Studia Islamica, No. 19, 1963, pp. 65-82 ; Aron Zysow, The Economy of Certainty:
An Introduction to the Typology of Islamic Legal Theory, PhD Dissertation, Harvard
University, 1984 ; Christopher Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law,
9th-10th Centuries C.E., Leiden, Brill, 1997 ; Wael B. Hallaq, The Origins and Evolution
of Islamic Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005 ; Jonathan Brown, The
Canonization of al-Bukhârî and Muslim: The Formation and Function of the Sunnî Hadîth
Canon, Leiden, Brill, 2007.
21 Baber Johansen, Contingency in a Sacred Law, op cit., p. 33.
22 Baber Johansen, Contingency in a Sacred Law, op cit., p. 36.
Studia Islamica 112 (2017) 264-293
Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free accessLa structuration financière 273
la tension identifiée n’a pas été résolue. La finance islamique a fait l’objet de
vives critiques, en étant accusée de simplement se conformer légalement au
fiqh, sans accéder au sens éthique supérieur. Derrière l’ingénierie des produits
financiers “sharia-compliant”, pouvant prendre une forme particulièrement
technique, ressurgissent les enjeux de la quête d’un sens ultime, mis en avant
par la première vision du monde. A la formalité légale comme critère défi-
nissant l’islamité, la figure religieuse Muhammad Taqi Usmani, lui opposera
un idéal de transformation de l’ordre économique et social. Les positions pu-
bliques de cette personnalité influente, président de l’Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), à savoir de l’orga-
nisme principal établissant les normes de conformité à la shariah en matière
financière, questionneront l’insuffisance de la légalité comme élément détermi-
nant le caractère islamique. De surcroît, au sein même de la finance islamique,
une forte divergence surviendra entre les opérations reconnues comme valides
dans le Golfe et en Malaisie.
L’opposition entre deux « visions du monde » : le politique contre le
droit islamique
La conformité à la shariah, certifiée par des jurisconsultes, doit permettre de
suivre la voie des commandements économiques divins. Pourtant, celle-ci peut
devenir paradoxalement le premier frein à la réalisation de l’idéal islamique :
dans la vision du monde des partisans de Mawdudi, les autorités religieuses
sont perçues comme empreintes d’un légalisme rigide. Et celui-ci représente
une des causes de la décadence qu’ils combattent. En se cantonnant à com-
menter et à suivre à la lettre les détails du Message, représentés dans le droit
islamique, les « gardiens de l’islam » sont accusés d’avoir annihilé le sens glo-
bal. Être le plus conforme à la shariah d’un point de vue légal n’implique pas,
pour ces autres, de l’être, par rapport à ce qu’ils entendent comme le sens
supérieur qu’il faut reconstituer. Bien plutôt, le droit, perçu par le courant du
Jamaat-i-islami comme une forme fossilisée du message originel, est pensé en
pleine contradiction avec le dynamisme de l’esprit politique du Coran. Ainsi,
la vision du monde de l’islam politique identifiée, rentre-t-elle en opposition
idéologique fondamentale avec celle d’une finance se voulant en conformité
avec le fiqh. Cette première perspective s’est construite en vue de contredire
ce qu’ils perçoivent comme un sens général atomisé par le droit. La portée
d’ensemble est vue comme anéantie par les éléments de détail infinis de la
casuistique juridique. La volonté de recouvrer un méta-sens est primordiale
pour dépasser tous ces petits détails de la vie quotidienne largement consacrés
Studia Islamica 112 (2017) 264-293 Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free access274 Coste
par le fiqh. Plus les connaisseurs légitimes du Coran étaient proches du détail,
selon eux, plus ils étaient éloignés de l’idéal « révolutionnaire » contenu dans
le texte sacré. Cette vue portée sur les petites choses est considérée exister au
détriment de cette perspective d’ensemble, que les réformistes ambitionnent
de retrouver. L’image globale, que l’ « idéologie islamique » entend (re-)créer,
est une réponse au corpus juris des oulémas, accumulé pendant plusieurs
siècles. Ces militants le ressentent comme immense, multiple, contradictoire,
et extérieur à l’homme23. La finalité exotérique du droit, c’est-à-dire l’objectiva-
tion du message divin en prescriptions légales, se voit confrontée à la teneur
subjective de chaque croyant, qui doit vivre le sens originel et unique de l’islam.
La « conversion » intérieure qu’évoque Mawdudi le montre : « on ne nait pas
musulman, on le devient », pourrait résumer sa conception. Pour opérer cette
transformation, le fidèle doit fournir un effort spirituel personnel. Le but étant
de saisir que le sens profond du message révélé est d’être une totalité vivante, et
non une vue morcelée de la vie24. L’approche légaliste, conçoit-il avec ses parti-
sans, dissocie le droit, de la communauté des individus. Une distance survient,
selon eux, entre le fidèle et les commandements divins par le fait de la média-
tion du fiqh. Le droit devient une réalité extérieure à l’homme, indépendante de
la croyance avérée ou non de celui-ci. Le respect des prescriptions légales peut
se faire indépendamment de toute croyance. Il est une forme objectivée, qui
ne peut sonder l’intériorité. Le rapport qu’entretient la personne à l’islam n’est
plus direct, intime, ésotérique, subjectif, mais concourt par le fruit du medium
extérieur que représente le droit. L’adéquation légale à la shariah revient, pour
la vision du monde de l’ « idéologie islamique », à ne pas comprendre la por-
tée dynamique de cette religion. Or, elle doit être vécue spirituellement et non
demeurer fixée dans un corpus de textes extérieur aux hommes.
Par ailleurs, ce caractère extérieur est accentué à la fois par le fait de réserver
à une seule élite religieuse le pouvoir d’émettre des jugements déterminant
sur la conformité à la shariah, d’une part ; et par la critique adressée voyant le
droit islamique comme étant de source secondaire, d’une autre. La restriction
de l’accès au sens divin, alors qu’il doit être intériorisé par tous dans la vision
du monde totalisante, ajouté à l’éloignement de la source primaire, œuvrent
encore à une plus grande distanciation avec l’approche intime jugée comme
nécessaire dans cet autre courant.
23 Entretien avec Khurshid Ahmad, Islamic Foundation, Leicester, Royaume-Uni, 5 et
6 octobre 2012.
24 Cf. Sayyid Abul A’la Mawdudi (1940), Let Us Be Muslim (Khutubat), trans. from Urdu,
Leicester, Islamic Foundation, 1982, pp. 48-49.
Studia Islamica 112 (2017) 264-293
Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free accessLa structuration financière 275
Ainsi, pour résumer, la focalisation sur le droit, qui intervient à nouveau
dans la finance islamique, pourtant à première vue anodine, révèle-t-elle des
lignes de fractures fondamentales entre ces deux courants : la perspective
juridique est accusée d’être la source de la décadence depuis des siècles par
l’émiettement du sens global dispersé dans les détails multiples, insignifiants
et contradictoires ; le medium que représente le droit distancie la personne
des préceptes originels, qui peut se limiter à suivre un simple formalisme ; le
fiqh, de nature extérieure, s’oppose dans cette conception au sens intérieur
qui, non seulement doit affecter intimement le croyant, mais doit de surcroît
bouleverser l’ordre du monde ; la fixité des injonctions légales, essentiellement
dérivées de la shariah par l’interprétation humaine, est perçue comme venant
à l’encontre de la portée dynamique, vitaliste, de l’islam.
Persistance des traits de l’ « idéologie islamique » contre la finance
islamique
Une des personnalités religieuses les plus influentes de la finance islamique
et, à la différence de nombreux autres shariah scholars, dont l’aura dépasse
de beaucoup ce milieu restreint, est Muhammad Taqi Usmani. Né en 1943 à
Deoband en Inde, il a suivi des études religieuses à Darul Ulum de Karachi,
ainsi qu’un parcours, peu usuel, séculier en droit à l’Université de Karachi, et
un master en littérature arabe de celle du Punjab à Lahore. Il a servi de juge à
la Cour d’appel de la shariah de la Cour suprême du Pakistan de 1982 à 2002,
mis en place dans le projet d’islamisation du Général Zia ul-Haq. Il est aussi
membre de l’International Islamic Fiqh Academy, organe de l’OCI basé à
Jeddah en Arabie Saoudite. Il est considéré comme « un des oulémas les plus
prolifiques partout ailleurs dans l’islam contemporain », écrivant des com-
mentaires en matière de ḥadīth, sur la finance islamique, ou sur des problèmes
relatifs à l’application de la shariah au Pakistan25. Quelque peu en porte-à-faux
avec la position traditionnelle de mufti, il entend s’adresser à une audience
internationale par la publication de certains ouvrages directement en anglais,
comme avec An Introduction to Islamic Finance26. Président de l’AAOIFI, il est
Muhammad Qasim Zaman, “Tradition and Authority in Deobandi Madrasas of
25
South Asia”, in Robert W. Hefner, Muhammad Qasim Zaman, (Eds.), Schooling
Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education, Princeton, Princeton
University Press, 2007, pp. 61-86, cf. p. 75.
26 Muhammad Taqi Usmani (1998), An Introduction to Islamic Finance, Leiden, Brill, 2012.
Pour Muhammad Qasim Zaman, la madrassa Darul Ulum de Taqi Usmani est celle qui
Studia Islamica 112 (2017) 264-293 Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free access276 Coste
membre de plus d’une douzaine de shariah boards d’institutions financières et
de banques islamiques à travers le monde.
Muhammad Taqi Usmani est le fils de l’ancien Grand mufti du Pakistan,
Muhammad Shafi (1897-1976). Ce dernier représente un des principaux ou-
lémas de Deoband à avoir soutenu la création de l’Etat du Pakistan. Ainsi,
marque-t-il une rupture avec la plupart des religieux qui, bien qu’opposés aux
Britanniques, n’ont majoritairement pas pris cause pour la partition, en pré-
férant l’alliance avec les hindous dans le parti du Congrès27. Taqi Usmani est
vu, à la fois, comme partageant l’approche politique de son père avec un grand
intérêt pour les questions constitutionnelles et légales concernant la shariah ;
et combinant des écrits extensifs sur la pure tradition classique des hadiths, en
même temps qu’une volonté d’introduire un savoir moderne28. Le mouvement
de Deoband, dont la plupart des oulémas indiens sont issus, au rang desquels
Muhammad Shafi qui a créé au Pakistan une branche du grand centre Darul
Ulum, est décrit comme mêlant de façon singulière : une perspective légale
en quête du rigorisme le plus pur, conjuguée avec le maintien de la spiritua-
lité soufie29. Les exercices spirituels du soufisme cohabitent avec l’emphase
de l’étude sur les hadiths lors de la formation religieuse. Ce qui peut être vu
comme contraire par d’autres courants à l’instar du salafisme hanbalo-wahha-
bite, est entendu comme parfaitement complémentaire30. A la différence de
cet autre réformisme traditionaliste, l’école de Deoband ne remet pas en cause
le taqlīd (l’imitation servile dictée par un religieux), pour lui opposer un besoin
de revenir aux sources directes du Coran et de la sunnah. À l’inverse, le mouve-
ment indien accorde une importance capitale au mufti dont il est nécessaire
de suivre la conduite, même sans que celui-ci n’ait besoin de se justifier. Ils
rejettent ainsi toutes les tendances modernistes qui favorisent une démocrati-
sation de la pratique de l’ijtihād. Il est attribué au shaykh une intimité spéciale
avec Dieu, lequel a gagné sa grâce suite au travail l’ayant amené à un stade
moral supérieur, et qui représente une sorte de sixième sens. Les autres thèmes
caractéristiques des fatwas sont la critique des coutumes locales, une grande
s’exprime le plus en anglais, cf. “Tradition and Authority in Deobandi Madrasas of South
Asia”, op cit., p. 81.
27 Ziya-ul-Hasan Faruqi, The Deoband School and the Demand for Pakistan, New York, Asia
Publishing House, 1963; Muhammad Taqi Usmani (4 March 1964), “Shaykh Muhammad
Shafi‘: The Mufti of Pakistan”, trans. from Arabic, 4 Dec. 2011, cf. www.deoband.org.
28 Muhammad Qasim Zaman, Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change,
Princeton, Princeton University Press, 2002, pp. 82 et s.
29 Barbara Daly Metcalf, Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900, Princeton,
Princeton University Press, 1982.
30 Barbara Daly Metcalf, Islamic Revival in British India, op cit., pp. 87-137.
Studia Islamica 112 (2017) 264-293
Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free accessLa structuration financière 277
attention portée aux détails de l’activité quotidienne, tout en ne rejetant pas
la technologie31.
Du point de vue de Taqi Usmani, l’islam ne s’oppose pas à l’avancée du savoir
et aux inventions. Cependant, il estime que le progrès matériel s’est retrouvé
mêlé avec des idées extérieures, qu’il nomme « les demandes du temps »32. Et
celles-ci ont participé à la décadence de l’Occident – l’obscénité, l’hédonisme,
etc. Il critique par ailleurs la vision moderniste de l’ijtihād de l’universitaire
Fazlur Rahman, associant ce droit législatif à l’ « ummah musulmane ». Et,
Taqi Usmani de demander si celui-ci entend par-là conférer cette prérogative à
« tout illettré et personne non civilisée »33. De surcroît, le rapport entre le po-
litique et la religion du mufti pakistanais affiche une forte ressemblance avec
la « vision du monde » du Jamaat-i-islami. Néanmoins, s’il critique également
la dissociation des matières cultuelles avec les autres sphères des activités hu-
maines, engendrée par une sécularisation, il reproche au courant de Mawdudi
d’avoir fait de l’Etat islamique le dessein suprême du message divin. « La vérité
est que le politique est une des branches de la religion, tout comme le domaine
des affaires et de l’économie est une branche de celle-ci, et, en effet, les règles
de la religion se rapportent au politique, tout comme elles ont trait aux af-
faires. Cependant, rien de politique ou du domaine des affaires ne constitue la
racine de la finalité du message de l’islam, ni un objectif fondamental de ses
règles et enseignements »34. La voie politique est un moyen, et non la finali-
té qui est l’établissement de la religiosité dans tous les domaines. En d’autres
termes, il s’accorde sur le fait que les commandements révélés embrassent tous
les champs de la vie, incluant le politique et l’économique. Néanmoins, il se
distancie quant à l’emphase excessive, selon lui, sur une seule dimension, au
détriment même du culte. Par ailleurs, il adopte une position similaire que le
Jamaat-i-islami relative à ce qui s’apparente à un « juste milieu », entre la ten-
dance monastique du retrait du monde, et ce qu’il voit comme étant le maté-
rialisme du capitalisme et du communisme35. Les préceptes économiques de
31 Barbara Daly Metcalf, Islamic Revival in British India, op cit., pp. 147-157. La question de
l’introduction d’un certain savoir comme la philosophie a fait l’objet de nombreux débats,
et ne permet pas d’afficher au sein de cette école une position claire depuis l’origine, cf.
Ziya-ul-Hasan Faruqi, The Deoband School and the Demand for Pakistan, op cit., pp. 31 et s.
32 Muhammad Taqi Usmani, (n.d) Islam and Modernism, trans. from Urdu, New Dehli,
Adam Publishers and Distributors, 2008.
33 Muhammad Taqi Usmani, Islam and Modernism, op cit., p. 81.
34 Muhammad Taqi Usmani (1987), “The Place of Politics in Religion”, trans., 31 May 2010. Cf.
www.deoband.org/2010/05/general/politics/the-place-of-politics-in-religion/.
35 Muhammad Taqi Usmani (1983), “An Introduction to Buying and Selling in Islam”, trans.,
16 Jan. 2013. Cf. www.deoband.org/2013/01/fiqh/business-and-trade/an-introduction-to
-buying-and-selling-in-islam.
Studia Islamica 112 (2017) 264-293 Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free access278 Coste
l’islam qui imputent à Dieu, et non à l’homme, la propriété réelle sont de la
même manière une voie alternative à ces idéologies. Taqi Usmani estime aussi
que leur finalité ne représente pas uniquement le bien-être matériel. Enfin, à
l’instar des partisans de l’ « idéologie islamique », par le biais de ses positions
critiques sur la structuration financière, il se réfère à la nécessité vitale de
faire primer un sens supérieur absolu, sur une approche légaliste. Cette der-
nière contrarie, d’après lui, la transformation de l’ordre présent, en authen-
tique réactualisation du modèle prophétique. Que les contrats de la finance
islamique ait été reconnus comme permis par une certification légale, occulte
le fait qu’il les considère comme transitoires, et non en phase avec les finalités
de la shariah36.
Dans la vie institutionnelle tumultueuse du Pakistan, deux moments sont
historiquement clés quant à la question de la suppression de l’intérêt de l’en-
semble de l’économie. L’un intervient en 1980 avec la publication du rapport
du Conseil de l’idéologie islamique (CII), reconstitué pour son programme po-
litique par le Président du nouveau régime de 1977, le Général Muhammad Zia
ul-Haq37. L’autre est le jugement de la Cour d’appel de la shariah de la Cour
36 Muhammad Taqi Usmani, “Looking for New Steps in Islamic Finance”, n.d, cf. www
.muftitaqiusmani.com.
37 Le Conseil de l’idéologie islamique (CII) avait été mis en place par la Constitution de 1962.
Sa réelle activité toutefois intervient lors de sa refondation par le Général Zia ul-Haq,
marquant ainsi la manifestation d’une des premières mesures après sa prise de pouvoir.
Le 10 février 1979, celui-ci établit une limite de temps de trois ans pour totalement par-
venir à cet objectif d’une islamisation intégrale de l’économie. Le CII rend son rapport
au Gouvernement intitulé L’Elimination du ribā de l’économie et les modes de finance-
ment islamiques en juin 1980 dans lequel il estime être possible en trois phases d’achever
cette mission. Les instruments privilégiés pour extraire définitivement l’intérêt du sys-
tème économique sont ceux répondant à la logique du partage des pertes et profits, ainsi
que des prêts sans intérêt (qard al-hassan). Si le Conseil de l’Idéologie a reconnu la dif-
ficulté de transformer le système sur cette base unique de l’utilisation de la mushāra-
kah et de la muḍārabah, et qu’il a pu cautionner d’autres mécanismes comme le leasing
(ijārah), il estime que l’utilisation de ces derniers doit être réduite à sa portion congrue,
puisqu’ils représentent un danger d’ouvrir « la porte de derrière à l’intérêt », cf. Ziauddin
Ahmad, “Present State of the Islamisation of the Financial System in Pakistan”, in IPS
(Ed.), Elimination of Riba from the Economy, Lahore Institute of Policy Studies, 1994,
pp. 65.-76, cf. pp. 66-67; Khurshid Ahmad, “Elimination of Interest (Riba): The Real
Hindrance”, in Khalid Rahman, Muhibul Haq Sahibzada, Mushfiq Ahmed (Eds.), Jama‘at-
e-Islami and National and International Politics, Vol. I, Islamabad, Book Traders, 1999,
pp. 233-249; Robert M. Hathaway, Wilson Lee (Eds.), Islamization and the Pakistani
Economy, Washington DC, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2004 ;
Aurangzeb Mehmood, “Islamisation of Economy in Pakistan: Past, Present and Future”,
Studia Islamica 112 (2017) 264-293
Downloaded from Brill.com07/16/2022 06:26:51AM
via free accessVous pouvez aussi lire