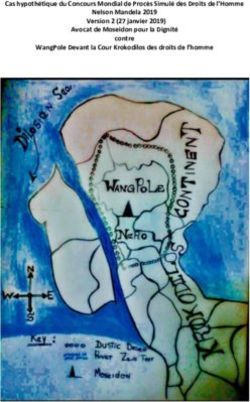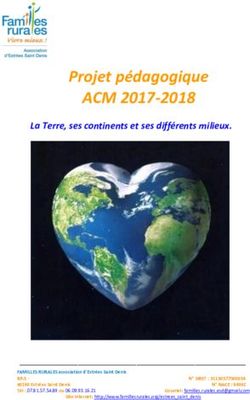LE SILENCE DE L'AQUARIUM - Mon Petit Éditeur - Sibylle de Boismorel
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Sibylle de Boismorel
LE SILENCE DE L’AQUARIUM
Mon Petit ÉditeurRetrouvez notre catalogue sur le site de Mon Petit Éditeur :
http://www.monpetitediteur.com
Ce texte publié par Mon Petit Éditeur est protégé par les lois et traités
internationaux relatifs aux droits d’auteur. Son impression sur papier
est strictement réservée à l’acquéreur et limitée à son usage personnel.
Toute autre reproduction ou copie, par quelque procédé que ce soit,
constituerait une contrefaçon et serait passible des sanctions prévues
par les textes susvisés et notamment le Code français de la propriété
intellectuelle et les conventions internationales en vigueur sur la
protection des droits d’auteur.
Mon Petit Éditeur
14, rue des Volontaires
75015 PARIS – France
IDDN.FR.010.0117279.000.R.P.2012.030.31500
Cet ouvrage a fait l’objet d’une première publication par Mon Petit Éditeur en 2012À Paloma
"Il faut se préparer à déplaire dans la vie, souvent, à beaucoup
de gens et parfois aussi à soi-même."
Henry James.Chapitre 1
Ce matin-là, je m’étais levée pour changer de monde.
Je restais, toute petite, devant la haute façade brillante et
opaque. Un immeuble miroir à Neuilly. Des collègues, des habi-
tudes, des rires, dans ce lieu vide d’âme. Je ne parvenais pas à
les imaginer.
Je voulais être bien pour faire mon entrée dans le grand
journal parisien. Je m’étais couchée des années trop tôt. À qua-
tre heures mes yeux étaient grands ouverts.
Je mettais fin ce matin à ma vie d’étudiante. Serais-je heu-
reuse dans ce cube de glaces ? Impossible de répondre. Je savais
seulement que je disais adieu à ma liberté. Désormais mon
temps qui était mon luxe ne m’appartiendrait plus qu’en partie.
Je m’en souviens très nettement. J’étais nerveuse. Avec le re-
cul, je trouve que j’avais de bonnes raisons pour cela. C’est bien
de ne pas savoir, j’en aurais perdu mes moyens.
Ma seule certitude, ce matin de septembre, c’était que ma
candidature avait été retenue par General News, la maison mère
du Groupe Ferrières, une société cotée du CAC 40. Je m’étais
passée trois millions de fois le film de mon arrivée. Surtout ces
derniers jours. Je voyais déjà que rien ne ressemblerait à mes
élucubrations. Ma cervelle avait travaillé pour rien, j’avais juste
réussi à me faire peur. Un ami qui partait travailler en Chine et
auquel j’avais demandé ce qu’il ressentait, m’avait dit qu’il ne
voulait pas y penser avant d’y être. C’était lui qui avait raison.
La porte coulissa en son milieu. Le hall était à la mesure du
bâtiment : vaste comme une cathédrale. Les indigènes se par-
9LE SILENCE DE L’AQUARIUM
laient à mi-voix, se croisant avec un signe de tête. J’étais une
étrangère débarquée de contrées du bout du monde, une immi-
grante qui ne connaissait pas les mœurs de la tribu. Je n’avais
pas les peintures de guerre de la bonne couleur, je faisais tache.
C’est sans doute la raison pour laquelle je recevais ces regards
durs.
Le sol en pierre noire, les murs sombres, faisaient un écrin
aux jardins, par un jeu de panneaux transparents. Les lieux
étaient baignés d’une lumière grise, filtrée par les baies teintées.
Perdu au milieu, un drôle de comptoir en forme de Z servait de
bureau à trois jeunes prêtresses en uniformes beiges.
Je me sentis vaciller dans mes bottes. Je fermai le premier
bouton de ma veste et je me dirigeai de ce côté.
L’une d’elles, sourcils arqués, maquillage de magazine et che-
veux remontés en un chignon sans reproche leva la tête et me
fit la grâce d’un sourire lointain :
— Les ressources humaines ? Qui dois-je annoncer ?
— Brune Gauthier.
Elle décrocha son téléphone. La ligne devait être occupée et
l’attente durait.
J’en profitais pour regarder autour de moi. L’endroit était
élégant à l’image de la hautaine hôtesse. J’essayais de tenir en
laisse mon appréhension qui avait la désagréable manie de se
matérialiser en boule dure dans ma gorge et en coton hydro-
phile dans mes jambes.
— Mademoiselle Gauthier, Madame la directrice des Res-
sources Humaines vous attend. Sixième étage au fond, après le
grand escalier. Les ascenseurs sont derrière le hall.
Pourquoi les architectes sadiques s’amusent-ils à cacher les
ascenseurs aux pauvres débutantes qui ne cherchent qu’à mon-
ter gentiment ?
Cécile Lapierre, le combiné à la main me désigne d’un signe
de la tête, en face de sa table de travail, un des deux fauteuils
10LE SILENCE DE L’AQUARIUM
sacs en forme de poires. Je suis assise très bas, le menton au ras
des genoux.
Je ne sais si cette position est censée me mettre à l’aise ou
me déstabiliser. Je renonce à trouver une réponse à cette ques-
tion qui est certainement traitée dans tous les manuels de
communication. J’examine la pièce spacieuse et les murs cou-
verts de dossiers, puis mon regard retombe sur la directrice.
Elle est toute en rondeur. Cheveux auburn presque ras, une
bouche charnue maquillée en rouge brun et des joues pleines.
Mais à regarder mieux, je trouve que le nez droit et volontaire
corrige la première impression. C’est la douceur bridée par la
détermination. Je reconnais son parfum pour l’avoir déjà porté
moi-même. Je me promets de me trouver une autre fragrance
sur mesure, celle-là. Une vague nausée me prend. L’idée me
vient de me lever, de lui dire que je n’en ai rien à faire et de sor-
tir en claquant la porte. J’imagine son air scandalisé. Ma fuite
heureuse dans l’escalier, l’air frais dehors…
Enfin la directrice du personnel raccroche et m’arrache à
mes divagations :
— Bienvenue ! Brune, c’est ça ? – Oui, Madame.
— Cécile. Appelle-moi Cécile, tout le monde se tutoie et
s’appelle par son prénom ici, autant commencer tout de suite.
Ça tombe mal, j’aime garder mes distances, la camaraderie de
convenance me donne des démangeaisons. Cependant je décèle
dans sa voix une note amicale. Et puis, si je ne suis pas capable
de laisser tomber les barrières, autant trouver un autre job.
Je lui fais mon plus beau sourire qui doit, ce matin, ressem-
bler davantage à une convulsion faciale qu’à un signe de
contentement.
Elle poursuit d’un ton plein d’emphase :
— Tu as un contrat dans le premier groupe de presse euro-
péen et tu n’es pas sans savoir que nous sommes également
présents aux USA, où, après New York et Washington, nous
venons de nous implanter à Dallas.
11LE SILENCE DE L’AQUARIUM
Mon interlocutrice ponctue son discours de ses petites
mains.
Au passage, je repère le « nous », qui prouve que Cécile fait
totalement corps avec Le Groupe. Les séminaires General
News, assurément, portent leurs fruits. Je parierais que le prési-
dent de la société n’y croit pas autant qu’elle. Il n’y a pas plus
snob qu’un chauffeur de star.
Cécile se lève, mettant fin à notre entretien. Je la suis dans
un long couloir, détaillant sa généreuse silhouette brimée par un
petit tailleur rouge. Elle ouvre une porte en verre et je me re-
trouve dans une sorte de bibliothèque sur deux nivaux où une
cinquantaine de personnes travaillent devant leurs écrans
d’ordinateurs. La mezzanine rejoint l’étage inférieur par un es-
calier métallique. La climatisation doit être au maximum car
malgré la concentration humaine, il fait glacial. Peut-être une
astuce pour empêcher la surchauffe des cerveaux en efferves-
cence, un procédé de rentabilisation de la matière grise en
fonction de la température ambiante. Je crains une nouvelle
rationalisation du travail, appliquée au monde de la Presse.
J’espère que le mien résistera au conditionnement, que je suis
dotée d’une cervelle mutante.
Un homme grand et sec, la cinquantaine, les tempes grises
s’avance vers nous. Son visage classique tranche avec sa che-
mise en Liberty et son pantalon terre cuite. Il a un regard très
direct et assez froid. Mon impression est plutôt bonne, j’ai un
détecteur de salopard incorporé et il ne se met pas à vibrer, ce
type-là me parait bien. Pas le genre jovial qui mime la sympa-
thie, pas le style faux-cul qui en fait trop, pas le genre pète-sec
qui assassine le moral. Non il est réservé et j’aime ça.
Cécile se charge des présentations :
— Christian, je te présente, notre nouvelle recrue, Brune
Gauthier. Brune, ton nouveau rédacteur en chef, Christian
Blaise.
Nous nous serrons la main.
12LE SILENCE DE L’AQUARIUM
Il se frotte la tempe, l’air de se demander ce qu’il va bien
pouvoir faire de moi. Cela me rassure car je me pose la même
question.
— Eh bien, Brune, tu vas t’installer ici. Essaie de réfléchir à
un article. Peu importe le domaine, je te laisse toute liberté. Le
service d’archives est au bout du corridor. Une conférence de
rédaction est prévue dans deux heures, elle sera dirigée excep-
tionnellement par le président Ferrières. Ça arrive de temps en
temps.
Il me désigne une table entre la fenêtre et une petite rousse
rondelette. Un sourire contraint et Christian Blaise
m’abandonne. Je m’installe à ma table et fais connaissance avec
l’ordinateur qui s’y trouve, nous n’avons pas été présentés, et je
le trouve peu accueillant, voire désagréable sur les bords. Les
ordinateurs et moi, ça fait deux. Après avoir réussi à
l’apprivoiser, je constate que ma tête est archi vide. Pas l’ombre
d’une idée intelligente fait mine de la traverser. En revanche, un
défilé d’inepties se présente sans relâche. Et puis le fait que je
me répète en continu : conférence de rédaction… conférence
de rédaction… est sûrement préjudiciable à ma concentration.
Un vrombissement de conversations maintient un niveau
sonore impropre à mon travail. De ravissantes jeunes femmes
brassent un air parfumé en faisant circuler des dépêches.
L’heure avançant, l’effervescence grimpe de plusieurs degrés, on
s’apostrophe maintenant d’un bout à l’autre de la pièce. Mes
nouveaux collègues paraissent assez intimes, échangeant bla-
gues limites et allusions obscures… Le monde de la Presse me
fait ce matin-là, l’impression d’un univers très contrasté, à la
fois exubérant et froid.
Par chance, je suis entrée dans le champ de conscience de
ma voisine rousse. Elle hausse son regard au-dessus de son
écran et prend acte de mon existence d’une façon relativement
inquiétante :
— Bienvenue dans l’arène !
13LE SILENCE DE L’AQUARIUM
Elle fait cliqueter autour d’elle une impressionnante collec-
tion de bracelets et de colliers hétéroclites. On dirait un vendeur
à la sauvette qui porte son stock sur lui pour mieux disparaître
en cas de problème. Un instant, j’envisage de lui demander le
prix d’un sautoir en grosses perles vertes, mais je me ravise juste
à temps.
J’essaie de préparer quelque chose qui tienne l’intérêt pour la
conférence, mais l’atmosphère survoltée et mes problèmes
techniques sur Vista ont raison de ma maigre inspiration.
Sur le boulevard, les platanes sont habillés de leurs teintes
d’automne et la vitrine, dans laquelle ils se réfléchissent, a prise,
avec le couchant, une teinte jaunâtre.
Le café est comble et un brouhaha soutenu m’accueille. J’ai
du mal à localiser Juliette, coincée à une table contre le mur.
Elle m’apostrophe à travers la salle et cinquante regards interro-
gateurs se tournent en même temps vers moi.
Sacrée Juliette qui adore se faire remarquer !
Je me glisse en face d’elle, l’embrasse sur les deux joues et
profite de l’attention éphémère du serveur pour commander un
chocolat chaud.
Juliette arbore un béret beige, très jeune fille dans la résis-
tance. Cela souligne ses boucles blondes. Elle penche vers moi
son visage pâle à peine rosi aux pommettes par un maquillage
suave.
— Alors ?
— Alors quoi ?
Elle me jette un regard de reproche.
— Brune ! Raconte, General News ! Tout quoi !
C’est passé. Je prends le temps de respirer. J’aime l’odeur de
bière et de limonade mélangée à celle des expressos.
Je sais que Juliette est impitoyable. Elle ne me laissera passer
aucun détail, aucune impression. Je choisis mes mots avec soin.
14LE SILENCE DE L’AQUARIUM
— Eh bien, on ne peut pas rêver pire ! Ça commence par la
conférence de rédaction ! Je n’ai que deux heures et le cerveau
en semoule.
Je mets deux sucres dans mon chocolat, faisant patienter Ju-
liette.
— Le Président Ferrières arrive très en retard. Il est très dif-
férent de son père, Charles Ferrières. Lui, tu as dû le voir dans
les journaux, il est souvent interviewé pour donner son avis sur
les questions économiques. Pour tout te dire, j’y fais attention
parce que ces gens ont une propriété à côté de chez moi à Va-
loire.
Juliette secoue la tête.
— Ah oui ? Je ne savais pas !
— Donc, j’en reviens au Président : Grand, blond… J’hésite,
réfléchissant à cette image et je poursuis : mais, tu sais… Je
choisis mes mots pour rendre à Juliette l’impression que m’a
faite cet homme : c’est simple, en un regard, on voit
l’intelligence, l’éducation. Impressionnant.
Mon amie digère l’information à sa manière, un long siffle-
ment s’élève au-dessus de notre table.
— Pas mal ! Quel âge ?
Je réfléchis.
— Je dirais la trentaine. On fait le tour de table, chacun ex-
pose son sujet, on retient ou pas. Je me sens à peu près comme
un presque condamné à mort qui va devoir sauver sa tête tout
seul. Je ne parierais pas lourd sur ma survie.
Les propositions de reportages sont intéressantes, pour cer-
taines décapantes. Cela dure longtemps. Un martyre C’est
bientôt à moi et je te jure que mes genoux tremblent tellement
sous la table, que je suis sûre que tout le monde les entend. Je
me maudis d’avoir choisi ce métier, j’aurais pu reprendre la dro-
guerie dans mon village en Sologne. Je serais en blouse grise, en
train de peser des clous pour le péquenaud du coin ! Quel bon-
15LE SILENCE DE L’AQUARIUM
heur ! Tout, plutôt que d’être là. Je pense à ma mère qui était
une bonne journaliste. Je la supplie de m’aider si elle m’entend.
Quand mon tour arrive, je préférerais être morte et enterrée !
J’entends d’abord une voix monocorde s’élever dans la salle
avant de réaliser que c’est la mienne. J’ai le temps de penser,
l’espace d’une seconde, que je dois absolument faire des exerci-
ces pour la raffermir. Je débite un drôle de couplet sur le retour
à la religion au vingt et unième siècle et le reportage que nous
pourrions faire à ce sujet en débutant sur la phrase célèbre de
Malraux.
Un silence complet suit mon intervention. Le genre de grand
froid qui accueille une grave bêtise quand on est enfant. Puis
une perche avec un chiffon sur la tête et des anneaux de rideaux
aux oreilles à l’autre bout de la table m’apostrophe :
— C’est la plus grosse connerie que j’ai entendue depuis
longtemps ! Ça n’intéressera personne à part quelques croulants
réacs
Quelques rires naissent à droite et à gauche.
Je me sens pâlir comme si mon visage se transformait en
iceberg, je ne sais comment réagir. J’aimerais que la moquette
sous mes pieds m’avale et me digère !
Juliette tape sur la table faisant déborder le contenu de ma
tasse dans la soucoupe.
— Quelle sale garce ! Tu lui as réglé son compte, j’espère !
Aboie-t-elle.
Je n’en attendais pas moins de mon amie.
— J’aurais bien aimé, mais je n’ai pas eu le temps de le faire
— Pourquoi ? S’étonne Juliette, intriguée.
La nuit tombe déjà quand je reprends ma voiture. Nous
sommes vendredi soir et je m’insère dans la masse compacte
des voitures immobilisées.
16LE SILENCE DE L’AQUARIUM
Tout le monde tente de s’échapper de Paris, pour un petit
intermède vert au prix de deux soirées dans les gaz
d’échappement ! Ça sera encore ainsi quand il faudra braquer
une banque pour se payer le plein d’essence. Le seul problème
c’est que je fais pareil et que, pire, je commence même à réflé-
chir à la banque la plus pratique !
J’allume la radio et trois bulletins d’informations plus tard,
évadée de la capitale, une sensation de paix décrispe mon dos.
Mes mains se détendent sur le volant. Je suis bien. Il n’y a rien
de tel que les angoisses pour goûter ensuite les joies très simples
de l’existence. La départementale, droite et noire, est bordée de
grands arbres roux que mes phares font naître de l’ombre telles
des apparitions étranges. J’aime cette route. Je la connais depuis
toujours, quand j’étais enfant, je trouvais le temps très long à
l’arrière de la voiture. En réalité entre Paris et Valoire, il faut
moins d’une heure.
La supérette, brillamment éclairée au néon dispense allègre-
ment sa lumière sur la petite place du village. Elle a remplacé
l’année dernière la vieille épicerie, « Chez Paulo ». Je ne m’en
suis pas réellement consolée, parce que le vieux Paulo était le
témoin de mes jeunes années-carambars, mais, traître, je vais
tout de même remplir mon caddy chez les nouveaux venus.
C’est mal. Mais c’est ainsi.
Je me gare devant l’école et j’enfile mon manteau. Dehors, je
suis accueillie par l’odeur aigrelette des platanes. La gérante du
« Spar » a encore changé de couleur de cheveux, depuis l’été.
Elle me fait un ravissant sourire commercial. Dans un panier en
plastique rouge, je ramasse deux trois courses pour nourrir des
amis qui doivent passer le dimanche chez moi, histoire de se
remettre de leur traque au chevreuil dans la région. Je rajoute
pour moi des munitions de chocolat.
Quand je regagne ma voiture, plus moyen d’ouvrir ma por-
tière, je dois me contorsionner par celle du passager. Quelle
17LE SILENCE DE L’AQUARIUM
misère ! Le vent s’est levé et je frissonne en m’asseyant au vo-
lant.
Je roule lentement dans la rue qui descend vers le « Café de
Sologne », penchant la tête au passage, je vois plusieurs hom-
mes au comptoir. Des chasseurs sans doute, la saison a
commencé.
Au bout du village, dans le tournant, mes phares balaient au
passage les hauts piliers de pierre de la propriété des Ferrières et
je m’engage dans notre ruelle.
Ma maison est la dernière à la sortie du village. C’est une pe-
tite villa des années vingt, en pierre grumeleuse avec un toit
pointu et de la vigne vierge. La façade est plongée dans
l’obscurité.
La douleur de la perte me revient, quand en arrivant, je
trouve la maison vide et froide. Je revois l’époque de mes pa-
rents vivants et je prends la mesure de ma solitude. Je gare ma
vieille Austin dans la rue et chargée de mes sacs, je pousse du
pied la barrière qui cède avec un grincement triste. Pourquoi
Les grilles jouent-elles ce méchant rôle dans la vie ? Quand une
maison est pleine, jamais elles ne feront cette chanson lugubre,
mais il suffit que les occupants l’aient désertée pour que les por-
tes des jardins viennent pleurer dans une sinistre plainte.
Passé le seuil, je perçois une odeur de feu de cheminée re-
froidi. La maison a conservé affectueusement l’empreinte de
mon dernier passage. Dans l’entrée, les vieux imperméables
accrochés aux patères sont autant de silhouettes bienveillantes.
La cuisine est froide. J’allume la suspension, deux mouches
mortes gisent sur la table en bois. Je pose mes provisions et je
mets la cuisinière en route. Le silence est profond. Il souligne
l’écho des voix disparues. Je refuse de tomber dans le gouffre
de la nostalgie, j’allume la radio et je branche la cafetière. Le
journal du soir accompagne mon dîner de sandwichs.
18Vous pouvez aussi lire