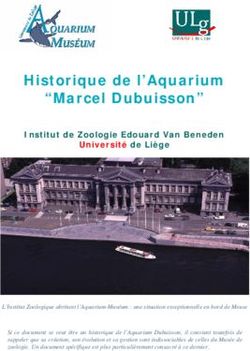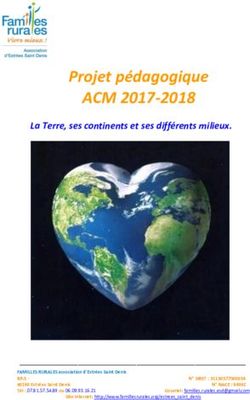EVELYNE DE LA CHENELIÈRE LA VIE UTILE - précédé de - LES HERBES ROUGES / scène-s - Numilog
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
EVELYNE DE LA CHENELIÈRE LA VIE UTILE précédé de ERRANCE ET TREMBLEMENTS LES HERBES ROUGES / scène-s
Collection « scène_s »
La vie utile
précédé de
Errance et tremblements
d’Evelyne de la Chenelière
est le dixième titre de cette collection
dirigée par Sylvain Lavoie.De la même auteure Au bout du fil, théâtre, Montréal, Éditions Élaeis, 1999. Théâtre (Des fraises en janvier / Au bout du fil / Henri & Margaux / Culpa), théâtre, Saint-Laurent, Fides, 2003. Au bout du fil / Bashir Lazhar, théâtre, Paris, Éditions Théâtrales, 2004. Désordre public / Aphrodite en 04 / Nicht retour, mademoiselle, théâtre, Saint-Laurent, Fides, 2006. Éloges, essai, avec des textes et des photos d’Ariane Émond et de Martine Doucet, Outremont, Les Éditions du Passage, 2007. L’héritage de Darwin, théâtre, Carnières-Morlanwelz, Lansman Éditeur, 2008. L’imposture, théâtre, Montréal, Leméac, 2009. Les pieds des anges ou De l’inquiétude existentielle à travers la représentation des anges, et de l’apparition de leurs pieds dans l’art de la Renaissance, théâtre, Montréal, Leméac, 2009. Le plan américain (avec Daniel Brière), théâtre, Montréal, Leméac, 2010. Bashir Lazhar, théâtre, Montréal, Leméac, 2011. La concordance des temps, roman, Montréal, Leméac, 2011. La chair et autres fragments de l’amour, théâtre, Montréal, Leméac, 2012. Lumières, lumières, lumières / Septembre, théâtre, Montreuil, Éditions théâtrales, 2015.
EVELYNE DE LA CHENELIÈRE
La vie utile
théâtre
précédé de
Errance et tremblements
essai
LES HERBES ROUGESLes Herbes rouges remercient le Conseil des arts du Canada,
le Fonds du livre du Canada ainsi que la Société de développement
des entreprises culturelles du Québec pour leur soutien financier.
Les Herbes rouges bénéficient également du Programme de crédit
d’impôt pour l’édition de livres du gouvernement du Québec.
© 2019 Éditions Les Herbes rouges
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
Bibliothèque et Archives Canada, 2019
ISBN : 978-2-89419-686-1 (pdf)Errance et tremblements
PREMIÈRE PARTIE
ÉCRIRE SUR UN MUR
Je me demande si ce que nous
appelons poésie n’est pas en vérité
quelque chose qui ne cesse d’habi-
ter, de travailler et de sous-tendre
la langue écrite pour la restituer à
cet illisible dont elle provient et vers
lequel elle nous maintient en marche.
GIORGIO AGAMBEN
Le feu et le récit
La vie utile a été créée au printemps 2018 à Espace GO,
après une résidence de trois ans qui allait, je l’ignorais
au départ, ébranler profondément ma pratique et ma
conception de l’écriture.
Telles qu’imaginées par la directrice artistique
Ginette Noiseux, les résidences à Espace GO veulent
favoriser un dialogue soutenu entre le théâtre et l’artiste
invitée. Pendant trois saisons, la résidente est appelée,
d’une part, à initier et à inspirer des créations dans la
programmation principale ; d’autre part, à investir un
espace en marge de la saison régulière en développant
des formes qui correspondent à ses questionnements et
à ses désirs artistiques, puis en invitant, le cas échéant,
d’autres artistes à se joindre à elle. Quand cette résidence10 errance et tremblements
m’a été offerte, j’ai été prise de vertige face à l’éventail
des possibles, et j’ai eu le pressentiment que ce serait l’en-
droit d’un conflit intérieur important, celui qui oppose le
dehors et le dedans. C’est que, ironiquement, on m’invi-
tait à occuper un lieu alors même que je me demandais
dans quel endroit je vivrais mieux.
Je tenais, avant de m’engager, à chercher en moi-
même par quelle approche je pourrais nourrir cette rési-
dence tout en étant en phase avec mes préoccupations les
plus profondes, les plus vitales. Il fallait surtout que je
trouve l’élan, le sursaut d’énergie, car, il faut bien le dire,
cette invitation arrivait à un moment où j’éprouvais une
grande fatigue morale par rapport à ce qu’on appelle cou-
ramment le métier ou, de façon plus imagée, le milieu.
Comment trouver une nécessité à mon travail quand
le monde hurle et court à sa perte ? Comment croire
encore en l’impact de l’art quand on ne fait plus de dis-
tinction entre le poète et le publicitaire, entre une soirée
au théâtre et une sortie au restaurant ? Comment, devant
ce qui ressemble à une sorte de censure par l’excès,
espérer tenir une parole qui ne soit pas immédiatement
neutralisée ?
« On dit que le sauvage en nous a disparu, que la
civilisation touche à sa fin, que tout a déjà été dit et que
nous venons trop tard pour être ambitieux 1 », déclarait
en 1926 Virginia Woolf dans son essai Le cinéma. Bien
que nous puissions déceler dans cette phrase une subtile
et délicieuse ironie, je crois que ce qu’elle évoque est un
sentiment douloureux commun à toutes les générations
depuis toujours, celui d’être né trop tard. Pourtant, cette
impression d’une irréparable rupture entre soi et le monde
1. Virginia Woolf, « Le cinéma », Essais choisis, trad. de Catherine
Bernard, Paris, Gallimard, coll. « Folio Classique », 2015, p. 296.écrire sur un mur 11
a peu à voir avec l’époque ou avec l’année de notre
naissance ; elle vient selon moi d’un décalage entre
notre interprétation du réel et la manière dont il nous est
présenté depuis l’enfance.
Voilà la rupture qui, au moment où Ginette Noiseux
m’offrait de devenir artiste résidente, me semblait grandir
inexorablement. Avant d’accepter l’invitation, j’ai donc
entamé un processus de réflexion qui m’a menée dans des
endroits où j’évitais soigneusement de m’attarder jusque-
là, des zones où je craignais de voir s’éteindre à tout
jamais mon désir d’écrire. Car c’est de cela qu’il s’agit :
maintenir en vie un désir de plus en plus chancelant.
L’écriture qui domine la place publique, et particuliè-
rement celle qui prend corps sur nos scènes, est souvent
terriblement loin de ce que j’attends d’elle. Elle est deve-
nue un espace qui s’apparente de plus en plus au tribunal,
à la chaire et au confessionnal. On y fustige, on y accuse
avec un aplomb qui me déconcerte, on y prêche au nom
de vertus qui m’ennuient, enfin on y fait des aveux et
des confessions à n’en plus finir, sans retenue, dans
une quête d’absolution qui me met mal à l’aise. Je vois12 errance et tremblements
dans cette recherche de cautionnement un symptôme de
notre époque en manque de garanties morales. Or ce qui
nous maintient ensemble dans la médiocrité et le renon-
cement, c’est le cautionnement généralisé. Le théâtre
serait lentement devenu assujetti à son sujet, assimilable
par une déclaration ; un art hygiénique, une subversion
conformiste, arrogante, consommable, indiscutable qui,
contrairement à ce qu’elle prétend, nourrit notre déni.
Quelle place reste-t-il pour l’écoute, l’inquiétude, le
doute, le désir, l’ambiguïté, le mystère, l’opacité, l’incer-
titude ? Y a-t-il encore un espace vacant à investir ? En
quel lieu ? Comment ? Pourquoi ? Pour qui ? Où se situe la
véritable résistance ? Le milieu théâtral est-il condamné
à être un entre-soi ? Me suis-je perdue dans une soumis-
sion heureuse à laquelle je dois ma place dans cet entre-
soi ? Suis-je vouée à redouter sans cesse la perte de cette
place que l’on m’a faite ou que j’ai prise ? Ne vaudrait-il
pas mieux essuyer un rejet définitif de la part du milieu
plutôt que de tenter désespérément de lui correspondre
pour m’y maintenir en vie ? Pourquoi m’arrive-t-il de
souhaiter une exclusion qui ne me permettrait aucune
réinsertion, qui ne me laisserait aucun espoir de pouvoir
un jour le réintégrer ? Est-ce précisément l’espoir qui
nous rend esclaves du pouvoir ? Devrais-je cesser à tout
jamais d’espérer pour être enfin paria, enfin disqualifiée
pour de bon, bref enfin libre ?
Un peu comme quand, petite, je rêvais d’avoir ma
place parmi les belles, les craintes, les désirables, les
redoutables de la cour d’école dont le pouvoir me faisait
envie : j’étais prête à tout pour obtenir leurs faveurs, pour
qu’elles me tendent la main et me fassent une place dans
leur lumière. Pourtant, s’il m’arrivait de gagner cette
place, je m’y sentais aussitôt malheureuse parce que jeécrire sur un mur 13
savais qu’elles pouvaient me la confisquer sans raison,
sans explication, et que cette place avait un prix : celui de
ma liberté. Faut-il être bannie pour être affranchie, pour
être à même de voir la possibilité d’un ailleurs ? Faut-il
être en dehors ? Et jusqu’à quelle frontière suis-je prête à
aller pour ne pas être tout à fait dedans ? Pour ne pas déve-
lopper l’habileté d’adapter ma parole au goût du jour ?
Pour ne pas devenir une artiste de circonstance ? Pour ne
pas voir mon imagination canalisée, prise d’avance par
ce qui ressemble de plus en plus aux lois intériorisées de
l’offre et de la demande ? Pour ne pas être tentée de par-
ticiper au jeu des gagnants, des vainqueurs, des décorés
du théâtre, des belles de la cour d’école, et pour ne pas
devenir aveugle à la violence de ce jeu ? Comment se fait-
il que le théâtre, qui depuis le début de son histoire est un
lieu où sont mis en cause les mécanismes de la domina-
tion, participe aujourd’hui à la diffusion du dogme de la
compétition, à la lutte pour le pouvoir auquel il prétend
résister ? Ce sont ces questions, entre autres, que j’ai tenté
d’arrimer à ma résidence, plutôt que les fuir.
Pour que je puisse m’engager auprès d’Espace GO, il
fallait absolument que je trouve une manière de me pro-
jeter dans un geste signifiant – et toutefois incertain –, un
endroit qui permette l’épanouissement de l’imprévisible,
car, dans l’état où je me trouvais, je ne savais plus rien
prévoir. J’ai donc proposé à Ginette Noiseux de fabriquer
une forme qui se déploierait pendant toute ma résidence,
et j’ai présenté mon projet en ces termes :
Je souhaite déployer un geste artistique
ample et lent.
Je souhaite donner au mot résidence son sens14 errance et tremblements
littéral en m’installant au théâtre comme dans
une demeure d’écriture.
Je souhaite déplacer le geste de l’écriture,
changer d’axe et de perspective, pour conquérir
de nouvelles libertés.
Je souhaite explorer les manières de rendre
compte de la transformation, de l’effacement, de
la progression de l’écriture, et rendre visibles
les suppressions, les ratures, les corrections, de
cette écriture mouvante.
Je souhaite m’engager dans un geste dont je
ne connais pas encore la signification exacte, et
demeurer à l’affût du surgissement de sens.
Je souhaite écrire « en transparence », sur
des supports visibles, surdimensionnés, pour que
le poème s’épanouisse dans l’édifice.
Je souhaite maculer les lieux de mots, en
donnant une dimension sensible et matérielle à
l’écriture.
Je souhaite que l’écrit soit ainsi « iconisé »,
et que les mots renvoient autant à leur image
mentale qu’à leur image graphique et acoustique.
Je souhaite que cette écriture, devenue
inscription du langage, mette en relation
l’éternité (traces de l’écriture) et l’instant (geste
de l’écriture).écrire sur un mur 15
Je souhaite que l’écriture, devenue graphie,
soit en lien avec l’espace, le temps et la durée.
Je souhaite enfin résister à la multiplication
d’événements artistiques appelant chaque fois la
promotion, la rentabilité, le commentaire, en me
concentrant sur une seule démarche évolutive.
J’ai nommé cela un chantier d’écriture, ma résidence
artistique étant consacrée à écrire sur un long mur qui
constitue un lieu de passage et de transition : le café-bar
d’Espace GO. Ces trois années d’écriture ont pris forme
en autant de couches, dont chacune cachait partiellement
la précédente – tel un palimpseste. La première année,
j’ai composé un montage de mots et de collages sur
une surface en bois ; la deuxième année, j’ai poursuivi
le travail sur une feuille de plexiglas qui a été posée à
quelques centimètres de la surface en bois ; la troisième
année, enfin, un tissu de tulle tendu, sur lequel j’ai cousu
des formes et des mots, est venu compléter le mur. Inspi-
rée des cocons et des chrysalides, cette dernière couche
était pour moi une manière de mettre en latence les
deux couches précédentes, tout en faisant ressentir leur
potentiel. Il me semblait alors que, devant l’image fixe
du mur, on pouvait avoir la sensation d’être face à des
réalités temporelles multiples : le passé, peuplé d’icônes
et de fantômes ; le présent, dont la perception est forcé-
ment chaotique ; le futur, temps des possibles et de la
fabrication.16 errance et tremblements
Je recommence
Le 13 août 2014, j’ai pris un pinceau, je l’ai trempé dans
la peinture rouge, j’ai grimpé sur un petit escabeau et j’ai
tracé, sur le mur blanc, des lettres qui disaient « Je
recommence ». Ainsi débutait ma résidence, par un geste
que je voyais comme une courbe interminable, inachevable.
Commencer ce mur me pétrifiait ; je ne pouvais me
résoudre à le maculer d’une tache qui représenterait le
commencement de quelque chose. En revanche, si la
tache se désignait elle-même comme un recommence-
ment, c’est-à-dire comme participant à une chose plus
vaste et déjà en marche, je sentais que je serais soudaine-
ment capable d’écrire. Oui, recommencer agissait en moi
comme un moteur puissant, un mouvement transformé
en but, un principe directeur qui allait, sans relâche – du
moins, je l’espérais –, renouveler mon impulsion d’écrire
en lui donnant des possibilités infinies. Et depuis ces
premières lettres tracées, un objet singulier s’est fabriqué
que j’essaie toujours de comprendre.
Ce qui m’a galvanisée dans ce qui est devenu le titre
du mur, Je recommence, c’est aussi sa valeur d’échec
annoncé – car je conçois le recommencement comme
une impossibilité fondamentale, une promesse indécente.
J’emploie ici le mot recommencement en y injectant la
notion de renouveau, et non pas simplement comme
une récidive. Il ne s’agit pas seulement de réitérer, mais
bien de re-commencer, c’est-à-dire de revenir à un état
qui a précédé l’habitude du regard que l’on pose sur les
choses. Pour tendre vers cette idée fantasmatique du re-
commencement qui nécessite une reconfiguration totale
du réel, je me suis projetée dans un désapprentissage
radical fondé sur la mémoire et l’oubli, comme si laécrire sur un mur 17
refonte de mon imaginaire devait d’abord passer par
la réactivation, puis la réaffirmation de notre mémoire
collective, transmise à travers le temps. J’ai donc choisi
deux livres fondateurs, édificateurs de mon imaginaire
et de mon rapport au réel, qui deviendraient les sources
principales de mon exploration d’une mémoire enfouie :
la Bible et le Précis de grammaire française.
Pourquoi la Bible ?
Que l’on pratique ou non une religion, que l’on soit de
telle ou telle confession, notre héritage religieux est lourd
et déterminant. Le sort de notre âme et son salut pèsent
comme une malédiction muette sur toutes les consciences.
Nous portons, depuis des millénaires, des processions
d’images se divisant essentiellement en deux pôles : celles,
terrifiantes, des cadavres, corps gonflés ou explosés,
dévorés par les bêtes ou rongés par les flammes ; celles,
sublimes, d’une promesse de repos, de béatitude, d’extase.
Peut-être que ces pôles agissent comme deux bornes
inconscientes qui nous permettent de tolérer l’intolérable
du réel, de vivre tout en sachant l’horreur ordinaire de
notre monde des vivants, de ne pas devenir fous devant
les images meurtrières qui nous parviennent de partout,
de nous berner nous-mêmes en envisageant la violence
comme le fruit d’événements extérieurs quand elle fait
partie de nous ; les images situées entre ces deux pôles
constituent une sorte de vide ne laissant que peu d’em-
preintes dans notre imaginaire. Paradoxalement, il s’agit
d’un vide saturé, un creux plein.
Ce qui m’intéresse d’explorer par l’écriture, c’est
clairement cette rupture dans un régime d’images18 errance et tremblements extrêmes, cet endroit que nous habitons, sorte de compromis iconique entre, d’un côté, la vue de notre propre décomposition et, de l’autre, cette contemplation extatique que les religions nous promettent. Comment investir cet espace – celui de notre existence terrestre – entre ce qu’on répugne à imaginer et ce dont on ose à peine rêver ? Mon travail veut envisager autrement cet endroit, le relire, le réinventer, en renouveler nos représentations ; le recommencer. Pourquoi la grammaire française ? Un arrachement, accidentel ou volontaire, est souvent le point de départ de cet état de réinvention auquel je tente d’accéder, ou, comme l’exprime Bernard-Marie Koltès, d’une « compréhension parfaite » du monde qui précé- derait tous les apprentissages, y compris – et peut-être surtout – celui de la langue. Comme si la langue avait le défaut, en désignant le monde, de justifier l’injusti- fiable, de nommer l’innommable : « Il s’agit de retrou- ver les facultés de perception premières, et d’autant plus profondes qu’elles sont premières. Il s’agit de chercher la compréhension parfaite, c’est-à-dire celle qui ignore l’exégèse et la justification 2. » L’exil serait une condition nécessaire à nos « facultés de perception premières », l’arrachement, la fuite comme opposition active au statu quo et à l’inertie, l’errance investie comme un projet nous permettant de quitter un territoire connu, familier jusqu’à l’aveuglement. 2. Bernard-Marie Koltès, Les amertumes, Paris, Éditions de Minuit, 1998, p. 10.
écrire sur un mur 19
J’ai doublement appliqué cette notion d’exil sur mon
mur d’écriture. D’abord, j’ai quitté une sorte de terre
natale, le lieu où j’écris depuis l’enfance : la page. Je me
suis arrachée à cette page où je suis née comme écri-
vaine, dans l’espoir d’un renouvellement du regard que je
pose sur le monde, et par le fait même de ma manière
d’y répondre par l’écriture. Sans que je quitte Montréal,
mon lieu d’écriture m’est devenu inconnu. J’ai aussi voulu
m’exiler de ma propre langue, en partant du principe que
la langue première non seulement désigne le réel, mais le
moule et le scelle. J’ai donc cherché à m’en emparer comme
d’une langue étrangère, ne serait-ce qu’en changeant mon
rapport avec la calligraphie de ma langue maternelle ; en
redécouvrant les dessins que trace son écriture.
Écrire de toutes ses forces
À l’entrée du théâtre, en guise de présentation de mon
objet qui prenait forme, j’ai posé ces mots :
Il n’y a pas longtemps, j’ai ressenti une émo-
tion très vive devant un petit garçon de deux ans
qui me racontait quelque chose. Je ne me sou-
viens pas de la teneur de ses propos, mais je
me souviendrai toute ma vie de son engagement
dans l’exercice du langage.
Je me souviens que j’ai pensé, alors qu’il
reprenait son souffle : il parle de toutes ses forces.
Ce n’était pas seulement le volume de sa
voix qui était fort (au maximum de ce que lui20 errance et tremblements
permettaient son souffle et ses cordes vocales,
me semblait-il), c’était la force de son corps tout
entier investi dans l’effort de dire, c’était une
force vitale incommensurable, c’était l’énergie
déployée pour trouver le mot qui ferait de lui un
être entendu, compris, c’était comme une main
tendue par la langue, c’était la recherche difficile
du chemin, ce parcours mental du combattant
qui relie le désir au concept, le concept au mot,
le mot à la phrase, la phrase à son élocution.
Chaque morceau de phrase prononcé était
une ébauche, une tentative, le contraire du
désespoir. Chacune des parcelles de son être
semblait être sollicitée pour rendre possible la
parole éclatante, vibrante, pleine.
J’ai le désir d’être comme ce petit garçon.
J’ai le désir d’écrire de toutes mes forces.
L’engagement corporel réquisitionné par l’action
d’écrire sur un mur fut pour moi une manière de rendre
visible et sensible la signification de mon engagement
envers la création. J’ai eu la sensation d’écrire l’écriture,
c’est-à-dire de la tracer, de la peindre, de la coller, de lui
donner une matérialité, voire une démesure qui trans-
cende la pensée elle-même.
Écrire debout, couchée, perchée, en faisant le pari
qu’un corps investi dans l’écriture peut arracher la
langue à son propre système d’aliénation, de banalisation,
d’assujettissement. Comme si seul le corps pouvait
rétablir l’étrangeté des mots, les dégager de toute valeurM
Collection « scène_s » Collection « s
« Et je vivrais ainsi, perchée, dans «ceEt véritable
je vivraischantier,
ainsi, perchée,
un da
chantier d’écriture qui ressemblerait chantier
à un jardin
d’écriture
suspendu…
qui ressemble
»
Durant trois ans, Evelyne de la Chenelière
Durant atrois
écritans,
sur Evelyne
un mur de la C
d’Espace GO, construisant de jour en d’Espace
jour la résidence
GO, construisant
artis- de jo
tique qui allait ébranler profondémenttique
sa pratique.
qui allaitElle
ébranler
raconte
profondém
ce parcours de création dans l’essai ce parcours
Errance de création dans l’es
et tremblements.
La pièce La vie utile est issue de La cette
pièce
résidence.
La vie utileJeanne
est issue
s’affaire dans son appartement quand s’affunairehomme
dans son apparaît
appartement
:
c’est la Mort. En même temps, Jeanne c’estenfant
la Mort.fait En
unemême
chutetemps,
mortelle à cheval. On ne sait pas quelle
mortelle
Jeanne à cheval.
rêve deOn l’autre,
ne sait pas
laquelle meurt vraiment. En même temps,
laquelle le meurt
père de vraiment.
Jeanne,En mêm
présence spectrale, parle de la mort.présence
En mêmespectrale,
temps, devantparle de la m
l’agonie de son père, Jeanne enfantl’agonie
décide de ne sonpaspère,croire
Jeanne en
en Dieu. En même temps, lors d’une enpromenade
Dieu. En même en forêt, la lors d
temps,
mère de Jeanne lui enseigne maladroitement
mère de Jeanne
les grands lui enseigne
prin- ma
cipes de l’existence. En même temps, cipes
les de
motsl’existence.
tombent, En telsmême te
des flocons de neige, en désordre. des flocons de neige, en désordr
La vie utile allie la reconstitution anarchique du passé
La vie utile allie laà reconstitution
la fabri- a
cation d’un avenir incertain, tempscation superposés
d’un avenir
comme incertain,
les tem
différentes couches du mur d’écriture diffde
érentes
l’artiste.
couches
Une œuvre du mur d’éc
palimpseste où la mémoire devient spectacle.
palimpseste où la mémoire devie
Formée en littérature et en jeu, Evelyne
Formée
de la
enChenelière
littérature et
esten jeu,
écrivaine et comédienne. La finesseécrivaine
de son œuvre
et comédienne.
prolifique La fine
fait d’elle l’une des figures les plus
fait d’elle
significatives
l’une desde filagures le
dramaturgie québécoise. dramaturgie québécoise.
ISBN 978-2-89419-683-0
9 7828 9 4 19 6 8 3 0Vous pouvez aussi lire