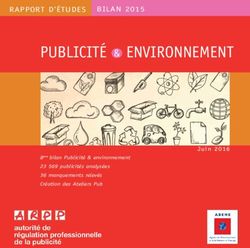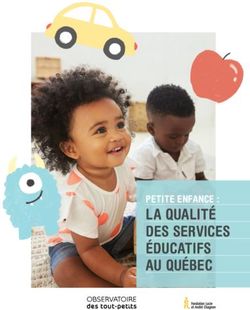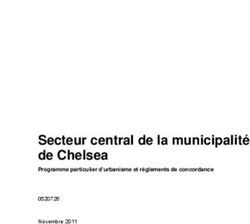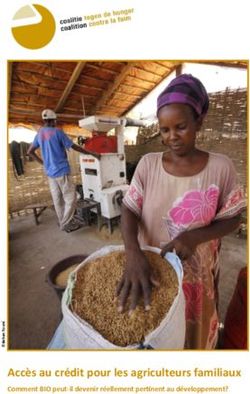"Le thème de l'eau abordé de manière ludique au cycle 1, en touchant la pensée complexe. " - Patrinum
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Mémoire professionnel Bachelor of Arts HEP Vaud en enseignement pour le degré primaire « Le thème de l’eau abordé de manière ludique au cycle 1, en touchant l’interdisciplinarité et en développant la pensée complexe. » Travail de Marika Hirt et Roxanne Iseli Sous la direction de Florence Quinche Membre du jury Yvan Schneider Lausanne, juin 2021
Remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidées dans la réalisation de notre
mémoire professionnel, et plus particulièrement :
- Madame Florence Quinche, notre directrice de mémoire, que nous aimerions
remercier pour son aide et sa disponibilité tout au long de ce processus.
- Monsieur Yvan Schneider, pour avoir accepté de participer en tant que jury lors de
la défense orale de notre travail.
- Mesdames Catherine Détraz et Véronique Geisser, nos praticiennes formatrices, que
nous remercions pour nous avoir permis de mettre en place notre séquence lors de
notre stage dans leur classe, et pour leurs conseils professionnels qui nous ont
beaucoup aidées.
- Les enseignantes qui ont pris du temps pour répondre à notre questionnaire.
- Monsieur Alain Hirt, le papa de Marika, pour avoir répondu à notre entretien et pour
nous avoir renseignées sur divers sujets liés au thème de l’eau dans la région
Riviera-Lavaux.
- Nos familles respectives, qui ont pris du temps pour relire notre travail.
2Table des matières
1. Introduction ........................................................................................................................ 5
1.1 Choix du thème .......................................................................................................... 5
1.2 Notre question de recherche ....................................................................................... 5
1.3 Concepts ..................................................................................................................... 6
1.4 Hypothèses ................................................................................................................. 6
1.5 Retour sur les entretiens exploratoires ....................................................................... 7
2. Partie théorique................................................................................................................... 8
2.1 Le développement durable ......................................................................................... 8
2.1.1 Lien entre le développement durable et l’éducation ........................................ 10
2.1.2 L’éducation en vue d’un développement durable à l’école .............................. 11
2.1.3 Plan d’études romand ....................................................................................... 12
2.1.4 Les compétences............................................................................................... 13
2.1.5 Les principes..................................................................................................... 14
2.2 La pensée complexe ................................................................................................. 15
2.2.1 Sciences naturelles ........................................................................................... 16
2.2.2 Activités créatrices et manuelles ...................................................................... 16
2.2.3 Arts visuels ....................................................................................................... 17
2.2.4 Français ............................................................................................................ 17
2.2.5 Capacités transversales ..................................................................................... 17
2.3 Le cycle de l’eau....................................................................................................... 18
2.3.1 Les étapes du cycle de l’eau ............................................................................. 18
2.3.2 Le rôle du climat et de la météo en lien avec le cycle de l’eau ........................ 19
2.3.2.1 Le rôle du climat sur le cycle de l’eau.......................................................... 19
2.3.2.2 Le rôle de la météo sur le cycle de l’eau ...................................................... 21
3 Partie pratique : description et analyse des activités menées en classe ............................ 22
3.1 Découverte du poisson et de son milieu ................................................................... 22
3.1.1 Mascotte de la classe et livre « Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans »
22
3.1.2 Aquarium .......................................................................................................... 23
3.1.3 Bricolage du poisson en 3D.............................................................................. 24
3.2 Livre L’eau ............................................................................................................... 24
3.3 Le bac à eau .............................................................................................................. 25
3.4 L’eau dans notre quotidien ....................................................................................... 26
3.5 Les caractéristiques de l’eau à l’aide des sens ......................................................... 28
3.5.1 Expériences des sens menées en 1-2P .............................................................. 28
33.5.1.1 La vue ........................................................................................................... 28
3.5.1.2 Le goût.......................................................................................................... 29
3.5.1.3 L’odorat ........................................................................................................ 30
3.5.2 Expériences des sens menées en 3P ................................................................. 31
3.6 Vidéo « Le voyage d’une goutte d’eau » .................................................................. 33
3.7 Kamishibaï « Le grand voyage de Balthazar »......................................................... 34
3.8 La roue du cycle de l’eau ......................................................................................... 35
3.8.1 Réalisations 1-2P .............................................................................................. 36
3.8.2 Réalisations 3P ................................................................................................. 37
3.9 Bricolage de la pochette du cycle de l’eau ............................................................... 38
3.10 Expérience de la bouilloire et de la casserole........................................................... 40
3.11 Expérience flotte / coule ........................................................................................... 41
3.11.1 Réalisations 1-2 P ............................................................................................. 42
3.11.2 Réalisations 3P ................................................................................................. 43
3.12 Expérience des mélanges.......................................................................................... 44
3.13 Pluviomètre .............................................................................................................. 46
3.14 Introduction au thème de la météo ........................................................................... 49
3.15 Préparation à l’évaluation certificative en 3P........................................................... 50
3.16 Évaluation certificative en 3P................................................................................... 51
4 Conclusion ........................................................................................................................ 53
5 Bibliographie .................................................................................................................... 55
6 Annexes ............................................................................................................................ 60
6.1 Entretiens exploratoires ............................................................................................ 60
6.2 Tableau résumant l’interdisciplinarité au sein des expériences et des créations ...... 69
6.3 Fiche vierge des panneaux explicatifs pour le pluviomètre ..................................... 77
6.4 Évaluation certificative 3P ....................................................................................... 78
7 Résumé et mots clés ......................................................................................................... 84
41. Introduction
1.1 Choix du thème
Pour notre travail de mémoire, il nous semblait intéressant de travailler sur la notion de
développement durable. Après avoir fait quelques recherches, nous nous sommes penchées sur
le thème de l’eau car il nous semble important qu’il soit traité à l’école, du fait que ce thème
fasse parti de notre quotidien dans de nombreux domaines comme la consommation, les
inégalités dans le monde, l’écologie … L'eau faisant partie intégrante de notre vie, il nous
semble pertinent et essentiel de travailler ce sujet avec les enfants dès leurs premières années
de scolarisation. Nous vivons dans une région (Riviera-Lavaux) à proximité du lac Léman et
de nombreuses sources d’eau (rivières, lacs de montagnes). Il nous a donc paru important et
intéressant que les élèves scolarisés dans cette région soient sensibilisés dès le plus jeune âge à
la question de cette eau potable qui coule de leur robinet. Nous aborderons ce thème de l’eau
en faisant un lien particulier avec les disciplines artistiques afin de faire resortir la créativité des
élèves. L’objectif de notre projet de mémoire est donc de concevoir plusieurs manières
d’aborder le thème de l’eau avec des élèves du premier cycle en touchant l’interdisciplinarité,
et ainsi de pouvoir tester ce qui sera le plus pertinent et ludique auprès des élèves. Ils devront
réaliser plusieurs productions manuelles en lien, ce qui sera une part des activités créatrices.
Nous décrirons également ce qu’il se passe au cours du cycle de l’eau, ainsi que le rôle du
climat et de la météo dans celui-ci. Aussi, la notion de développement durable sera mise en
avant, notamment car elle est un sujet clé de notre société d’aujourd’hui. Nous introduirons
aussi les élèves à la pensée complexe.
Cela nous sera utile pour notre future profession d’enseignante, car le thème de l’eau fait partie
d’un objectif du PER à aborder au cycle 1 et nous saurons comment nous diriger pour toucher
et intéresser au maximum nos élèves. Nous n’avons encore jamais pu voir ce thème de leçon
donné en classe, il est donc pertinent pour nous de l’essayer et le découvrir.
1.2 Notre question de recherche
Cela nous a conduites à notre question de recherche : « Comment aborder le thème de l’eau de
manière ludique au cycle 1, en touchant l’interdisciplinarité entre les activités créatrices et
manuelles, les arts visuels et les sciences de la nature, dans le but d’introduire les élèves à la
pensée complexe ? ».
51.3 Concepts
Cela soulève plusieurs concepts. Pour commencer, le concept de l’enseignement de manière
ludique. En effet, lorsque ce thème nous a motivées pour notre mémoire, nous avons
directement pensé à l’aspect ludique. Il est majeur pour nous de transformer de manière
pédagogique n’importe quel thème enseigné, et c’est ce que nous visons à faire au travers de la
résolution de notre problématique.
Un autre concept en lien est celui de l’interdisciplinarité. Pour résoudre notre problématique,
nous nous sommes tournées vers le côté des sciences et du français de la thématique de l’eau.
Pour compléter cette transdisciplinarité, nous lions également notre thème de l’eau aux activités
créatrices et manuelles, et aux arts visuels.
1.4 Hypothèses
Un de nos objectifs est donc de faire produire aux élèves, une ou plusieurs réalisations en lien
avec le thème de l’eau. Nous avons là-dessus plusieurs hypothèses qui pourraient être testées
dans nos classes du cycle 1. Nous précisons qu’à ce stade, nous n’avons encore rien eu le temps
d’explorer. Cependant, nous nous sommes basées sur plusieurs dossiers que nous avons trouvés
sur le site Éducation211, évoquant des tâches déjà réalisées avec des classes sur ce sujet. Nos
hypothèses viennent donc principalement de ces lectures, mais également d’idées auxquelles
nous avons pensé par nous-mêmes, sans certitude de leur faisabilité.
Comme hypothèses nous avons sélectionné les suivantes. D’abord du côté AC&M (activité
créatrices et manuelles) et AVI (arts visuels) :
1) un système de récupération afin de mesurer la quantité d’eau de pluie tombée ; 2) traces
récoltées sous forme de dessins constituant un dossier.
Puis, du côté sciences de la nature : 1) expériences sensorielles (toucher, goûter, sentir) ; 2)
visionnage de vidéos ; 3) lecture d’histoire et/ou de Kamishibaï sur le thème du cycle de l’eau ;
4) observation des réactions de l’eau (mélanger, objets flottent ou coulent) ; 5) découverte du
poisson, animal emblématique de l'élément eau ; 6) diverses expériences et observations
d’évaporation et de condensation de l’eau.
1
EDUCATION21. Eau. https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/eau
61.5 Retour sur les entretiens exploratoires
Avant de démarrer notre séquence, nous avons fait passer cinq entretiens exploratoires sous
forme de questionnaire à remplir.
Les quatre premiers questionnaires ont été envoyés à des enseignantes travaillant dans
différents établissements primaires du canton de Vaud, toutes au cycle 1. Nous avons fait le
choix d’interroger deux généralistes 3-4H et deux généralistes 1-2H, afin de bien pouvoir
représenter la totalité du cycle. Le cinquième entretien est une retranscription d’une discussion
avec Monsieur Alain Hirt, maître fontainier au SIGE (société intercommunale de gestion).
Depuis plus d’une dizaine d’années, il s’occupe régulièrement de faire visiter à toutes sortes de
public les divers systèmes d’exploitation de l’eau potable et des eaux usées sur tout le district
de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Pour donner suite à la lecture des réponses reçues, nous avons pu constater que le thème de
l’eau n’est pas abordé de manière concrète en classe au cycle 1. Même si les opportunités de
visites instructives sur ce thème sont disponibles dans notre région, ce thème n’est pas celui sur
lequel les enseignantes interrogées mettent la priorité. D’ailleurs, aucune de nous deux n’a vécu
une leçon sur le thème de l’eau durant nos stages. Les enseignantes abordent ce sujet dans des
occasions spontanées, lors de sorties dans la nature, le long d’une rivière ou lorsque les élèves
sont au lavabo par exemple. Ces constatations nous ont amenées à vouloir rechercher comment
faire en sorte que ce thème de l’eau soit plus attractif pour les élèves et les enseignant-e-s, et
comment ce dernier peut être enseigné de manière ludique. Nous tenterons de répondre à cela
au travers de notre mémoire.
72. Partie théorique
2.1 Le développement durable
Le monde vit une époque pleine de changements. Il se modifie à une vitesse qui ne cesse
d’augmenter et les conséquences sur notre environnement ainsi que sur l’humain sont devenues
un sujet clé. Notre société prend petit à petit conscience des défis mondiaux auxquels elle sera
confrontée dans un futur assez proche, qu’il s’agisse par exemple du réchauffement climatique,
des inégalités économiques, de l’égalité entre hommes et femmes, etc. C’est dans cette question
de soucis pour le futur, que nous souhaitons nous diriger vers un développement durable.
Un développement durable a pour but de garantir à tous les être-humains de notre monde actuel,
mais aussi futur, un mode de vie de bonne qualité tout en assurant et respectant les ressources
et limites de notre planète.
En d’autres mots, cet objectif planétaire vise à répondre à nos besoins actuels tout en
garantissant et assurant les ressources essentielles et nécessaires aux générations futures. Le
développement durable n'est pas un modèle figé, au contraire, c’est un processus qui ne cesse
d’évoluer, et cela, en fonction des acteurs et des contextes.
Le développement durable est représenté par trois principales dimensions interdépendantes :
l’environnement naturel, la société et l’économie. Ces trois pôles peuvent être représentés sous
forme de schéma, avec au centre, le développement durable.
Figure 1: Schéma du développement durable
8La figure précédente représentant le schéma du développement durable décrit de manière
visuelle le développement durable en mettant en avant différents axes ainsi que les principales
dimensions de celui-ci. Au cœur de ce schéma se trouve le développement durable. La
dimension sociale, la dimension économique et celle de l'environnement sont mises en avant
en violet. Elles se chevauchent, ce qui rend explicite le fait qu’elles sont interdépendantes.
L’une n’agit pas sans l’autre. Ces processus environnementaux, écologiques et sociétaux ont un
rôle dans l’avenir (axe horizontal avec les générations passées et futures) mais agissent aussi
sur différentes échelles spatiales (axe vertical, au niveau local ou au niveau mondial).
En d’autres termes, comme le résume un document de la Fondation Education et
Développement2, afin de satisfaire nos besoins de notre génération ainsi que de la génération
future, qu’ils soient matériels ou immatériels, « nous avons besoin d’une économie au service
du bien commun, d’une société solidaire pour garantir sa cohésion ainsi qu’un environnement
naturel gardant sa capacité à se régénérer ».
De nos jours, nous employons plutôt le terme « durabilité » que « développement durable », car
ce dernier présuppose que la croissance économique est une nécessité. Le terme de
« durabilité » porte moins une connotation économique, mais porte plutôt sur un sens global.
Le schéma présenté ci-dessus, datant des années 80, représente donc une durabilité faible, où
les trois pôles sont égaux et se joignent pour avoir une société durable. Ce schéma a longtemps
été utilisé, mais n’est plus tout à fait d’actualité, car il met en avant une asymétrie. En effet,
sans l’environnement, il n’y a plus de sphère sociale ou économique. En revanche, sans
l’homme qui représente le pôle social et le pôle économique, la biosphère se porterait très bien.
L’usage de la notion de « durabilité » est donc plus adéquat.
On oppose ce modèle de durabilité faible, anciennement nommé développement durable, au
paradigme de la durabilité forte qui relève que depuis des années ce concept de développement
durable a été mis en place, mais qu’il ne fonctionne pas car la sphère économique prend le
dessus. Dans cette idée de « durabilité forte », c’est la sphère environnementale qui met des
limites au développement de notre société et à la sphère économique.
2
FONDATION EDUCATION ET DEVELOPPEMENT. (2010). Éducation en vue du développement durable :
Une définition. Accès : https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/edd-
definition_FEE_FED.pdf
9Figure 2 : Modèle de durabilité forte
Ce schéma montre que la biosphère est considérée comme un support des autres dimensions, et
qu’elle permet aux autres dimensions d’exister.
2.1.1 Lien entre le développement durable et l’éducation
L'éducation joue un rôle primordial dans la visée du développement durable. Elle vise à nous
former, faire évoluer et grandir dans un but personnel mais aussi dans un but de vivre en société
et de la construire. Dans le cas du développement durable, comme mentionné ci-dessus,
l’éducation prend une place importante, car sans celle-ci, la mise en œuvre de cet objectif
planétaire est difficilement réalisable, voire impossible.
L’éducation peut former la société dans la réalisation d’actions et l’atteinte d’objectifs en vue
du développement durable. Par cela, nous pouvons faire un lien avec l’ « Agenda 2030 » du
développement durable qui comporte 17 objectifs définis en 2015 à atteindre d’ici 2030.
L’ « Agenda 2030 » a été mis en vigueur en 2016 par les 193 États membres de l’ONU, dont la
Suisse.
10Parmi ces objectifs de l’ « Agenda 20303 », les suivants sont relatifs à l'enseignement en vue du
développement durable :
• L’objectif 4 qui met en avant qu’il faut « assurer l’accès de tous à une éducation de
qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long
de la vie ».
• Et plus particulièrement le sous-objectif 4.7 qui explique qu’il faut « d’ici à 2030, faire
en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires
pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du
développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des
sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté
mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture
au développement durable ».
Ces objectifs démontrent que l’éducation en vue d’un développement durable doit être mise en
pratique dans le but de sensibiliser toute la société, et ce dès son plus jeune âge.
2.1.2 L’éducation en vue d’un développement durable à l’école
L’éducation en vue d’un développement durable n’est pas une discipline en tant que telle, nous
la définissons plutôt comme une approche qui peut être appliquée à toutes les disciplines dites
plus « scolaires », mais aussi aux disciplines artistiques par exemple. Il s’agit de mettre cette
approche en lien avec différentes disciplines, et donc de travailler sur la pluridisciplinarité en
se posant des questions sur l’avenir. Le travail peut par exemple se faire au niveau géographique
en travaillant la répartition des ressources dans le monde, travailler au niveau de la science sur
un phénomène naturel, travailler l’économie en mettant en avant les disparités, etc. Cette
éducation au développement durable met finalement en lien une grande partie de ces
disciplines.
Afin de travailler l’éducation au développement durable, il s’agit de partir sur des méthodes
analytiques et participatives quant aux objectifs du développement durable tout en passant aussi
par la créativité, le but étant d’acquérir des compétences nécessaires pour tendre vers un
3
CONFEDERATION SUISSE. (2020). Objectif 4: Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. Accès :
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-
entwicklung/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-und-hochwertige-bildung.html
11développement durable. Cette éducation accompagne chaque personne à réfléchir à sa place
dans le monde et sur ce qu’il faut faire pour viser un développement durable sur le court, mais
aussi sur le long terme.
Inscrite dans la Constitution suisse, l’éducation en vue du développement durable à l’école
publique est présente dans les programmes scolaires. Qu’il s’agisse du Plan d’études romand
(PER), du plan d’étude alémanique (« Lehrplan 21” ») ainsi que du plan d’étude du Tessin
(piano di studio), l’éducation au développement durable y figure et est prise en compte.
2.1.3 Plan d’études romand
Si nous nous intéressons plus particulièrement au Plan d’études romand, l’éducation au
développement durable se retrouve principalement dans la partie « commentaires généraux
pour la formation générale » et plus particulièrement au sein de la partie nommée
« interdépendances » qui propose de travailler ce sujet à travers différents thèmes en y faisant
un lien avec l’aspect économique et social, tout cela à travers le temps et le spatial comme
mentionné précédemment. L’éducation au développement durable n’est donc pas considérée en
tant que discipline dans le Plan d’études romand, la formation générale étant mise en pratique
avec les disciplines et non pas indépendamment.
Éducation21 a mis en avant différentes compétences et principes à travailler lors de l’éducation
en vue du développement durable.
122.1.4 Les compétences
Éducation214 propose dix compétences à développer en vue d’un développement durable, telles
que des compétences personnelles, disciplinaires, méthodologiques et sociales.
Figure 3 : Compétences de l'EDD
Le schéma ci-dessus représente les dix compétences de l’éducation au développement durable
proposées par Éducation21. Elles sont classées en trois catégories : les compétences
personnelles qui consistent à agir de manière autonome, les compétences sociales qui consistent
à interagir dans des groupes hétérogènes et finalement les compétences disciplinaires et
méthodologiques qui consistent à se servir d’outils de manière interactive.
Parmi les compétences personnelles, il y a la responsabilité qui consiste à développer un sens
d’appartenance au monde ; les valeurs qui consistent à faire le point sur ses propres valeurs
mais aussi celles d’autrui ; et finalement aussi l’action qui regroupe le fait d’être conscient de
ce que l’on fait et d’utiliser des marges de manœuvres.
Pour ce qui est des compétences sociales, il y a les perspectives, dans une idée de changement
de perspectives ; l’idée de collaboration ; et aussi de participation à des processus collectifs.
Finalement, il y a encore les compétences dites disciplinaires et méthodologiques. Celles-ci
regroupent le rapport aux savoirs qui consiste en la « construction des savoirs interdisciplinaires
4
EDUCATION21. (2013). Compétences EDD. Accès : https://www.education21.ch/fr/competences-edd.
13prenant en compte différentes perspectives » ; le fait de penser en systèmes ; l’anticipation sur
les actions ; et finalement la pensée créatrice qui consiste à « penser de manière critique et
constructive ».
Pour notre travail de Bachelor, nous avons décidé de principalement nous axer sur les
compétences de la pensée créatrice, la responsabilité, et l’idée de collaboration et de
participation.
2.1.5 Les principes
Éducation215 propose aussi sept principes pédagogiques spécifiques à appliquer pour la
conception et l’organisation des processus d’enseignement et d’apprentissage en vue d’un
développement durable.
Figure 4: Principes pédagogiques de l’EDD
Le schéma ci-dessus représente visuellement les sept principes pédagogiques.
L’orientation selon les visions : mettre en avant la pensée créative dans le but de construire et
appliquer une représentation de l’avenir.
La pensée en systèmes : les thèmes sont abordés sur le plan interdisciplinaire en faisant des
liens parmi les disciplines.
La participation et l’empowerment : tous les acteurs présents, tels que les élèves et les
enseignants sont impliqués dans les décisions.
L’équité des chances : tout le monde a les mêmes chances de s’impliquer et de participer.
L’approche à long terme : le but étant de travailler le processus dans la durée.
5
EDUCATION21. (2013). Principes EDD. Accès : https://www.education21.ch/fr/principes-edd.
14La réflexion sur les valeurs et l’orientation vers l’action : mener une réflexion sur les façons de
penser et les valeurs au niveau individuel et collectif.
L’apprentissage par exploration : travailler par la recherche et l’exploration en utilisant les
savoirs des élèves en formulant et vérifiant les différentes hypothèses de réponses à une
question de recherche.
Dans notre projet sur l’eau, nous avons décidé de nous axer principalement sur les principes
pédagogiques de l’apprentissage par exploration, l’orientation selon les visions, et
particulièrement sur la pensée en systèmes.
2.2 La pensée complexe
La complexité est le fait que les système étudiés sont complexes, car ils ont de nombreuses
composantes et que l’on arrive pas toujours à les modéliser. Il y a une limite par rapport à la
complexité du réel, nous schématisons pour penser et réfléchir, mais nous n’avons pas accès à
tous les éléments d’un système.
Développer la pensée complexe consiste à, par le biais d’activités éducatives, valoriser et mettre
en avant le développement de multiples capacités utiles à la compréhension et à la mise en
pratique de nombreuses thématiques. Le but étant de permettre aux enfants mais aussi aux
adultes de se construire une conscience plus enrichie, ouverte et surtout complexe. La pensée
complexe nous propose donc de mettre en lien les contradictions et de mettre en avant leur
interdépendance. C’est dans ce sens-là que nous pouvons travailler l’interdisciplinarité dans le
milieu de l’éducation afin d’entraîner et mettre en avant la pensée complexe de chaque individu.
La complexité valorise donc l’éducation au développement durable.
Ayant toutes les deux choisi de travailler avec des élèves du cycle 1, c’est naturellement que
nous nous sommes tournées vers les enfants âgés de 4 à 8 ans pour nos recherches. Cette
problématique de la pensée complexe avec les élèves a très souvent été abordée avec des enfants
plus âgés, en scolarité au cycle 2. De nombreux écrits et recherches existent sur ce thème, mais
nous avons pu faire le constat qu’ils touchaient très peu les élèves du premier cycle. C’est
pourquoi, dans notre travail de Bachelor en enseignement primaire, nous avons tenté d’ouvrir
cette pensée complexe et l’utilisation de l’interdisciplinarité aux élèves en début de scolarité.
Avec les élèves du cycle 1, nous travaillons donc des étapes préliminaires de la complexité, qui
permettent de construire les bases qui les conduiront plus tard vers une pensée complexe. Parmi
15ces bases, il y a la compréhension des interactions (cause-effet), qu’il peut y avoir plusieurs
causes pour un effet, que l’on peut mesurer les effets, les observer et les analyser.
Habituellement, dans les classes de 1 à 4H, l’interdisciplinarité est effectuée par les
enseignant.e.s de manière spontanée à partir d’un thème. Par exemple, en fonction de la saison.
Si nous sommes en automne, nous traiterons des aspects de cette dernière lors d’un bricolage
en AC&M, d’une chanson en musique et d’une dictée à thème en français.
Nous compterons avec des marrons en mathématiques, et découvrirons les caractéristiques de
la châtaigne en sciences. En effet, pour que l’interdisciplinarité porte son nom, cela doit toucher
au moins deux disciplines et posséder un fil conducteur commun. Comme écrit dans l’article
de Yves Lenoir (2015) : « la réflexion sur l'interdisciplinarité n'a de sens que dans un contexte
disciplinaire et qu'elle présuppose l'existence d'au moins deux disciplines de référence et la
présence d'une action réciproque »6.
Voici comment nous l’avons exploitée sur le thème de l’eau avec nos élèves de 1P, 2P et 3P à
travers différentes disciplines.
2.2.1 Sciences naturelles
Le thème des sciences, ou encore appelé par certain.e.s connaissance de l’environnement, est
la discipline centrale de notre travail. Tous les projets que nous avons réalisés en
interdisciplinaire tournent autour du thème de l’eau et de son cycle, qui sont à la base des thèmes
généralement abordés sur les périodes d’enseignement des sciences. Ainsi, les sciences ont été
le fil rouge de notre travail. Toutes nos activités touchent plusieurs disciplines, mais elles ont
toujours en commun de toucher la discipline des sciences (voir tableau résumé des activités en
annexes).
2.2.2 Activités créatrices et manuelles
Nous avons créé un objet principal avec tous les élèves ; une roue du cycle de l’eau. Nous avons
pris une assiette en carton, sur laquelle nous avons collé un schéma rond illustrant les étapes du
cycle. Pour bien en comprendre le sens, nous avons ajouté une épingle parisienne et une flèche
en papier, afin de faire tourner la flèche dans le sens du cycle de l’eau.
6
Lenoir, Y. (2015). Quelle interdisciplinarité à l’école ?. Cahiers pédagogiques. Canada : Faculté d’éducation de
l’Université de Sherbrooke.
16Avec les élèves de 1-2P, nous avons réalisé un poisson en 3D. Pour la fabrication, nous avons
utilisé divers matériaux tels que des pailles, du papier et de la ficelle. Nous avons, par ce
bricolage, représenté différentes parties du corps d’un poisson.
Avec les élèves de 3P, nous avons fabriqué un pluviomètre. Pour ce faire, nous avons découpé
en deux une bouteille en PET, gardant uniquement le bas. Les élèves ont pu la décorer.
Ils ont également dû découper et décorer la règle qui servira à mesurer l’eau de pluie tombée
dans le pluviomètre. Les détails sur ces productions manuelles se trouvent dans la partie
pratique de notre mémoire.
2.2.3 Arts visuels
La pratique du dessin est très utile afin d’aborder un thème en particulier. Nous en avons fait
usage pour vérifier la compréhension et les observations des élèves, principalement lors de
diverses expériences réalisées. Les élèves ont aussi utilisé le dessin pour illustrer leurs
conceptions initiales et connaissances préalables quant aux diverses facettes du thème de l’eau.
Nous sommes aussi passées par les arts visuels pour illustrer les différentes parties du cycle de
l’eau.
2.2.4 Français
Le vocabulaire touchant aux aspects du cycle de l’eau est complexe. En effet, il y a plusieurs
choses sur lesquelles il faut être précis et qui doivent être explicitées aux jeunes enfants.
L’évaporation et la condensation par exemple, sont la plupart du temps des mots inconnus pour
eux. Il s’agit alors d’en donner la définition mais aussi de les illustrer et de donner du sens à
ces mots spécifiques à ce thème.
2.2.5 Capacités transversales
Tout au long de notre séquence, nous avons travaillé autour des cinq capacités transversales
proposées dans le Plan d’études romand, telles que la collaboration, la communication, les
stratégies d’apprentissage, la pensée créatrice et la démarche réflexive.
Nous avons travaillé la collaboration en faisant des expériences en groupes ainsi que lors de la
réalisation de la pochette du cycle de l’eau, où le but était de la réaliser à plusieurs.
La communication a été travaillée tout le long, qu’il s’agisse d’exprimer son savoir, de travailler
en groupe, etc.
Les stratégies d’apprentissage ont surtout été pratiquées en 3P, mais aussi explorées en 1-2P.
17La pensée créatrice a été travaillée à partir d’activités d’arts visuels et de travaux manuels.
Finalement, la démarche réflexive a été pratiquée, chaque enfant pouvait à tout moment
exprimer son opinion et a parfois dû se remettre en question, se décentrer.
2.3 Le cycle de l’eau
Le cycle de l’eau décrit les mouvements de l’eau sur Terre. L’eau circule sans arrêt, mais sous
différentes formes : nuages, pluies, lac, mer, rivières, neige, glace … Les formes que l’eau
adopte au fil des jours et des saisons sont nombreuses. Les océans couvrent plus de 70% de la
Terre, l’eau salée représentant 97,2% se trouvant sur notre planète. Seulement 2,8% est de l’eau
douce, et c’est cette dernière qui est la plus facilement utilisable pour nos besoins. Depuis
plusieurs milliards d'années, l’eau opère un circuit fermé et toute vie sur Terre en dépend. Ce
circuit se décompose en plusieurs étapes, que nous allons détailler.
Figure 5 : Cycle de l'eau
2.3.1 Les étapes du cycle de l’eau
L’évaporation marque le début du circuit. Grâce à la chaleur (ou l’énergie solaire) dégagée par
le soleil, l’eau des océans, mers, et lacs s’évapore sous forme de vapeur dans l’atmosphère. Une
partie de l’eau qui s’évapore provient également de la transpiration de la végétation et des
animaux. Cette vapeur d’eau viendra ensuite s’accumuler dans les nuages, tel que nous pouvons
les voir dans le ciel. C’est le processus par lequel l’eau liquide change d’état et se transforme
en gaz ou en vapeur.
18L’atmosphère se retrouve donc pleine d’eau. C’est une sorte d'autoroute qui fait circuler l’eau
autour du globe terrestre. Le ciel contient constamment de l’eau, et sa forme la plus visible est
celle des nuages que nous pouvons apercevoir à l'œil nu. Cependant, même un ciel
complètement dégagé contient de l’eau ! Les particules formant la vapeur d’eau sont si petites,
que si elles sont trop espacées, nous ne pouvons plus les percevoir.
La condensation est l’étape où la vapeur d’eau se refroidit au contact de l’atmosphère, pour
devenir des gouttelettes. C’est l’étape du processus où la vapeur d’eau change à nouveau d’état
et redevient liquide. La condensation est responsable du brouillard ou de la brume que l’on peut
apercevoir.
Lorsque les gouttelettes d’eau grossissent et s’accumulent dans les nuages, l’eau retombe sur la
terre sous forme de précipitations. C’est à cause des changements climatiques variant la
température, que les nuages s'alourdissent et que la vapeur d’eau retombe sur le sol sous forme
d’eau pluviale, de grêle ou de neige. L’eau va alors soit s’infiltrer dans le sol jusqu’aux nappes
phréatiques, soit ruisseler sur le sol sous forme de rivières pour finalement atteindre à nouveau
les océans, mers et lacs.
L’eau se transforme donc plusieurs fois lors de son voyage, et passe par plusieurs états. Grâce
à son cycle, l’eau circule et cela lui permet de se renouveler sur Terre.
2.3.2 Le rôle du climat et de la météo en lien avec le cycle de l’eau
2.3.2.1 Le rôle du climat sur le cycle de l’eau
Le climat est aujourd’hui un sujet plus que d’actualité, et l’eau est totalement impliquée dans
tout ce qui tourne autour du système climatique. La relation entre l’eau et le climat est étroite,
et réciproque. En effet, comme vu durant les étapes de son cycle, l’eau est mobile, ce qui lui
permet de naviguer entre les couches terrestres et l’atmosphère. Sa mobilité est engagée grâce
à ses nombreux changements d’état : le solide ou liquide devient gazeux grâce à l’énergie
dégagée par les rayons du soleil.
Si on prend ce cycle sur une échelle régionale, on peut observer le cycle local de l’eau. Le
mécanisme est identique mais le cycle concerne une zone géographique réduite : l’eau qui
s’évapore va retomber localement sous forme de pluie, s'infiltre dans le sol, dans les nappes
phréatiques, et alimente les végétaux présents localement avant de s’évaporer à nouveau. L’eau
contenue dans l’atmosphère et dans les sols de cette zone joue un rôle sur la régulation de la
19température locale. En conclusion, le cycle local de l’eau influence le climat local. Ainsi,
lorsqu’on traite de cela à plus large échelle, on constate que le cycle de l’eau perturbe le système
climatique, de même que les changements climatiques peuvent perturber le cycle de l’eau. Le
maintien de ces deux systèmes, à l’échelle locale aussi bien qu’à l’échelle terrestre, est donc
primordial.
Si on se penche sur les effets du réchauffement climatique à l’échelle mondiale et en lien avec
l’eau, un aspect ressort : celui du manque d’eau et de la sécheresse. Une sécheresse est définie
par le manque de ressource en eau. En effet, dans certaines régions du globe, l’eau est une
denrée qui se fait de plus en plus rare. Ce manque d’eau se développe avec la diminution, voire
la disparition des précipitations sur une période donnée. Les précipitations sont issues de
l’évaporation de l’eau des sols et des océans, et si l’eau ne retombe pas sur terre pour s’évaporer
à nouveau, le cycle de l’eau ne peut pas se faire selon les étapes habituelles. Les précipitations
ne se font donc plus et le cycle est momentanément interrompu. Cela entraîne une sécheresse
agricole, car le manque d’eau dans les sols ne nourrit pas les végétaux, puis une sécheresse
socio-économique lorsque la quantité d’eau disponible ne peut plus répondre aux besoins de la
population.
À l’inverse, le réchauffement climatique peut amener à un surplus d’eau dans certaines régions,
on parle alors d’inondation. Plus la température est haute, plus la capacité de l’air à contenir de
l’eau augmente. Le changement climatique provoque alors une accélération du cycle de l’eau.
Aujourd’hui, il est difficile de prévoir à quelle vitesse ce cycle sera accéléré et quelles régions
vont être impactées par cet effet. Ces précipitations qui s’intensifient, augmentent le niveau des
mers et océans. L’évaporation se fait moins rapidement que la quantité d’eau qui est précipitée.
Figure 6 : Impact du changement climatique
202.3.2.2 Le rôle de la météo sur le cycle de l’eau
La météo, raccourci du terme météorologie, a pour but de prévoir dans la mesure du possible
les changements de temps qui vont survenir. Cette science se fonde sur l’observation des
conditions atmosphériques : la pression, la température, le vent …
La météo est donc à la base du rythme qu'adopte le cycle de l’eau. Lorsque le soleil est plus
chaud, il dégage davantage d’énergie et l’évaporation sera plus intense. Les précipitations
pourront alors se faire seulement si la température de l’atmosphère se refroidit. Toutes ces
conditions sont nécessaires au bon déroulement du cycle de l’eau, et dépendent donc de ces
critères.
Tous les deux ont un lien très étroit avec le cycle de l’eau, car tout ce qui touche au climat de
notre planète impactera les étapes de ce dernier. Les changements que notre planète a subi au
cours des dernières années se font ressentir, et on l’observe au travers des phénomènes cités
précédemment. Avec nos élèves du cycle 1, nous avons choisi d’aborder principalement le cycle
de l’eau et son fonctionnement, ainsi que les raisons pour lesquelles il se produit. Avec les 3P,
nous avons choisi de poursuivre le sujet en touchant la météo et le climat qui sont des sujets,
selon nous, plus complexes.
213. Partie pratique : description et analyse des activités menées en
classe
Sur la durée d’un semestre, nous avons pu mettre en œuvre dans nos classes de stage respectives
diverses activités sur le thème de l’eau. Nous avons réalisé ces activités dans une classe de 1-
2P ainsi que dans une classe de 3P.
3.1 Découverte du poisson et de son milieu
3.1.3 Mascotte de la classe et livre « Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans »
Objectifs PER :
L1 13-14 - Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire… utiliser un
vocabulaire approprié au sujet et au contexte.
MSN 16 - Explorer des phénomènes naturels …
Classe : 1-2P
Pour commencer la découverte du poisson et de l’eau dans la classe de 1-2P, nous nous sommes
basés sur la mascotte de la classe « Melon » qui est un poisson en forme de ballon et sur
l’histoire de Marcus Pfister nommée « Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans ». Cette
histoire ainsi que la mascotte de la classe nous ont permis de découvrir les caractéristiques du
poisson ainsi que le milieu dans lequel il vit, et ce qui se trouve autour.
Figure 7 : Couverture du livre "Arc-en-ciel le plus Figure 8 : Mascotte de la classe "Melon"
beau poisson des océans"
223.1.4 Aquarium
Objectifs PER :
L1 13-14 - Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire…
- Utilise un vocabulaire approprié au sujet et au contexte.
MSN 16 - Explorer des phénomènes naturels …
Classe : 1-2P
Par la suite, les élèves de la classe 1-2P ont aussi eu l’occasion de préparer l’aquarium du futur
poisson de la classe. Pour cela, ils ont mis les différents éléments nécessaires dans l’aquarium,
notamment de l’eau et du sable au fond. Les élèves ont pu découvrir ces deux éléments
principaux dans l’histoire « Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans » citée au-dessus. Ils
y ont aussi ajouté quelques décorations d’aquarium. Il a ensuite fallu laisser reposer environ
deux semaines l’aquarium afin que l’eau puisse développer des bactéries saines. Les élèves ont
fait toute cette préparation pour finalement accueillir notre poisson de classe qu’ils ont décidé
de nommer « Tom ». Une fois le poisson dans l’eau, les élèves ont pu découvrir comment le
poisson respire sous l’eau. Nous avons donc pu travailler sur la notion de bulle, ce qui se passe
avec l’air dans l’eau. Chaque jour, un élève est chargé de donner à manger au poisson. Cette
activité a été réalisée sur deux moments séparés de deux semaines environ.
Les élèves ont beaucoup apprécié cette activité et sont régulièrement allés observer Tom. Ils
ont été très attentifs au bien-être de leur poisson. Les enfants se sont posés de nombreuses
questions sur comment le poisson respire sous l’eau, ce qui nous a permis de mener une
discussion en rassemblant tous les savoirs connus des élèves.
Figure 9 : Aquarium de la classe et poisson "Tom"
23Vous pouvez aussi lire