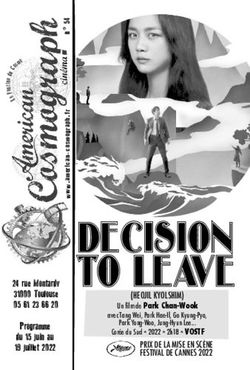Mehdi Achouche Université Stendhal Grenoble III - Université Le ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
SILENT RUNNING ET DARK STAR : SCIENCE-FICTION, CONTRE-CULTURE
ET LE « NEW HOLLYWOOD »
Mehdi Achouche
Université Stendhal Grenoble III
Lorsque l’on songe à l’impact et à la représentation de la contre-culture à Hollywood, on
songe immédiatement à Easy Rider (1969), sans doute le film emblématique du mouvement, où
la figure du biker semble à la fois satiriser et régénérer celle du cow-boy sur sa monture, road
trip d’un nouveau genre réconciliant dans une certaine mesure les valeurs beatniks et hippies.
Néanmoins au-delà du cycle biker de la deuxième partie des années soixante, la science-fiction
(SF) est sans doute le genre hollywoodien le plus empreint des valeurs et du regard typiques de la
contre-culture. Pourtant la science-fiction est aussi historiquement un des genres les plus
fortement ancrés dans l’imaginaire et même dans l’identité américaine, au même titre que le
Western. La science-fiction tend de même à mettre en scène des tropes et des valeurs qui n’ont a
priori que peu à voir avec celles de la contre-culture. Le détournement satirique et dystopique du
genre dans les années soixante-dix rend donc l’évolution de celui-ci particulièrement
emblématique de l’impact de la contre-culture sur Hollywood et sur la culture « populaire »
américaine en général.
Le New Hollywood
Avant même 1969, Hollywood commence à se faire l’écho, sinon de la mentalité hippie ou
de la contre-culture, du moins du vent de renouveau et de révolte qui agite alors la société
américaine. C’est le cas dès 1967 avec The Graduate et Bonnie and Clyde qui, chacun à leur
manière bousculent les traditions esthétiques, thématiques et éthiques du Hollywood de
l’ancienne génération. Comme le montre la couverture de Time Magazine qui date de décembre
1967, on commence alors à parler d’un « New Hollywood, » terme aujourd’hui majoritairement
adopté par les spécialistes pour désigner ce « nouveau » cinéma qui, de 1967 à 1977,1 adopte et
adapte le style exubérant et subversif qui est celui de la contre-culture à l’écran comme à la ville.
Tout se doit d’être nouveau pour les rebelles et critiques de l’époque, en culture comme en
politique, du « Nouveau Roman » à la « Nouvelle Gauche » en passant par la « Nouvelle
Histoire, » le « Nouveau Cinéma » et la « Nouvelle Vague. » Comme le signale encore la
couverture de Time, de façon quelque peu caricaturale, la mise en scène narrative et esthétique
par ces films d’une violence et d’une sexualité débridées autrefois tabous ou simplement
connotées compte parmi les aspects les plus frappants d’un cinéma profondément influencé par
les nouvelles cinématographies européennes, le néoréalisme italien ou la Nouvelle Vague
française notamment (Truffaut et Godard se voient d’ailleurs proposer Bonnie and Clyde, tandis
1
Les dates ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des critiques. Si 1977 tend à faire consensus comme date de
clôture de ce nouvel Hollywood, l’année 1968 (année durant laquelle Bonnie and Clyde et The Graduate engrangent
la plupart de leurs bénéfices) ainsi que 1969 (Easy Rider) peuvent parfois être citées comme l’année du grand
commencement. Néanmoins 1967 est de loin l’année la plus souvent mentionnée. Peter Krämer a raison de souligner
l’ambiguïté du terme « New Hollywood, » parfois utilisé pour désigner le cinéma qui se fait depuis les années 1980 ;
nous reviendrons sur ce point en conclusion.que le A bout de souffle de Godard exerce une grande influence sur le film) (Biskind 26-27).
Souvent écrits, tournés et interprétés par de jeunes débutants, 2 ces films mettent en scène de
jeunes héros insouciants qui s’y rebellent littéralement contre les figures de l’autorité et du
système (les parents, la police, l’armée), pratiquent l’amour libre, font l’expérience de la drogue,
etc., sans qu’un film comme Bonnie and Clyde assène une morale claire et bienséante à son
intrigue.3 Ce dernier film est d’autant plus frappant qu’il reprend et subvertit un des genres
majeurs du cinéma hollywoodien, le film de gangster, dont son propre studio de production, la
Warner, est l’emblème historique, produisant la plupart des films du genre dans les années trente
(époque où se déroule précisément Bonnie and Clyde). Le nouvel Hollywood correspond à la fin
de la prédominance des studios dans l’écologie hollywoodienne, au profit surtout du metteur en
scène, que l’on commence à qualifier, sous l’influence de la critique française, d’« auteur. » Sous
cette même influence le cinéma de genre est réhabilité, les genres les plus conventionnels et les
plus commerciaux apparaissant désormais comme capables, du fait même de leurs conventions,
de véhiculer une réflexion, voire une subversion, réelle. D’où également pour de nombreux
critiques le début du Nouvel Hollywood en 1967 avec Bonnie and Clyde. Comme l’écrit Peter
Biskind dans son histoire du Nouvel Hollywood :
If the Bond films legitimized government violence, and the Leone films legitimized
vigilante violence, Bonnie and Clyde legitimized violence against the establishment, the
same violence that seethed in the hearts and minds of hundreds of thousands of frustrated
opponents of the Vietnam War. […] Bonnie and Clyde was a movement movie; like The
Graduate, young audiences recognized it was ‘theirs’ (Biskind 49).
Tous les critiques ne rejoignent pas l’analyse de Biksind, et Peter Sklar souligne l’absence
remarquée dans les films de l’époque de la guerre du Vietnam, des luttes afro-américaines et
féministes ou encore de l’émergence des sous-cultures gay et lesbiennes : « Film subjects and
forms are likely–more likely–to be determined by the institutional and cultural dynamics of
motion picture production than by the most frenetic of social upheavals » (Sklar 322). En réalité
ces films, comme Bonnie and Clyde le montre déjà, reflètent bien leur époque mais de façon
certes moins explicite que ne le voudrait Sklar, et les films de genre, malgré leurs conventions et
leur rigidité apparente, illustrent particulièrement le rapport qui se tisse entre le contexte social et
le cinéma hollywoodien – et aucun genre plus radicalement que la science-fiction.
La nouvelle science-fiction
En termes de subversion générique, la science-fiction est, avec le Western, celle qui va
alors le plus loin. Comme le Western, la science-fiction est en effet vécue comme un genre
profondément américain, traduisant l’immortalité de la Frontière, de la Conquête et du rugged
individualism qui sont représentés depuis au moins 1893 comme reposant au cœur de
2
Il existe deux vagues de réalisateurs emblématiques du Nouvel Hollywood : les réalisateurs qui tournent les
premiers films identifiés à celui-ci, dans la deuxième moitié des années soixante, sont nés dans les années vingt ou
trente et tournent souvent depuis les années cinquante ou le début des années soixante (Robert Altman, Arthur Penn,
Stanley Kubrick, Sam Peckinpah, Woody Allen, Francis Ford Coppola, et al.) ; le début des années soixante-dix voit
l’arrivée de jeunes réalisateurs appartenant véritablement à la baby-boom generation, nés pendant ou après la
deuxième guerre mondiale (Martin Scorcese, Steven Spielberg, Brian De Palma, Paul Schrader, John Milius, Terence
Malick) (Biskind, Easy Riders, Raging Bulls, 15 ; Sklar 323).
3
Le Hays Code, censurant depuis presque quarante ans les productions hollywoodiennes, est abrogé en 1968.
Désormais les films feront l’objet d’une classification déterminant l’âge à partir duquel un film pourrait être interdit.
74l’expérience et de l’identité nationales. Si l’essence du Western traditionnel est de mettre en
image l’épopée triomphale de l’Euro-Amérique toujours plus à l’ouest, la self-reliance et la
générosité démocratique du héros euro-américain prototypique, sa supériorité face aux
sanguinaires « Indiens » et sa capacité à dominer et à dompter « la nature, » la science-fiction
américaine prolonge simplement cette représentation dans l’avenir.
Se perpétuant ad aeternam dans l’infini de l’espace, la Frontière traditionnelle se
transforme alors ironiquement à son tour en « Nouvelle Frontière, » comme le proclame Kennedy
en 1960 puis le monologue du générique de Star Trek (1966-1969), celle d’une exploration
géographique et d’une innovation technologique infinies. La notion rassure l’Amérique quant à la
pérennité de l’identité nationale, son éternel leadership technologique et sa capacité à triompher
de civilisations barbares, totalitaires et souvent cryptocommunistes. L’avenir se substitue au
passé pour une conception mythique et ironiquement statique de l’Histoire où le Progrès n’a
ironiquement plus vraiment cours et où la véritable utopie, au-delà des incroyables technologies
et merveilleuses cités futuristes classiques, est bien celle d’une Euro-Amérique triomphante
symbolisée de façon transparente par les Empires et Fédérations typiques de ces textes. Le
Progrès (et la Frontière est au final la déclinaison américaine du mythe occidental du Progrès) ne
doit in fine s’appliquer qu’à la technologie et certainement pas à l’ordre politique et social euro-
américain consensuel. Pour la SF américaine traditionnelle en définitive, « plus ça change, et plus
c’est la même chose, » le progressisme apparent du genre cachant un conservatisme apparemment
inscrit dans son ADN même.
Si elle est plus complexe qu’il n’est souvent dit, la science-fiction hollywoodienne des
années cinquante supporte dans les grandes largeurs cette vision traditionaliste. Si des exceptions
existent, la plupart des films SF de la décennie dressent le portrait d’une Euro-Amérique du
consensus que le héros (un jeune et fringant scientifique et/ou militaire) sauve de l’invasion et de
la destruction en alertant les autorités, et rencontre sa future épouse par la même occasion. La
figure de l’extraterrestre est omniprésente et symbolise l’ennemi totalitaire extérieur, qui n’a de
cesse de menacer l’ordre démocratique américain. La science et la technologie font de même
l’objet de représentations globalement positives, même si dès cette époque le malaise vis-à-vis de
la technologie nucléaire est palpable. En se focalisant sur le présent – souvent symbolisé par une
petite ville paisible de la middle America menacée par l’invasion – plutôt que sur l’avenir, la SF
hollywoodienne manifeste son peu d’intérêt pour l’ordre social futur et pour une quelconque
évolution à venir : « Earth, by which they meant the U.S.A., circa 1955, was utopian enough for
everyone » (Biskind, Seeing is Believing 115).
Or tout change dans les années soixante avec l’avènement de ce qu’on appelle la « New
Wave, » littérature SF d’origine britannique beaucoup plus sombre et critique que son
prédécesseur. Comme son homonyme francophone, la Nouvelle Vague, la New Wave cherche à
dynamiter les conventions, les règles esthétiques sclérosantes et dépassées de son aînée tout en
cherchant à défendre des valeurs politiques et idéologiques fortement ancrées à gauche. Comme
l’écrit Edward James dans son histoire de la SF :
Most of the ‘classic’ writers had begun writing before the Second World War, and were
reaching middle age by the early 1960s; the writers of the so-called New Wave were
mostly born during or after the war, and were not only reacting against the sf writers of the
past, but playing their part in the general youth revolution of the 1960s which had such
profound effects upon Western culture. It is no accident that the New Wave began in
75Britain at the time of the Beatles, and took off in the United States at the time of the
hippies […] (James 167).
Au-delà des collages, de son ‘psychédélisme’ formel, de son insistance axiomatique à explorer le
« inner space » de ses personnages plutôt que l’espace extérieur traditionnel (James 170) et de ses
autres expérimentations formelles, la New Wave imagine typiquement un gouvernement futur qui
a tourné au fascisme et un monde décadent en lente autodestruction ; elle met en scène les
dangers de la pollution industrielle et de guerres impérialistes inspirées du Vietnam (mais
transposées sur d’autres planètes), l’omnipotence des multinationales et des médias qui leur sont
dévoués, la destruction de l’environnement, l’oppression des minorités sexuelles, raciales et
ethniques, l’hyper-violence qui gangrène des mégapoles aliénantes, l’obsession malsaine des
individus pour la technologie, etc., adoptant « a more realistically pessimistic attitude to human
nature and the ability of technology to improve the human condition » (James 175).
Le genre dystopique (l’inverse presque exact de l’utopie) se révèle particulièrement efficace
dans la stigmatisation et la dénonciation de ces différents maux, et traduit la défiance de l’époque
vis-à-vis du méta-récit de la modernité, qui est aussi celui de la SF – ce que l’on en vient de plus
en plus à qualifier de « mythe du progrès, » dont chacun de ces maux est comme une des facettes
soudainement dévoilée. Le progrès technologique n’est plus automatiquement associé au progrès
social mais peut désormais au contraire être associé au conservatisme, à la continuité de
l’oppression du pouvoir bourgeois, blanc et/ou patriarcal. Deux des réalisateurs les plus
étroitement identifiés à la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard et François Truffaut, réalisent
d’ailleurs leurs propres dystopies SF : le premier signe Alphaville en 1965 (où une intelligence
artificielle oppresse la cité à force de rationalité inhumaine) ; le second met en scène l’année
suivante Fahrenheit 451, adaptation du roman dystopique de l’auteur américain Ray Bradbury
(1953). La SF et le cinéma semblent ainsi dès le départ les véhicules idéaux à la critique sociale
de la nouvelle génération, leur rencontre paraît donc logique.
La contre-culture européenne et américaine critique systématiquement le « complexe
militaro-industriel » et plus largement la « technoscience, » terme éminemment péjoratif qui
apparaît dans les années soixante-dix et qui dénonce le détournement du projet scientifique à des
fins bassement militaires et mercantiles. Comme l’écrit l’inventeur du terme, le philosophe belge
Gilbert Hottois, le terme est vite devenu « une sorte de symbole du mal absolu, concentrant tous
les fléaux de l’époque : technicisme et technocratie, capitalisme multinational, néo-libéralisme
économique, pollution, épuisement des ressources naturelles, effet de serre, impérialisme
américain, globalisation, injustice mondiale, disparition des valeurs humanistes, etc. » (Goffi 23-
24).
Les années soixante et soixante-dix ne s’attaquent certes pas exclusivement à la science et à la
technologie, mais celles-ci sont néanmoins critiquées avec une violence particulière en tant que
fondations du modèle de développement occidental et du « complexe militaro-industriel »
américain alors en guerre en Indochine. Le conflit vietnamien rappelle par ailleurs à de nombreux
Américains, « libéraux » ou conservateurs, les guerres amérindiennes du XIXe siècle, semblant
reproduire le schéma d’une Euro-Amérique avide de prouver sa supériorité technologique et
civilisationnelle sur les sauvages qu’elle rencontre. Comme l’écrit l’historienne Frances
Fitzgerald dans sa célèbre histoire de la Guerre du Vietnam, Fire in the Lake: “The national myth
is that of creativity and progress, of a steady climb upward into power and prosperity, both for the
76individual and for the country as a whole. Americans see history as a straight line and themselves
standing at the cutting edge of it as representatives for all mankind. They believe in the future as
if it were a religion […]” (Fitzgerald 9).
La prééminence du progrès technologique au sein de l’imaginaire américain, son importance
meurtrière au Vietnam et sa place centrale dans le capitalisme consumériste tant critiqué en font
donc une cible de choix pour la contre-culture. La science et la technologie tendent alors à perdre
l’aura et le prestige qui étaient les leurs depuis les Lumières, et ici la dénonciation véhiculée par
la contre-culture n’a rien de spécifiquement américain mais s’étend au contraire à toutes les
sociétés occidentales.
C’est ce que critiquent Jürgen Habermas et l’Ecole de Francfort lorsqu’ils dénoncent
« l’institutionnalisation du progrès scientifique et technique » : la science et la raison « désormais
[…] ne vont plus dans le sens d’une démystification (Aufklärung) politique, servant de fondement
à une critique des légitimations en vigueur, mais deviennent elles-mêmes des principes de
légitimation » (Habermas 4, 8). La « dialectique des Lumières » que décrivent Horkheimer et
Adorno conduit ainsi à la corruption historique du projet moderne ; comme l’écrit Herbert
Marcuse : « La puissance libératrice de la technologie – l’instrumentalisation des choses – se
convertit en obstacle à la libération, elle tourne à l’instrumentalisation de l’homme » (Habermas
1).
Il est donc logique de voir un genre étroitement associé aux valeurs traditionnelles de la
science, du Progrès et de l’identité américaine, être détourné et réinvesti de sens pour une SF que
d’aucuns qualifieront d’ « anti-SF » tant elle leur apparaît antinomique de la SF traditionnelle. 4
Rien d’étonnant non plus à voir se multiplier dans les années soixante-dix les Westerns dits
« révisionnistes » mais aussi une SF désormais sombre, critique et dystopique, en quelque sorte
révisionniste à son tour – les deux genres peuvent devenir de puissants instruments de la
subversion. La science-fiction adopte désormais typiquement le schéma de l’anticipation (ou
extrapolation), se situant dans un avenir proche (plutôt que le lointain futur traditionnel) et
abandonnant l’espace sidéral et la figure de l’extraterrestre pour se recentrer sur la Terre et sur le
devenir d’une société humaine minée par l’hyper-capitalisme.
Le genre ne renie pourtant pas non plus l’utopisme, en particulier dans sa déclinaison
américaine : la science-fiction féministe des années soixante et soixante-dix (dont Ursula K. Le
Guin est peut-être l’auteur le plus célèbre) s’évertue à proposer dans ses pages des modes de vie
alternatifs et pastoralistes fortement empreints des idéaux et des valeurs de la contre-culture
(retour à la terre et abandon relatif de la technologie, mode de vie collectiviste, libération
sexuelle, rites religieux néo-païens, fascination pour les civilisations et pour les spiritualités
amérindiennes et asiatiques, etc.). Ces textes manifestent ainsi « une haine particulière pour la
technologie vue comme la raison d’être de la machine militaire américaine » (Spalding-
Andréolle, 73). L’heroic fantasy et ses mondes crypto médiévaux où la magie remplace la science
et la forêt la mégapole, rencontre donc également un succès logique à partir des années soixante,
comme en témoigne l’immense succès sur les campus américains de l’édition de poche du Lord
of the Rings de Tolkien, qui devient « la bible de la contre-culture » (James 180).
Deux des plus célèbres romans issus des années soixante sont ainsi les romans SF Stranger
in a Strange Land de Robert Heilein (1961) et Dune de Frank Herbert (1965) qui, à leur tour,
rencontrent un très grand succès auprès des étudiants américains. Ces textes proposent la venue
4
Raymond Williams, “Science Fiction,” Science Fiction Studies 46 15:3 (1988).
77d’un Messie libérateur et le réveil d’une certaine spiritualité, permettant seule à l’humanité de
s’arracher des griffes de l’establishment, du consumérisme qui affecte la Terre (Stranger) ou de
l’oppression des impérialistes du futur (Dune). Ce dernier roman propose un univers d’où ont été
bannis les ordinateurs et les Intelligences Artificielles (IAs), remplacés par des « Mentats, » des
humains aux exceptionnels pouvoirs cognitifs et parapsychiques ; tandis que l’ « épice, » la
principale matière première du futur, permet à ses consommateurs d’atteindre un niveau de
conscience supérieur. Stranger voit quant à lui son héros instaurer sur Terre une Eglise néo-
païenne au sein de laquelle se pratique l’amour libre et qui promet de transformer la Terre en une
Utopie du futur.5 Le héros, Candide moderne en provenance d’Utopia, offre au lecteur américain
un regard neuf sur sa propre société et semble proposer des solutions analogues à celle de la
contre-culture.
L’avènement de la fantasy et de la SF répond enfin à un autre phénomène structurel de
l’époque, la légitimation croissante de la culture populaire, vécue comme plus authentique,
impertinente et subversive que la grande ou la haute culture élitiste qui avait seule droit de cité
jusqu’alors. A la fois ultra commerciaux et idéologiques, le Western comme la SF se prêtent
parfaitement au détournement et à la subversion tout en participant d’une libération de la parole
et de l’imaginaire où ludique et politique font bon ménage. Le phénomène est particulièrement
frappant dans le tournant que prend la science-fiction hollywoodienne à la fin des années
soixante. Si le nouvel Hollywood naît en 1967, la renaissance de la science-fiction
hollywoodienne voit quant à elle le jour en 1968, l’année où Roszack crée le terme de « contre-
culture. » Cette année-là sortent en effet au cinéma les deux premières expressions de la
« nouvelle » SF hollywoodienne. Tout d’abord 2001: A Space Odyssey de l’Anglais Stanley
Kubrick, le premier film à prouver véritablement que la science-fiction peut appartenir à autre
chose au cinéma qu’à la série B. Le film suggère sans l’expliciter une vision radicalement autre
de l’histoire américaine et de la technologie et propose une spiritualité extraterrestre qui résonne
chez les spectateurs de l’époque. De nombreux hippies sont d’ailleurs fascinés par le fameux
« space trip » du film (la « star gate sequence » qui voit dans le dernier acte l’astronaute
Bowman envoyé aux confins de l’univers). La machine (l’intelligence artificielle HAL) se
retourne pour la première fois contre le héros américain, tandis qu’un troublant parallèle entre
technologie, progrès, intelligence et violence meurtrière est établi dès la première séquence du
film et le célèbre match cut voyant le premier outil préhistorique – qui est aussi une arme
meurtrière – se transformer en une station spatiale futuriste, résumé frappant de l’histoire
humaine. L’avenir de celle-ci, contenue dans la nouvelle forme de vie « post humaine » du « star
child » final, est donc pour le moins ambivalent.
Le deuxième film à sortir en 1968, Planet of the Apes, propose quant à lui une vision post-
apocalyptique bientôt omniprésente dans le cinéma SF des années soixante-dix et qui dénonce
l’arme nucléaire et le militarisme de l’époque. La célèbre fin du film, où l’astronaute interprété
par Charleston Heston découvre la Statue de la Liberté à demi enfouie sur une plage et comprend
que la prétendue exoplanète sur laquelle il se trouvait est en réalité une Terre post-apocalyptique,
contient une ironie particulière eu égard aux conventions et à l’histoire de la SF : prétendant
appartenir au sous-genre classique du planet opera (une histoire située sur une planète
particulière que l’on explore en long et en large), où un héros rencontre traditionnellement une
civilisation moins évoluée et/ou moins « éclairée, » le film se transforme finalement en conte
5
L’Eglise en question, la Church of All Worlds, est d’ailleurs créée dans le sillage de la publication du roman et
existe encore à ce jour (http://www.caw.org/, dernier accès le 15/01/2012).
78post-apocalyptique, typique de la nouvelle époque, où ce sont bien les humains qui apparaissent
au final comme non éclairés et brutaux. Le film, qui satirise dans le même temps les relations
« raciales » via des singes et des gorilles qui se substituent ironiquement aux Afro-Américains,
opère ainsi une transition parfaite entre les deux époques et inaugure la renaissance de la science-
fiction hollywoodienne. Comme dans Stranger et dans Dune, le film utilise son monde
secondaire pour offrir une vision originale, spéculaire et critique, de la société américaine
présente.
L’anticipation dystopique se fait bientôt omniprésente, ne cessant de dépeindre l’avenir
cauchemardesque de l’Amérique « si les choses continuent de la même façon. » La surpopulation
urbaine ravage ainsi l’Amérique de 2022 dans Soylent Green (1973) ; la pollution a détruit
l’écosystème terrestre dans Silent Running (1972) ; la société est devenue une dictature urbaine
techno-fasciste dans THX-1138 (1971) et dans Logan’s Run (1976) ; tandis que la technologie,
souvent sous la forme d’intelligences artificielles (Colossus, 1970 ; Demon Seed, 1977),
d’androïdes assassins (Westworld, 1973 ; The Stepford Wives, 1975 ; A Boy and His Dog, 1975),
des sociétés hyper technologiques et oppressives de THX et de Logan’s Run (dotées de leurs
propres IAs et androïdes) ou des mondes futurs ravagés par l’apocalypse nucléaire (A Boy and
His Dog ; Damnation Alley, 1977) est fermement rejetée. Tous ces films manifestent ainsi pour la
première fois dans l’histoire hollywoodienne une défiance extrême envers l’autorité (le
gouvernement, la direction d’une multinationale) et la faillite du modèle américain traditionnel –
le Progrès mène à la catastrophe, et la technologie est surtout mortifère, particulièrement la
bombe atomique, comme en témoignent les innombrables intrigues post-apocalyptiques de la
décennie.6 Là où les années cinquante localisaient systématiquement le danger comme un danger
exogène à une société américaine représentée comme parfaite, le cinéma des années soixante-dix
ne voit plus qu’un danger endogène, intrinsèque à la faillite du modèle américain, où les
technologies censées hier garantir le triomphe de la nation, en premier lieu l’arme nucléaire,
provoquent au contraire sa destruction, l’asservissement et l’objectification des citoyens.
L’utopisme inhérent à la science-fiction traditionnelle est fermement repoussé, mais pour laisser
place à une nouvelle forme d’utopie, plus proche des valeurs de la contre-culture. L’évolution est
particulièrement flagrante lorsque l’on se penche sur le cas de deux films, Dark Star et Silent
Running, qui appartiennent à l’anticipation dystopique tout en satirisant à leur tour le space opera
classique. Ces deux films diffèrent en certains points importants des autres films de la période,
pourtant ce sont paradoxalement ces différences qui en font les films les plus emblématiques de
la nouvelle science-fiction cinématographique.
Dark Star, l’étoile noire de la SF
L’arme atomique réside également au centre de Dark Star, qui sort en 1974. Le film se pose
avant tout comme un film loufoque et satirique – le film promet déjà dans son titre de passer du
côté « sombre » de l’étoile SF, à moins que cela ne soit l’étoile américaine, celle du drapeau
comme celle du shérif. Le film, le premier long-métrage de John Carpenter, satirise le schéma le
plus emblématique de la SF américaine, le space opera, c’est-à-dire les aventures intergalactiques
d’un vaisseau spatial et de son fier équipage (« Dark Star » est le nom du vaisseau). Quasiment
absent des écrans durant la période 1968-1977, le genre ne semble plus pouvoir être traité que sur
6
Quelques films post-apocalyptiques avaient déjà vu le jour dans les années cinquante : Five, 1951 ; The World, the
Flesh, the Devil, 1959 ; On the Beach, 1959 – mais leur nombre fait pâle figure face aux dizaines de films produits
dans les années soixante-dix.
79un mode satirique fortement empreint de l’imaginaire de la contre-culture. Tout comme THX-
1138, le premier film d’un certain George Lucas sorti trois ans auparavant, Dark Star consiste à
l’origine en un film d’étudiants de l’école de cinéma de la University of Southern California.
D’une durée originelle de 45 minutes et doté d’un budget de 6 000 dollars, le métrage est bientôt
étendu à 84 minutes (de nouvelles séquences sont tournées) et à un budget total de 60 000 dollars,
somme ridicule même pour l’époque (2001 fut produit six ans auparavant avec un budget
d’environ 10,5 millions de dollars). Et comme THX (que Dark Star ne manque pas de référencer
au passage), qui citait dans son prologue le serial Buck Rogers pour en moquer le futurisme
techno utopique, Dark Star s’ingénue à tourner en dérision la classique « Conquête de l’espace »
(titre d’un film triomphaliste de 1955).
Loin des héroïques astronautes d’antan et de leurs aventures excitantes, les héros sont ici
des militaires à la détente facile qui cherchent à faciliter la colonisation de l’univers, mais surtout
à tuer l’ennui en atomisant les planètes « instables » et donc « inutiles » qui croisent leur passage,
et dont la destruction ponctue l’ennui profond de leur existence (le film s’ouvre sur la dix-
neuvième destruction de ce type). Le prologue du film laisse deviner que la Terre a déjà été la
victime de la démente colonisation américaine, la base d’où est retransmise la communication qui
apparaît à l’écran étant située en Antarctique – le continent le plus sauvage a fini par être
colonisé, c’est désormais le tour de l’univers tout entier, comme le veut le schéma SF
traditionnel. Or, s’il faut en croire le contenu de la retransmission d’ouverture, l’Amérique du
futur est très loin de ressembler à Utopia et rappelle plutôt l’Amérique frivole (il est question de
prime time et de reviews) et bureaucratique (le Congrès surveille les financements), tandis que
l’attitude et le ton léger de l’intervenant soulignent déjà l’inanité de l’entreprise des astronautes.
L’ironie centrale au film est que ces braves astronautes et militaires américains, embarqués dans
leur absurde mission depuis au moins dix ans, en sont arrivés à ressembler physiquement plus à
de fumeux hippies qu’aux fringants astronautes des missions Apollo. D’un côté, les quatre
membres de l’équipage représentent la caricature d’un militarisme tourné en dérision : à un de ses
hommes qui lui apprend qu’il y a 95% de chances de trouver de la vie intelligente dans tel
système solaire, le commandant Doolitle répond agacé : « Who cares ?! […] Find me something
that I can blow up!! » Boiler est une grande brute fascinée par les armes, au plus grand mépris de
sa propre sécurité. Les autres membres de l’équipage sont des bombes nucléaires dotées de
raison, impatientes d’être lancées contre un objectif et d’accomplir leur mission existentielle. On
sent dès la première scène à bord du vaisseau que pour les astronautes également, l’opération de
destruction signifie tout : une fois la planète liquidée, ils abandonnent soudain leur
professionnalisme et retombent dans leurs pathétiques idiosyncrasies, se plaignant bientôt du
manque de papier hygiénique à bord du vaisseau.
Les astronautes sombrent ainsi peu à peu dans l’aliénation, victimes de leurs multiples
névroses. Tous se laissent dangereusement pousser les cheveux, la barbe et la moustache,
écoutent de la musique rock dans un dortoir dominé par des posters playboy et fument des
cigarettes dont on se demande si elles contiennent uniquement du tabac… Totalement névrosés à
bord de leur vaisseau déliquescent, les hommes se laissent de plus en plus aller dans le grand
n’importe quoi – la violence sourde de Boiler est comiquement contrastée à sa coquetterie (il a les
cheveux longs et blonds, il passe son temps à se tailler la moustache), Pinback devient
schizophrène et développe des personnalités multiples, tandis que Talby s’isole dans la tour
d’observation pour contempler sans cesse les étoiles. Les humains sont à peine soutenus dans un
80semblant de raison par l’Intelligence Artificielle du bord, seule présence ‘féminine’ du métrage
(et référence au HAL de 2001).
Les bombes « thermostellaires, » capables de réduire en cendres des planètes entières et
bientôt plongées dans les affres de la « phénoménologie » et de l’ontologie cartésienne, semblent
elles-mêmes plus intelligentes et rationnelles que les astronautes du vaisseau. Un monstre d’allure
ridicule (il s’agit en réalité d’un ballon gonflable de plage) rôde dans le vaisseau, moquant les
monstres emblématiques de la SF des années cinquante, mais ici l’animal est surtout la victime de
la bêtise des membres de l’équipage, en premier lieu Pinback qui a voulu s’offrir un animal de
compagnie et qui ne sait plus que faire de cet encombrant passager. La musique country qui
accompagne les plans extérieurs du vaisseau, satire de la musique instrumentale grandiose
traditionnellement d’usage, connote plutôt l’équipage comme de pathétiques rednecks et
référence ironiquement l’Amérique profonde et le Western.
Les astronautes finiront par être tués par leur propre technologie, en l’occurrence une
bombe thermonucléaire fascinée par la logique cartésienne qui crée son propre big bang originel :
« Let there be light » sont ses dernières paroles, créateur cette fois de mort plutôt que de vie et
suggérant dans le même temps que la bombe se prend peut-être elle-même pour une divinité. La
fin souligne ainsi ironiquement, à la suite de 2001, la solution de continuité entre intelligence et
destruction, tout en faisant de ces technologies des entités presque plus sympathiques que les
humains du bord. Finalement Doolitle, seul rescapé de l’explosion, tente de pénétrer dans
l’atmosphère d’une planète voisine sur une planche de surf improvisée, pour un final qui fait
autant référence à celui de Dr. Strangelove (où un pilote / cow-boy retombait sur Terre en
chevauchant une bombe atomique), qu’à la fin de Kaleidoscope, la nouvelle de Ray Bradbury (un
des grands précurseurs de la New Wave) dont elle est inspirée. L’écran procède alors à un fondu
au noir, avant d’afficher ironiquement « made in Hollywood. »
Cette référence finale est certes ironique, dans la mesure où Dark Star est un film
indépendant plutôt que produit par une des grandes majors hollywoodiennes ; néanmoins le film,
malgré son ton tragicomique, donne un aperçu très fidèle de la transformation que subit la SF
hollywoodienne au tournant des années soixante-dix. A la dénonciation et à la moquerie doit
cependant succéder un contre-modèle, des valeurs et un imaginaire alternatif. Dark Star reste
ambivalent sur ce point : il rend ses personnages plus sympathiques du fait de leur lente
transformation en hippies, mais ne fait jamais vraiment l’apologie de ces derniers. Talbot et
Doolittle sont in fine les deux personnages que le film rédime ; à la bêtise et à l’inanité
confirmées de Boiler et de Pinback, Doolittle fait mentir son surnom en s’activant et en faisant
preuve de sang-froid et d’intelligence, de même que le misanthrope Talbot, qui redescend enfin
de son nuage pour donner un coup de main à ses compagnons. Néanmoins le film ne dépasse pas
le cadre de la satire humoristique, se contentant de suggérer l’invasion hippie d’un vaisseau de la
NASA livré à lui-même.
Tout comme Silent Running, Dark Star est fortement redevable de 2001, même s’il choisit
d’en satiriser les principales caractéristiques. Pourtant tous deux, sur des modes certes très
divergents, procèdent de la même déconstruction du space opera et au-delà de la science-fiction
américaine, Dark Star ajoutant un imaginaire psychédélique et un ton irrévérencieux à sa propre
révision du genre. Silent Running ne fait pas autre chose, mais le fait sur un mode à nouveau très
différent.
81Silent Running, la Nouvelle Frontière écologique
On a vu que, face au cauchemar urbain et technologique de l’Amérique moderne, plusieurs
de ces films proposent, à l’image de la SF littéraire de la période, un contre-idéal bucolique et
pastoral. Les héros de Logan’s Run trouvent refuge dans une forêt miraculeusement régénérée et
opposée à la cité aliénante. Les héros de Soylent Green sont littéralement hantés par le souvenir
de la campagne, de la végétation disparue et d’une nature pure et régénératrice. Les personnages
au centre de A Boy and His Dog sont en quête d’un mythique havre de paix bucolique au milieu
de la destruction post-apocalyptique. Les derniers représentants de l’humanité dans The Omega
Man (1971) vivent au milieu de la nature, loin des ruines de la civilisation déchue. Blade Runner,
dans sa version initiale (1982), imagine ses héros fuir la mégapole infernale pour une nature
verdoyante et resplendissante. Alors que le premier Earth Day est célébré en 1970, et que les
best-sellers de Rachel Carson alertent le grand public depuis déjà une décennie (le titre du film
fait par ailleurs étrangement écho à celui du grand ouvrage de Carson, Silent Spring), la science-
fiction devient le premier genre à mettre en scène et à thématiser la destruction de
l’environnement par la technologie et/ou les forces du capitalisme américain et à proposer une
réflexion d’ordre « écologiste, » terme qui prend à la même époque, en anglais et en français, sa
signification politique et éthique actuelle.7
Le film qui véhicule le plus clairement une réflexion d’ordre écologiste est bien Silent
Running, tourné en 1971 et distribué sur les écrans en 1972. Silent Running doit en réalité son
existence autant à Easy Rider qu’à 2001 : le succès du premier film pousse en effet la Universal à
renouveler l’expérience en confiant un minuscule budget (un million de dollars) à cinq jeunes
réalisateurs et à leur donner carte blanche, espérant renouveler le succès commercial du métrage
de Peter Fonda et Dennis Hopper pour une prise de risque de toute façon minimale. Silent
Running est réalisé par Douglas Trumbull, au prestige certain puisqu’il est responsable des effets
spéciaux de 2001, dont il réutilisera d’ailleurs certaines séquences non utilisées dans le film. On
voit ici comment les studios et les producteurs, confrontés à un nouveau public et à de nouvelles
attentes, désarmés face à des films aussi novateurs que Bonnie and Clyde, The Graduate ou Easy
Rider, donnent plus ou moins carte blanche à de jeunes « auteurs, » scénaristes et/ou réalisateurs
qui sont supposés comprendre la nouvelle ère.
A nouveau situé à bord d’un vaisseau spatial et mettant une fois encore en scène les
omniprésentes armes nucléaires de la décennie, Silent Running s’articule autour de la dissonance
que constitue la présence dans l’espace de la dernière forêt terrestre. Le héros, Freeman Lowell,
s’occupe en effet des derniers spécimens de la flore et de la faune terrestres à bord d’une Arche
de Noé spatiale du futur. Les phénomènes régulièrement dénoncés à l’époque, jamais clairement
explicités par le film tant ils tombaient, même confusément, sous le sens des spectateurs
contemporains (« la guerre, la surpopulation, la pollution, » comme l’égrène le prologue de
Logan’s Run) ont eu raison de la biosphère. Les derniers spécimens de la flore et de la faune
terrestres ont été envoyés dans l’espace dans des bulles écologiques embarquées à bord de
vaisseaux nommés d’après des parcs nationaux.8 Le vaisseau à bord duquel officie Freeman est
ainsi le Valley Forge, nom qui permet dans le même temps de référencer ironiquement l’histoire
7
Néanmoins l’opposition symbolique et narrative entre la mégapole et la campagne, entre la nature et la technologie,
remonte au XIXe siècle, en particulier aux années 1880 et 1890 (e.g. News from Nowhere de William Morris, 1890 ;
A Traveler from Altruria, 1894), époque du premier grand développement économique occidental. Il s’agit là d’un
des nombreux parallèles que l’on peut établir entre cette époque et la contre-culture, qui apparaît à certains égards
comme une « deuxième vague. »
8
Le film ne justifiera jamais ce besoin d’envoyer les bulles dans l’espace plutôt que de conserver ces forêts dans des
bulles situées sur Terre.
82nationale (l’armée de George Washington hiverna dans des conditions très difficiles à Valley
Forge durant l’hiver 1777-1778).
La deuxième séquence du film joue précisément de cette connexion patriotique : un
traveling arrière part du visage de Freeman de l’autre côté du hublot du vaisseau pour reculer
progressivement, révélant au spectateur le nom du vaisseau et la bannière étoilée peinte à ses
côtés, ainsi que le statut précis du navire et le nom de la compagnie à laquelle il appartient :
American Airlines Space Freighter (public et privé semblent être étroitement mêlés dans cet
avenir). Dans le même temps un monologue en voix-off, que l’on comprend être un discours du
Président des Etats-Unis datant de 2000 ou de 2001, confirme la catastrophe écologique
nationale : « On this first day of a new century, we humbly beg forgiveness, and dedicate these
last forests of our once beautiful nature, in the hope that they will one day return and grace our
foul earth. Until that day, may God bless these gardens. » Le discours est suivi d’une musique
instrumentale grandiose qui vient souligner la majesté des vaisseaux qui défilent sereinement
sous l’œil de la caméra, plans traditionnels à la SF qui rappellent 2001. Or la toute première
séquence du film consistait en un traveling similaire situé cette fois dans la bulle écologique du
vaisseau, la caméra soulignant les nombreuses beautés de cette nature préservée. Le merveilleux
naturel est donc suivi d’un merveilleux technologique, les deux séquences étant reliées par
Freeman et ce discours sur la nécessaire rédemption de l’Amérique. Sans rejeter la technologie
aussi radicalement que le font les autres films de la période, Silent Running met ainsi les deux
pôles en regard, et tentera en réalité plus tard de les réconcilier. Pourtant l’humanité du futur n’a
pas encore appris sa leçon, comme le démontrent les membres de l’équipage, qui n’ont rien à
faire des arbres et ne font que suivre les ordres. Freeman est le seul à se préoccuper de ces arbres
et de ces animaux et à se passionner pour eux, chérissant le désir de voir son travail mener à la
régénération de la Terre et de la biosphère. Il devient ainsi la tête de Turc de ses camarades, qui
raillent le tree-hugger qu’est Freeman. Lorsque le Président des Etats-Unis fait une déclaration
solennelle à la flotte dans le premier acte, Freeman pense le grand jour arrivé ; las, le Président
ordonne la destruction des bulles et la réaffectation des vaisseaux à leur vocation première – le
commerce. Fou, Freeman assassine ses compagnons et fuit le reste de la flotte, se retrouvant seul
dans son jardin. L’ode à la nature et au besoin de la protéger est transparente, comme le
démontrent, si besoin est, les quelques séquences accompagnées des chansons de Joan Baez,
chanteuse engagée aperçue encore récemment dans le dernier film de Jean-Luc Godard, Film
Socialisme, ainsi qu’à la Fête de l’Humanité en septembre 2011.
Or, le plus frappant dans Silent Running est que l’on ne propose pas au spectateur une
dystopie où tout va mal, ou un monde post-apocalyptique, mais un futur où tout va apparemment
pour le mieux. Il s’agit, comme l’explique amèrement Freeman, d’un futur idéal : « Sur Terre où
83que vous alliez la température est la même, 24°. Tout est identique. Les gens sont tous identiques.
Quel genre de vie est-ce là ? » Utopia a été accomplie et « il n’y a presque plus de maladies, de
pauvreté, et tout le monde a un travail. » L’ennui est qu’« il n’y a plus non plus de beauté, plus
d’imagination, plus de Frontières à conquérir, » et plus d’arbres. Le problème réside donc bien
dans le projet moderne traditionnel lui-même, pas tant son échec ou son détournement qu’au
contraire son succès triomphal, qui ne mène in fine qu’au matérialisme et au technoscientisme le
plus bas. Le problème de l’utopie moderne n’est pas son échec mais bien paradoxalement son
succès total, instaurant un âge d’or lisse et sans saveur, comme l’illustre la nourriture synthétique
lyophilisée que mangent les collègues de Freeman durant cette même scène sans rien trouver à y
redire. La disparition de la nature est donc aussi le marqueur de la faillite spirituelle et morale
totale d’une société qui a oublié que le progrès n’était pas toujours quantifiable en termes de
durée de vie ou de taux de chômage. Silent Running se fait ainsi symptomatique du rejet, après
les désastres totalitaires, d’un imaginaire utopiste assimilé à l’uniformisation, à l’hyper-
rationalisation et au désenchantement du monde. La modernité classique serait donc à son tour
totalitaire, justifiant le pessimisme des philosophes et des sociologues de Francfort. Ici la science-
fiction servirait également à réveiller dans chaque spectateur le « sense of wonder » souvent
assimilé au genre, sa capacité de s’émerveiller devant les merveilles de l’univers et de la nature
(plutôt que, comme auparavant, devant le génie technologique humain). La scène du débat entre
Freeman et ses camarades, un des passages clés du film, montre aussi un Freeman vociférant aux
yeux écarquillés, bien engagé sur un chemin qui le mène possiblement à la folie. Le film joue
ainsi d’une relative ambiguïté quant à Freeman, suggérant que, si l’humanité a sombré dans la
folie mercantile et écocide, Freeman est peut-être lui aussi victime de son propre déséquilibre
mental.
Silent Running présente l’intérêt supplémentaire qu’il ne propose pas la même dualité
binaire entre nature et technologie que la plupart des autres films de la décennie. Après avoir tué
les autres membres de l’équipage et avoir fui à bord du vaisseau, Freeman se lie d’amitié avec
trois petits robots, qu’il humanise progressivement (il leur donne des noms, leur apprend à jouer
au poker), et à qui il apprend à soigner un être humain ainsi qu’à s’occuper de la forêt (eux sont
déjà programmés pour entretenir le vaisseau, là où les humains ne faisaient apparemment pas
grand-chose d’autre que s’amuser). Loin des robots meurtriers typiques de la période, symboles
animés d’une technologie meurtrière, les drones de Silent Running proposent à l’inverse des
créatures artificielles dont l’innocence comique tend à les humaniser, là où les humains eux-
mêmes (Freeman y compris) sont plutôt déshumanisés par leur folie et leurs faiblesses. Décidant
de se suicider afin de sauver la biosphère, Freeman laisse derrière lui le dernier de ces robots
s’occuper de la forêt qui continue à flotter dans l’espace, peut-être éternellement… C’est ainsi
l’humanité qui se suicide symboliquement, laissant derrière elle sa technologie et la nature, ne
méritant au final ni l’une ni l’autre.
Conclusion
Le « Nouvel Hollywood » ne s’avèrera pourtant au final, comme la contre-culture dans
son ensemble, qu’une parenthèse, une époque où Hollywood s’ouvre et se livre aux auteurs et où
même les genres essentiellement américains, américanistes même pourrait-on dire, comme le
Western et la science-fiction, se font « nouveaux » et « révisionnistes. » L’ère se referme en
1977, ironiquement clôturée par un film de science-fiction qui scelle l’avènement de l’hyper-
84Vous pouvez aussi lire