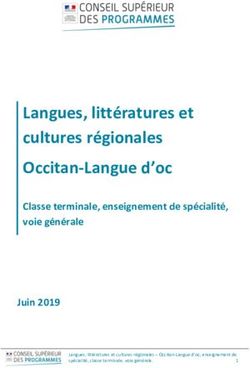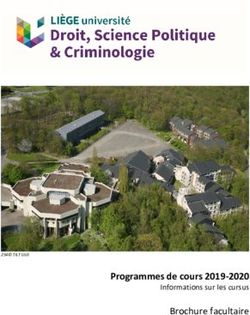Trabajo Fin de Grado Le débat sur le langage inclusif en France The inclusive-language debate in France
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Trabajo Fin de Grado
Le débat sur le langage inclusif en France
The inclusive-language debate in France
Autora
Elisa Montañés Rodrigo
Directora
Nieves Ibeas Vuelta
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
2021Table de matières
Introduction ................................................................................................................................ 2
1. La polémique en France : le langage inclusif dans la scène politique ................................... 4
1.1. Décisions politiques concernant le langage inclusif ....................................................... 6
1.2. Le débat sur la féminisation du langage en France à partir 1980 .................................... 9
1.3. Quelques résistances à la féminisation de la langue française ...................................... 12
2. La contribution du mouvement féministe à la féminisation du langage .............................. 16
2.1. Point de départ : femmes et langage.............................................................................. 17
2.2. Apports du mouvement féministe et révendications ..................................................... 18
2.3. De nouvelles propositions sur l’écriture inclusive ........................................................ 21
3. Nouvelles approches : l’apport et la critique de certains auteurs......................................... 23
3.1. Anne-Marie Houdebine ................................................................................................. 23
3.2. Patrick Charaudeau ....................................................................................................... 25
Conclusion ............................................................................................................................... 28
Bibliographie............................................................................................................................ 30
Annexes.................................................................................................................................... 33
1Introduction
L’Organisation des Nations Unies définit le langage inclusif, aussi dénommé dans
d’autres pays « langage non-sexiste », comme une manière de s’exprimer sans discriminer
personne selon son sexe ou son identité de genre, de manière à effacer tout stéréotype de genre.
Le langage inclusif est considéré par l’ONU comme un outil qui sert à « promouvoir l’égalité
de genre » et à « lutter contre les préjugés ». Lorsque nous parlons de langage inclusif, le terme
inclut si bien l’expression orale que l’expression écrite (qui reçoit le nom d’ « écriture
inclusive »).
En France, le sujet du langage inclusif a été depuis quelques années l’objet d’un débat
très polarisé. Des les premières réflexions féministes sur la présence ou la non-présence des
femmes et du féminin dans la langue dans les années 60-70 en France, le débat s’est accru lors
de la création de la Commission de terminologie pour la féminisation de métiers, de grades et
de fonctions en 1984. En 2017, le débat a été relancé lors de la publication d’un manuel scolaire
en écriture inclusive des Éditions Hatier. Aujourd’hui, l’écriture inclusive est redevenue
d’actualité avec la circulaire du 6 mai, à travers laquelle le ministre de l’Éducation Nationale a
interdit son emploi, dans un débat encore plus polarisé qu’auparavant.
Dans ce dossier, je propose un bref parcours à travers l’histoire du langage inclusif en
France, le débat suscité depuis 1980 avec certaines politiques linguistiques et sociales
publiques mises en œuvre, les demandes féministes en matière linguistique, et quelques
résistances importantes que les défenseurs du langage inclusif ont dû et doivent affronter.
Dans la première partie, mon dossier se concentre sur la naissance et l’évolution du débat
sur le langage inclusif en France. Dans la deuxième, mon travail se tourne sur le rapport entre
femme(s) et langage dans l’histoire récente, ainsi que sur les contributions et la lutte des
défenseurs de la langue non-sexiste. Finalement, la troisième partie du travail met en valeur les
contributions de spécialistes de l’analyse de la langue, du langage et du discours à propos du
langage inclusif.
Du point de vue théorique et méthodologique, j’ai pris en compte les thèses de
spécialistes comme Patrick Charaudeau, Anne-Marie Houdebine-Gravaud et Éliane Viennot,
pour les questions qui portent sur la langue et le langage et, notamment, les réflexions sur
l’écriture inclusive. En ce qui concerne la perspective féministe et de genre, je me suis
intéressée aux travaux de spécialistes universitaires essentielles dans l’histoire du féminisme
2français comme Michelle Perrot, Christine Planté ou les propres Viennot et Houdebine, ainsi
qu’à des contributions significatives publiées à propos du sujet dans les Les Cahiers du Grif et
Clio. En outre, mon travail a éxigé la recherche et consultation de documents officiels du
gouvernement français, et de publications médiatiques qui illustrent l’actualité du débat.
31. La polémique en France : langue et langage inclusif dans la scène
politique.
Dans son manuel de grammaire non-sexiste, Lessard et Zaccour (2018 : 31) définissent
le terme « féminisation » comme « un ensemble de procédés d’écriture ou de discours qui
évitent l’emploi générique du masculin ». Ces mécanismes servent à transformer, soit les mots,
soit les phrases, afin de mettre en lumière la présence des femmes. Le mouvement féminisme
cherche à rendre la langue1 « plus égalitaire », ce qui doit passer, d’après Éliane Viennot, par
des mesures de renforcement du féminin dans le domaine linguistique (2014 : 130).
Il faut signaler que la prééminence du masculin n’en est « ni intuitive, ni naturelle, ni
nécessaire » : elle n’est pas « intrinsèque à la langue français », mais plutôt c’est le résultat des
efforts de beaucoup d’auteurs, de linguistes et d’intellectuels misogynes (Lessard & Zaccour,
2018 : 9). Ce secteur de la société, défenseurs de la prévalence du genre masculin sur le
féminin, a mené une lutte pour la « masculinisation »2 de la langue, qui repose notamment sur
deux piliers : tout d’abord, l’effacement des termes féminins désignant les professions nobles ;
ensuite, la défense de la « préséance » du masculin et de sa transformation en genre générique
(Lessard & Zaccour, 2018 : 9).
La linguiste Anne-Marie Houdebine-Gravaud, qui a largement travaillé sur la présence
des femmes dans la langue française et qui a acquis une grande reconnaissance dans ce
domaine, défend que la décision d’utiliser le masculin comme « générique », même si elle peut
sembler arbitraire en ce qui concerne la morphologie, elle ne l’est pas, car en français, le genre
porte une valeur sexuée lorsqu’il est utilisé pour désigner les humains (1999 : 31).
En effet, aux XVIIe et XVIIIe siècles, ce secteur social « masculiniste » s'acharne
contre les terminaisons féminines existant dans la langue française, et certains mots référant à
des occupations savantes seront spécialement attaqués (Lessard & Zaccour, 2018 : 10).
1
Par langue, on entend un système de signes vocaux et graphiques, conventionnels, utilisé par un groupe
d’individus pour l’expression du mental et la communication (définition du Centre National de Ressources
Textuelles et Lexicales : https://www.cnrtl.fr/definition/langue.)
2
Le terme masculinisation est défini par Christine Bard dans Les mots de l’Histoire des femmes -ouvrage rédigé
par le comité de rédaction de la revue CLIO, Femmes, Histoire, Société, et coordonné en 2004 par Michelle
Zancarini-Fourne- comme « le processus, individuel ou collectif, qui rapproche le sexe féminin du sexe masculin,
souvent synonyme de virilisation en l’absence de distinction entre le masculin (corporel, réel) et la virilité
(psychique, mythique) » (Zancarini-Fourne, 2004 : ¿ ?).
4Cette volonté tenace de « masculinisation » de la langue continue dans le domaine de
la grammaire(Lessard & Zaccour, 2018 : 12).. Jusqu’au XVIIe siècle, le français fait l’accord
des adjectifs et des verbes à partir du nom ou du sujet le plus proche, ou, en d’autres termes,
par proximité. Par contre, Éliane Viennot3 explique comment le discours social, culturel et
politique dominant a fait triompher l’idée du masculin qui l’emporte sur le féminin, ce qui a
provoqué la disparition de l’accord de proximité, et la naissance du principe « le masculin
l’emporte sur le féminin », une règle qui est arrivée jusqu’à nos jours.
Dans le contexte contemporain, la demande d’une féminisation de la langue passe par
le réapprentissage à parler et à écrire, selon Lessard et Zaccour (2018 : 18), et c‘est précisément
du cadre écrit que l’écriture inclusive s’occupe. En ce sens, je voudrais mettre en lumière la
difficulté de cette tâche en ce qui concerne la graphie, qui, comme soutient Éliane Viennot
(2014 : 122), implique une remise en question de l’écriture actuelle et l’apport de nouvelles
propositions capables de satisfaire aux besoins des locuteurs d’une manière claire.
Dans son travail intitulé « Où en est le féminisme aujourd'hui ? », la sociologue et
historienne Françoise Gaspard affirme que si le français de France, malgré « les réticences de
l’Académie française » et « quelques nostalgiques d’un universalisme linguistique qui
neutralise le genre humain », se rapproche du français de pays comme la Suisse, la Belgique
ou le Québec, dans lesquels, depuis les années 1970 et du féminisme dit de la « deuxième
vague », la féminisation des titres et fonctions est sociale et politiquement accepté « comme
allant de soi », c’est dans une large mesure partie grâce au féminisme (Gaspard, 2002 : 59).
Lors de son entretien en 2002 avec Margaret Maruani et Chantal Rogerat, Michelle Perrot,
considérée comme la grande historienne du féminisme, avoue que, dans son cas, le féminisme
fut d’abord « une rébellion contre la condition faite aux femmes [...] au moment des choix
décisifs », (Perrot, 2002 : 6)».
Pour Perrot, le féminisme change complètement la perspective sur l’histoire, qu’elle
comprend comme « un regard »4, (Perrot, 2002 : 8) et si « l’avènement des femmes au récit
3
L’invention du « maculin qui l’emporte sur le féminin » : http://www.elianeviennot.fr/Langue-accords.html
4
Cf. https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/la-nuit-revee-de-michelle-perrot-69-la-
nuit-revee-de-michelle-perrot-entretien-23-1ere-diffusion. Michelle Perrot a contribué de manière très
significative à l’émergence de l’histoire des femmes et du genre, et l’histoire des marges, dont est une des
pionnières en France, mais aussi à renouveler la discipline et ses objets. Professeur émérite de l’Université Paris
VII-Denis Diderot, où elle a effectué une grande partie de sa carrière après avoir quitté la Sorbonne au début des
années 1970, elle a dirigé avec Georges Duby l’Histoire des femmes en Occident (5 vo., Paris, Plon, 1991-1992)
et publié en 2001 l’ensemble de ses articles sur la question dans Les femmes ou les silences dans l’histoire (Paris,
Flammarion, 1998). Plus récemment, Les Ombres de l’histoire. Crime et châtiment au XIXe siècle (Paris,
5historique est lié au féminisme », c’est notamment par les questionnements et les
revendications du mouvement de libération des femmes (2011 : 6-7). Le féminisme français
contemporain est, de ce point de vue, le résultat de grands efforts pour l’égalité, en vue de la
consécution de l’égalité d’opportunités des femmes dans tous les domaines de la société et
d’autres aspects qui concernent, par exemple, la représentation et le langage. La langue est
d’ailleurs « un des hauts lieux de la lutte féministe », comme remarque Julie Abbou (2019 :
235).
En tout cas, l’intervention des pouvoirs politiques s'avère décisive pour l’évolution
d’une société. La féminisation de la langue exige un cadre politique favorable, un
gouvernement pour mettre en place des mesures effectives pour l’égalité d’opportunités des
femmes dans la société. Elle implique aussi l’existence d’un cadre légal pour la défendre et la
faire avancer. Or, les interventions dans la langue tendent à susciter de grandes polémiques
dans la société (Baudino, 2006 : 187). En France, depuis la fin du XIXe siècle, le débat se
concentre sur l’accès des femmes à la sphère publique, en rapport direct avec la féminisation
des noms de métiers et de fonctions.
1.1. Décisions politiques concernant le langage inclusif
En ce qui concerne la prise de décisions politiques en matière linguistique, elles
prennent normalement la forme de circulaire, et ont une influence décisive sur l’évolution de
la langue. C’est à partir de 1980 que le gouvernement français, sous la présidence de François
Mitterrand, envisage une action politique dans cette direction grâce notamment à l’intervention
d’Yvette Roudy, ministre des Droits de la femme entre 1981 et 1986. Tout d’abord, en 1983 a
lieu la promulgation d’une nouvelle loi pour l’égalité entre hommes et femmes qui travaillent
dans une entreprise, la Loi no 83-635 du 13 juillet 19835, dite loi « Roudy ». En 1984, sous
l’impulsion des mouvements féministes, Yvette Roudy constitue une Commission de
féminisation des noms de métier et de fonction, présidée par Benoîte Groult, dite la
« Commission Groult »6. Deux ans plus tard, le travail achevé, le premier ministre Laurent
Flammarion, 2001), Histoire de chambres (Paris, Seuil, 2009) ou Le Chemin des femmes (Paris, Robert Laffont,
2019).
5
Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000504474/
6
Comission Groult est l’appellation utilisée à plusieurs reprises dans le Rapport de la Commission Générale de
terminologie et de néologie :
6Fabius publie la Circulaire du 11 mars 1986 relative à la féminisation des noms de métier,
fonction, grade ou titre (Journal Officiel, 1986) (voir Annexe 1). Pourtant, malgré tout le travail
d’observation et de recommandations mené par la « Commission Groult » et toute l'opposition
que celle-ci a dû affronter, cette circulaire n’est pas finalement appliquée. Après l’arrivée de la
droite au pouvoir en 1995 (Jacques Chirac), et un nouveau Premier ministre (Alain Juppé), non
plus. Tous les domaines s’entrelacent en société et affectent les uns les autres et, comme affirme
Anne-Marie Houdebine-Gravaud (1999 : 24), ce sont des décisions sociales et politiques qui
ont compliqué l’avancée vers la féminisation du français de France.
Or, en 1998, le Premier ministre socialiste Lionel Jospin, décide de reprendre la
question de la féminisation et s’engage à implanter le principe de parité dans les institutions à
travers une révision constitutionnelle (Baudino, 2006 : 190). Le 8 mars 1998, une nouvelle
Circulaire du 6 mars 1998 relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou
titre7 est publiée, dans laquelle Jospin exprime sa décision de faire appliquer celle du 11 mars
1986. Cette volonté se traduit un an après par la parution de Femme j’écris dans ton nom :
guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions8, préfacé par
Jospin (Annexe 2). Cette initiative politique conforme les premiers pas vers la théorisation de
la féminisation de la langue française, tout comme la reconnaissance de l’importance de la
langue dans la lutte féministe.
De 1998 au présent, les actions se sont poursuivies. En 2000, le Ministère de
l’Éducation nationale a publié une circulaire à ce sujet9. Plus tard, en 2012, le Premier ministre
François Fillon publie la Circulaire n° 5575/SG du 21 février 201210 communiquant sa décision
de supprimer les termes « mademoiselle », « nom de jeune fille », « nom patronymique »,
« nom d’épouse » et « nom d’époux » des documents administratifs. À partir de ce moment, il
devient obligatoire d’utiliser « madame » pour se référer à une femme, tout comme
« monsieur » pour un homme. L’état civil des femmes cesse d’être une donnée à considérer
tout comme il était déjà habituel pour les hommes.
https://www.culture.gouv.fr/content/download/93489/file/rapport_1988_feminisation-
cogeter_def.pdf?inLanguage=fre-FR
7
Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000556183.
8
Texte publié sous la responsabilité du professeur Bernard Cerquiglini, linguiste alors vice-président du Conseil
supérieur de la langue française, par le Centre national de la recherche scientifique et par l’Institut national de la
langue française.
Disponible sur : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/994001174.pdf.
9
Bulletin Officiel de l'Éducation nationale nº 10 du 9 mars 2000. Disponible sur :
https://www.education.gouv.fr/botexte/bo000309/MEND0000585X.htm.
10
Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/34682.
7Afin de continuer ce travail pour réussir la parité et l’égalité entre hommes et femmes
en France, le Haut Conseil à l’Égalité (HCE) publie en 2015 un Guide pratique pour une
communication sans stéréotype de sexe11, presenté comme outil disponible pour les personnes
ayant la volonté « de s’engager pour une communication exemplaire » dans n’importe quel
endroit. Sur le site web, le HCE met aussi en relief le grand intérêt social suscité par cette
publication, si bien dans format papier qu’électronique : l’ouvrage est devenu un ouvrage de
référence sur les stéréotypes de sexe dans le discours.
Dans ce même esprit, la Circulaire relative à la politique d’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la fonction publique 12, publiée le 22 décembre 2016, engage
des nouvelles dynamiques afin d’« assurer une égalité effective entre les femmes et les hommes
dans la vie professionnelle ». Dans les dernières années, les différents gouvernements,
notamment le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et
de l’Égalité de chances, ont continué à promouvoir des initiatives et à publier des consignes en
faveur de l’égalité. Par contre, en ce qui concerne l’écriture inclusive, les différents
gouvernements se montrent assez réticent et même contraire à ce type de langage comme, par
exemple, lors de la publication de la Circulaire du 21 novembre 2017 relative aux règles de
féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française13
par laquelle le premier ministre Édouard Philippe interdit l’usage de l’écriture inclusive dans
les documents administratifs. Quatre ans plus tard, Jean-Michel Blanquer, actuel ministre de
l’Éducation nationale, dans sa Circulaire du 5 mai 202114, adressée « aux recteurs et rectrices
d'académie ; aux directeurs et directrices de l'administration centrale ; aux personnels du
ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports », proscrit dans le cadre de
l’enseignement l’usage de l’écriture « dite ‘inclusive’ qui utilise notamment le point médian »
sous prétexte que celui-ci « constitue un risque énorme pour la transmission du français15.
11
Disponible sur : http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pratique-_vf-_2015_11_05.pdf
12
Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/41661
13
Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036068906
14
Disponible sur : https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo18/MENB2114203C.htm.
15
Propos de Blanquer dans la Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale,
le jeudi 6 mai 2021. Disponible sur : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion-
cedu/l15cion-cedu2021050_compte-rendu.
8L’écriture et le langage inclusifs restent en tout cas un sujet de débat très polémique
dans tous les domaines, et les politiques linguistiques se situent au centre du débat et, en
particulier, les « orientations d’intervention féministe sur le langage » (Abbou, 219 : 238).
1.2. Le débat sur la féminisation du langage en France à partir 1980
Comme Claudie Baudino l’indique dans son travail sur le rapport entre linguistique et
politique en matière de féminisation de la langue (2006 : 188), le débat s’est déclenché avec
force en France dans les années1980, lors de la création de la « Commission Groult ».
L’Académie française s’est présentée déjà à l’époque comme défenseure de la grammaire
traditionnelle avec la publication d’une Déclaration de l'Académie française le 14 juin 1984
(voir annexe 3) sur laquelle je reviendrai ci-dessous.
La féminisation de la langue en France est devenue l’objet de grandes polémiques qui
ont atteint l’opinion publique, soulevant des divisions apparemment irréconciliables. Ce débat
ne se limite pas à la sphère publique : il est également arrivé à l’Assemblée générale, même si
le droit des femmes à être nommées en féminin leur est reconnu depuis 1986.
En janvier 2014, lors du débat sur la loi Duflot sur l'accès au Logement, le député Julien
Aubert a joué une scène gênante dans la vie politique française. Membre du parti politique
UMP, Aubert s’est adressé à plusieurs reprises à la présidente de la séance, Sandrine Mazetier,
comme « Madame le Président », alléguant qu’il suivait les indications de l’Académie
française. Sandrine Mazetier a montré son opposition avec fermeté : « C'est Madame la
présidente, ou il y a un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal »16. L’obstination
d’Aubert lui a valu une sanction d’accord à l’article 71 du règlement de l’Assemblée
Générale17, mais 139 députés de son groupe parlementaire lui ont montré leur soutien,
demandant au Président de l’Assemblée de lui lever la punition. Deux membres significatifs
de son parti, Henri Guaino et François Fillon, signent la tribune « ‘Madame le président’ :
l'ultimatum de 140 députés de l'opposition à Claude Bartolone », le 9 octobre 2014, dans Le
16
Extrait de l’article « Un député persiste à dire «Madame le président» et écope d'une sanction » du journal
Libération : https://www.liberation.fr/france/2014/10/07/un-depute-persiste-a-appeler-sandrine-mazetier-
madame-le-president-et-ecope-d-une-sanction_1116530/
17
L’article prévoit, soit la privation du quart de l’indemnité parlementaire pendant un mois, soit une sanction
financière de 1378 euros, selon la Normative de l’Assemblée nationale. Disponible sur : https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/divers/texte_reference/02_reglement_assemblee_nationale#D_Article_71_191.
9Figaro18, où ils exigent l’annulation de la sanction imposée à Aubert, et se réfèrent de nouveau
à Sandrine Mazetier en tant « vice-président de l’Assemblée ».
Mais le débat sur la féminisation de la langue ne se limite pas à l’oral. Il concerne aussi
l’écriture inclusive. Dans son Manuel de grammaire non sexiste de la langue française : le
masculin ne l’emporte plus !, les chercheurs Michaël Lessard et Suzanne Zaccour définissent
la « féminisation du langage »:
Un ensemble de procédés d’écriture ou de discours qui évitent l’emploi générique du masculin. Elle
transforme les mots (féminisation lexicale) et les phrases (féminisation syntaxique) pour « dégenrer » le
français, ou encore pour mettre en lumière l’existence des femmes. Au moyen de diverses stratégies, elle
refuse d’accepter que le « masculin l’emporte » et propose une façon de s’exprimer sans sexisme. (2018 :
31)
L’écriture inclusive désigne justement ces stratégies de féminisation du discours, mais à l’écrit.
D’ailleurs, le débat politique sur l’écriture a exploité en France lors de la parution d’un manuel
scolaire en écriture inclusive destiné aux élèves de CE2 par les Éditions Hatier, un évènement
qui a produit un grand scandale en 2017. Au moment de cette publication, le Haut Conseil à
l’égalité s’est positionné en faveur de l’initiative lui montrant son soutien à travers les réseaux
sociaux (voir Annexe 4), ce qui n’a pas été aussi bien accueilli par tout le monde. Le député
Julien Aubert et seize de ses collègues parlementaires (onze hommes et cinq femmes) se sont
adressés au ministre de l’Éducation nationale pour lui demander l’interdiction de l’usage de
l’écriture inclusive dans les manuels scolaires, qui empêche « la propagation de l'écriture
inclusive dans les livres de nos enfants »19.
Le débat s’est accru lors de la publication d’une tribune de presse signée par trente-
deux linguistes (parmi lesquels Jacqueline Authier-Revuz, Jean Giot, ou Astrid Guillaume)
contre l’écriture inclusive, dans le magazine conservateur Marianne, le 18 septembre 2020
(voir Annexe 5)20. Dans cette rubrique, les linguistes publient une liste de défauts de l’écriture
inclusive, considérée comme un « péril de mort » pour la langue française. Ils dénoncent qu’il
18
Ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, était député des Yvelines. Ancien Premier ministre,
François Fillon était député de Paris et co-président par intérim de l'UMP. Disponible sur :
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/10/09/31001-20141009ARTFIG00393-madame-le-president-l-
ultimatum-de-139-deputes-de-l-opposition-a-claude-bartolone.php.
19
Information extraite de l’article « Le député LR Julien Aubert veut interdire l’écriture inclusive dans les
manuels scolaires et la compare à de la "novlangue") » du journal Huffingtonpost :
https://www.huffingtonpost.fr/2017/10/11/le-depute-lr-julien-aubert-veut-interdire-lecriture-inclusive-dans-les-
manuels-scolaire-et-la-compare-a-de-la-novlangue_a_23240035/
20
Disponible sur : https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/une-ecriture-excluante-qui-s-impose-par-la-
propagande-32-linguistes-listent-les
10s’agit d’une « écriture excluante », car la langue « n’a pas pour principe de fonctionnement de
désigner le sexe des êtres le sexe des êtres », affirmant qu’elle « s’impose par la propagande »
idéologique, et ils s’emprennent aux points médians utilisés.
La réponse en faveur de l’égalité qui passe par le langage ne s’est pas fait attendre. Le
25 septembre 2020, une nouvelle tribune, signée par soixante-cinq linguistes qui s’opposent à
la première publication, est publiée dans le journal Mediapart21 (voir Annexe 6). Au même
temps, les linguistes Éliane Viennot et Raphaël Haddad publient à leur tour un article dans
Slate comme réaction à la critique contre l’écrit contre l’écriture inclusive : « Écriture
inclusive : le retour du ‘péril mortel’ ? »22.
Le débat sur la féminisation du langage est arrivé à nos jours par la publication d’une nouvelle
circulaire du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel
Blanquer le 5 mai 2021 (voir Annexe 7). Ce document, qui concerne la féminisation de
l’écriture, communique l’interdiction de l’usage de points médians dans le cadre de
l’enseignement, une dont Éliane Viennot aime justement « sa discrétion et sa neutralité »
(2014 : 122). Dans le document, le ministre argumente que l’usage des points médians dans
l’écriture pourrait constituer « un obstacle pour l'accès à la langue d'enfants confrontés à
certains handicaps ou troubles des apprentissages ». Favorable à la féminisation des noms de
métiers –« l'usage de la féminisation des métiers et des fonctions doit être recherché »- et à la
promotion de l’égalité entre les filles et les garçons à travers la « lutte contre les représentations
stéréotypées », Blanquer insiste sur les problèmes de lecture et de compréhension dérivés de
« la fragmentation des mots et des accords » 23. D’après, Michaël Lessard et Suzanne Zaccour,
il faut du temps pour tout changement, et aussi pour celui-ci :
Tout est une question d'habitude et de perspective. […]. L'esthétique de la langue est arbitraire,
et c’est en commençant à employer des mots que l’on s’habitue à les entendre et à les prononcer
– jusqu’à apprendre à les aimer (2018 : 21).
À propos du rapport entre le débat politique et le débat linguiste sur la féminisation de
la langue en France, Christophe Benzitoun, spécialiste en linguistique française à l’Université
21
Disponible sur : https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/250920/au-dela-de-l-e-criture-
inclusive-un-programme-de-travail-pour-la-linguistique-d-aujour.
22
Disponible sur : http://www.slate.fr/story/195341/ecriture-inclusive-tribune-marianne-academie-francaise-
retour-peril-mortel.
23
Disponible sur : https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo18/MENB2114203C.htm.
11de Lorraine, auteur du livre Qui veut la peau du français ? (2021), défend une modernisation
du français :
L'écriture inclusive ou l'écriture non sexiste est devenue un épouvantail politique. Dès qu'il y a
une difficulté, le ou la responsable politique brandit ce sujet comme pour faire diversion. […]
La forme écrite de notre langue est restée figée depuis des siècles alors que la forme orale elle,
ne cesse d'évoluer. Or les responsables politiques refusent de voir la langue écrite évoluer et
c'est là le nœud des difficultés des élèves.24
Cependant, les attaques contre les actions politiques pour rendre visibles les femmes et
le féminin dans la langue française et mettre fin aux sexismes ont été interprétées comme une
atteinte claire et directe contre les demandes émanant du mouvement féministe en faveur d’un
emploi non sexiste de la langue et contre le mouvement féministe lui-même : finalement, ce
sont des féministes et des progressistes qui ont contesté les circulaires de 2017 et 2021
(Viennot, 2021 : 2).
1.3. Quelques résistances à la féminisation de la langue française
Le débat sur le langage et l’écriture inclusive concerne tous les endroits et milieux. Par
contre, toutes les déclarations n’imprègnent la société et la polémique de la même manière : le
pouvoir et l’influence de certaines personnes conditionne souvent l’acceptation de l’opinion
publique de ses affirmations et idées. C’est pourquoi j’ai voulu sélectionner un exemple d’une
figure publique et d’une institution qui occupent une place importante dans la société française.
En ce qui concerne les médias, dont l’influence sur la société et sur l’opinion publique
est objet de nombreuses études25 et a été largement analysé, il m’a semblé intéressant de
prendre en compte une intervention radiophonique de Raphaël Enthoven, l’une des
personnalités françaises les plus polémiques et médiatisées. Philosophe, écrivain attiré par les
médias, conseiller de la rédaction de Philosophie Magazine, animateur de radio -Les Vendredis
de la philosophie, Les Nouveaux Chemins de la connaissance (2007-2011), Le monde selon
Raphaël Enthoven (2011-2012) sur France Culture, etc.- et de télévision (Philosophie, sur
Arte), Enthoven s’est prononcé ouvertement contre l’écriture inclusive dans ses interventions
24
Citation disponible sur : https://www.franceculture.fr/politique/lecriture-inclusive-un-debat-tres-politique.
25
Quelques études sur l’influence des médias : Kessler, D. (2012). « Les médias sont-ils un pouvoir ? » Pouvoirs,
4(4), 105-112. ; Langelier, R.E. (2006). « L’influence des médias électroniques sur la formation de l’opinion
publique : du mythe à la réalité » Lex Electronica, 11 (1).
12médiatiques sur ce sujet, et en le faisant, son avis atteint un retentissement incontestable. Le 26
septembre 2017, il a participé à une émission de radio sur Europe 1, où il a régulièrement une
chronique matinale: Le fin mot de l’info. Dans ce programme, il jette un regard philosophique
sur des thèmes divers. Lors d’une de ces interventions, il a parlé de l’écriture inclusive comme
d’« une agression de la syntaxe par l’égalitarisme », tout en maintenant un ton de ridiculisation
et d’invraisemblance. Il s’est montré absolument contraire à l’usage des points médians car, à
son avis, cela donne lieu à des mots « illisibles ».
Même s’il reconnait l’injustice et l’inégalité par rapport aux hommes que les femmes
ont souffert pendant siècles (dénoncée dans les recherches féministes en diverses disciplines),
il soutient qu’« aucun procédé n’y remédie moins que l’écriture inclusive ». À son avis,
l’écriture inclusive « appauvrit » le langage, et il la compare au « novlangue » de George
Orwell dans son roman 1984. En outre, il accuse l’écriture inclusive d’« attentat à la mémoire »
considérant que toute langue est une mémoire, et affirme que l’effacement de ces règles dites
« masculinistes » dans la langue, n’efface pas le sexisme dans la société. Quelques journaux se
sont faits écho des mots d’Enthoven, comme le Huffintongpost26 ou FranceCulture27. Par
conséquent, Les médias peuvent donc servir à amplifier les voix, les idées et les opinions de
certaines personnes qui participent à la vie publique, et réussisent une certaine reconnaissance
ou crédibilité face à la société.
Du point de vue institutionnel, l’Académie française est restée sans doute le bastion
principal contre la féminisation de la langue française. Pendant très longtemps, l’Académie a
adopté une attitude très conservatrice de la langue, notamment par rapport à l’écriture inclusive.
L’une des premières attestations de sa résistance à la féminisation de la langue c’est sa
Déclaration du 14 juin 198428 « rappelant le rôle des genres grammaticaux en français », en
réaction contre la Commission Groult et donc, contre la féminisation des noms de métiers et
de fonctions. L’Académie conclut dans le document l’insuffisance de la marque du féminin :
En français, la marque du féminin ne sert qu’accessoirement à rendre la
distinction entre mâle et femelle. [...] Tous ces emplois du genre grammatical
constituent un réseau complexe où la désignation contrastée des sexes ne joue qu’un
26
Disponible sur : https://www.huffingtonpost.fr/2017/09/26/pour-raphael-enthoven-lecriture-inclusive-releve-
du-negationnisme-vertueux_a_23223168/
27
Disponible sur : https://www.franceculture.fr/societe/ecriture-inclusive-le-feminin-pour-que-les-femmes-
cessent-detre-invisibles
28
Disponible sur : https://www.academie-francaise.fr/actualites/la-feminisation-des-noms-de-metiers-fonctions-
grades-ou-titres-mise-au-point-de-lacademie
13rôle mineur. Des changements, faits de propos délibéré dans un secteur, peuvent avoir
sur les autres des répercussions insoupçonnées. (2014 : 1)
Lors de la publication du manuel scolaire des Éditions Hatier en écriture inclusive, une
nouvelle déclaration sur ce sujet a été rédigée par « les Immortels » le 26 octobre 2017,
l’accusant de « péril mortel » pour la langue et s’y opposant complètement. Le lendemain,
Dominique Bona, académicienne depuis 2013, renfonce cette dénonce sur FranceCulture:
l’écriture inclusive « porte atteinte à la langue elle-même » 29. Néanmoins, quinze jours après,
dans un entretien accordée à Libération, c’est la propre Bona qui commence à parler la
nécessité de « rouvrir le débat sur la place du féminin dans la langue française » 30 au sein de
l’Académie française.
Le manque d’unanimité de l’Académie à propos d’une possible réforme de la langue
française devient de plus en plus évident. Le 13 décembre 2017, Raphaëlle Rérolle, journaliste
au Monde depuis 1986 et rédactrice en chef-adjointe au Monde des Livres, aborde la
perspective de l’Académie dans son article « Ecriture inclusive : malaise à l’Académie
française » (13/12/2017)31, sur la fracture ouverte au sein de l’Académie, présentant Hélène
Carrère d’Encausse, comme le principal pilier contre la féminisation de la langue :
Derrière la bannière de leur secrétaire perpétuel, Hélène Carrère d’Encausse –
qui refuse de féminiser son titre (et d’en parler avec Le Monde) –, les sages du quai de
Conti ne sont pas unanimes sur tous les aspects d’une hypothétique réforme. Certains
profitent aussi de l’occasion pour faire souffler un petit vent de contestation sur le
fonctionnement de l’Académie.
Le 28 février 2019, l’Académie française s’exprime enfin sur la féminisation des noms
de métiers et de fonctions, en adoptant à majorité un rapport32 présenté par une commission
d’étude comprenant quatre de ses membres : Gabriel de Broglie, Michael Edwards, Dominique
Bona et Danièle Sallenave33. Une semaine auparavant, Bona, chargée de ce dossier, met en
29
Disponible sur : https://www.franceculture.fr/societe/dominique-bona-de-l-academie-francaise-l-ecriture-
inclusive-porte-atteinte-a-la-langue-elle-meme
30
Disponible sur : https://www.liberation.fr/debats/2017/11/13/dominique-bona-l-academie-francaise-devrait-
rouvrir-le-debat-sur-la-place-du-feminin-dans-la-langue-_1609811/
31
Disponible sur : https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/12/13/ecriture-inclusive-malaise-a-l-academie-
francaise_5228736_3232.html
32 Rapport disponible sur : https://www.academie-francaise.fr/sites/academie-
francaise.fr/files/rapport_feminisation_noms_de_metier_et_de_fonction.pdf
33
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/28/l-academie-francaise-se-resout-a-la-feminisation-des-
noms-de-metiers_5429632_3224.html
14valeur l’ouverture et la tolérance qui, à son avis, caractérisent ce rapport34. Dans un entretien
sur TV5 Monde, c’est Sallenave qui défend la nécessité de « se lier à l’état des évolutions de la
société », favorable à la visibilité des femmes et consciente que cette visibilité « ne s’imposera
totalement que si les noms de leurs fonctions et de leurs métiers sont féminisés » 35.
À l’heure actuelle, l’Académie française s’est prononcée le 7 mai 2021 dans le cadre du
débat sur l’interdiction de l’usage des points médians dans l’enseignement, par sa Lettre
ouverte sur l’écriture inclusive36, dans laquelle l’écriture apparaît comme source de
problèmes :
L’écriture inclusive trouble les pratiques d’apprentissage et de transmission de la langue
française, déjà complexes, en ouvrant un champ d’incertitude qui crispe le débat sur des
incantations graphiques. (Annexe 8)
34
Entretien disponible sur : https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2019/02/20/37002-
20190220ARTFIG00028-dominique-bona-la-feminisation-permettra-aux-femmes-de-sortir-d-un-malaise-
linguistique.php
35
Entretien disponible sur : https://information.tv5monde.com/terriennes/titres-et-metiers-au-feminin-l-
academie-francaise-valide-286408
36
Disponible sur : https://www.academie-francaise.fr/actualites/lettre-ouverte-sur-lecriture-inclusive
152. La contribution du mouvement féministe à la féminisation du langage
Au cours de l’histoire, la langue française a subi des modifications d’ampleur variable
parmi lesquelles, selon Éliane Viennot, certaines ont eu le but de renforcer la « plus grande
noblesse du sexe masculin » (2014 : 101). Depuis quelques décennies, ces modifications et
interventions, encore défendues par un secteur non négligeable de l’opinion publique
contemporaine, trouvent l’opposition explicite d’un autre secteur sensible à une approche plus
ouverte du discours qui consiste à rendre compte du genre37 et, donc, rendre plus visible les
femmes et le féminin dans l’utilisation de la langue.
La non-représentation des femmes dans la langue française a entraîné progressivement
leur effacement dans « l’imaginaire populaire ». Dans le numéro de la revue Les Cahiers du
GRIF, Langage et féminisation de la langue (1992), Marcelle Marini affirmait que l’apport
fondamental de la recherche féministe consistait, précisément, à « rendre visibles la production
littéraire des femmes et leurs places (réelle mais passée sous silence) dans la culture
commune » (1992 : 137). À la mort de Marini en 2007, Christine Planté38 a rappelé que cette
universitaire, qui a collaboré à la fondation en 1989 du centre interdisciplinaire CEDREF
(Centre d’enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes), des
Cahiers du GRIF, puis les Cahiers du CEDREF, a pris une part active aux débats sur le
renouvellement de l’enseignement et de la parole (Planté, 2007 : 230). Les contributions de
Marini39, responsable d’analyses importantes dans des domaines encore peu travaillés dans la
recherche féministe française, comme la langue, et ses réflexions sur « le neutre, la
37
La notion de genre renvoie dans son usage actuel, renvoie aux « ensembles de rôles sociaux, sexués et système
de représentation définissant le masculin et le féminin » (définition de Françoise Thébaut publiée dans Les mots
de l’Histoire des femmes, 2004). Dans le(s) discours(s) féministe(s), la notion de genre s’avère fondamentale.
Dans l’article « Le genre et les études féministes françaises : une histoire ancienne », Isabelle Clair et Jacqueline
Heinen abordent l’histoire du terme genre avec une perspective rétrospective. Introduit en France à partir des
années 1990, genre sert très souvent à reprendre d’autres concepts des années 1970-80 tels que « rapports
sociaux » ou « patriarcat ». Sa polysémie actuelle produit souvent débat et polémique, tout comme de possibles
malentendus (2013 : 1).
38
Christine Planté est professeure émérite de littérature française et d’études sur le genre à l’Université Lyon II,
membre de l’unité de recherche LIRE XVIIIe-XIXe siècles, co-responsable des études Masculin/Féminin à
l’Université Lumière-Lyon 2.
39
Outre ces données, Marcelle Marini a participé à la fondation de l’UFR Sciences des textes et documents (STD)
de l’Université de Paris 7, où elle a enseigné jusqu’en 1992. Elle est aussi l’auteure de plusieurs ouvrages sur le
féminisme dans le monde, les femmes et leur place au sein du savoir, a également traité la thématique de
« l’écriture féminine ». Elle est l’auteure de textes considérés essentiels comme ses Territoires du féminin. Avec
Marguerite Duras, en 1977 (Paris : Minuit), les numéros spéciaux des Cahiers du CEDREF Femmes/sujets des
discours, en 1990 et Continuités et discontinuités du féminisme, en 1995, entre autres, ou son chapitre sur « La
place des femmes dans la production culturelle » dans le vol. 5 de L’Histoire des femmes en Occident. Le XXe
siècle en 2002 (projet codirigé par Georges Duby et Michelle Perrot qui a contribué à l’émergence de l’histoire
des femmes, publié par Plon).
16différentiation, l’indifférenciation et la question du symbolique », demandaient « un certain
courage intellectuel dans l’université française des années 1970 et 80, peu favorable au
féminisme » (Planté, 2007 : 230).
En fait, le féminisme poursuit une remise en valeur du statut des femmes dans la société,
à travers une remise en question de la langue et de son usage en société. Il est donc intéressant
d’analyser quelles sont les demandes et les propositions féministes pour réussir un langage et
une écriture non-sexistes.
2.1. Point de départ : femmes et langage
La situation sociale en France a beaucoup changé et évolué tout au long de l’histoire.
Par contre, les capacités des femmes pour gouverner, pour combattre et même pour exercer
certains métiers prestigieux et considérés donc masculins, a été toujours remise en question par
l’hégémonie engendrée par la dite « masculinité hégémonique »40, concept propre à la
sociologie du genre et développé par Raewyn Connell dans le cadre d’une « théorie des
rapports de genre » [social theory of gender] (1995 : 76 et ss.)41, est lié à une idée féministe
fondamentale. D’une part, le concept d’hégémonie me semble « indéniablement utile »,
comme Raewyn Connell (2015) affirme, « pour penser les rapports de genre et surtout la
manière dont les structures de pouvoir genré opèrent, se stabilisent et se modifient » ; d’autre,
l’hégémonie ne cesse de se construire, de se renouveler et d’être contestée », ce qui arrive avec
le discours féministe, qui le met en question dès le début.
Selon le récit proposé par Éliane Viennot, le genre masculin a été longtemps regardé
comme le genre le plus « noble », et un groupe d’intellectuels s’est occupé à modifier la langue
pour qu’elle puisse représenter cette idée de supériorité et de prédominance du masculin sur le
féminin (2014 : 65). Par exemple, la règle qui affirme que « le masculin l’emporte sur le
féminin » a effacé la règle grammaticale de l’accord de proximité, qui était logique et simple.
40
Ce concept, propre à la sociologie du genre, est développé par Raewyn Connell dans le cadre d’une « théorie
des rapports de genre » [social theory of gender] (1995: 76 et ss.), est lié à une idée féministe fondamentale. D’une
part, le concept d’hégémonie me semble « indéniablement utile », comme Raewyn Connell (2015) affirme, « pour
penser les rapports de genre et surtout la manière dont les structures de pouvoir genré opèrent, se stabilisent et se
modifient »; d’autre, l’hégémonie ne cesse de se construire, de se renouveler et d’être contestée », ce qui arrive
avec le discours féministe, qui le met en question dès le debut.
41
Cf. également son article « Hégémonie, masculinité, colonialité » (trad. Joëlle Marelli ». Genre, sexualité &
société [en ligne], 13, printemps 2015 [URL : https://journals.openedition.org/gss/3429], consulté le 13 mai 2021.
17Vous pouvez aussi lire