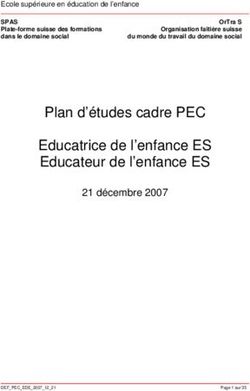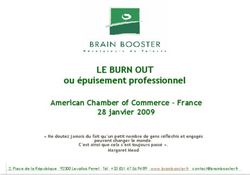Penser Salman Rushdie - Numilog
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Penser
Salman Rushdie
coordonné par DANIEL SALVATORE SCHIFFER
DOMINIQUE BAQUÉ / STÉPHANE BARSACQ / TAHAR
BEN JELLOUN / SHANI BENOUALID / VÉRONIQUE
BERGEN / JEANNETTE BOUGRAB / PASCAL
BRUCKNER / SOPHIE CHAUVEAU / CATHERINE
CLÉMENT / ÉRIC FOTTORINO / RENÉE FREGOSI /
NATHALIE HEINICH / ISABELLE DE MECQUENEM /
PIERRE MERTENS / EDGAR MORIN / VÉRONIQUE
NAHOUM-GRAPPE / CHRISTIANE RANCÉ / ROBERT
REDEKER / GUY SORMAN / PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF /
MICHEL TAUBE / VALÉRIE TRIERWEILER / PHILIPPE
VAL / OLIVIER WEBER / JEAN-CLAUDE ZYLBERSTEIN
l’aubePenser Salman Rushdie
La collection Monde en cours
est dirigée par Jean Viard
Ouvrage édité
par Laurent Cohen et Jean Viard
© Éditions de l’Aube
et Fondation Jean-Jaurès, 2022
www.editionsdelaube.com
ISBN 978-2-8159-5377-1Penser Salman Rushdie
coordonné par Daniel Salvatore Schiffer
Dominique Baqué, Stéphane Barsacq, Tahar Ben Jelloun,
Shani Benoualid, Véronique Bergen, Jeannette Bougrab,
Pascal Bruckner, Sophie Chauveau, Catherine Clément,
Éric Fottorino, Renée Fregosi, Nathalie Heinich,
Isabelle de Mecquenem, Pierre Mertens, Edgar Morin,
Véronique Nahoum-Grappe, Christiane Rancé,
Robert Redeker, Guy Sorman, Pierre-André Taguieff,
Michel Taube, Valérie Trierweiler, Philippe Val,
Olivier Weber, Jean-Claude Zylberstein
éditions de l’aube
fondation jean-jaurès
Aux victimes du terrorisme islamiste
comme de toute barbarie politico-religieuse
Introduction
Salman Rushdie ou le sens d’une œuvre :
liberté, humanisme, tolérance
« Quelle foi politique rendra compte de la
souffrance du monde ? […] Quelle foi politique
rendra compte de la mort ? »
André Malraux, La Condition humaine
12 août 2022, Chautauqua Institution, centre culturel situé
dans l’État de New York : Salman Rushdie, écrivain anglo-
américain d’origine indienne, âgé de soixante-quinze ans, est
grièvement blessé, sauvagement poignardé au cou et dans l’ab-
domen, alors qu’il s’apprête à donner une conférence sur scène,
trente-trois ans après qu’une fatwa, décret de mort à durée indé-
terminée (« éternelle » dans le langage islamiste), a été émise
à son encontre le 14 février 1989, assortie d’une récompense
de trois millions de dollars pour son assassin, par l’ayatollah
Khomeyni, ancien Guide suprême de la République islamique
d’Iran. Son hypothétique crime, aux yeux de ces fanatiques
religieux d’un autre âge ? S’être rendu coupable, tout à la fois,
de « blasphème » et d’« apostasie », transgressions religieuses
toutes deux sanctionnées par la peine de mort selon l’interpré-
tation la plus extrémiste de la loi coranique, et plus précisément
de l’obscurantiste charia, sa lecture la plus littérale, pour avoir
9Daniel Salvatore Schiffer
écrit et publié, à travers le monde, ses Versets sataniques, livre
très vite devenu, suite à sa publication en 1988, une des œuvres
de fiction – un roman, en aucun cas un essai à thèse – les plus
universellement célèbres1.
C’est donc pour défendre Salman Rushdie, son œuvre tout
autant que sa pensée, mais aussi, plus généralement et par-delà
même son cas spécifique, nos valeurs démocratiques en leur
ensemble, faites de principes théoriquement universels (comme
la vérité ou la justice), que les auteurs de cet ouvrage collectif,
dont j’ai ici l’honneur de diriger la publication à travers des textes
récents ou nouveaux, et pour la plupart inédits, manifestent
ouvertement leur admiration pour l’écrivain en tant que tel, en
même temps qu’ils soutiennent sans réserves l’homme persécuté
par la barbarie islamiste, même s’ils ne confondent certes pas ces
deux plans, a priori distincts, d’analyse ni d’action2.
Ainsi ces intellectuels, ardents défenseurs de la libre pensée
et de la réflexion critique, des droits de l’homme et de la femme,
face à cette agression abjecte, en tous points contraire à l’esprit
de tolérance, à la liberté de parole comme de conscience ou de
création, au respect des idées et au sens même de la démocratie,
expriment-ils ici, aux seuls mais glorieux noms de la liberté, de
l’humanisme et de la tolérance, leur entière solidarité, leur sou-
tien moral et leur compassion humaine envers Salman Rushdie,
l’un des exemples les plus éminents, estimables et courageux de la
lutte contre toute forme de totalitarisme, de dogmatisme ou d’in-
tégrisme, qu’ils soient politiques, idéologiques ou théologiques.
C’est également là, par-delà la tragédie d’un acte aussi épou-
vantable, par-delà même ce danger permanent que représente la
menace du terrorisme islamiste, ainsi que nous en avons mal-
heureusement fait auparavant aussi la douloureuse expérience
lors des sanguinaires attentats de Charlie Hebdo, de l’Hyper
Cacher, du Bataclan, de Nice, de Bruxelles ou du World Trade
Center de New York, un enjeu, planétaire, de civilisation :
civilisation dont, lucides et vigilants, ces auteurs défendront
partout et toujours, inlassablement, les inaliénables principes
10Introduction
comme les imprescriptibles valeurs, démocratiques aussi bien
qu’éthiques. Telle est la raison, précisément, pour laquelle cet
ouvrage collectif, conçu comme une mosaïque autour de la per-
sonnalité, mais surtout de la pensée aussi bien que de l’œuvre
de Samuel Rushdie, peut se prévaloir ici, au vu de l’importance
du sujet traité comme de la diversité des thèmes abordés ou de
la variété des styles privilégiés, d’une telle qualité, chacun dans
son domaine respectif et sa sphère de compétence, d’auteurs,
par-delà même leur crédibilité professionnelle, leur prestige indi-
viduel ou leur renommée institutionnelle. Quant à leurs textes,
ils ont été répartis ou classifiés sur le plan méthodologique, mais
afin d’en faciliter également une identification plus pragmatique,
en fonction de leur genre ou teneur, en trois catégories distinctes,
bien que celles-ci se recoupent ou se chevauchent même parfois,
ainsi que l’indique clairement leur intitulé successif : I, « Pour
Salman Rushdie » ; II, « L’œuvre et la pensée » ; III, « Débat cri-
tique ». Leurs auteurs, eux, y apparaissent, au sein de chacun de
ces groupes, par ordre alphabétique.
Salman Rushdie, ainsi : un écrivain qui, par sa dimension
intellectuelle tout autant que par sa notoriété internationale, a sa
place, assurément, aux côtés de quelques-uns des plus beaux et
grands esprits des xxe et xxie siècles, ses frères et sœurs d’âme
bien plus encore que d’armes (certes exclusivement scriptu-
rales), tels, pour ne mentionner ici que les plus connus d’entre
eux, Alexandre Soljenitsyne, Václav Havel, Günter Grass, Elie
Wiesel, Dobrica Ćosić, Alexandre Zinoviev, Umberto Eco,
Ismaïl Kadaré, Amos Oz, David Grossman, Orhan Pamuk,
Czesław Miłosz, Taslima Nasreen (elle aussi menacée de mort
par la fureur sanguinaire des islamistes de tout poil), Nadine
Gordimer, Toni Morrison, Doris Lessing, Svetlana Alexievitch,
Tom Wolfe, Patrick Süskind, Philip Roth, James Ellroy, Paul
Auster, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Paulo
Coelho, Gao Xingjian, Liu Xiaobo, Peter Handke, Roberto
Saviano et, surtout, autre géant de la littérature universelle,
Gabriel García Márquez, duquel il se rapproche le plus, sur le
11Daniel Salvatore Schiffer
plan littéraire, par cette caractéristique inhérente, tant par sa
forme que par son contenu, à son œuvre, qualifiée de « réalisme
magique » (à qui l’on pourrait aussi joindre un autre écrivain
majeur, certes moins baroque stylistiquement et plus cérébral
analytiquement, au sein de la littérature sud-américaine, Jorge
Luis Borges).
Car, effectivement, Salman Rushdie est d’abord, par-delà
ce que l’on peut narrer de sa vie ou évoquer de sa carrière, un
écrivain : un romancier, plus précisément encore, et même, pour
tout dire, l’un des plus brillants, sinon féconds, de sa génération.
Davantage : c’est avec la tradition du conte philosophique en sa
plus noble expression – celle, par exemple, que donnent à voir,
à l’illustre siècle des Lumières, le Candide et autre Zadig, de
Voltaire, ou, mieux encore, les bien nommées Lettres persanes, de
Montesquieu – que renoue le texte Les Versets sataniques qui vient
donc de le porter jusqu’aux portes, heureusement demeurées à ce
jour fermées pour lui, de la mort.
Mais que raconte, au fond, afin de lever une bonne fois pour
toutes l’énorme malentendu en la matière, cette œuvre de pure
fiction, située, intellectuellement parlant, aux seuls mais riches
confins de l’imaginaire romanesque, voire poétique, et de la thèse
philosophique, voire, fût-ce de loin, théologique ? C’est ce qui
reste à expliquer au lecteur non encore averti quant à cette ques-
tion d’ordre herméneutique, sinon épistémologique.
Des « Versets sataniques » en forme de conte philosophique
Quelques très synthétiques mots, donc, concernant le
contenu, en un bref résumé, ici, de ces fameux, et bien inof-
fensifs pour les trop rares esprits qui les ont véritablement lus,
Versets sataniques. C’est l’écrivaine, journaliste et réalisatrice
Abnousse Shalmani, dissidente d’origine iranienne et spécialiste
de l’œuvre rushdienne, qui nous en fournit, dans un court mais
instructif entretien qu’elle accorda à France Info (l’une des radios
les plus écoutées du pays) au lendemain même (13 août 2022) de
12Introduction
cette tentative d’assassinat, l’éclairage le plus pertinent. De fait,
y déclare-t-elle, textuellement :
Seulement un tiers du roman concerne un prophète qui
s’appelle Mahmoud et où sont repris les versets sataniques
qui apparaissent dans le Coran. Au moment de la Révélation,
Mahmoud va voir l’ange Gabriel qui lui dit qu’il faut vivre
en bonne entente avec les autres religions polythéistes.
Mais quand Mahmoud descend de sa montagne, il se rend
compte que l’ange Gabriel était en fait Satan déguisé. Gabriel
explique alors qu’il n’y a qu’une foi et qu’il faut convertir tout
le monde.
Abnousse Shalmani, dans la foulée, poursuit, en des propos
non moins adéquats quant à l’esprit présidant à ce qui n’est donc
là, en réalité, qu’un roman et, de surcroît, en forme de fable :
Salman Rushdie imagine alors ce qu’il se serait passé si l’ange
Gabriel n’était jamais revenu, si c’était Satan qui avait pris sa
place et si le Coran était composé de versets sataniques. C’est
un travail d’imaginaire. Il se relie ainsi à la tradition islamique
de l’ijtihad, la tradition de l’interprétation personnelle [des
textes sacrés]. L’ijtihad a été remis en question entre le xie et
le xiiie siècle. Cela a été la fin de la pensée critique. C’est à
ce moment-là que le monde arabo-musulman a commencé
à se fermer.
Et, plus incisive encore dans ce lumineux commentaire, de
conclure :
Salman Rushdie rouvre l’interprétation personnelle. Il se
replace dans une tradition islamique qui est celle des « et
si ».
Il se rapproche de ce qu’est le roman, de ce qu’est la
littérature, de ce qu’est l’interprétation personnelle, la liberté
de l’homme3.
13Daniel Salvatore Schiffer
Ainsi, au vu de semblable exégèse, concise mais capitale pour
bien comprendre, à sa juste valeur et réelle portée, l’esprit dans
lequel ont été écrits ces Versets sataniques, est-on autorisé à en
inférer, très légitimement, que ce à quoi Salman Rushdie se livre
en fait là, en cette création essentiellement littéraire, purement
imaginaire et fictive, n’est autre que ce que fit en effet Voltaire,
lumière d’entre les Lumières, lorsqu’il inventa, au faîte de son
génie intellectuel comme de son talent stylistique, ses contes
philosophiques, tels donc Candide ou Zadig. Mieux : c’est, contre
tout fanatisme idéologique, tout fondamentalisme religieux ou
tout intégrisme fidéiste, un authentique appel à la tolérance,
à l’intense mais bienveillant débat d’idées tout autant qu’au res-
pectueux pluralisme des croyances – une sorte d’« œcuménisme
neutre », sinon de « transcendance laïque », pour faire bref tout
en demeurant néanmoins rigoureux – que Rushdie lance ici très
loyalement, à l’instar, une fois encore, de Voltaire dans son indé-
passable, et plus prégnant que jamais à l’aune de cette dramatique
actualité à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui, Traité
sur la Tolérance !
Mais celui à qui le prophète Mahmoud, dans ces Versets sata-
niques de Rushdie, fait inévitablement songer, c’est, en premier
lieu, au Zarathoustra de Nietzsche, cet ermite avide de quête
spirituelle et à la fois « surhomme » (préfiguration, après avoir
annoncé « la mort de Dieu », de son ultérieur Antéchrist) qui,
nanti lui aussi d’une indéfectible sagesse philosophique après
s’être longtemps exilé, loin du tumulte de toute société, au som-
met d’une montagne quasiment inaccessible pour le commun des
mortels, en redescend, après une retraite de dix ans, afin de mieux
dispenser ainsi à ses semblables, tel un maître supérieur d’intel-
ligence (à l’égal d’un Siddhartha – qu’Hermann Hesse, l’un des
écrivains les plus représentatifs de la Mitteleuropa, magnifia en
un roman resté célèbre –, précurseur de Bouddha), les précieux
enseignements, recueillis dans ce qu’il nomme la « transmutation
des valeurs », de son expérience humaine et, surtout, intérieure :
une critique radicale, dans le sillage de l’éthique spinoziste, de
14Introduction
la morale judéo-chrétienne, que Salman Rushdie, fort de cette
impérieuse leçon de vie, libre de tout préjugé et donc émancipa-
trice de tout carcan, transposera, quant à lui, au niveau de l’islam.
Un islam, tenons-nous toutefois à préciser ici, dont l’immense
et riche culture, pour laquelle nous nourrissons évidemment le
plus profond respect, n’est certes pas à confondre, loin de là, avec
l’islamisme, qui n’en est malheureusement, par son outrancière
radicalité dans l’interprétation de ses textes sacrés et du Coran en
particulier, que le criminel et sectaire dévoiement philosophico-
théologique, sinon politique : l’islamo-fascisme, comme nous le
définirons à regret, mais pour d’autant mieux le dénoncer intel-
lectuellement et le condamner tout à la fois, avec la plus grande
et énergique fermeté, idéologiquement ! A fortiori lorsque, cir-
constance d’autant plus accablante en cette indicible barbarie,
son terrorisme tue, aveuglément ou sciemment !
D’où, problématique mais néanmoins indispensable au vu
de la gravité de la situation, sinon de l’importance de la menace
planant quotidiennement au-dessus de nous, cette interrogation :
l’islamisme ne serait-il donc fort, du moins en Occident, que
de la faiblesse, ou plus exactement de la vulnérabilité, à défaut
de véritable fragilité, de nos démocraties ? Répondre par l’affir-
mative s’avérerait certes délicat, dans la mesure où semblable
position philosophique pourrait facilement servir, hélas, d’indu
et dangereux alibi, avec tout ce que pareil procédé intellectuel
comporte de fallacieux idéologiquement, pour un pouvoir poli-
tique soucieux de mettre avant tout en place, au sein même de
nos sociétés, une dictature tout aussi suspecte et de non moins
mauvais aloi. Éviter donc à tout prix, quoi qu’il advienne, l’insi-
dieux et contreproductif piège, nonobstant la périlleuse islami-
sation – c’est, nous le constatons chaque jour davantage, un fait
indéniable, malgré notre compréhensible réticence à l’admettre –
de notre culture, sinon de notre civilisation, et par-delà même le
bien-fondé de pareille crainte, en cédant malencontreusement,
par la pire des manœuvres dilatoires, à la tentation totalitaire,
désastreuse conséquence en même temps qu’effet pervers de
15Daniel Salvatore Schiffer
discours souvent aussi démagogiques ou hâtifs qu’hypocrites
ou malsains ! Mais il n’empêche : la question, aussi nécessaire
qu’urgente, mérite à l’évidence, mue là par une lucidité que l’on
désirerait certes salvatrice, d’être objectivement, rationnellement
et non émotionnellement, posée, quoique devant donc être dotée
là, en la circonstance, de toutes les précautions oratoires, comme
de la prudence méthodologique aussi bien que des nuances
conceptuelles, d’usage à telle et pénible enseigne.
L’avertissement, il y a près de deux cents ans, du grand poète
Heinrich Heine s’avère hélas aujourd’hui, comme en 1933 avec
le gigantesque autodafé des nazis, d’une dramatique, récurrente,
mais non moins écœurante, actualité : « Là où l’on brûle les
livres, on finit aussi par brûler des hommes. » À méditer, plus
que jamais, en ces jours de malheur où nous nous tenons donc,
fermes et résolus, aux côtés de cet universel symbole de la liberté
qu’est Salman Rushdie !
Il n’y a toutefois pas, dans ses Versets sataniques, par ailleurs
non dénués également d’un capiteux mais délicieux parfum
d’exotisme, que d’indubitables traces de Voltaire, et du meilleur
cru, voire de Montesquieu ou même du Diderot de La Religieuse
et autres Jacques le Fataliste ou Bijoux indiscrets. Un lecteur
attentif, exigeant et informé pourra aussi y déceler, comme dans
l’ensemble de l’œuvre rushdienne (romans, nouvelles et essais
confondus) – des Enfants de minuit, parus en 1981, à Joseph
Anton : une autobiographie, publié en 2012 (et qui explique,
notamment, la genèse de son œuvre précisément), en passant par
La Honte (1983), Le Sourire du Jaguar (1987), Le Dernier Soupir
du Maure (1995), La Terre sous ses pieds (1999), Furie (2001),
Shalimar le Clown (2005) ou L’Enchanteresse de Florence (2008) –,
de non moins évidentes influences de quelques-uns des esprits
les plus éclairés au sein de notre culture occidentale, du Moyen
Âge à l’Âge classique, en passant par la Renaissance, dont, émer-
geant au premier rang et parfois même émaillés d’une invincible
dose d’humour par-delà leur aspect souvent tragique, le Dante
de La Divine Comédie (qui inspira jusqu’à la monumentale Porte
16Introduction
de l’Enfer de Rodin), le Pétrarque du Canzoniere, le Boccace du
Décaméron, l’Arioste du Roland furieux, l’Arétin des Sonnets luxu-
rieux, le Tasse de la Jérusalem délivrée, le Sebastian Brant de La
Nef des fous, l’Érasme de l’Éloge de la Folie, le Thomas More de
L’Utopie, le Giordano Bruno du Candelaio (comédie qui lui valut,
jusqu’à la condamnation au bûcher, les foudres de l’Inquisition),
le Rabelais de Gargantua en sa très libertaire abbaye de Thélème,
le Cervantès de l’épique Don Quichotte, le Cyrano de Bergerac
(l’un des maîtres du libertinage érudit) de l’Histoire comique des
États et Empires de la Lune et autre analogue Histoire comique des
États et Empires du Soleil, le John Milton du nostalgique Paradis
perdu ou encore le Michel-Ange d’une fresque telle que le colos-
sal Jugement dernier au sein de la chapelle Sixtine, chef-d’œuvre
d’entre les chefs-d’œuvre. Certains de nos plus grands poètes
romantiques (ou même préromantiques), anglais et allemands
surtout, ne manquent pas non plus, en cette éblouissante pro-
cession d’aèdes, à l’appel, notamment, William Blake avec son
Mariage du Ciel et de l’Enfer (qui marqua un courant pictural tel
que le préraphaélisme), Shelley (voir sa prodigieuse Révolte de
l’Islam ou, encore, un pamphlet tel que La Nécessité de l’athéisme,
auquel s’ajoutent des écrits aussi séditieux que The Devil’s Walk
et A Refutation of Deism) et lord Byron (lequel, surnommé le
« diable boiteux » en raison de son pied bot et de ses mœurs
dissolues, à l’instar de son subversif Don Juan plus encore que du
Don Giovanni de Mozart, fut également étudiant, tout comme
Rushdie, à l’université de Cambridge) ou, plus flagrant encore, le
Goethe du mythique Faust, figure emblématique (qui inspirera,
en musique, des compositeurs aussi grandioses que Berlioz avec
sa Damnation de Faust et Liszt avec sa Faust-Symphonie, ou, par-
ticulièrement flamboyant dans l’histoire de l’art, Delacroix avec
son Faust et Méphistophélès) du diable incarné, quoique sa toute
première apparition au sein de la littérature européenne remonte
au xvie siècle déjà, dans une pièce de théâtre, La Tragique
Histoire du docteur Faust, de Christopher Marlowe, dramaturge
élisabéthain contemporain de Shakespeare. Oscar Wilde, d’une
17Daniel Salvatore Schiffer
certaine manière, le réactualisa, en pleine ère victorienne, avec
son somptueux Portrait de Dorian Gray, récit dans lequel son tra-
gique héros s’avère lui aussi en quête d’une éternelle jeunesse et
immortelle beauté, tandis que Thomas Mann, dans la première
moitié du xxe siècle, en fera une adaptation romanesque particu-
lièrement réussie avec son Docteur Faustus : l’histoire d’un musi-
cien qui, suivant en cela son fabuleux modèle goethien, vendit,
lui aussi, son âme au diable afin de conserver intactes jeunesse et
beauté, mais qui, fatalement, finit par périr, châtié, sous l’abo-
minable férule du nazisme. Dostoïevski, en ce qui concerne la
littérature russe du xixe siècle, ne fut pas, lui non plus, en reste à
ce propos, ainsi que le donnent à lire ses conflictuels Possédés. Et
puis, comment ne pas oublier, en ce superbe éventail des pour-
fendeurs de toute intolérance religieuse (catholique, protestante
ou orthodoxe, plus que, la nuance est de taille, chrétienne), le
Baudelaire, dandy et « maudit », des Fleurs du mal, flanquées là
de ses très impies Litanies de Satan, le Rimbaud, à peine moins
transgressif, d’une Saison en enfer, la George Sand de la Mare au
diable (inspirée par une gravure tirée des Simulacres de la Mort,
de Holbein), ou, peut-être plus sulfureux encore sur ce plan-là,
le Barbey d’Aurevilly, chantre décadent d’une certaine esthétique
« sataniste » (aux côtés d’un peintre aussi excentrique que le sym-
boliste Félicien Rops, influencé par les médiévales visions cau-
chemardesques, sinon apocalyptiques, d’un Jérôme Bosch), des
Diaboliques ? Et que dire, enfin, de récits aussi spirituellement
tourmentés, et pourtant aussi fascinants sur le plan psychologique
que captivants à l’échelon narratif, que, pour ne s’en tenir ici qu’à
la littérature française de la première moitié du xxe siècle, la tri-
logie des Mystères, de Péguy ; Les Caves du Vatican, de Gide ; Sous
le soleil de Satan, de Bernanos ; Le Diable au corps, de Radiguet ;
Le Démon du bien, de Montherlant ; La Pharisienne, de Mauriac ;
Pour en finir avec le jugement de Dieu, d’Artaud ; Le Diable et le
Bon Dieu et autre Saint Genet, comédien et martyr, de Sartre, ou
encore Théorie de la religion et même Histoire de l’œil de ce para-
doxal « mystique sans Dieu », selon l’oxymorique mais judicieux
18Introduction
mot de Malraux, que fut Georges Bataille ? Le plus iconoclaste
des livres, toutefois, à cet infernal sujet ? Le Diable (Il Diavolo),
de Giovanni Papini, penseur italien injustement négligé nonobs-
tant ses dommageables et même répréhensibles accointances,
parfois, avec le fascisme mussolinien !
D’autre part, Satan lui-même, que la Bible, et en particulier
l’Ancien Testament dans le prophétique Livre d’Isaïe (cha-
pitre 14, versets 12-14) appelle également Lucifer – syntagme
nominal d’origine latine, composé du substantif lux (« lumière »)
et du verbe ferre (« porter »), signifiant littéralement, dans cet
ancien idiome, « porteur de lumière » – n’est-il pas présenté,
toujours par les Saintes Écritures, comme la toute première,
mais surtout très séduisante, créature de Dieu, avant même qu’il
ne devienne par la suite, au terme de cette sorte de fraude théo-
logique, un ange rebelle et, finalement, par cette suprême faute
religieuse que constitue pareil acte de désobéissance, déchu ?
Ainsi, pour en revenir de façon plus circonstanciée, par-delà
même la richesse tout autant que l’abondance de ces impor-
tantes références littéraires et artistiques, au sujet qui nous pré-
occupe directement ici, est-ce donc un livre, le nôtre, dont le
titre, Penser Salman Rushdie, indique d’emblée, en ce crucial et
libre débat d’idées où nulle censure n’a été imposée ni aucune
contrainte préétablie, qu’il s’agit ici aussi, indépendamment de
tout clivage idéologique comme de toute orientation politique,
par-delà même les hommages rendus ou les souvenirs évoqués,
et a fortiori notre légitime sentiment d’indignation, de révolte
ou de solidarité face au drame humain dont vient donc d’être
victime l’insigne auteur des Versets sataniques, d’une réflexion
plus approfondie, d’une analyse plus articulée et d’une étude plus
argumentée, tant sur le plan philosophique qu’éthique, sans rien
négliger en outre de son contexte historique ni de son environne-
ment sociologique, quant à la marche, trop souvent claudicante,
du monde contemporain : ce monde au regard duquel il incombe
impérativement et, en première instance, aux intellectuels pré-
cisément – penseurs de tous bords (non extrémistes, certes) ou
19Daniel Salvatore Schiffer
de toutes confessions (non fanatiques, bien entendu) – d’être,
plus que jamais aujourd’hui au vu de cette tragique actualité, les
vigilantes sentinelles afin qu’il ne verse point, justement, en une
quelconque anarchique et chaotique dérive totalitaire, sinon fas-
cisante, voire tyrannique.
Car, pour employer ici une analogie au regard de cette admi-
rable forme de Résistance, les méritoires opposants d’aujourd’hui
à l’islamisme ne sont-ils pas, d’une certaine façon, comparables,
par l’héroïque vaillance de leur combat, quoique avec les aména-
gements politico-idéologiques de circonstance, aux non moins
louables dissidents d’hier du stalinisme, et bien plus encore,
certes toutes proportions gardées dans la mesure où la Shoah fut
un crime unique dans les annales de l’(in)humanité, du nazisme ?
Conclusion, quant à la pensée aussi bien qu’à l’œuvre rush-
diennes ? Honneur une fois encore, n’en déplaise à ses détrac-
teurs, ennemis ou assassins, à Rushdie, indissoluble mixte
d’intelligence et de sensibilité, précieuse synthèse de cœur et de
raison, comme, particulièrement bien inspiré lui aussi, le prônait
déjà également, à l’Âge classique, Blaise Pascal dans ses Pensées.
La conscience propre : le seul tribunal qui vaille ! Liberté,
humanisme, tolérance : trois valeurs morales en même temps que
trois principes universels sans lesquels, ainsi qu’il a été souligné
dès le début de cette introduction au présent ouvrage, il n’est pas
de démocratie qui tienne !
Salman Rushdie ou, donc, en effet, le génie humain, plus
encore qu’intellectuel, à portée d’œuvre !
Daniel Salvatore Schiffer
Philosophe, écrivain,
professeur de philosophie de l’artI Pour Salman Rushdie
Pour Salman Rushdie
La seule fois où j’ai discuté avec Salman Rushdie, ce fut
quelques jours après l’attentat qui a frappé New-York en sep-
tembre 2001. Son nom était déjà très célèbre. Qu’il ait pu être
attaqué à New York précisément, en août 2022, nous a tous
révoltés : comment un tel écrivain peut-il être victime d’une
haine telle qu’elle soit inexpiable ? On sait que Spinoza fut aussi
attaqué au couteau, et qu’il en réchappa aussi, non sans garder à
l’esprit toute sa vie ce dont sont capables « les passions tristes ».
En attaquant Salman Rushdie, son agresseur savait-il ce qu’il
faisait ? Agissait-il par aveuglement ? Mû par l’appât de l’argent ?
Par désir suicidaire ? Qu’importe. Une chose est sûre : de Salman
Rushdie, il n’avait lu aucun roman. Si on considère l’histoire de
l’islam, on sait que certains de ses plus hauts esprits, poètes ou
mystiques, n’y ont pas toujours rencontré une forte mansuétude
– ce que j’écris, on l’imagine, par euphémisme. Je pense entre
autres à Rûmî comme à Sohrawardi d’Alep, mais aussi, naturel-
lement, à Hallâj, qui nous est connu grâce à Louis Massignon,
qui a médité sur la passion du Crucifié de Bagdad. Mais les trois
hommes que je viens de citer furent victimes de débats situés
à l’intérieur de la théologie. Le cas de Salman Rushie diffère
quelque peu : c’est un écrivain, un romancier. Autrement dit, c’est
quelqu’un qui est attaqué à l’intérieur non pas de la question reli-
gieuse, mais dans l’expression de son art. Et pourtant, nul n’ira
nier que l’islam, sur ses différents versants, n’ait d’art majeur, et
23Stéphane Barsacq
dans tous les domaines – des arts qui continuent à nous émouvoir.
Peut-être la forme du roman lui est-elle plus étrangère, comme
l’a suggéré Milan Kundera. Belle hypothèse. Mais je ne le crois
pas. Certes, au sortir du Moyen Âge, le roman, avec Rabelais,
inaugure cet âge de l’esprit où la fantaisie ne rend de compte
qu’à elle-même, en débordant les plans religieux et politique.
D’une certaine manière, toute l’histoire du roman est celle de
l’apprentissage de mythologies non religieuses qui viennent revi-
vifier les mythes. C’est, au choix, Don Quichotte, de Cervantès,
ou Simplicius Simplicissimus, de Grimmelhausen. À cet égard,
Salman Rushdie s’inscrit dans un arc commencé avec les fabliaux
et qui va jusqu’à James Joyce, lequel, soit dit entre parenthèses,
eut aussi maille à partir avec son pays, l’Irlande. La liste est longue
des écrivains mis à mort par les régimes politiques, à dater de la
Révolution : on a Chénier en France, Mandelstam en URSS, qui
écrivit d’ailleurs sur Chénier, sans compter les grands écrivains,
de Sade à Boulgakov ou à Soljenitsyne, qui furent en butte à la
censure. Dans le cas de Salman Rushdie, ce qui frappe, c’est la
profonde absurdité de sa condamnation, et que celle-ci non seu-
lement ne se soit pas éteinte avec le temps, mais qu’elle ait eu un
écho. Osons l’idée que Salman Rushdie a été attaqué non pour
ses réflexions religieuses, mais précisément pour tout le reste :
son talent, sa liberté, son sens de l’imagination, tout ce qui fait
de lui non pas un contempteur de telle ou telle religion, mais un
modèle à suivre pour se libérer. C’est dire si toute tentative de
mettre à mort un tel homme est par définition vouée à l’échec.
Me revient à ce propos un dialogue qu’on trouve dans la pièce
de Joyce au titre si parlant : Les Exilés (1918). À un moment, se
joue un dialogue entre un père et son fils. Le père demande au
fils s’il sait ce qu’il lui appartient ; à quoi le fils répond en don-
nant l’exemple de leur troupeau de moutons. Mais, corrige alors
le père, c’est faire erreur ; car ces moutons peuvent toujours être
volés, preuve qu’on ne possède jamais rien de ce qu’on croit avoir
sous la main, comme un objet ; et le père de dire : « C’est ce que
tu donnes qui est à toi, car personne ne peut te le reprendre. »
24Pour Salman Rushdie
À cet égard, Les Versets sataniques comme les autres œuvres de
Salman Rushdie sont inaliénables. Elles ne pourront lui être
reprises. Elles sont données. Elles ne pourront périr avec leur
créateur, car elles vivent avec tous ses lecteurs. Que les « fous
de Dieu » y songent. Voire qu’ils relisent, dans le Coran, le ver-
set 32 – divinement inspiré – de la sourate V :
Celui qui a tué un homme
qui lui-même n’a pas tué,
ou qui n’a pas commis de violence sur la terre,
est considéré comme s’il avait tué tous les hommes ;
et celui qui sauve un seul homme
est considéré comme s’il avait sauvé tous les hommes.
Stéphane Barsacq
ÉcrivainVous pouvez aussi lire