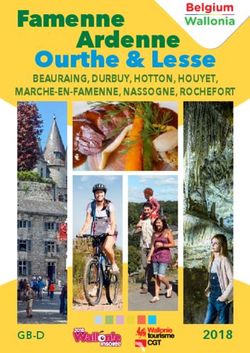Personnel domestique international: Rappeler la norme, protéger les victimes
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Personnel domestique
international:
Rappeler la norme,
protéger les victimes
Auteur: Nathalie Cobbaut
1Personnel domestique international:
Rappeler la norme, protéger les victimes
Une publication de la Fondation Roi Baudouin
rue Brederode, 21 à B-1000 Bruxelles
Cette brochure est également disponible en néerlandais sous le titre:
Buitenlands huispersoneel: Normen herbevestigen, slachtoffers beschermen
Auteur: Nathalie Cobbaut, journaliste
Coordination pour la Fondation Roi Baudouin:
Françoise Pissart, directrice
Jean-Pierre Goor, responsable de projet
Graphisme: Sylvie Peeters
Impression: BIETLOT
Illustrations: Marie Dorigny
Cette publication est également disponible en version électronique.
Celle-ci peut être téléchargée gratuitement sur le site www.kbs-frb.be de la
Fondation Roi Baudouin.
Cette publication peut être commandée gratuitement sur notre site www.kbs-
frb.be, par e-mail à l’adresse publi@kbs-frb.be ou auprès de notre Centre de
Contact, tél . +32-70-233 738, fax +32-70-233 727
Dépôt légal: D/2005/2848/05
ISBN: 2-87212-459-4
Mai 2005
Avec le soutien de la Loterie Nationale
2Table des matières
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Etat des lieux: le personnel domestique international dans notre pays . . . . . . . 7
Le cadre légal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
En droit du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
En droit de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
La loi sur l’occupation des travailleurs étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Un cas à part: le personnel domestique diplomatique . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Les abus les plus fréquents dans le cadre du travail domestique . . . . . . . . . . 15
En cas de non-respect du cadre légal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
L’intervention des services du Contrôle des lois sociales . . . . . . . . . . . . . 17
Un recours devant les tribunaux du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
En cas d’abus de vulnérabilité: La loi sur la traite des êtres humains . . . . . . . 21
Adresses utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Textes législatifs et réglementaires cités
• Loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail;
• Loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers;
• Arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique
de certains étrangers;
• Circulaire n°1415 du 7 juin 1999 du Ministère des Affaires étrangères, du
Commerce extérieur et de la Coopération au développement relatives aux
conditions d’octroi des cartes d’identité spéciales aux domestiques privés;
• Loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la
traite des êtres humaines et la pornographie enfantine (insérée dans la loi du
15 décembre 1980 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers en Belgique (article 77bis).
Index
• Contrat de travail domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• Sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• Permis de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• Carte d’identité spéciale (pour personnel domestique diplomatique) . . . . 13
• Contrôle des lois sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
• Titres-services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• Traite des êtres humains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
34
Introduction
Encore aujourd’hui, à l’aube du XXIème siècle, de trop nombreuses
femmes et hommes sont victimes d’exploitation dans le cadre du
travail domestique. Les demandes d’aide à domicile sont en aug-
mentation, différentes raisons peuvent expliquer cela: une certaine
dualisation de la société, l’organisation actuelle du travail, et par
exemple le nombre croissant de foyers où les deux parents travail-
lent, mais aussi l’augmentation du nombre de personnes âgées
vivant seules.
Dans le monde, on estime le nombre de ces travailleurs domesti-
ques à plusieurs millions de personnes, essentiellement des travail-
leuses migrantes et généralement ce phénomène de nouvelle
domesticité se développe dans l’économie informelle. S’il existe,
en Belgique, un cadre réglementaire propre au travail domestique,
celui-ci est souvent ignoré. Pour ce qui est des domestiques tra-
vaillant au domicile privé d’agents diplomatiques, une circulaire
ministérielle de 1999 enjoint les ambassades d’appliquer les dispo-
sitions de droit belge.
Le fait que les travailleurs domestiques venant de l’étranger se
retrouvent le plus souvent sur le territoire belge sans titre de séjour
valable, complique à l’extrême le statut de ce personnel domesti-
que.
L’ensemble de ces situations accroît la vulnérabilité de ces person-
nes, et certains employeurs en abusent. Ne nous voilons pas la
face, l’exploitation économique des travailleurs domestiques
existe. Dans certains cas, cette exploitation se transforme en véri-
table esclavage domestique.
C’est pourquoi il importe de rappeler le cadre juridique existant afin
que les normes en vigueur soient respectées et que, de manière
plus générale, les droits de ces travailleurs domestiques soient pris
en compte. Sans avaliser le caractère illégal du séjour pour bon
5nombre d’entre eux, il s’agit de réaffirmer les règles élémentaires
de droit qui régissent les relations entre employeurs et travailleurs
et d’envisager les éventuels recours dont ces derniers peuvent se
prévaloir en cas d’abus. Tel est l’objectif de cette brochure à desti-
nation des services de première ligne qui se trouveraient confron-
tés à de tels travailleurs manifestement exploités et qui souhaite-
raient les aider dans la mesure du possible à faire valoir leurs droits.
La Fondation Roi Baudouin lance cette campagne de sensibilisa-
tion en collaboration avec le Service public fédéral Emploi, Travail
et Concertation sociale, en concertation avec la Direction du
Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et le Conseil
National du Travail.
ORCA (Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten) et le
CCEM (Comité Contre l’Esclavage Moderne) contribueront à diffu-
ser l’information auprès des services sociaux et des communautés
de migrants concernés.
6Etat des lieux:
Le personnel domestique
international dans notre pays
Il est difficile d’évaluer le nombre de travailleurs domestiques occupés dans notre
pays. Il n’existe pas à ce jour d’instruments d’évaluation de ce phénomène. Ce
que l’on sait, c’est que cette situation est intimement liée au phénomène de l’im-
migration pour raisons économiques. On estime qu’il y a à l’heure actuelle 175
millions de migrants dans le monde (soit environ 2,8 p.c. de la population mon-
diale) et qu’une part importante de ces migrants ont décidé de quitter leur pays
en raison d’une qualité de vie insuffisante et avec l’espoir d’améliorer leurs condi-
tions de vie pour eux-mêmes et leur famille.
Ces travailleurs étrangers sont généralement cantonnés dans des secteurs éco-
nomiques marginaux et insuffisamment réglementés. On les retrouve principale-
ment dans l’agriculture, l’horticulture et la construction, mais aussi dans le sec-
teur du travail domestique. Les travailleurs domestiques migrants sont le plus
souvent des femmes contraintes d’accepter ce type de travail pour survenir à
leurs besoins et à ceux de leur famille souvent restée dans le pays d’origine.
Parmi les régions du monde ayant des ressortissants présents dans notre pays,
on cite le plus souvent l’Europe centrale et orientale (la Pologne figure chez nous
en première place), l’Asie (avec une importante communauté philippine en
Belgique), l’Afrique et l’Amérique du Sud (on estime par exemple à quelque 8000,
le nombre d’immigrés équatoriens à Bruxelles).
Le travail domestique: une notion floue
Si l’on ne sait quantifier aujourd’hui le volume de ce personnel domestique inter-
national, la notion même de travail domestique reste floue. Dans une résolution
sur la normalisation du travail domestique dans l’économie informelle, adoptée le
30 novembre 2000, le Parlement européen parle à cet égard de notion indéfinie.
L’on pourrait retenir, dans une acception au sens large de la notion de travail
domestique, qu’il s’agit d’une combinaison de tâches et d’une série de fonctions
qui se rapportent à la gestion quotidienne d’un foyer, prises en charge par un tra-
vailleur occupé au domicile de son employeur pour les besoins du ménage de ce
dernier et celui de sa famille. Mais cette définition ne recouvre pas une catégorie
juridique en tant que telle. En effet, la législation belge définit le travailleur domes-
tique comme étant celui qui effectue les travaux manuels d’ordre ménager et ne
vise sous cette dénomination que les femmes de chambre, les valets, cuisinier(e)s
et autres femmes d’ouvrage. Repris sous la catégorie d’ « employés de maison »,
que l’on retrouve dans certaines dispositions de droit social, sont visés: les gou-
vernantes, les gardes-malades ou les précepteurs d’enfants, qui effectuent des
tâches intellectuelles, ou encore les hommes de peine, les chauffeurs privés ou
les jardiniers, occupés à des tâches d’ordre principalement manuel, mais non
ménagères.
Interne ou externe
Ce type d’activités peut s’envisager sous deux formes: soit en tant que person-
nel domestique interne, qui travaille pour un seul employeur et qui réside chez cet
employeur, soit en tant que personnel domestique externe, auquel cas ces travail-
7leurs possèdent un domicile autre que le lieu de travail et sont occupés par un
seul ou plusieurs employeurs.
Par ailleurs, deux catégories d’employeurs sont principalement concernées par
une telle situation de travail. On situe une partie du personnel domestique inter-
national comme étant embauché par des diplomates qui emploient ce personnel
à leur domicile privé. Par ailleurs, on trouve également cette catégorie de travail-
leurs auprès d’employeurs privés, généralement des familles aisées qui ont les
moyens de se payer les services d’une domesticité.
Un cadre légal peu respecté
S’il existe un cadre légal dans l’arsenal juridique belge, qui devrait s’appliquer à
cette réalité de travail, l’on constate bien souvent qu’il n’en est rien et que ces tra-
vailleurs exercent leurs activités sans contrat de travail, ni protection sociale. Ce
constat est d’autant plus flagrant que ces emplois de travailleurs domestiques
sont majoritairement occupés par des travailleurs migrants qui se trouvent géné-
ralement en séjour illégal sur le territoire belge et pour lesquels notre pays ne déli-
vre pas de visa, ni de permis de travail, estimant qu’il n’y a pas de pénurie de main
d’œuvre qui justifierait l’embauche de travailleurs immigrés. Il n’existe donc que
très peu de possibilités pour ces personnes de régulariser leur situation.
La possession d’un titre de séjour valable sur le territoire belge ne signifie pas for-
cément davantage que la légalité soit respectée. Car, même s’il existe une régle-
mentation applicable au travail domestique, encore faut-il que les employeurs s’y
conforment en concluant un contrat de travail en bonne et due forme et en effec-
tuant les démarches relatives à l’embauche d’un travailleur. Malgré l’existence de
lourdes sanctions si l’on établit une occupation de travailleurs au noir dans le chef
d’un employeur, un certain nombre d’entre eux préfèrent rester dans l’illégalité et
prendre le risque de se voir infliger de lourdes amendes.
Une position vulnérable
Le statut plus que précaire du personnel domestique international dans lequel
bon nombre de ces travailleurs se trouvent aujourd’hui entraîne dès lors dans leur
chef une vulnérabilité particulière, d’autant plus marquée pour les travailleurs
migrants en situation illégale. Si, dans de nombreuses situations, on peut repérer
des cas d’abus qui se caractérisent par l’absence de contrat de travail, des salai-
res excessivement bas, des horaires excessifs ou encore l’absence de jours de
congés, tout comme le manque de protection en cas de litiges, cette exploitation
économique peut dans certains cas se transformer en véritable esclavage (enfer-
mement, confiscation des papiers d’identité, isolement du monde extérieur),
accompagné, le cas échéant, de sévices physiques et psychologiques, heureuse-
ment plus rares, mais pas nécessairement dénoncés ni réprimés.
8Le cadre légal
En droit du travail
Le titre V (articles 108 à 118) de la loi du 3 juillet 1978 porte sur le contrat de tra-
vail domestique. Selon cette législation, sont considérés comme travailleurs
domestiques, les travailleurs qui s’engagent contre rémunération à effectuer sous
l’autorité d’un employeur, principalement des travaux ménagers d’ordre manuel
pour les besoins du ménage de l’employeur ou de sa famille (article 5).
Les contours d’une définition
Trois conditions doivent être réunies: il doit s’agir de travaux ménagers ; ces tra-
vaux doivent avoir un caractère manuel prédominant et l’activité doit être desti-
née directement et principalement au profit du ménage d’un employeur et non
d’une entreprise commerciale, industrielle ou agricole. Sont donc repris dans
cette catégorie: les cuisiniers, les valets ou femmes de chambre, couturières, fil-
les de cuisine, repasseuses, femmes de ménage.
Le contrat de travail domestique est conclu pour une durée déterminée, pour un
travail nettement défini ou pour une durée indéterminée. Il peut être soit écrit, soit
oral. Mais en cas de durée déterminée ou de travail nettement défini, un écrit doit
être rédigé, faute de quoi le contrat conclu est considéré comme l’étant pour une
durée indéterminée.
La période d’essai est de 14 jours et pendant ce délai, chaque partie pourra rési-
lier le contrat moyennant un préavis de deux jours prenant cours le lendemain du
jour où le préavis aura été notifié.
L’employeur a l’obligation de mettre à la disposition du travailleur les vêtements
nécessaires à l’accomplissement de son travail, de veiller à ce que le travail s’ac-
complisse dans des conditions d’hygiène et de confort convenables et de mettre
à la disposition du domestique de quoi assurer la garde de ses effets personnels.
Rémunération, temps de travail et résiliation du contrat
Pour ce qui est de la rémunération, depuis le 4 mars 2004, la Commission pari-
taire de la gestion d’immeubles (n°323) a vu par arrêté royal sa compétence élar-
gie aux travailleurs domestiques: dès lors la convention collective de travail
n°65.530/CO/323 du 30 septembre 1999 s’applique à cette catégorie de travail-
leurs selon le barème ouvriers.
Age du travailleur Salaire horaire Salaire mensuel Cat. 3 par mois
16 5,1438 847,01 -
17 5,5847 919,60 -
18 6,0255 992,21 1167,3
19 6,4664 1.064,81 1252,70
20 6,9073 1.137,40 1338,12
21 7,3483 1.210,01 1423,52
21,5 + 6 mois d’ancienneté 7,5509 1.243,36 1462,76
22 + 12 mois d’ancienneté 7,6408 1258,19 1480,20
Outre la notion de revenu minimum mensuel brut, la loi sur le contrat de travail
prévoit des dispositions particulières pour la rémunération des travailleurs
domestiques. Une partie de cette rémunération peut être octroyée en nature, mais
elle ne peut dépasser un certain montant de la rémunération globale, soit 20 %
de la rémunération globale pour des avantages tels que le fait d’être nourri ou
9blanchi, 40 % de cette rémunération si le travailleur dispose d’une maison ou d’un
appartement, 50% s’il est complètement logé et nourri. Pour l’application de cette
règle, une évaluation forfaitaire est appliquée: 0,55 € pour le petit déjeuner, 1,09 €
pour le dîner, 0,84 € pour le souper et 0,74 € pour le logement (une pièce d’habi-
tation). Les avantages en nature doivent être évalués et portés à la connaissance
du travailleur au moment de l’engagement ou plus tard, au moyen d’un avenant
au contrat.
Les règles légales relatives à la durée du travail ne s’appliquent pas aux travail-
leurs domestiques: ceux-ci peuvent donc en principe prester plus de 38
heures/semaine, sans que cette durée de travail n’entraîne le paiement d’un sur-
salaire pour prestations supplémentaires.
En matière de repos dominical, là aussi une dérogation au principe général existe
pour les travailleurs domestiques: l’arrêté royal du 3 mars 1965 prévoit la possi-
bilité d’occuper au travail un dimanche sur 4 dimanches successifs, avec repos
compensatoire dans les six jours qui suivent ce dimanche. Par ailleurs, sur les dix
jours fériés auxquels les travailleurs domestiques ont droit, ils ne peuvent travail-
ler plus de trois jours fériés par an. Enfin le travail de nuit est autorisé sans limita-
tion pour les hommes de 18 ans et plus.
Les garanties en cas de résiliation du contrat de travail sont les suivantes: s’il est
conclu pour une durée déterminée, le contrat de travail domestique prend fin à la
date précisée dans le contrat. Conclu pour une durée indéterminée, il peut être
mis fin au contrat de travail par chacune des parties moyennant un préavis: de
deux jours durant l’essai ; de 28 jours calendrier dans le chef de l’employeur et
de 14 jours dans le chef du travailleur, si l’ancienneté de ce dernier est de moins
de 20 ans et de 56 jours dans le chef de l’employeur et de 28 jours dans le chef
du travailleur, s’il a plus de 20 ans de maison.
Travailleurs domestiques et employés de maison
Si l’on veut englober une réalité plus large que la définition de travailleur domes-
tique, telle que décrite dans la loi du 3 juillet 1978 et considérer également les gar-
des-malades, gouvernantes, précepteurs, mais aussi les chauffeurs ou encore les
jardiniers, il faudra se référer aux dispositions réglementaires générales relatives
au contrat de travail, qui diffèrent selon qu’il s’agit de tâches intellectuelles ou de
tâches manuelles. Dans le premier des cas, les dispositions relatives au contrat
de travail employé seront d’application ; dans le second, c’est un contrat de tra-
vail ouvrier qui sera préféré. Si l’on veut analyser la légalité d’une relation de tra-
vail, il faudra vérifier si les conditions de conclusion, d’exécution, de suspension
et, le cas échéant, de résolution du contrat de travail ont été respectées, en ce
compris les conventions collectives de travail éventuelles qui concernent ces dif-
férentes catégories de travailleurs.
(Certaines organisations syndicales ont demandé la révision du statut de travail-
leur domestique afin d’y inclure les différentes réalités que recouvre aujourd’hui le
travail effectué dans un ménage privé.)
10En droit de la sécurité sociale
Tous les secteurs de la sécurité sociale (maladie-invalidité, chômage, pensions,
prestations familiales, accidents de travail et maladies professionnelles) sont
d’application aux travailleurs domestiques et les employeurs doivent dès lors
cotiser pour ces différents régimes, sauf celui des allocations familiales. Les
domestiques ont bel et bien droit à ces allocations, financées par les fonds de
réserve de l’Office national des allocations familiales des travailleurs salariés
(ONAFTS), mais l’employeur qui engage un domestique ne doit pas payer la coti-
sation patronale (7 %) destinée aux allocations familiales.
Cela dit, il existe une série d’exceptions à l’assujettissement à la sécurité sociale
pour cette catégorie de travailleurs. Par exemple les domestiques externes qui ne
travaillent pas plus de 4 heures par jour pour le même employeur, ni plus de 24
heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs ne sont pas assujettis.
L’employeur est donc exempté du paiement des cotisations de sécurité sociale et
le travailleur ne perçoit pas d’indemnités sociales. En principe la législation rela-
tive aux accidents de travail et aux maladies professionnelles est d’application.
Le législateur a également prévu dans l’arrêté royal n°483 du 22 décembre 1986
une exonération de toutes les cotisations patronales à l’ONSS, (à l’exception de
celles pour le secteur des vacances annuelles, du congé-éducation payé et de
l’accueil des enfants), pour les employeurs qui procéderaient à l’engagement d’un
premier travailleur domestique ou d’un employé de maison. Cette exonération vise
en effet les travailleurs domestiques, soit les travailleurs qui effectuent des tâches
ménagères d’ordre manuel, mais aussi les employés de maison, soit les travailleurs
qui effectuent à l’intérieur ou à l’extérieur d’une maison pour les besoins privés de
l’employeur et de sa famille, des travaux non ménagers manuels ou intellectuels.
Pour être effective, l’exonération est subordonnée au fait que le travailleur engagé
doit au moment de son engagement: soit être chômeur complet indemnisé, soit
bénéficier du revenu d’intégration, soit bénéficier de l’aide sociale, sans pouvoir
bénéficier du revenu d’intégration en raison de sa nationalité. Ces conditions non
cumulatives doivent exister depuis au moins six mois. Cette exonération de coti-
sations est valable durant toute la durée du contrat. L’employeur reste tenu de
souscrire une police d’assurance contre les accidents de travail.
La loi sur l’occupation des travailleurs étrangers
Comme déjà relevé, le travail domestique concerne de façon importante, voire
prépondérante, des travailleurs étrangers. Or la législation belge réglemente l’em-
bauche de tels travailleurs: la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des tra-
vailleurs étrangers prévoit que ceux-ci doivent disposer d’une autorisation d’oc-
cupation et d’un permis de travail valide pour occuper un emploi dans notre pays.
Cette condition ne s’applique pas aux ressortissants d’un Etat membre de
l’Espace économique européen (les pays de l’Union européenne, plus l’Islande, la
Norvège et le Lichtenstein).
De manière préalable, le ressortissant étranger qui souhaite séjourner plus de
trois mois sur le territoire doit disposer d’un passeport valide et demander expres-
sément un visa-Schengen de type D, qui correspond à une autorisation de séjour
provisoire. La demande doit se faire auprès des postes diplomatiques et consu-
laires belges du pays dans lequel le demandeur de visa est domicilié. L’étranger
souhaitant venir en Belgique pour y travailler doit être en possession, en plus d’un
titre de séjour valide, d’un certificat récent de bonne vie et mœurs couvrant les
cinq dernières années, d’un certificat médical obtenu auprès d’un médecin agréé
11par l’ambassade et d’une autorisation d’occupation. C’est sur base de cette der-
nière que le ressortissant étranger pourra demander un visa.
Trois types de permis
Pour travailler sur le territoire belge, le ressortissant étranger (hors les cas des res-
sortissants issus d’un Etat membre de l’Espace économique européen) doit dis-
poser d’un permis de travail. Il en existe trois sortes:
• le permis de travail A est valable pour toutes les professions salariées et d’une
durée illimitée. Il est accordé au ressortissant étranger qui justifie, sur une
période de maximum 10 ans de séjour légal et ininterrompu précédant la
demande, de quatre années de travail couvertes par un permis de travail B.
• le permis de travail B est limité à l’occupation chez un seul employeur et est
valable 12 mois maximum. L’autorisation d’occupation octroyée à l’employeur
entraîne l’octroi automatique d’un permis B. C’est l’employeur qui doit intro-
duire la demande.
• le permis de travail C est valable pour toutes les professions salariées et pour
tout employeur, pendant une durée d’un an. Il est accordé à des ressortissants
qui ne disposent en Belgique que d’un droit de séjour limité (ex.: les étudiants,
les candidats-réfugiés, les régularisés soumis à la condition de trouver un tra-
vail ou les régularisés pour un an renouvelable, les victimes de la traite des
êtres humains…).
Toutes les personnes titulaires d’un permis de séjour pour une durée illimitée
(regroupement familial, régularisés sans condition…) sont dispensées de permis
de travail. Enfin, avec l’élargissement de l’Union à dix nouveaux pays depuis le
1er mai 2004, des mesures transitoires ont été prises: pendant une période tran-
sitoire, la possession d’un permis de travail B sera nécessaire pour un ressortis-
sant des dix nouveaux pays membres souhaitant travailler en Belgique (sauf les
ressortissants de Chypre et de Malte) et la condition relative à la pénurie de main-
d’œuvre sera examinée lors de la demande d’une autorisation d’occupation (voir
ci-après). Après ce délai, cette condition ne sera plus d’application.
Le Permis B et les travailleurs migrants
Pour le permis B, la demande d’autorisation d’occupation par l’employeur doit
être introduite auprès des services régionaux de placement (le Forem pour la
Wallonie, l’Orbem pour Bruxelles, le VDAB pour la Flandre et l’Arbeitsamt pour la
communauté germanophone) et est délivrée en même temps que le permis de
travail. A priori elle doit être demandée avant l’arrivée du ressortissant étranger
sur le territoire belge et n’est accordée que s’il n’est pas possible de trouver sur
le marché de l’emploi belge un travailleur apte à occuper de manière satisfaisante
et dans un délai raisonnable l’emploi envisagé. Or la Belgique possède à cet
égard une position très restrictive et argumente les refus systématiques de
demandes de permis sur base de la possibilité de trouver des travailleurs dispo-
nibles sur le marché de l’emploi pour occuper ces emplois. Seule une série de
dérogations à cette règle, énumérée de manière limitative dans la loi, permet de
ne pas tenir compte de la situation du marché du travail: c’est le cas pour les jeu-
nes au pair, les étudiants étrangers ou encore les stagiaires.
12Un cas à part: le personnel domestique diplomatique
Plusieurs catégories de travailleurs étrangers sont dispensées de permis de tra-
vail obligatoire, dont les domestiques des diplomates, ainsi que les domestiques
accompagnant des touristes pour un séjour de moins de trois mois. Pour ce qui
est du personnel domestique directement attaché aux ambassades comme per-
sonnel de service, un certain nombre de règles propres aux relations diplomati-
ques s’appliquent. En ce qui concerne le personnel domestique travaillant au
domicile privé d’agents diplomatiques, il existe une procédure particulière supplé-
mentaire.
Le séjour en Belgique des domestiques privés au service des diplomates est
réglementé selon l’arrêté royal du 30 octobre 1991 concernant les documents de
séjour en Belgique de certains étrangers. En réalité cet arrêté royal reprend une
série d’exceptions à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers. Dans son article 4, alinéa 7, cet
arrêté royal précise que le personnel domestique privé au service d’un diplomate
reçoit une carte d’identité spéciale, modèle IV, octroyée par le Service public fédé-
ral Affaires étrangères, Service du Protocole. La demande de cette carte d’iden-
tité se fait dès l’arrivée de la personne concernée en Belgique.
Les conditions d’octroi
La circulaire n°1415 du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce
extérieur et de la Coopération au développement du 7 juin 1999 (complétée
par une circulaire plus récente n°755 du 12 décembre 2002) précise les conditions
d’octroi d’une carte d’identité spéciale aux domestiques privés .
Lecandidat doit répondre aux conditions suivantes:
• Ne pas séjourner illégalement sur le territoire ;
• Ne pas être en séjour temporaire (touriste, étudiant, au pair…) ;
• Avoir atteint l’âge de 18 ans ;
• Ne pas avoir de lien de parenté avec l’employeur ou tout autre membre de la
mission ;
• Avoir un passeport national d’une durée de validité d’au moins six mois au
moment de la demande d’un visa ;
• Etre en possession d’une attestation de bonne santé ;
• Etre en possession d’un certificat de bonne vie et mœurs.
Ces deux derniers documents devant être soumis lors de la procédure d’obten-
tion du visa ou de la carte d’identité spéciale.
Dans une attestation séparée, adressée au service du Protocole, le futur
employeur doit déclarer que le contrat conclu avec le travailleur domestique res-
pecte les dispositions de droit belge, nonobstant les privilèges et immunités
diplomatiques.
Les mentions du contrat de travail
Un contrat de travail en bonne et due forme et conforme à la législation belge doit
être signé par l’employeur et le domestique privé. Il est transmis au service du
Protocole dans le cadre de la procédure d’obtention du visa et de la carte d’iden-
tité spéciale. Ce contrat est rédigé, soit en néerlandais, soit en français ou encore
en anglais soit dans une langue comprise du domestique. Après approbation, le
contrat est envoyé à la direction du Protocole à l’ambassade belge qui délivre le
visa et qui, obligatoirement, invitera le domestique pour un entretien final afin de
s’assurer que celui-ci a bien compris et est d’accord sur les termes du contrat.
Le contrat de travail doit mentionner:
• la date d’entrée en service ;
13• le lieu d’exécution du contrat ;
• le montant du salaire, les avantages en nature octroyés, ainsi que les disposi-
tions sur les conditions de travail conformes à la législation belge ;
• le nombre d’heures de travail par semaine ;
• le fait que le travailleur sera assujetti à la sécurité sociale belge, à moins que
l’employeur ne prouve que le travailleur est assujetti à un régime de sécurité
sociale, au moins équivalent à celui de la Belgique, de l’Etat d’origine du diplo-
mate ou d’un Etat tiers.
L’employeur s’engage par contrat à:
• offrir un emploi à temps plein au domestique. S’il n’est pas en mesure de lui
offrir un tel engagement, l’employeur devra permettre au domestique de
conclure un contrat complémentaire avec un deuxième diplomate ;
• fournir en principe un logement au domestique, ainsi qu’aux personnes dont
il a éventuellement la charge ;
• payer les frais de retour du domestique (et des personnes à sa charge) dans
son pays d’origine à la fin du contrat ou à toute autre rupture du contrat, sauf
si un nouvel engagement avec un diplomate a fait l’objet d’un contrat accepté
par la Direction du Protocole ;
• laisser le domestique en possession de son passeport ou de sa carte d’iden-
tité spéciale.
Le contrat prend fin au moment de la cessation des fonctions diplomatiques de
l’employeur en Belgique.
Lorsque le contrat se termine, le domestique doit remettre sa carte d’identité spé-
ciale à l’employeur qui la renvoie ensuite au service du Protocole, et quitter le ter-
ritoire sauf s’il a régularisé son séjour ou s’il a conclu un contrat approuvé par le
service du Protocole avec un autre fonctionnaire diplomatique.
Remise de la carte d’identité spéciale et voies de recours
La circulaire de 1999 prévoit également que la carte d’identité spéciale soit remise
en mains propres au travailleur domestique, ce que le Service du Protocole des
Affaires étrangères applique aujourd’hui de manière systématique. Lors de la pre-
mière remise de la carte et ensuite à chaque renouvellement annuel de la carte, le
personnel domestique est reçu pour un entretien personnel avec un responsable
au Protocole. Il se voit signifier ses droits et renseigner un interlocuteur qui pourra
intervenir en cas d’éventuel litige entre employeur et travailleur (en l’occurrence le
directeur général de la Direction générale Contrôle des lois sociales, SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale, M. Aseglio, rue Ernest Blerot 1 à 1070 Bruxelles –
T.02 233 47 66, fax 02 233 48 27). Les entretiens personnels avec les domesti-
ques se déroulent à la direction du Protocole.
Par ailleurs la circulaire rappelle que le Chef de la mission diplomatique est tenu
de veiller au respect des engagements souscrits par ses collaborateurs et qu’en
cas d’abus avérés dans le chef d’un agent diplomatique, la Direction du Protocole
se réserve le droit de refuser l’octroi de cartes d’identité spéciales aux domesti-
ques privés que cet agent souhaite engager.
Dans les faits, les recours donnent rarement lieu à des poursuites judiciaires et les
abus ne sont généralement pas sanctionnés par la justice, en raison de l’immu-
nité attachée aux ambassades et à leur personnel. Cela dit, il existe des sanctions
spécifiques aux usages et coutumes propres au milieu diplomatique.
Vous trouverez un spécimen de contrat de travail dans le document « Clés pour…
engager du personnel domestique non-ressortissant de l’Espace économique
européen » édité par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
14Les abus les plus fréquents
dans le cadre du travail domestique
Selon une étude du réseau européen Respect, opérationnel depuis 1997 grâce
aux subsides du programme Daphné de la Commission européenne, on peut rele-
ver des abus de deux types dans le cadre du travail domestique:
• les uns relatifs aux droits de la personne ;
• les autres plus spécifiquement en rapport avec le statut de travailleur.
Relativement au non-respect de la législation en matière de droit social, l’on peut
repérer des manquements récurrents:
• l’absence de contrat de travail (encore qu’un contrat écrit ne soit pas néces-
saire pour un contrat à durée indéterminée) ;
• le non-respect des minima de rémunération, fixés par convention collective ;
• le non-respect de la durée du travail, des règles spécifiques en matière de
repos du dimanche et d’occupation des jours fériés ;
• le non-respect des avantages en nature promis lors de l’engagement ;
• l’absence de déclaration aux différents régimes de sécurité sociale (hormis les
cas d’exception contenus dans la réglementation).
• on peut ajouter à cette liste le non-respect des conditions spécifiques au
régime d’occupation des jeunes au pair, dont on suspecte dans certains cas
qu’il soit l’objet d’un détournement afin de fournir à des familles aisées du per-
sonnel domestique bon marché. Pour cette raison, le dispositif d’autorisation
d’occupation sur base de ce statut a été considérablement renforcé en 2001
afin d’éviter les éventuels abus.
D’autres abus, non spécifiquement liés au statut de travailleur, mais qui découlent
de la situation de vulnérabilité de ce personnel domestique, peuvent être relevés:
• Le défaut de nourriture (malnutrition) ou l’octroi de nourriture de mauvaise
qualité (déchets, nourriture avariée) ;
• le défaut de logement adéquat si l’employeur s’est engagé à fournir ce loge-
ment (obligation de dormir dans le hall, la cuisine) ;
• la séquestration (interdiction de quitter la maison) ;
• la confiscation des papiers d’identité ;
• la violence psychologique (menaces, offenses et injures graves) ;
• la violence physique (coups de poing, coups de pied) ;
• les abus sexuels et les viols.
A l’occasion du descriptif des abus et autres irrégularités dont les travailleurs
domestiques font l’objet, notamment en raison de leur situation illégale sur le ter-
ritoire, il est important de rappeler qu’il existe une Convention internationale sur
la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille. Cette convention a été élaborée au regard de la situation de vulnérabilité
dans laquelle se trouvent fréquemment les travailleurs migrants et leur famille, du
fait, entre autres, de leur éloignement de l’Etat d’origine et d’éventuelles difficul-
tés tenant à leur présence dans l’Etat d’emploi.
Cette convention définit des normes internationales concernant le traitement, les
conditions de vie et les droits de ces travailleurs, quel que soit leur statut. Elle
couvre les droits et la protection des travailleurs migrants à toutes les étapes du
processus d’expatriation et étend la notion d’égalité de traitement en demandant
que les travailleurs immigrés et les membres de leur famille soient traités sur un
pied d’égalité. La Convention a également pour ambition de ne pas mélanger,
dans une confusion préjudiciable aux travailleurs migrants, les trois aspects que
15soulève la situation du migrant illégal, en tant que contrevenant aux lois sur l’im-
migration, en tant que travailleur et en tant qu’être humain.
Adoptée le 18 décembre 1990 par l’Assemblée générale des Nations Unies, la
Convention relative aux droits des migrants est entrée en vigueur le 1er juillet
2003 dans 22 pays, parmi lesquels ne figure pas la Belgique. Or il s’agit là d’un
instrument important dans la défense des droits des êtres humains, au même titre
que la Convention sur les droits de l’enfant ou contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Cela dit, la Belgique reconnaît certains droits de manière inconditionnelle à toute
personne se trouvant sur son territoire, comme le droit à être soigné, à se loger
ou encore le droit à l’instruction pour les enfants en âge de scolarité.
16En cas de non-respect du cadre légal
L’intervention des services du Contrôle des lois sociales
Comme on l’a déjà relevé, le travail domestique se situe le plus souvent dans le
champ de l’économie informelle. La réglementation du travail domestique, telle
qu’elle est décrite dans la loi du 3 juillet 1978, n’est que trop rarement appliquée,
ainsi que les dispositions en matière de sécurité sociale qui se rapportent à cette
situation d’occupation de travailleurs pour des tâches domestiques. En ce qui
concerne le personnel domestique privé des diplomates, là aussi, des irrégulari-
tés peuvent être constatées, en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat de
travail, tel qu’il a été conclu par les parties.
Nonobstant la situation irrégulière du travailleur sur le territoire belge et sans que
cela ne lui soit préjudiciable (par exemple un risque d’expulsion), le Contrôle des
lois sociales peut intervenir pour constater les différentes infractions au droit
social. Mais si l’employeur risque de se voir poursuivi et condamné, si les infra-
ctions sont établies, le travailleur en situation illégale aura certainement plus de
difficultés à faire valoir ses droits (voir supra « Un recours devant le tribunal du
travail »).
Contrôler l’application du droit social
Une des missions essentielles des services du Contrôle des lois sociales (qui
dépendent du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) consiste à informer,
conseiller, concilier et contrôler dans les différents domaines du droit réglemen-
taire du travail et du droit conventionnel du travail (déterminé par le champ d'ap-
plication des conventions collectives de travail et qui comprend par exemple les
conditions générales de travail et contrats collectifs, les salaires minimums...). A
l’égard de ces réglementations, le Contrôle des lois sociales possède également
la faculté de dresser des procès-verbaux, lesquels seront transmis à l’Auditorat
du travail. L’auditeur du travail peut sur cette base décider de poursuivre l’em-
ployeur sur le plan pénal pour le non-respect d’une série de dispositions relevant
du droit social et pour lesquelles des amendes pénales et/ou des peines d’empri-
sonnement sont prévues dans les différentes législations.
Punir les infractions
Les infractions relevées peuvent concerner le non-respect de la durée du travail
ou des dispositions relevant de conventions collectives de travail, l’absence de
documents sociaux ou encore d’autorisation d’occupation nécessaire pour tout
travailleur non ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen.
Les peines encourues par les employeurs qui ne respectent pas la législation en
vigueur peuvent être très élevées: en cas d’absence de déclaration immédiate à
l’emploi (DIMONA) ou d’inscription au registre du personnel, le contrevenant ris-
que une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an et/ou une amende pénale de
500 € à 2.500 €, majorée des décimes additionnels. Pour l’occupation fraudu-
leuse d’un travailleur étranger, il risque cette fois un emprisonnement d’un mois à
un an et/ou une amende de 15.000 € à 75.000 €.
Si le Parquet décide de ne pas poursuivre, des amendes administratives peuvent
néanmoins être infligées aux contrevenants, éteignant ainsi les poursuites judi-
ciaires. Les montants des amendes administratives sont eux aussi assez signifi-
catifs (de 1.875 € à 6.250 € pour une absence de déclaration à l’embauche ; de
3.750 € à 12 500 € en cas d’occupation frauduleuse d’un travailleur étranger).
17Veiller au respect des conventions
Le Contrôle des lois sociales a également pour fonction d'informer et de conseil-
ler sur ce qui relève du domaine du droit civil du travail (contrat de travail, protec-
tion de la maternité, intervention dans les frais de transport (uniquement pour la
SNCB) des ouvriers et des employés...) et du droit collectif du travail non rendu
obligatoire. Dans le domaine du droit civil du travail, l’Inspection n'a qu'une com-
pétence d'avis. Si le litige n'est pas réglé suite à son intervention, la partie qui
s'estime lésée peut porter l'affaire devant le tribunal du travail compétent car il
s’agit là d’un litige civil.
L’administration comme interlocuteur
En ce qui concerne le personnel domestique engagé par des agents diplomati-
ques dans le cadre de leur domicile privé, la circulaire n°1415 du 7 juin 1999
(complétée par la circulaire n°755 du 12 décembre 2002) stipule qu’en cas de liti-
ges entre l’employeur et le domestique privé, les deux parties pourront faire appel
à la médiation du Directeur général de la Direction générale Contrôle des lois
sociales, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Michel Aseglio, rue Ernest
Blerot 1 à 1070 Bruxelles – T. 02 233 47 66, fax 02 233 48 27. Depuis l’instaura-
tion de cette mesure, une quinzaine de plaintes par an ont été ainsi déposées
auprès de ce fonctionnaire de l’administration fédérale. Après audition du plai-
gnant, ce fonctionnaire rédige un rapport (environ cinq par an), lequel est envoyé
auprès du service du Protocole des Affaires étrangères qui s’efforce, dans les limi-
tes de ses compétences, de mettre bon ordre dans le litige. Ce qui ne signifie pas
qu’une procédure judiciaire devant les tribunaux belges ne puisse être engagée,
mais le risque de voir retenue l’immunité de juridiction dans le chef de l’agent
diplomatique existe, même si les magistrats ont de plus en plus tendance à inter-
préter celle-ci de manière restrictive.
Les limites du Contrôle des lois sociales
Deux difficultés doivent être soulignées lorsque l’intervention des services du
Contrôle des lois sociales est envisagée: d’une part, le fait que la loi du 16 novem-
bre 1972 précise dans son article 4 que les inspecteurs sociaux, munis de pièces
justificatives de leurs fonctions, ne peuvent néanmoins pénétrer dans les locaux
habités qu’avec l’autorisation préalable du juge au tribunal de police. Par local
habité, il y a lieu d’entendre le domicile et, de façon générale, tout lieu (en ce com-
pris les dépendances) occupé par une personne en vue d’y établir sa demeure ou
sa résidence réelle et où elle a droit, à ce titre, au respect de son intimité, de sa
tranquillité, de sa vie privée (Cass., 23 juin 1993, JLMB, 1993, 1058). En effet, les
inspecteurs du Contrôle des lois sociales ne peuvent pénétrer d’autorité dans des
lieux privés sans autorisation, ce qui limite les possibilités de contrôle puisqu’ils
doivent en demander l’autorisation à un juge de police et faire état d’éléments jus-
tifiant cette demande.
D’autre part, même si le travailleur domestique est occupé alors qu’il n’a aucun
titre valable pour séjourner sur le territoire, cet état de fait ne peut entraver l’ap-
plication de la loi. Le salaire journalier est ainsi dû, ainsi que la rémunération
garantie en cas d’incapacité de travail ou encore l’indemnité de rupture, si l’em-
ployeur met fin au contrat sans motif grave et sans respecter le délai de préavis.
Idem pour le respect des temps de travail et de repos ou encore la protection de
la maternité. Cela dit, s’il existe des instruments juridiques permettant en théorie
de faire respecter les droits des travailleurs illégaux, les choses sont bien plus
délicates dans les faits. En effet, si les services du Contrôle des lois sociales peu-
18vent éventuellement constater des infractions à la législation sociale et rédiger
des procès-verbaux permettant la poursuite des employeurs, le rétablissement
dans leurs droits des travailleurs illégaux devant les tribunaux civils est beaucoup
plus aléatoire, notamment en raison des risques d’expulsion que ces travailleurs
encourent en se manifestant au grand jour pour faire valoir leurs droits.
La piste des titres-services
Une des solutions qui peut être proposée par le Contrôle des lois sociales afin de
régulariser la situation de travailleurs effectuant du travail domestique sans que la
législation sociale soit respectée, réside dans le système des titres-services. Il
convient néanmoins de préciser que cette piste des titres-services n’est pas
applicable aux étrangers en situation irrégulière.
En effet, depuis le 1er janvier 2004, les particuliers–personnes physiques, ayant
leur domicile en Belgique, peuvent payer à une entreprise agréée des prestations
d’aide à domicile de nature ménagère, au moyen de titres-services donnant droit
à une réduction d’impôt. Le titre acheté 6,70 € coûte, après déduction fiscale,
4,69 € (chiffres 2004).
Les prestations visées sont: le nettoyage de l’habitation, le nettoyage des vitres,
la lessive, le repassage, de petits travaux de couture, la préparation des repas au
domicile de l’utilisateur. En dehors du domicile, le travailleur rémunéré suivant le
système des titres-services peut effectuer les courses pour le particulier, faire le
repassage de ce dernier dans un local de l’entreprise agréée ou encore aider aux
déplacements d’une personne moins mobile ou d’une personne âgée, via une
centrale pour personnes moins mobiles.
Les travailleurs concernés par le système des titres-services doivent être inscrits
comme demandeurs d’emploi, soit comme travailleurs de catégorie A qui perce-
vaient déjà des allocations de chômage, un revenu d’intégration ou une aide
sociale financière avant d’être occupé dans les liens du contrat de travail titres-
services et qui, pendant leur occupation, continuent à prétendre à ces allocations;
soit comme travailleurs de catégorie B qui regroupent tous les autres travailleurs
occupés dans les liens d’un contrat titres-services (à savoir la personne sans tra-
vail et sans allocations qui souhaite travailler ou encore la femme d’ouvrage qui
travaille au noir et souhaite régulariser sa situation). Ces travailleurs doivent
d’abord s’inscrire auprès d’un service régional de l’emploi comme demandeur
d’emploi libre avant de pouvoir être intégrés dans ce système. Ce système n’est
donc envisageable pour les travailleurs domestiques migrants que s’ils ressortis-
sent à l’une de ces catégories.
Les services sont exécutés par les travailleurs engagés dans les entreprises spé-
cifiquement agréées dans le cadre du dispositif. Ces entreprises peuvent être des
entreprises commerciales, des ASBL, des ALE, des mutualités, des CPAS, de
sociétés à finalité sociale ou des travailleurs indépendants occupant des salariés
(Pour plus d’infos: www.titres-services.be ).
Liste détaillée des adresses des services du Contrôle des lois sociales p. 25
19Vous pouvez aussi lire