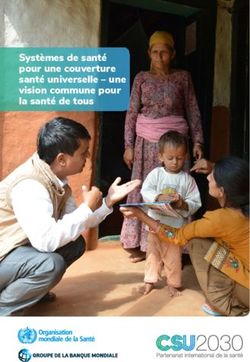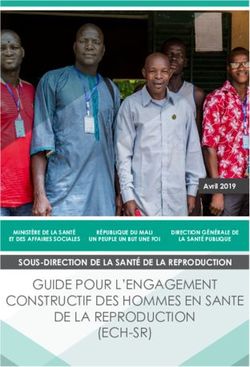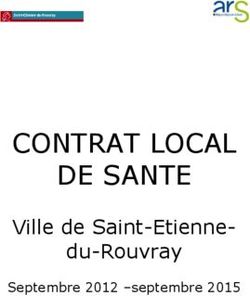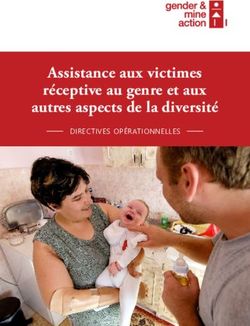PLAN LOCAL DE SANTÉ 2020-2022 PUBLIQUEAvignon - Contrat de ville du Grand Avignon
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
-2-
SOMMAIRE
Présentation de l’Atelier Santé Ville ______________________________________ 3
Une démarche locale d’animation et coordination - p.3
Une démarche basée sur 3 piliers - p.3
Les principaux objectifs de l’Atelier Santé Ville - p.5
Une approche à articuler avec les axes stratégiques du programme territorial de santé Vaucluse - p.7
Mise en place d’un Atelier Santé Ville dans les QPV _____________ 8
Faire du thème de l’accès à la santé un enjeu de territoire partagé - p.8
Le processus de création de l’ASV du Grand Avignon pour aller vers un Plan local de santé publique - p.8
Les territoires concernés - p.9
Diagnostic santé des QPV du Grand Avignon ________________________ 13
Une population relativement éloignée du système de soins - p.13
La densité médicale - p.20
Tendances relatives à l’état de santé de la population : des indicateurs de santé moins favorables qu’en PACA - p.22
Annexe 1 - p.25
Annexe 2 - p.26
Les enjeux liés à l’alimentation - p.31
La qualité de l’air et ses impacts sur la santé - p.35
Plan d’actions ___________________________________________________________________________ 37
1.Accès aux droits, à la santé et prévention - p.37
2.Faire émerger des environnements favorables à la santé - p.47
3.Renforcer le soutien à l’inclusion sociale et à l’accès aux soins des femmes et mères vulnérables - p.61-3-
Présentation de l’Atelier Santé Ville
Une démarche locale d’animation et coordination :
Le Référentiel national des Ateliers Santé Ville définit comme suit ce qui au premier abord
laisse à penser qu’il s’agirait de l’organisation d’ateliers de santé par une ville :
L’Atelier Santé Ville (ASV) est à la fois une démarche locale et un dispositif public qui se
situe à la croisée de la Politique de la Ville et des politiques de santé, dont l’objectif est
de contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé :
ise en place par le Comité interministériel de la Ville en 1999, la démarche
M
Atelier Santé Ville s’inscrit dans la loi relative à la lutte contre les exclusions, qui
a pour objectif d’améliorer la santé de la population et en particulier des plus
démunis, et s’articule avec les priorités régionales des Programmes d’Accès à
la Prévention et aux Soins (Praps). L’ASV s’inscrit ensuite dans la Loi de Santé
Publique du 9 août 2004.
lle s’insère dans le dispositif contractuel de la Politique de la Ville entre la
E
collectivité territoriale (commune, EPCI) et l’État. L’ASV anime, renforce et
adapte les différents axes de la politique de santé publique au niveau local.
« L’Atelier Santé Ville a pour enjeu de participer à l’amélioration de la santé des
habitants des quartiers prioritaires et à la réduction des inégalités de santé. »
Une démarche basée sur 3 piliers :
L’Atelier Santé Ville a vu son cadre réglementaire et législatif évoluer. La circulaire du 13 juin
2000 a fixé son cadre de référence et légitimé sa démarche au niveau national. En 2006, le
gouvernement a décidé de généraliser la démarche des ASV au niveau national afin de renforcer
la dynamique santé sur les territoires inscrits en Politique de la Ville au niveau national et de
faire de la démarche des ASV le point d’appui du développement local de la santé publique
par la déclinaison territoriale des Plans Régionaux de Santé Publique (PRSP). La mise en place
des Agences Régionales de Santé (ARS) et l’élaboration des Contrats Locaux de Santé (CLS)
constituent une nouvelle donne qui a conduit à l’actualisation de ce cadre de référence à travers
l’élaboration du référentiel national des Ateliers santé ville destiné aux services de l’État, aux
collectivités territoriales et aux ARS.
L’ASV prend appui sur trois fondements préfigurant une politique publique de santé :
Une approche globale de la santé à partir des déterminants de santé.
Une approche de proximité, au plus près des besoins des populations, et basée
sur la participation citoyenne.
Une démarche de coordination des acteurs et des actions de santé en faveur
des habitants des quartiers prioritaires.-4-
1)
Une approche globale de la santé à partir des déterminants de santé :
L’Atelier Santé Ville fonde sa démarche sur une approche globale, transversale et posi-
tive de la santé au sens de la définition de la santé de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) comme étant : « un état de complet bien-être physique, mental et social
et [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité », et de
promotion de la santé au sens de la charte d’Ottawa, qui s’attache à identifier et à agir
sur les déterminants de santé liés aux conditions de vie de la population : l’habitat,
l’emploi, l’éducation, les ressources, le cadre de vie, l’accès aux droits, l’environnement.
Considérant ainsi que la santé est une affaire de bien-être et de bien-vivre et qu’elle ne
relève donc pas uniquement du secteur soin, l’approche de l’Atelier Santé Ville se veut
intersectorielle et transversale, à la croisée du social, de l’insertion et de l’éducation, des
politiques d’habitat et de l’environnement. Elle vise en ce sens à interroger, repérer et
identifier les facteurs et processus de dégradation de la santé en œuvre dans les terri-
toires dits « sensibles » et chez les populations qui y vivent, avec une attention particu-
lière portée aux groupes populationnels qui s’y socialisent (les enfants et adolescents)
et ceux qui se constituent dans le tissu social comme pourvoyeurs de façons d’être et
de se soigner (associations, groupe d’influence, prédicateurs, aumôniers…).
2)
Une approche de proximité, au plus près des besoins
des populations, et basée sur la participation citoyenne :
L’Atelier Santé Ville constitue en tout premier lieu un espace, à une échelle de proxi-
mité telle qu’un quartier, à l’intérieur duquel des professionnels ainsi que des habitants
peuvent se rencontrer et travailler ensemble, sur les thèmes inhérents aux besoins et
aux problématiques détectés. Il s’agit donc :
d’articuler les interventions sanitaires, sociales et administratives,
et de faciliter les coopérations entre ces différents secteurs.
L’enjeu pour l’ASV est ainsi double :
Il s’agit de proposer sur le long terme des actions concertées dans les
domaines de l’accès aux soins, de la prévention et de la promotion de la santé
aux habitants afin qu’ils trouvent des réponses à leurs besoins, sur la base
d’un diagnostic partagé de santé, avec une attention prioritaire portée aux
populations en situation de vulnérabilité.
Il s’agit aussi de favoriser le développement et l’efficacité des partenariats entre
les différents acteurs locaux, en sollicitant la participation des patients, des
habitants et des citoyens ainsi que des partenaires institutionnels et associatifs.-5-
3)
Une démarche de coordination des acteurs et des actions
de santé en faveur des habitants des quartiers prioritaires :
De par son rôle de coordination, l’Atelier Santé Ville crée l’espace et le temps
pour la rencontre, la réflexion et l’action entre acteurs de différents secteurs. Il
favorise une pluridisciplinarité qui apporte de la complémentarité dans les ré-
ponses et donne l’occasion de travailler à la participation active des habitants, afin
d’être au plus près des besoins identifiés localement et de mieux y répondre.
L’ASV représente à ce titre :
un lieu de mobilisation,
ne instance de coordination de ces partenaires en vue :
u
- de la réalisation puis de l’actualisation d’un diagnostic partagé des problèmes
à traiter,
- de la mise en oeuvre d’un programme d’actions concertées de santé publique
à l’échelle locale,
- et d’une évaluation régulière des résultats obtenus, et si possible avec
les habitants.
Elle favorise la concertation des acteurs, le travail en réseaux et le développement de partena-
riats autour d’une démarche et d’objectifs communs.
Les principaux objectifs de l’Atelier Santé Ville :
L’Atelier Santé Ville a pour principal enjeu de participer à l’amélioration de la santé des habi-
tants des quartiers prioritaires et à la réduction des inégalités de santé, en répondant à plu-
sieurs objectifs :
méliorer la connaissance de l’état du territoire en matière de santé en
A
identifiant au niveau local les besoins spécifiques de la population et les
déterminants de santé liés aux conditions de vie en concertation avec les
habitants et les professionnels : il s’agit d’établir puis de mettre à jour un
diagnostic partagé de santé, et de plus en plus de participer à l’observation
locale de santé.
aciliter la mobilisation et la coordination des différents acteurs du territoire,
F
avec pour objectif d’améliorer les actions existantes et d’initier de nouveaux
projets :
- en rassemblant des acteurs autour d’une démarche et d’objectifs communs
et en favorisant la concertation des acteurs : à partir des problématiques et des
ressources identifiées grâce au diagnostic partagé de santé, il s’agit de définir
des objectifs prioritaires et d’envisager des programmes d’intervention de façon
concertée pour chaque quartier,
- en favorisant l’interconnaissance, la mise en relation et la coordination
des différents acteurs du territoire afin de faciliter le travail en réseau et le
développement de partenariat dans les champs sanitaire, social, médico-social,
éducatif...-6-
enforcer les compétences des acteurs locaux : à travers l’information autour
R
de la santé, la formation, le soutien méthodologique aux porteurs projets, etc...
évelopper la participation active des habitants à toutes les phases des
D
programmes de promotion de la santé (diagnostic, définition des priorités,
programmation, mise en œuvre et évaluation),
avoriser l’accès à la santé de la population améliorer la prise en charge
F
des populations précarisées (droits sociaux, prévention, soins), à travers le
soutien à une programmation annuelle d’actions de prévention primaire, de
santé communautaire et d’accès à la santé portées par les associations et une
coopération plus étroite entre professionnels de différents secteurs.
ettre en cohérence la Politique de la Ville et les politiques de santé (locale et
M
régionale), en faisant remonter les informations au niveau régional (ARS, veille
sanitaire) en matière de :
- analyse des principaux dysfonctionnements et barrières de l’accès aux droits, à la
prévention et aux soins,
- questions concernant les pratiques professionnelles sanitaires, sociales et
d’insertion,
- qualité et organisation de l’offre de soins,
- besoins en formation des professionnels accueillant des publics en situation de
précarité,
- amélioration de l’articulation entre les différentes initiatives, etc...
- participation aux différents instances et réseaux thématiques et à différents
niveaux
- contribution à l’élaboration du contrat local de santé
- harmonisation de la coordination du contrat local de santé et de son articulation
avec l’ASV....
ssurer le suivi et évaluation des projets engagés et travailler sur les questions
A
d’évaluation d’impact en santé.
Une approche par thématique... :
L’Atelier Santé Ville œuvre à la fois sur des thématiques prioritaires de santé publique identi-
fiées à partir du diagnostic partagé de santé et sur des approches populationnelles. Parmi les
thématiques prioritaires sur lesquels les ASV se trouvent le plus souvent amenés à travailler :
L’observation
L’accès aux droits et aux soins
La prévention et promotion de la santé :
- Nutrition
- Activité physique
- Hygiène bucco-dentaire
- Éducation à la santé
- Campagne de vaccination, promotion des dépistages organisés
- Lutte contre le cancer
- Vie affective et sexuelle
- Prévention VIH/IST/Hépatites-7-
Santé mentale et souffrance psychosociale :
- L’addictions et conduites à risques
- L’estime de soi
- La semaine d’information sur la santé mentale (Sism)
- Le conseil Local de Santé Mentale (CLSM)
- Le travail en réseau et interconnaissance des acteurs
Santé et environnement :
- La lutte contre l’habitat indigne
- La prévention du saturnisme
- La qualité de l’air
- La pollution
Parcours de soins :
- Les réseaux de santé
- Les praticiens libéraux et maisons de santé pluridisciplinaires
- Le secteur médico-social
- Le lien ville-hôpital
…combinée à une approche populationnelle :
L’Atelier Santé Ville fonde aussi son approche en fonction des caractéristiques des différents publics :
Santé et précarité, Périnatalité, Petite enfance, Enfance/jeunesse, Santé des femmes, Pa-
rentalité, Violences, Personnes isolées, Vieillissement et sédentarité, Personnes en situa-
tion de handicap, Santé des migrants / gens du voyage, Personnes en insertion, Santé au
travail, Santé des détenus
L’ASV œuvre principalement avec les professionnels et secteurs en interaction avec ces
publics, et parfois directement en direction de ces publics.
Une approche à articuler avec les axes stratégiques du programme
territorial de santé Vaucluse :
L’amélioration de l’organisation territoriale du système de santé constitue l’un des objectifs fort
de la loi « Hôpital, patient, territoire ». Le Projet Régional de Santé (PRS), publié par le Directeur
de l’ARS en septembre 2018 est l’outil majeur de la définition de la politique de santé au niveau
régional. Afin d’être au plus près des besoins des habitants et réduire au mieux les inégalités de
santé qui persistent dans des territoires significativement différents en termes de peuplement,
de relief, d’environnement, etc… des programmes départementaux de santé ont été établis.
Leur élaboration « s’est inscrite dans une démarche de démocratie sanitaire pour une meilleure
compréhension réciproque entre décideurs, acteurs et usagers ». En effet, la programmation
départementale doit « contribuer à une vision commune des actions des uns et des autres, en fa-
cilitant l’échange d’informations et en définissant des axes de travail en commun » (Programme
territoriale de santé du Vaucluse, Délégation territoriale du Vaucluse, ARS Paca, 2012-2016, p3.).
C’est dans la continuité de cette orientation stratégique que notre démarche ASV s’inscrit en
considérant lors de l’élaboration du diagnostic local de santé les axes stratégiques prioritaires
déterminés par l’ARS pour les territoires du Vaucluse.-8-
Mise en place d’un Atelier Santé Ville
dans les QPV du Grand Avignon
Faire du thème de l’accès à la santé un enjeu de territoire partagé
Le Contrat de Ville 2015-2020 annonce son ambition de créer un Atelier Santé Ville (ASV) dont
la vocation première est l’élaboration d’« un état des lieux des pratiques et des acteurs, un
diagnostic des besoins des habitants et des professionnels de santé et l’élaboration d’une
stratégie intercommunale ».
Cet outil est attendu par de nombreux acteurs de l’éducation et de l’insertion professionnelle.
Ceux-ci font face à des situations individuelles qu’ils ne peuvent pas gérer car les problématiques
ne relèvent pas de leurs compétences mais de problèmes de santé, allant de la dyslexie aux
troubles mentaux, en passant par toute forme de pathologies physiques non détectées ou non
prises en compte.
Dans le Contrat de Ville, les partenaires expriment leur volonté d’investir le champ de la santé
pour bâtir un Atelier Santé Ville à long terme dans le cadre d’une stratégie locale de santé
publique qui bénéficierait aux habitants des quartiers prioritaires.
Le Contrat de ville fait ainsi du thème l’accès à la santé un enjeu de territoire pour les QPV.
Le processus de création de l’ASV du Grand Avignon pour aller vers
un Plan local de Santé Publique
La mission initiale a posé deux objectifs :
ettre en place une dynamique d’animation territoriale de santé par la création et la
M
mise en œuvre de l’Atelier Santé Ville.
Bâtir une stratégie territoriale de santé en lien avec les besoins, les attentes et les
ressources du territoire du Grand Avignon préfigurant un Plan local de santé publique.
Le Contrat de Ville 2015-2020 établit une démarche en trois étapes majeures que nous rappelons
ici :
à 1ère étape (2017-2019) : Réalisation d’un état des lieux ou diagnostic santé avec
concertation des acteurs locaux de la santé (institutions, associations, habitants).
à 2e étape (2019-2020) : Élaboration de la stratégie du Plan local de santé publique (PSLP)
et création de l’Atelier Santé Ville.
à 3e étape (2020-2022) : Mise en œuvre des premières actions de santé dans le cadre du
Contrat de Ville.-9-
Si le schéma de construction de la démarche ASV préfigure un phasage en trois étapes, cela
n’exclut aucunement le fait que des orientations, des dispositions, ou des actions spécifiques
à l’une des phases puissent se réaliser en amont ou en aval de l’étape programmative dans
laquelle elles ont été inscrites. En effet, en plus d’impulser de nouvelles actions et dynamiques
de mutualisation en santé, la démarche ASV a également vocation à :
Pérenniser et consolider les actions engagées qui donnent satisfaction,
Encourager les dynamiques locales de santé existantes (sensibilisation, prévention…),
Répondre à temps aux diverses sollicitations des acteurs (habitants, professionnels de
santé, institutionnels, citoyens) pour préserver l’esprit d’une démarche participative et
collaborative qui fonde et légitime la création d’un ASV.
La démarche doit répondre à une méthodologie d’élaboration à la fois rigoureuse et souple,
directive (orientations décidées par le comité de pilotage) et participative (co-construction avec
les acteurs de terrain), objectivable et modulable.
Les territoires concernés :
Le décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville
dans les départements métropolitains identifie cinq quartiers prioritaires pour le territoire du
Grand Avignon :
A Avignon :
Les quartiers Sud (Monclar, Champfleury, Rocade Sud, Barbière, Croix des Oiseaux),
Les quartiers Nord-est,
Le quartier Saint-Chamand.
Au Pontet :
Les quartiers Camp Rambaud – les Mérides,
Les quartiers Joffre et Centre-ville.
Nom des quartiers Médiane (en euros) du
prioritaires Commune Population revenu déclaré par unité
de consommation
Quartiers Sud Avignon 17 186 7 243
Quartiers Nord Est Avignon 4 612 6 752
Saint Chamand Avignon 2 813 6485
Camp Rambaud – Le Pontet 741 8 094
Les Mérides
Joffre / Centre ville Le Pontet 2 982 8 936
TOTAL 28 314
Source : INSEE- 10 -
Quartiers prioritaires d’Avignon- 11 - Quartiers prioritaires du Pontet
- 12 -
Les principales caractéristiques d’alerte des habitants des QPV mentionnées dans le Contrat
de Ville du Grand Avignon 2015-2020 sont les suivantes :
es quartiers aux revenus particulièrement bas et très inégaux traduisant la grande
D
précarité des habitants
Une population jeune avec une très forte présence des moins de 10 ans
Des quartiers qui se féminisent progressivement et qui accueillent des femmes en
précarité
Une surreprésentation des familles monoparentales
Une part de population immigrée et/ou d’origine étrangère particulièrement élevée
Des quartiers qui perdent massivement des habitants
Un dynamisme économique insuffisant malgré la présence d’une Zone Franche Urbaine
à Avignon
De très bas niveaux de qualification parmi les plus bas de la région PACA
Une densité médicale faible relativement au reste du Grand Avignon traduisant une plus
grande difficulté d’accès aux soins- 13 -
Diagnostic santé des QPV
du Grand Avignon
La santé est un axe transversal dans le cadre de la Politique de la Ville. Elle s’articule avec des
problématiques sociales, l’éducation ou encore le cadre de vie. Ainsi, la pauvreté, le type d’emploi,
le logement, la qualité de l’environnement, l’isolement, le niveau de formation, l’immigration et
la barrière de la langue sont autant de freins à lever pour favoriser l’accès aux soins et à la santé.
Une population relativement éloignée du système de soins
1)
La situation dans le Grand Avignon
Il n’existe pas d’écart significatif entre le nombre de personnes ayant eu recours à un médecin
généraliste libéral parmi les habitants du Grand Avignon et ceux de la région PACA. En revanche,
l’écart se creuse lorsque l’on s’intéresse à d’autres spécialistes1 :
Le nombre de personnes ayant eu recours à un pédiatre est inférieur de 28 %
par rapport à PACA.
Le nombre de personnes ayant eu recours à un dentiste est inférieur de 6,8 %
par rapport à PACA.
Le nombre de personnes ayant eu recours à un psychiatre est inférieur d’environ 40 %
par rapport à PACA.
La CMU-C (désormais Complémentaire santé solidaire)2 est un dispositif essentiel pour favoriser
l’accès aux soins et à la santé. Toutefois, on constate une moindre participation des personnes
bénéficiaires de la CMU-C aux dispositifs de prévention.
Les enfants bénéficiaires de la CMU-C ont moins souvent effectué un bilan de prévention
buccodentaire ou une consultation que ceux non bénéficiaires de ce dispositif. C’est chez les
enfants les plus jeunes (6 et 9 ans) que l’écart est le plus marqué : il est d’environ 12 points, au
désavantage des enfants couverts par la CMU-C. En outre, la part d’enfants effectuant un bilan
de prévention buccodentaire ou une consultation diminue avec l’âge, qu’ils soient couverts ou
non par la CMU-C. Tandis que près de 36 % des enfants bénéficiaires de la CMU-C ont réalisé
un bilan ou une consultation à 6 ans, ils ne sont plus que 13 % à 18 ans3 .
Le constat d’une moindre participation des bénéficiaires de la CMU-C à la prévention s’applique
également au niveau de participation des femmes (50-64 ans) au dépistage organisé du cancer
du sein. Sur l’année 2017-2018, près de 43 % de celles ne bénéficiant pas de la CMU-C se sont
fait dépister contre 26 % de celles couvertes par la CMU-C45.
Sirsé PACA [en ligne]. Observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, chiffres clés 2018. Accessible à : http://www.sirsepaca.org/#c=home.
1
Source : DRSM Paca-Corse
2
Depuis le 1er novembre 2019, la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) et l’ACS (aide au paiement d’une complémentaire santé) ont été
remplacées par la Complémentaire santé solidaire (Ameli.fr).
3
Sirsé PACA [en ligne]. Observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, chiffres clés 2017. Accessible à : http://www.sirsepaca.org/#c=home.
Source : DRSM Paca-Corse
4
Remarque : L’amélioration de la couverture du dépistage du cancer du sein est un des objectifs associés à la loi relative à la politique de santé publique du
9 août 2004. Il s’agit d’atteindre un taux de couverture du dépistage (dépistage organisé et dépistage individuel) de 80 % pour les femmes de 50 à 74 ans.
5
Sirsé PACA [en ligne]. Observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, chiffres clés 2017-2018.- 14 -
2)
La situation dans les QPV du Grand Avignon : hypothèse d’une situation
moins favorable
Une population fragilisée :
Plusieurs facteurs illustrent la fragilité de la population vivant dans les QPV. S’ils existent
indépendamment les uns des autres, ils peuvent aussi se cumuler ce qui renforce la fragilité
des personnes concernées.
En 2016, plus de la moitié des habitants des QPV étaient pauvres, ce qui représente près
de 15 500 habitants67 . Selon les quartiers, 25 à 41 % des ménages sont composés d’une
seule personne8 et 18 % des familles sont monoparentales, or ces ménages sont plus souvent
concernés par la pauvreté9 .
En 2018, le taux d’emploi au sein des QPV (29 % à 50 % selon les quartiers) est inférieur à celui
du Grand Avignon (57,7 %). Parmi les personnes en emploi, 21 à 24 % des salariés occupent
un emploi précaire contre 14 % parmi les salariés de l’agglomération dans son ensemble. Par
ailleurs, cette même année, on comptait 20 % de demandeurs d’emploi parmi les habitants des
QPV contre 13 % parmi les habitants du Grand Avignon10.
Enfin, plus de 10 000 immigrés11 vivent dans les QPV. Cela représente 36 % des habitants
tandis qu’on compte 12 % d’immigrés parmi les habitants du Grand Avignon12. Cela peut
impliquer un certain nombre de problématiques, comme la barrière de la langue ou l’accès à
l’emploi ce qui fragilise d’autant plus cette population.
Accessible à : http://www.sirsepaca.org/#c=home. Source : ARS Paca
6
Le taux de pauvreté re¬présente la part des personnes dont le niveau de vie est inférieur à 60% du niveau de vie médian de la population (soit un niveau
de vie égal à 1015 euros par mois pour une personne seule en 2015).
7
Données sur la Politique de la Ville. In INSEE. INSEE [en ligne]. INSEE, 30 mars 2020. Accessible à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4191749?somm
aire=2500477. Source : INSEE-DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA, FiLoSoFi, 2016
8
Données sur la Politique de la Ville. In INSEE. INSEE [en ligne]. INSEE, 30 mars 2020. Accessible à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4191749?somm
aire=2500477. Source : INSEE, RP 2015
9
Compas, Diagnostic de la Politique de la Ville, novembre 2017
10
Données sur la Politique de la Ville. In INSEE. INSEE [en ligne]. INSEE, 30 mars 2020. Accessible à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4191749?som
maire=2500477
11
Personne née étrangère à l’étranger et résidant en France. Certains immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers (Haut Conseil à
l’Intégration).
12
Données sur la politique de la ville. In INSEE. INSEE [en ligne]. INSEE, 30 mars 2020. Accessible à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4191749?som
maire=2500477. Source : INSEE, RP 2015- 15 -
Des indicateurs de fragilité davantage marqués chez certaines publics :
Les mineurs
3 818, soit 46 % des jeunes de moins de 18 ans des QPV couverts sont bénéficiaires de
la CMU-C (contre environ un quart des mineurs couverts du Grand Avignon)13 . Dans son
diagnostic sur la Politique de la Ville, le Compas souligne que les parents font beaucoup plus
souvent la demande d’accès à la CMU-C car celle-ci est essentielle pour ces tranches d’âge14 .
Il est intéressant de rapprocher ces jeunes des mineurs vulnérables relevés par l’indicateur
de fragilité du Compas15 . En 2013, on en comptait 4 070 dans les QPV soit près de la moitié
des mineurs qui vivent dans ces quartiers. Leur situation est d’autant plus préoccupante qu’à
l’exception des quartiers sud, la part des mineurs vulnérables a davantage augmenté dans les
QPV qu’en dehors entre 2008 et 2013. Selon les quartiers, cette augmentation va de 5,5 points
à 13,7 points16 .
Comparaison entre le nombre de mineurs bénéficiaires de la CMU-C et le nombre
de mineurs vulnérables vivant dans les QPV du Grand Avignon
Nombre de béneficiaires Nombre de mineurs
de la CMU-C de moins vulnérables (2013)
de 18 ans (2018)
Quartiers Sud 2 346 2 530
Quartiers Nord Est 729 810
Saint Chamand 428 440
Camp Rambaud – 29 n.d
Les Mérides
Joffre / Centre ville 286 290
TOTAL QPV 3 818 4 070
Source : CNAM - Compas, Diagnostic de la Politique de la Ville, novembre 2017
13
Données sur la Politique de la Ville. In INSEE. INSEE [en ligne]. INSEE, 30 mars 2020. Accessible à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4191749?som
maire=2500477
14
Compas, Diagnostic de la Politique de la Ville, novembre 2017
15
Vivre dans une famille monoparentale, vivre dans famille nombreuse (3 enfants et plus), vivre au sein d’une famille où « tous les parents » ont un bas
niveau de formation (BEPC ou brevet des collèges au plus), vivre dans une famille comptant au moins un parent se déclarant au chômage ou occupant un
emploi précaire, vivre dans une famille sans aucun adulte actif en emploi, vivre dans une famille locataire du parc social ou dans un logement précaire, vivre
dans un logement surpeuplé - Compas, Diagnostic de la Politique de la Ville, novembre 2017
16
Compas, Diagnostic de la Politique de la Ville, novembre 2017- 16 -
Comparaison entre la part de mineurs bénéficiaires de la CMU-C et la part de mineurs
vulnérables selon la zone géographique
France 11,60 % Part des mineurs vulnérables parmi
l’ensemble des mineurs (2013)
Part des bénéficiaires de la CMU-C
PACA 14,10 % parmi les mineurs couverts (2018)
21,70 %
CA du GA Avignon
24 %
16,3 %
Le Pontet 22 %
32,60 %
Avignon
35 %
48,8 %
Total QPV 46 %
0 10 20 30 40 50
Source : INSEE, Données sur la Politique de la Ville, 30 mars 2020 - Compas, Diagnostic de la
Politique de la Ville, novembre 2017
Les entretiens réalisés avec les professionnels du territoire étayent l’hypothèse d’une situation
moins favorable des jeunes vivant dans les QPV en matière de recours aux soins et à la
prévention. La santé buccodentaire en est une illustration particulièrement marquante. Les
intervenants de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et de l’Union Française pour
la Santé Buccodentaire (UFSBD) dans les établissements scolaires à partir du CP témoignent
d’un nombre important d’élèves avec plusieurs caries. Malgré la transmission des besoins
de soins aux parents et la prise en charge de la consultation et des soins dans le cadre du
programme M’T dents17 , la visite chez le dentiste n’a pas systématiquement lieu.
En outre, la situation familiale des jeunes identifiés comme vulnérables (famille monoparentale
ou au contraire nombreuse, faible niveau de formation des parents…) ne favorise pas la
transmission des savoirs de base en matière d’alimentation, d’hygiène ou encore d’usage des
médicaments. Dans ce contexte, l’éducation à la santé mais aussi la sensibilisation des parents
apparaissent comme des enjeux majeurs pour limiter la reproduction des inégalités sociales de
santé et améliorer la portée des actions.
17
M’T dents : des rendez-vous offerts chez le dentiste. In Ameli.fr. Ameli.fr [en ligne]. CNAM, 28 juillet 2020. Accessible à : https://www.ameli.fr/vaucluse/
assure/sante/themes/carie-dentaire/mt-dents- 17 -
La réussite éducative constitue également un enjeu majeur au regard de l’environnement dans
lequel évoluent les mineurs vulnérables. Des problèmes de santé peuvent se cumuler avec
les indicateurs de fragilité mentionnés ci-dessus. Les professionnels intervenant auprès des
jeunes constatent un manque d’orthophoniste. La surexposition aux écrans a également été
mentionnée à plusieurs reprises. Enfin, les professionnels témoignent d’un mal être, à différent
degré, chez les jeunes comme au sein des familles.
La part d’enfants de moins de 3 ans vivant dans les QPV du Grand Avignon constitue un
autre élément caractéristique de ces quartiers. En 2013, ces enfants représentent 6 % de
leur population contre 3,7 % de la population du Grand Avignon. Les besoins de soins et
d’actions de prévention sont très importants pour cette tranche d’âge. L’action de la PMI
dans les QPV est donc essentielle18 . Il y a 3 services de PMI répartis à Avignon au sein des
Espaces Départementaux des Solidarités (EDES) (est/centre-ville, ouest et sud) et 1 à l’EDES
de Montfavet.
Il y a également un Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP). Cette structure qui fait
partie de l’hôpital Henri Duffaut d’Avignon intervient auprès des enfants de 0 à 6 ans et de leurs
parents en cas de trouble du développement avéré ou suspecté, en cas de handicap ou dans
des situations à risque nécessitant une surveillance spécifique.
18
Compas, Diagnostic de la Politique de la Ville, novembre 2017. Source : INSEE, RP 2013- 18 -
Les femmes
La situation des femmes des QPV est encore moins favorable que celle de la population des
QPV en général. Fragilisées tant sur le plan de la situation familiale que sur le plan de l’emploi,
elles sont plus à même de se trouver dans des situations de précarité.
Selon les QPV, les femmes sont à la tête de 86 à 91 % des familles monoparentales. Ces mères
ne disposent que d’une seule source de revenu. Elles peuvent en outre rencontrer des difficultés
pour faire garder leurs enfants ce qui peut les pousser à se tourner vers des emplois à temps
partiel voire à renoncer à exercer une activité. Par conséquent, les familles monoparentales
sont plus souvent concernées par la pauvreté19.
En ce qui concerne l’emploi, les femmes des QPV sont dans une situation moins favorable à la
fois vis-à-vis des hommes des QPV et vis-à-vis des femmes vivant en dehors des QPV.
Le quartier de Camp Rambaud - Les Mérides fait figure d’exception puisqu’une femme sur
deux y est en emploi. Dans les autres QPV, le taux d’emploi des femmes se situe entre 25 % et
39,7 % tandis qu’à l’échelle du Grand Avignon, plus d’une femme sur deux occupe un emploi.
De plus, à l’exception de Camp Rambaud - Les Mérides, le taux d’emploi des femmes actives
dans les QPV est inférieur de 4 à plus de 7 points au taux d’emploi de l’ensemble des actifs
des QPV20.
En ce qui concerne les emplois précaires, c’est entre les femmes des QPV et l’ensemble des
femmes du Grand Avignon que l’écart se manifeste le plus. A l’exception de Camp Rambaud
- Les Mérides, 19 à 23 % des femmes des QPV occupent un emploi précaire contre 15 % des
femmes du Grand Avignon21.
Parmi les salariées vivant dans les QPV, près de 40 % sont à temps partiels contre 13 % des
hommes de ces quartiers et 32 % des femmes du Grand Avignon22.
Les femmes des QPV sont davantage touchées par le chômage. 16 % d’entre elles sont
enregistrées parmi les demandeurs d’emploi contre environ 12 % des femmes du Grand
Avignon. En revanche, elles sont moins nombreuses dans cette situation que les hommes des
QPV (moins de 24 %) . Cela pourrait s’expliquer par le fait que les femmes des QPV sont moins
actives (ni en emploi, ni à la recherche d’un emploi). En 2013, 62 % des femmes vivant en QPV
étaient actives contre 84 % des femmes du Grand Avignon et 89 % des hommes vivant en
QPV24 25.
L’hypothèse d’une situation moins favorable des femmes vivant dans les QPV en matière de
recours aux soins et à la prévention est également corroborée par les retours d’expérience des
professionnels du territoire.
Le dépistage du cancer du sein apparaît comme une priorité. Dans un quartier, 5 femmes
auraient été diagnostiquées du cancer du sein cette année et dans un autre 3 mamans seraient
décédées en raison d’un dépistage tardif. Le suivi gynécologique est quant à lui souvent limité
aux périodes de grossesse.
En dernier lieu, les femmes représentent près de 55 % des personnes bénéficiaires de la
CMU-C dans les QPV. Cela constitue un indice supplémentaire de la précarité des femmes
vivant dans ces quartiers26.
19
Compas, Diagnostic de la Politique de la Ville, novembre 2017. Source : INSEE, RP 2010
20
Données sur la Politique de la Ville. In INSEE. INSEE [en ligne]. INSEE, 30 mars 2020. Accessible à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4191749?so
mmaire=2500477. Source : INSEE, RP 2015
21
Ibidem
22
Compas, Diagnostic de la Politique de la Ville, novembre 2017. Source : INSEE, RP 2013
23
Données sur la Politique de la Ville. In INSEE. INSEE [en ligne]. INSEE, 30 mars 2020. Accessible à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4191749?so
mmaire=2500477
24
Compas, Diagnostic de la Politique de la Ville, novembre 2017. Source : INSEE, RP 2013
25
Remarque : Alors que l’écart entre le taux d’activité des hommes et des femmes s’est considérablement réduit entre 1990 et 2013 en dehors des QPV
passant de +18 % à +5%, il a augmenté au sein des QPV passant de +26 % à +27 % - Compas, Diagnostic de la Politique de la Ville, novembre 2017
26
Données sur la Politique de la Ville. In INSEE. INSEE [en ligne]. INSEE, 30 mars 2020. Accessible à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4191749?so
mmaire=2500477. Source : CNAM- 19 -
Les personnes âgées
La part des personnes âgées vivant dans les QPV est faible comparée à l’ensemble du Grand
Avignon. Les 60-74 ans représentent 12 % de la population de ces quartiers contre plus de 16
% de la population du Grand Avignon. Les 75 ans et plus représentent quant à eux 5,5 % de la
population des QPV contre plus de 9 % de celle du Grand Avignon27.
Toutefois, ce public ne peut être appréhendé indépendamment du contexte de ces quartiers.
Comme illustré précédemment, les habitants des QPV du Grand Avignon cumulent un certain
nombre de déterminants de santé défavorables (pauvreté, précarité de l’emploi, isolement,
moindre recours à la prévention...). L’état de santé des personnes âgées se trouve inévitablement
impacté par leurs parcours de vie et leurs comportements en matière de santé. Les personnes
d’âge actif en mauvaise santé auraient d’ailleurs une probabilité plus importante de le rester
et d’être dépendantes en vieillissant28. Les associations qui travaillent avec ce public dans les
QPV constatent que certaines personnes sont en perte d’autonomie avant 60 ans en raison
d’accidents du travail ou de maladies chroniques de longue durée. Malgré le manque de
données précises sur les QPV d’Avignon, le bureau d’études Compas observe que de manière
générale, les taux de recours à l’allocation personnalisée d’autonomie dans ces quartiers sont
beaucoup plus importants et interviennent souvent plus tôt (entre 70 et 75 ans) que ceux qui
sont observés dans les autres territoires29.
C’est pourquoi malgré un taux de personnes âgées globalement moins important dans les QPV
que dans le reste du Grand Avignon, une attention particulière doit être portée aux besoins
sanitaires de ces personnes car ils sont susceptibles d’être plus importants. Cela est d’autant
plus valable dans certains quartiers, qui connaissent une population âgée plus importante par
rapport à la moyenne des QPV. C’est le cas des quartiers sud et de Camp Rambaud – Les
Mérides. Dans le premier, 13 % des habitants sont âgés de 60 à 74 ans et 6 % de plus de 75
ans. Dans le second, plus de 21 % des habitants sont âgés de 60 à 74 ans et 9,6 % de plus de
75 ans30. De plus, le vieillissement de la population combiné à la sédentarité dans les quartiers
implique d’anticiper une hausse de la part des personnes âgées vivant au sein des QPV.
Par ailleurs, les personnes âgées des QPV font face à l’isolement. Selon les QPV, près de 22 %
à 30 % des ménages d’un seul individu sont composés d’une personne âgée de 60 à 74 ans et
21 à 25 % d’une personne âgée de 75 ans et plus. Les femmes sont davantage concernées par
l’isolement. Dans les quartiers sud, elles représentaient plus de 53 % des ménages composés
d’une personne de 60 à 74 ans et environ trois quarts des ménages d’une personne âgée de
75 ans et plus31 32.
27
Données sur la Politique de la Ville. In INSEE. INSEE [en ligne]. INSEE, 30 mars 2020. Accessible à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4191749?so
mmaire=2500477
28
Suzanne Maury. Le vieillissement de la population. In : Les politiques publiques. La documentation Française, 2018. pp. 243-251
29
Compas, Diagnostic de la Politique de la Ville, novembre 2017
30
Données sur la Politique de la Ville. In INSEE. INSEE [en ligne]. INSEE, 30 mars 2020. Accessible à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4191749?so
mmaire=2500477
31
Ibidem. Source : INSEE, RP 2015 - Remarques : pour la part des femmes parmi les ménages d’une seule personne âgée de 60 à 74 ans et 75 ans et
plus, les données ne sont pas disponibles pour l’ensemble des quartiers.- 20 -
La densité médicale
Densité des professionnels de santé libéraux selon la zone géographique
(nombre de professionnels pour 100 000 habitants)
CA du
Total Avignon Le Pontet Grand
QPV Paca France
Avignon
Infirmiers libéraux et 176 76 341 193 260 143
sages-femmes
Professionnels de
la rééducation et
de l’appareillage 74 183 182 172 213 147
(masseurs-kinésithérapeute, ostéo-
pathe, orthophonistes, pédicures-po-
dologues...)
Médecins généralistes 42 123 136 111,7 102 78
Médecins spécialistes 14 234 51 150 117 81
Chirurgiens-dentistes 10 71 79 63,7 70 55
Laboratoires de biologie 6 12 22 12,5 13 5
et d’analyses médicales
Source : Données SIG du Grand Avignon – INSEE, estimation démographique 2015 – DRSM
Paca-Corse, 2019 – AMOS, 2017
Note méthodologique :
Les résultats présentés dans ce tableau ont été obtenus à partir des données suivantes :
- Pour les QPV d’Avignon et du Pontet :
Le nombre de professionnels de santé identifiés par le SIG à partir de la base SIRENE.
L’estimation démographique de l’INSEE, basée sur le recensement de 2015.
Les résultats présentés correspondent au nombre de professionnels identifiés via la base
SIRENE pour 100 000 habitants recensés par l’INSEE.
- Pour les villes d’Avignon, du Pontet ainsi que pour le Grand Avignon :
Les données émanent de la Direction Régionale du Service Médical Paca-Corse (DRSM).
Elles correspondent au nombre de professionnels de santé libéraux installés au 1er janvier
de l’année 2019 pour 100 000 habitants recensés par l’INSEE.
- Pour la France :
Les données émanent d’Assurance Maladie Offre de Soins (AMOS). Elles correspondent au
nombre de professionnels de santé libéraux présents et actifs au 31 décembre de l’exercice
pour 100 000 habitants recensés par l’INSEE.
Les sources utilisées étant différentes selon les niveaux d’observation, il faut tenir compte
des variations méthodologiques dans les résultats présentés ici.
Ces résultats n’ont pas vocation à refléter l’exactitude de la densité des professionnels de
santé libéraux ; ils visent avant tout à donner une tendance.- 21 -
1) La densité de médecins généralistes et spécialistes est plutôt satisfaisante dans le Grand
Une densité médicale mitigée pour le Grand Avignon :
Avignon. On observe une densité similaire à PACA pour les laboratoires de biologie et d’analyses
médicales. En revanche, pour les autres professions médicales, le nombre de professionnels
pour 100 000 habitants y est bien inférieur à celui de la région PACA. Au contraire, si l’on
compare la densité médicale du Grand Avignon à celle de la France, l’agglomération est bien
mieux dotée.
En ce qui concerne les structures, on compte :
maison régionale de santé, située sur la rocade sud et une maison de santé
1
pluriprofessionnelle au Pontet.
e centre hospitalier Henri Duffaut à Avignon, établissement support du Groupement
L
Hospitalier de Territoire (GHT) de Vaucluse. Notons la présence d’une Permanence
d’accès aux soins et à la santé mère enfant, à partir d’une consultation santé-
environnement.
e centre hospitalier de Montfavet, établissement public de santé mentale qui a
L
une mission de prévention, de soins en santé mentale et de réinsertion auprès de la
population du Vaucluse et du nord des Bouches-du-Rhône. Il inclut plusieurs structures
(centre d’activités thérapeutiques à temps partiel, centre médico-psychologique,
institut médico-éducatif, hospitalisation de jour...) dans le Grand Avignon : Avignon,
Velleron, Le Pontet.
Une offre hospitalière privée importante :
– A Avignon : centre chirurgical Montagard, institut du cancer Sainte Catherine, polyclinique
Urbain V, clinique Rhône-Durance, centre de rééducation du Lavarin.
– Aux Angles : clinique du Grand Avignon.
– A Villeneuve-lès-Avignon : clinique Belle Rive (établissement de psychiatrie générale).
2) La densité médicale au sein des QPV est plus faible que dans les communes dans
Une densité médicale faible dans les QPV33 :
lesquelles ils sont situés ou dans le reste du Grand Avignon. Les infirmiers libéraux et sages-
femmes sont la seule exception puisque les QPV sont mieux dotés qu’Avignon. Dans certains
quartiers, comme les quartiers nord-est, Saint Chamand, Joffre-centre-ville ou Camp Rambaud-
Les mérides, il n’y a aucun médecin généraliste dans l’enceinte du quartier. Les médecins
spécialistes sont également rares que ce soit dans le quartier ou à proximité.
La densité de professionnels de santé est toutefois à nuancer car certains professionnels
se trouvent hors périmètre du quartier mais dans un rayon inférieur à 2km. Par exemple, la
clinique Rhône-Durance se trouve à proximité des quartiers sud et dispose d’une offre
médicale diversifiée. En outre, Avignon reste une ville moyenne et Le Pontet une petite ville. La
mobilité spatiale est facilitée pour les habitants des QPV du fait de l’échelle territoriale et des
infrastructures de transports.
Ajoutons que les freins au recours aux soins ne se limitent pas à des critères géographiques.
Recréer le lien entre les habitants et les professionnels de santé en accompagnant les premiers
et en sensibilisant les seconds aux freins du public dans l’accès à la santé est un préalable
indispensable.
Voir en annexes pour le détail par quartier
33 - 22 -
Tendances relatives à l’état de santé de la population du Grand
Avignon : des indicateurs de santé moins favorables qu’en PACA :
1)
Les déterminants de santé :
Bien que l’on ne dispose pas de données précises sur le rapport des habitants des QPV au
système de soins, les éléments quantitatifs et les retours d’expérience des professionnels
évoqués précédemment laissent supposer qu’ils en sont plus éloignés que les habitants du
Grand Avignon.
Les difficultés économiques sont un facteur bien identifié de renoncement aux soins. La
CMU-C (désormais Complémentaire santé solidaire) contribue de façon considérable à réduire
les inégalités d’accès aux soins des ménages les plus pauvres. Parmi les habitants des QPV
couverts, près de 8 500 bénéficient de la CMU-C (soit 32 %). Si l’on rapproche ces chiffres
du nombre de personnes pauvres, on constate que plus de la moitié d’entre eux (55 %) sont
couverts par la CMU-C34 . Toutefois, comme illustré précédemment, les personnes bénéficiaires
de la CMU-C ont moins recours aux soins et à la prévention.
Comme le souligne l’Observatoire des inégalités dans un dossier consacré à la construction des
inégalités sociales de santé, le travail peut être pathogène : manipulation de produits chimique,
port de charges lourdes, rythmes de travail irréguliers, tâches répétitives...35. Le fait d’occuper
un emploi précaire augmente les chances d’être confronté à des conditions de travail pénibles
et peut être source de stress en raison de l’incertitude qui pèse sur la pérennité de l’emploi et
des revenus. En outre cela influe sur le rapport à la douleur. Lorsqu’une personne accomplit
régulièrement des tâches pénibles, « le seuil à partir duquel la plainte devient possible s’élève » 36
ce qui peut se traduire par un renoncement aux soins ou à un recours plus tardif. Le chômage
peut également produire des effets sur la santé en raison des inquiétudes qu’il génère sur
l’avenir. Rappelons que dans les QPV 21 à 24 % des salariés occupent un emploi précaire et
que 20 % de la population est à la recherche d’un emploi37.
Par ailleurs, plusieurs travaux ont montré que l’isolement relationnel multipliait jusque par 2
le risque de non-recours aux soins38. Si l’isolement se cumule à la précarité de l’emploi ou
au chômage, la santé des personnes concernées se retrouve alors doublement impactée, or
comme souligné précédemment, il s’agit d’éléments caractéristiques des habitants des QPV.
En ce qui concerne la population immigrée, soit 36 % des habitants des QPV39, la barrière de la
langue est un problème bien identifié tant pour accéder à l’information (dispositifs d’accès aux
soins, prévention...) qu’aux soins. Il importe également de tenir compte des rapports culturels
qu’entretient la population avec les problématiques de soin, de la maladie ou encore de la
prévention. Des professionnels auprès de ce public ont par exemple évoqué des maladies
taboues.
34
Données sur la Politique de la Ville. In INSEE. INSEE [en ligne]. INSEE, 30 mars 2020. Accessible à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4191749?so
mmaire=2500477
35
Obsrvatoire des inégalités. Comment se construisent les inégalités sociales de santé ? Le Tour de la question [en ligne], 2010. Accessible à : https://www.
inegalites.fr/Comment-se-construisent-les-inegalites-sociales-de-sante
36
Ibidem
37
Données sur la Politique de la Ville. In INSEE. INSEE [en ligne]. INSEE, 30 mars 2020. Accessible à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4191749?so
mmaire=2500477
38
Philippe Warin. Renoncement à des soins et précarité. In : Bénédicte Boisguerin. Le renoncement aux soins. Actes du colloque. DREES, 2011,
pp.81-89.
39
Données sur la Politique de la Ville. In INSEE. INSEE [en ligne]. INSEE, 30 mars 2020. Accessible à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4191749?so
mmaire=2500477. Source : INSEE, RP 2015Vous pouvez aussi lire