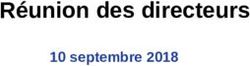Plan particulier de mise en sûreté des écoles de l'Isère - POUR ASSURER LA FORMATION DES FUTURS CITOYENS
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
P
Plan particulier
P
de mise en sûreté
M des écoles
S de l'Isère
POUR ASSURER
LA FORMATION
DES FUTURS CITOYENSUne aide à la gestion de crise
en 6 points essentiels
P Pour répondre à vos attentes
P
I - Une mission de sécurité obligatoire
M II - Une connaissance de votre environnement
III - Une réflexion sur les locaux
IV - Un équipement nécessaire
S V - Une gestion à préparer
VI - Une documentation à s'approprier
2
Février 2008L
ES importants dégâts consécutifs à la tempête de 1999 suivis
peu de temps après par l'accident dramatique de l'usine AZF à
Toulouse, ont conduit à nous mobiliser afin que les établisse-
ments scolaires s'inscrivent dans une démarche de prévention face
à l'éventualité de tels événements.
Le département de l'Isère, de par sa configuration géographique
et son dynamisme économique, compte de multiples situations ré-
pertoriées à risques :
- soit d'origine naturelle : chutes de blocs, avalanches, glissements
P de terrain, inondations...,
- soit d'origine industrielle : 29 sites SEVESO recensés, 3 sites
nucléaires, de nombreux barrages hydro-électriques, des
canalisations de produits dangereux....
Ainsi les écoles doivent-elles se préparer à ces possibles situations
P de crise afin d'assurer la sécurité de la communauté éducative, ce
qui sous-tend tout à la fois un travail de sensibilisation en direction
des jeunes élèves et la réalisation de consignes spécifiques pour les
personnels encadrant.
M
La prise en compte de cette organisation se doit donc d'être forma-
lisée au travers d'un document appelé « plan particulier de mise en
sûreté » (P.P.M.S.), qui au delà des crises majeures permettra éga-
lement d'acquérir les réflexes adaptés devant les problèmes plus
fréquents tels que, par exemple, une fuite de gaz ou un accident de
circulation impliquant un transport de matières dangereuses.
S Dans ce contexte, et au regard des différentes interrogations qui
peuvent se poser à vous à ce sujet, j'ai souhaité que soit réalisé un
document simple et le plus complet possible qui puisse répondre à
vos attentes. Ce document élaboré en collaboration avec les diffé-
rents partenaires concernés (Service départemental d'Incendie et
de Secours, Direction régionale de l'Industrie de la Recherche et de
l'Environnement, Institut des Risques Majeurs) devrait pouvoir vous
apporter toute l'aide et l'information nécessaire sur les mesures
qu'il vous appartient de prendre localement.
Je compte donc sur l'engagement de chacun d'entre vous afin que
chaque école se dote d'un plan adapté aux risques et assure les ac-
tions nécessaires pour une éducation à la sécurité et à l'environne-
ment des enfants dont nous avons la charge.
Grenoble, février 2008
Jacques AUBRY
Inspecteur d'académie,
Directeur des Services Départementaux
de l'Education Nationale de l'Isère
3I - Une mission
de sécurité obligatoire
S e mettre à l'abri dès lors qu'intervient une crise majeure d'ori-
gine naturelle ou technologique, c'est répondre à notre mis-
P sion de surveillance et de sécurité des élèves accueillis à l'école.
"L'institution scolaire assure la sécurité des élèves qui lui sont
confiés. Elle doit veiller à ce que les élèves ne soient pas expo-
sés à subir des dommages et n'en causent à autrui ; le devoir de
P surveillance incombe aux enseignants et aux directeurs d'écoles".
(Circulaire 97-178 du 18/09/1997).
"Ainsi pour aider et sensibiliser la communauté scolaire, le Minis-
tère de l'Education Nationale a publié un guide pour l'élaboration
M
du P.P.M.S. (B.O.E.N. hors série N° 3 du 30 mai 2002). Ce guide
s'inscrit dans une démarche de prévention et de protection afin
que l'école soit à même d'assurer la sécurité des élèves dans l'at-
tente de l'arrivée des secours".
Le décret 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation, à
S la prévention des risques, aux missions des services de secours,
à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des rè-
gles générales de sécurité, vient conforter la responsabilité des
enseignants en ce domaine. Ce décret a d'ailleurs été repris par la
circulaire N° 2006-085 du 24 mai 2006 parue au B.O.E.N. N° 33 du
14 septembre 2006.
Vous pouvez également consulter le VADE-MECUM du directeur
d'école, Annexe 1 publié le 18/04/2007 - "Responsabilité des di-
recteurs d'école en matière de surveillance et de sécurité des élè-
ves".
La prise en charge des mesures de sécurité s'impose naturelle-
ment à chaque enseignant. Celles-ci font partie des programmes
notamment ceux sur l'éducation à l'environnement et au dévelop-
pement durable "composante importante de la formation initiale
des élèves". Les risques majeurs en sont un des aspects (circulaire
N° 2004-110 du 08 juillet 2004).
5II - Une connaissance
de votre environnement
L a première démarche consiste à connaître les risques auxquels
la commune et l'établissement scolaire sont soumis. Il convient
P de prendre l'attache du Maire, responsable de la sécurité sur sa
commune et qui, à ce titre, se doit d'informer, d'alerter et d'orga-
niser les secours.
Tout d'abord, un document établi par Monsieur le Préfet recen-
P se l'ensemble des risques pour chacune des 533 communes de
l'Isère. Ce document qui s'appelle le Dossier Départemental sur
les Risques Majeurs (D.D.R.M.) peut être consulté en mairie et à la
préfecture. Vous pouvez également avoir accès à ces informations
sur le site www.prim.net dans la rubrique "ma commune face aux
M
risques".
En fonction des situations, la commune peut disposer d'un :
• D.C.S. : dossier communal synthétique (En 2005, 172 dossiers
avaient été réalisés par le Préfet de l'Isère. Puis, la réglementa-
S tion a remplacé les D.C.S. par de simples portés à connaissan-
ce).
• D.I.C.R.I.M. : document d'information communal sur les ris-
ques majeurs établi par le Maire dès lors que la commune est
soumise à un plan de prévention des risques naturels ou à un
plan particulier d'intervention.
Enfin et au regard des risques connus, le Maire peut établir un
plan communal de sauvegarde, P.C.S., dans lequel le P.P.M.S. de
l'école trouve naturellement sa place.
Les sites industriels ou nucléaires sont parfaitement identifiés ;
mais sachez que si votre école se situe non loin d'une voirie,
vous pouvez toujours être confronté à la survenue d'un accident
lié à un transport acheminant des matières dangereuses (T.M.D.)
ou tout simplement à une fuite accidentelle de gaz sur la voie
publique.
Les sites naturels à risques sont également dans notre départe-
ment nombreux et reconnus : éboulements, avalanches, crues
torrentielles….
6III - Une réflexion sur les locaux
L e choix d'un espace de mise à l'abri s'avère nécessaire pour la
plupart des risques mais surtout lors de la survenue d'un nua-
P ge toxique.
Il ne s'agit pas de créer à tout prix un lieu de confinement parfai-
tement étanche mais plutôt de rechercher des surfaces d'accueil
situées d'abord à l'opposé (ou au plus loin) du risque supposé et
P dont les principales caractéristiques seront les suivantes :
• fenêtres les plus étanches possible à l'air (ou aisément calfeu-
trables).
• faux-plafonds ne donnant pas directement dans le volume des
M
toitures.
• absence d'aération ou possibilité de couper la ventilation.
Les recommandations préconisées par le C.E.T.E. (Centre d'étu-
des techniques de l'Equipement) de LYON sont de 1,5 m2 par per
sonne pour les surfaces et de 3,6 m3 pour le volume.
S Si globalement la salle de classe répond à ces caractéristiques, ce
choix sera à privilégier. En effet cette option permet d'assurer la
continuité de l'activité ordinaire de l'enfant et évite le stress que
peut provoquer une concentration importante d'élèves dans un
lieu unique.
Ce travail sur le choix sera à réaliser en concertation étroite avec
les services responsables de la mairie et les sapeurs-pompiers.
Enfin, et en fonction de l'importance de l'école, un découpage de
zones par unités de 2 classes s'avère un principe intéressant pour
ne pas isoler un enseignant.
7IV - Un équipement nécessaire
L es zones de mise à l'abri ainsi définies devront disposer
impérativement :
• d'un sanitaire ou seau d'aisance,
• d'un point d'eau ou bouteilles d'eau,
• de rubans adhésifs si cela est nécessaire,
P • d'une radio à piles mentionnant la fréquence de "France Bleu
Isère" à écouter,
• d'une trousse de secours,
• d'une petite réserve alimentaire : sucre/denrées non périssables
• de jeux,
P • des documents de gestion de crise : liste des présents, condui-
tes à tenir, répertoire téléphonique….
ATTENTION
Lors des périodes de mise à l'abri qui peuvent durer plus de
2 heures la température des salles augmente d'environ de 3 à 4
M degrés ; il faut donc :
• se protéger des rayonnements du soleil (occultation à prévoir),
• éteindre les appareils électriques producteurs de chaleur,
• assurer des activités les plus calmes possible,
• aérer les locaux après l'alerte.
S Enfin le directeur disposera d'un téléphone lui permettant de
pouvoir en permanence être relié au réseau sans devoir quitter
ses élèves ou son équipe. Au même titre il conviendra que l'école
puisse mettre en place un système interne de communication.
RAPPEL SUR L'ALERTE :
L'autorité qui, sur demande du
Préfet, donne l'ordre de mise à
l'abri est :
• le maire,
• l'entreprise via la sirène du site (Signal National d'alerte) qui
peut être relayée par téléphone.
Cependant, selon les situations cet ordre peut être donné éven-
tuellement par les pompiers, la gendarmerie, la police ou par
vous-même si l'urgence le nécessite. Dans tous les cas si vous en-
tendez la sirène vous devez, à titre préventif, vous mettre en situa-
tion de mise à l'abri dans l'attente des instructions.
La fin de mise à l'abri sera donnée par les autorités compétentes.
8V - Une gestion à préparer
A u même titre que les exercices d'alerte et d'évacuation en
matière de sécurité incendie, un exercice de mise en sûreté :
• se prépare,
• se formalise,
• se teste une fois par an.
P Le Directeur d'école et l'équipe enseignante rédigent le P.P.M.S.
dont la validation ne peut se faire qu'au travers d'exercices.
Les consignes sont écrites et connues de tous les personnels pour
P assurer la mise en sécurité des élèves, et ce dès la pré-rentrée.
Le document "Plan Particulier de Mise en sûreté" est soumis à
chaque rentrée scolaire au conseil d'école.
Sur ce document devront figurer :
M • les consignes internes
• les coordonnées des autorités qui seraient à joindre si nécessaire :
Pompiers 18 (ou N° européen 112)
SAMU 15
S Gendarmerie/Police
Mairie
Inspection académique
17
à compléter
numéro dédié uniquement en cas d’accident risques majeurs :
06 82 04 39 39
IEN de circonscription à compléter
Ces numéros sont à afficher dans chaque zone de mise à l'abri
Compte tenu de la saturation des lignes, les services de
secours ne seront à contacter qu'en cas d'extrême urgence
Il est important que les parents soient informés de ne pas
venir chercher leurs enfants durant une période de crise et qu'ils
sachent que ceux-ci sont en sécurité à l'école.
Les parents seront d'autant plus confiants qu'ils connaîtront le
degré de préparation de l'école face à la situation de crise.
Les élèves seront d'autant plus autonomes et responsables qu'ils
connaîtront la nature des risques encourus et auront adaptés les
comportements attendus lors d'exercices répétés.
9VI - Une documentation
à s’approprier
De nombreux documents existent à caractère administratif ou
pédagogique ou les 2 à la fois sur ce thème des risques majeurs.
P Vous devez donc trouver au sein de votre école :
• Plan Particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs :
BOEN n° 3 du 30/05/2002.
P • Les établissements d'enseignement face à l'accident majeur :
ONS (Observatoire National de la Sécurité) - juin 2002.
• Les documents publiés par la commune : journal/DVD….
M • Les documents diffusés lors des campagnes d'information par
le CIRIMI/SPIRAL.
• Présentation des risques majeurs en Rhône-Alpes : CDROM -
2003 - SPIRAL/CIRIMI/DRIRE/IRMA.
S • Mallettes pédagogiques : CDROM sur les risques - IRMA.
• Les risques majeurs en Rhône-Alpes "Vous informer pour
mieux prévenir" : Brochure IRMA 2007.
10Des référents et des sites à
connaître
REFERENTS
• Le maire de la commune.
P
• L’IEN de circonscription ou son ACMO (agent chargé de la mise
en œuvre des règles de sécurité). Ils pourront si besoin vous
mettre en relation avec le responsable du dossier risques
majeurs pour le 1er degré.
• Le correspondant risques majeurs de l’Inspection Académique :
04 76 74 79 07.
P • Le médecin, conseiller technique départemental du service de
la promotion de la santé des élèves : 04 76 74 78 80.
• L’inspecteur hygiène sécurité, coordonnateur académique
risques majeurs - Rectorat : 04 76 77 54 33.
M SITES
www.education.gouv.fr
pour accéder au BOEN hors série n° 3 de mai 2002
http://eduscol.education.fr
S puis accéder aux documents sur "l'éducation à la sécurité"
http://ons.education.gouv.fr
pour accéder aux documents de l'Observatoire National de Sécurité.
www.ac-grenoble.fr/ia38 :
• site hygiène et sécurité : rubrique "risques majeurs" pour accé-
der au présent document ;
• site pédagogique : rubrique "sciences et mathématiques" pour
accéder aux fiches pédagogiques "risques majeurs".
www.irma-grenoble.com
pour accéder au forum sur les PPMS.
www.iffo-rme.fr/generalites/ecole
pour accéder au réseau des formateurs risques majeurs.
www.ecologie.gouv.fr et
www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr
Ministère de l'écologie et du développement durable.
www.prim.net
pour accéder au portail de la prévention des risques majeurs.
11Cité administrative : 1, rue Joseph-Chanrion - 38032 Grenoble Cedex 01
Téléphone : 04 76 74 79 79 - Télécopie : 04 76 74 79 95
e-mail : ce.ia38@ac-grenoble.fr - Site web : http://ia38.ac-grenoble.frVous pouvez aussi lire