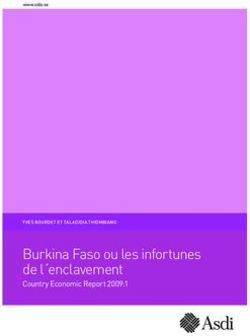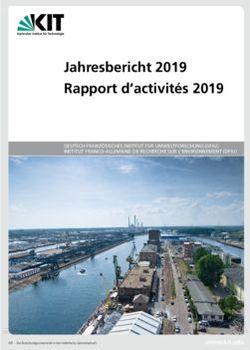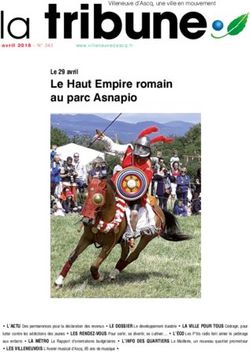Profil environnemental de Basse-Normandie - Les sous-sols et la géodiversité - La Basse-Normandie est le manuscrit géologique le plus complet de ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Profil environnemental
de Basse-Normandie
Les sous-sols et la géodiversité
Affleurements rocheux le long du littoral de La Hague / Patrick Galineau / DREAL BN
❝ La Basse-Normandie est le manuscrit
géologique le plus complet de France... ❞Réalisation de la thématique
Ce document a été conçu grâce à la contribution de nombreux rédacteurs issus de services spécialisés dans le domaine de
l’environnement. Il présente un état des lieux des sous-sols et de la géodiversité en Basse-Normandie. Compte tenu de
l’état de la connaissance et de l’importance du thème considéré, ce recueil ne peut être exhaustif. Il prend en compte les
données qui ont été transmises par les acteurs mobilisés. Une rubrique internet dédiée permet son actualisation et son
enrichissement. Les services de l’État ont coordonné l’ensemble des travaux.
Directeur de publication : Jean Charbonniaud, Préfet de la région Basse-Normandie, Préfet du Calvados
Directrice de la rédaction : Caroline Guillaume, Directrice régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement de Basse-Normandie (DREAL)
Cadrage : Michel Guéry, Philippe Surville (DREAL)
Conception et management : Sandrine Héricher (DREAL)
Développement graphique et mise en page : Séverine Bernard (DREAL)
Direction technique et expertise : Frédéric Gresselin (DREAL)
Rédaction
Un patrimoine géologique d’intérêt international : Frédéric Gresselin (DREAL)
Les usages des sous-sols, les altérations et les risques : Sylvie Boutten, Melissa Delavie, Nathalie Desruelles, Frédéric
Gresselin, Guillaume Goodwin, Sandrine Héricher, Mathieu Morel, Matthieu Pelletier (DREAL)
Avec les contributions de : Jacques Aubry, Françoise Gigot (Lithothèque), Catherine Varlet-Coeffier (Lycée Malherbe de
Caen)
Cartographies : Julien Defenouillère, Séverine Bernard (DREAL), Chloé Delaigues (Ecovia)
Relecture
Conseil régional de Basse-Normandie : Thierry Berthaux, Isabelle Bureau
DREAL : Christine Bordier, Ludovic Genet, Michel Guéry, Olivier Lagneaux, Marie-Josée Lopez-Jollé, Annie Magnier,
Philippe Surville, Patrice François
Ecovia : Roland Thaler
Lycée Malherbe de Caen : Catherine Varlet-Coeffier
Lithothèque de Normandie : Françoise Gigot
Secrétariat Général aux Affaires Régionales : Jeanne de la Porte, Vincent Rivasseau
Photographies : cet ouvrage a bénéficié de la transmission de photographies de la part de nombreux contributeurs.
Les droits de reproduction ont été accordés spécifiquement pour l’usage du Profil environnemental. Toute reproduction
complémentaire pour d’autres utilisations nécessite l’accord des auteurs.
ISBN : 978-2-11-151133-0 - Dépot légal : novembre 2015
La réalisation de ce document a bénéficié de financements de l’Union Européenne (FEDER) et de l’État (Ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie).
3Dans les versants escarpés du bocage, dans de nombreuses carrières et le long
du littoral, sur les estrans ou dans les falaises, la nature révèle
en Basse-Normandie quelques affleurements géologiques du plus grand intérêt,
national ou international.
C’est à travers l’étude de notre région, dès la fin du XVIIIe siècle, que des
pionniers ont contribué à poser les fondements d’une nouvelle discipline : la
géologie. Leurs noms sont peu connus du grand public. Ces érudits étaient
des membres de la « Société Linnéenne de Normandie », créée par Arcisse de
Caumont en 1823 et qui diffusa à l’époque une revue scientifique d’audience
internationale.
Grâce à ces savants, l’Université de Caen a rayonné dans le passé et notre
patrimoine est connu des géologues du monde entier. S’il suscite toujours autant
d’intérêt, deux siècles après la naissance des sciences de la Terre, c’est qu’il est
d’une grande valeur scientifique et pédagogique. La Basse-Normandie est en
effet le manuscrit géologique le plus complet de France.
Ces prestigieuses ressources ont offert à nos villes et à nos villages de
magnifiques constructions et monuments. L’exemple le plus réputé est celui de
la pierre de Caen qui traversa la Manche et même l’Atlantique pour édifier de
célèbres monuments tels que la cathédrale de Durban en Angleterre ou Christ
Church à Montréal.
Dès le Néolithique, nos ancêtres ont exploité les moindres richesses du sous-sol :
silex, houille, fer et autres métaux, pierres à chaux et de taille, craie, argiles…
Les matériaux les plus rares sont désormais épuisés ou trop difficiles d’accès et
ne peuvent actuellement bénéficier d’une valorisation économique.
Le gisement de roches massives de types grès, granites, calcaires… est
volumineux et pour l’essentiel dédié à la fabrication de granulats. Il fait l’objet
d’une exploitation raisonnée.
L’exploitation des gisements souterrains a laissé de nombreuses cavités dont
quelques-unes seulement sont parfaitement connues. À l’exception de certains
secteurs localisés, la connaissance de l’aléa et la maîtrise du risque sont peu
avancés, même si l’État et l’Union européenne ont tenté de mobiliser les
collectivités, moins avancées sur ces aspects.
Valérie Guyot/DREAL BN
51 Un patrimoine géologique d’intérêt international 9
• Les roches les plus anciennes de France : l’Orosirien de l’anse du Cul Rond (âgées de 2 milliards d’années)
• Le Néoprotérozoïque et la création de la chaîne de montagne cadomienne (de -640 à -540 millions
d’années)
• Du Cambrien à la création de la chaîne de montagne varisque : une microplaque située au large de l’Afrique
(de -540 à -320 millions d’années)
• Le cycle alpin (de -200 millions d’années à aujourd’hui)
2 Les fonctionnalités des sous-sols 35
• Les fonctionnalités écologiques
• Les fonctionnalités économiques : l’extraction de matériaux
3 Les altérations et les risques liés au sous-sol 47
• Le stockage des déchets
• Les cavités souterraines
• Les glissements de terrain et chutes de blocs
• Le risque sismique
4 Synthèse et enjeux 68
• Chiffres clés
• Grille « AFOM »
• Enjeux et orientations
5 Acteurs régionaux et bibliographie 71
• Acteurs régionaux
• Bibliographie
71. Un patrimoine géologique
d’intérêt international
À découvrir d
ans ce chapit
La géologie de la Basse-Normandie est d’une grande richesse. La région re
appartient dans son intégralité à la plaque armoricaine même si, à l’Est, cette XX Des roches parmi les plus anciennes
de France
dernière disparaît sous les recouvrements secondaires et tertiaires du Bassin XX Le Néoprotérozoïque et la création
parisien. de la chaîne de montagne
cadomienne
XX Du Cambrien à la création de la
À l’Ouest, le Massif armoricain, fortement plissé, forme des paysages de collines
chaîne de montagne varisque
bocagères, incisées de vallées plus ou moins échancrées et parcourues de zones XX Le cycle alpin
humides. À l’Est, le Bassin parisien propose un relief plus doux de plaines et de
plateaux, aux vallées ouvertes ou en auge, et quelques collines qui courent du
Pays d’Auge au Perche.
Du littoral escarpé du Cotentin ...
? Définition
La géodiversité représente
« l’ensemble des éléments des sous-
sols, sols et paysages qui, assemblés
les uns aux autres, constituent
des systèmes organisés, issus de
processus géologiques ».
Cela concerne autant les
phénomènes passés de la Terre,
Olivia Durande/DREAL BN observables dans les sous-sols, sols
et paysages (traces de vie...), que
les phénomènes courants actuels
... aux bocages de l’Orne (biologiques, climatiques...) qui
agissent sur ces composantes.
Le monde minéral est le substrat
de la vie, les écosystèmes actuels
ne sont que la dernière image
d’un livre que le géologue cherche
à reconstituer. L’environnement
géologique et l’histoire de la
Terre fournissent des indices
qui permettent de comprendre
l’évolution de la vie et de la
biodiversité actuelle. Ainsi, la
géodiversité est le complément
indissociable de la biodiversité.
Marc Heller
9Profil environnemental de Basse -Normandie
Décembre 2015
| Les sous-sols et la géodiversité
La Basse-Normandie tient depuis plusieurs centaines de millions d’années yy
un registre des plus complets sur l’histoire de notre planète. La tectonique
des plaques n’a plus de secret pour elle. Elle a vécu l’élévation de trois chaînes de
Le monde minéral est
montagnes. Elle peut témoigner de l’explosion de la vie et de la disparition des le substrat de la vie.
dinosaures. Elle était « invitée » à l’ouverture de l’Atlantique. Elle est incollable yy
sur les grandes glaciations. Qui peut se « vanter » d’avoir autant voyagé dans
le monde et amoncelé autant de souvenirs qu’elle nous offre sous la forme
de roches et de fossiles ? Probablement beaucoup d’autres régions à travers le
monde mais celle-ci est une des plus riches à l’échelle de la planète.
La spirale géologique
Réalisation : DREAL de Basse-Normandie et Agence Bingo
Repères
Les richesses géologiques,
minéralogiques et
paléontologiques font partie du
patrimoine naturel au même titre
que la biodiversité (article L 411-
5 du code de l’Environnement).
Un inventaire du patrimoine est
mené dans chaque région sous la
responsabilité des DREAL, sur la base
d’une méthode élaborée au niveau
national par le Muséum National
d’Histoire Naturelle, avec l’appui
technique du Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM).
La DREAL coordonne l’élaboration
de l’inventaire en s’appuyant sur
l’Association Patrimoine Géologique
de Normandie et le Conseil
Scientifique du Patrimoine Naturel
(CSRPN) de Basse-Normandie.
Les inventaires du Calvados et de
l’Orne sont disponibles sur le site
internet de la DREAL, celui de la
Manche est en cours de réalisation.
10La baie d’Écalgrain et l’anse du Cul Rond (50)
Repères
La Terre s’est formée il y a environ
4,5 milliards d’années et la vie y est
apparue il y a 3,5 milliards d’années.
Les seules traces de l’évolution
de la planète encore identifiables
aujourd’hui sont enregistrées dans les
roches présentes.
Pour dater les événements de
l’histoire de la Terre et des êtres
vivants, on dispose de deux types
d’outils : la stratigraphie et la
radiochronologie. La stratigraphie
permet d’établir la succession
d’événements au cours du temps en
déterminant l’ancienneté relative
des roches et des fossiles qu’elles
contiennent (datation relative). La
radiochronologie, par mesure de la
décroissance radioactive d’isotopes,
permet, dans certaines conditions,
d’assigner à une roche ou à un fossile
son âge exact (datation absolue).
Olivia Durande/DREAL BN
11Profil environnemental de Basse -Normandie
Décembre 2015
| Les sous-sols et la géodiversité
L’échelle stratigraphique est la division des temps géologiques fondée sur l’étude des strates sédimentaires qui se sont déposées
successivement au cours du temps. Elle est divisée en grandes unités, les ères, elles-mêmes divisées en unités de plus en plus courtes,
les systèmes ou les périodes, les époques ou les séries et les étages. L’étage est l’unité de base de l’échelle stratigraphique ; il est
représenté par un stratotype, c’est-à-dire une couche géologique caractérisée par un contenu lithologique et paléontologique spécifique.
12 Les roches les plus anciennes de France :
l’Orosirien de l’anse du Cul Rond (âgées de 2 milliards d’années)
La géologie de la Basse-Normandie est un manuscrit dont
les premières pages ont été définitivement perdues. Il
ne reste aucune trace de l’histoire régionale au-delà de
2 milliards d’années. Seuls, de cette lointaine époque,
? Définitions
persistent quelques lambeaux d’un socle orosirien (icartien) Roche métamorphique : roche
dont les témoins les plus célèbres affleurent dans la Hague qui a subi une transformation
et à Guernesey, dans l’Icart Bay. minéralogique et structurale à la
suite d’élévations de la température
C’est à marée basse que l’Anse du Cul Rond (Jobourg, 50) dévoile les plus beaux et de la pression
faciès des roches les plus vieilles de France. Elles sont datées de 2 milliards
d’années et prennent la forme de gneiss et de migmatites. Formées dans l’écorce Gneiss : roche métamorphique. Les
terrestre profonde, elles reposent désormais à la surface du globe. gneiss de l’anse du Cul Rond sont
d’anciennes roches sédimentaires
Nez de Jobourg (50) (paragneiss) et magmatiques
(orthogneiss) qui, portées dans
des conditions de température et
de pression très élevées (550°c et
5 à 6 kilobars minimum) se sont
progressivement transformées en
gneiss. Certains minéraux inclus dans
ces gneiss sont datés de 2 milliards
d’années. Ce sont les seuls témoins
connus de cette époque en
Basse-Normandie.
Migmatites : roche d’origine
gneissique qui s’est engagée dans
un processus de fusion partielle.
Laurent Mignaux/MEDDE-MLETR
Orthogneiss oeillés
Frédéric Gresselin/DREAL BN
13Profil environnemental de Basse -Normandie
Décembre 2015
| Les sous-sols et la géodiversité
Le Néoprotérozoïque et la création de la chaîne
de montagne cadomienne (de -640 à -540 millions d’années)
De nouveaux quelques feuillets arrachés et l’histoire
reprend au Néoprotérozoïque, il y a 640 millions d’années.
L’épopée de la plaque armoricaine débute.
Pendant 100 millions d’années (Ma), la Basse-Normandie
? Définitions
est « sous le feu des projecteurs ». C’est l’époque Orogenèse : ensemble des
« glorieuse » de la création de la chaîne de montagne événements aboutissant à la
cadomienne, dont le nom fait référence au nom latin de formation d’une chaîne de
Caen (Cadomus). montagnes par compression.
Arcs insulaires : ensembles d’îles,
la plupart volcaniques, réparties en
La chaîne cadomienne, ou « The Cadomian belt », comme l’appellent les un ou plusieurs alignements courbes
Anglo-saxons, est, à l’époque, une chaîne de montagne puissante qui dessinant des arcs à convexité
s’étend du Canada à l’Espagne et du Royaume-Uni à la Pologne. généralement tournée vers le
large. Leur présence résulte de la
La Basse-Normandie est, à cette époque, un système d’arcs insulaires situé au subduction d’une plaque océanique
large de l’Afrique. Les processus cinématiques qui régissent son fonctionnement sous une autre plaque tectonique.
s’apparentent à ceux actuellement observés dans les archipels du Pacifique,
au large de l’Australie (L’arc des îles Mariannes par exemple). Edifiés par un Pluton : roche grenue formée par
volcanisme particulièrement abondant autour de –585 Ma, les arcs insulaires du cristallisation lente d’un magma
Vast et de Coutances forment des cordillères montagneuses bordées de toute part profond.
par des mers profondes. Les produits d’érosion générés par les arcs viennent s’y
déposer.
La diorite de Coutances
Le plus vaste des bassins sous-marins est celui de la Mancellia. Situé au Sud-
Est de l’arc de Coutances, il est le siège, entre -585 Ma et -540 Ma, d’une
importante sédimentation qui donne naissance au « flysch briovérien ». Ce flysch
est une formation détritique essentiellement constituée de grès et de schistes.
Elle atteint plusieurs milliers de mètres d’épaisseur dans le bassin mancellien.
La principale phase de déformation liée à la constitution de la chaîne de
montagne cadomienne se situe vers -540 Ma. Les bassins sédimentaires se
trouvent progressivement émergés et leurs sédiments font l’objet d’un intense
serrage. Les plis et les failles qui en résultent, orientés Nord-Est/Sud-Ouest
structurent encore la région de nos jours.
Frédéric Gresselin/DREAL BN
Soumis à de très fortes pressions, les parties les plus profondes du bassin
mancellien entrent en fusion vers - 540 Ma et émettent un abondant La diorite de Coutances est le principal
magmatisme. En remontant vers la surface, les magmas donnent naissance à de pluton armant l’Arc de Coutances.
nombreux plutons : granodiorites de Vire, d’Avranches, de la Ferté-Macé, d’Athis, D’autres diorites se mettent en place
de Fougères, d’Izé… En s’injectant dans le flysch briovérien, les magmas le plus au Nord, dans l’arc du Vast. Les
diorites ressemblent à des granites mais
transforment par cuisson en cornéennes et schistes tachetés.
sont moins acides que ces derniers.
14Le flysch briovérien de la vallée de la Laize (14)
? Définitions
Granodiorite : roche cristalline un peu
moins riche en silice qu’un granite.
Cornéenne : roche « dure comme de la
corne » issue de la cuisson d’une roche
parent (grès, schistes, calcaires…) par
une intrusion magmatique.
Schistes tachetés : roche très dure
issue également de la cuisson d’une
roche parent par une intrusion
magmatique. Situé plus loin de
l’intrusion que la cornéenne et donc
porté à une température moindre que
cette dernière, le schiste tacheté est
moins bien recristallisé, moins dur et
Frédéric Gresselin/DREAL BN
davantage altérable. Ainsi, dans le Sud
de la Normandie, les schistes tachetés
Le flysch briovérien est une formation détritique essentiellement constituée de « grès
forment-ils des reliefs assez mous
et de schistes ». Sur des milliers de mètres d’épaisseur affleurent des alternances de
grauwackes, de grès et de siltites, anciens matériaux de remplissage du bassin océanique là où les cornéeennees déterminent
de la Mancellia. la présence de reliefs accentués
ceinturant les granodioritiques.
15Profil environnemental de Basse -Normandie
Décembre 2015
| Les sous-sols et la géodiversité
Totalement émergée à l’issue de l’orogénèse cadomienne, la plaque armoricaine La discordance angulaire entre
subit alors une phase d’érosion continentale de grande ampleur. Les premiers les terrains du Néoprotérozoïque
dépôts recouvrent la chaîne cadomienne en discordance. (anciennement appelé
Briovérien) et ceux du Cambrien
Cette discordance angulaire s’observe de façon spectaculaire dans la vallée de
la Vire ou de la Laize, à Jacob Mesnil, où elle attire chaque année des milliers de
géologues en herbe venus de toute la France et des pays voisins.
ns
rie
a mb
tsc
pô
Dé
brio
Dé érien
pôt s
v
Le conglomérat cambrien, formation fluviatile à galets, repose sur le Néoprotérozoïque
s
discordance
(entre -1 milliard et - 540 millions d’années) plissé et érodé angulaire
Françoise Gigot/Lithothèque de Normandie
Galets cambriens issus de l’érosion de la chaîne cadomienne (Equeurdreville-Hainneville)
? Définitions
Discordance : surface d’érosion
séparant un ensemble plissé
lors d’une phase tectonique
d’un autre ensemble non plissé
par cette dernière, car déposé
postérieurement à la déformation.
La discordance cadomienne
correspond à la présence des terrains
cambriens reposant sur les terrains
néoprotérozoïques plissés.
Caldeira : cratère volcanique
géant pouvant mesurer plusieurs
kilomètres de diamètre lié à
Frédéric Gresselin/DREAL BN l’affaissement d’un volcan par
effondrement de la chambre
La période de décompression qui suit l’orogenèse cadomienne au Cambrien magmatique qui l’alimente.
s’accompagne d’une montée des derniers magmas que cette dernière a généré.
Les régions de Saint-Germain-le-Gaillard (Nord-Cotentin) et d’Alençon (Orne) Ignimbrite : roche formée de débris
sont alors le siège d’un véritable « feu d’artifice ». Les volcans explosifs de lave acide issus d’une nuée ardente
libèrent localement, par le biais de nuées ardentes, des centaines de mètres et soudés avant leur refroidissement.
d’épaisseur de roches éruptives. De tels trésors constituent aujourd’hui le Elle est principalement de couleur gris
soubassement d’une partie de la forêt d’Ecouves… foncé à gris-bleu. Le mot ignimbrite
vient du latin, de ignis, le feu, et
La vie paraît absente à cette époque et semble attendre l’explosion de la dernière imber, la pluie.
caldeira pour s’épanouir dans la région. Aucun fossile n’a été jusqu’ici trouvé dans
les terrains briovériens. Pyroclastites : roches issues
d’éruptions extrêmement violentes
au cours desquelles les volcans
expulsent des volumes considérables
de cendres et de ponces et émettent
des coulées acides riches en gaz.
16Le fossé volcanique du Maine
Source : J. Le Gall, 1993
Repères
Des volcans en Basse-Normandie :
la caldeira cambrienne d’Ecouves
(Source : J. Le Gall, 1993)
Au cours du Cambrien, la bordure
Sud-Est de la Mancellia est le siège
d’une intense activité volcanique
s’étendant d’Ecouves à la Charnie.
L’extension de la province volcanique
est estimée à plus de 75 km de long
(limite Nord inconnue) et 50 km
de large. Les centres éruptifs
se situent au sein de grandes
caldeiras dont celle d’Ecouves.
Les produits émis, ignimbrites
et pyroclastites, reflètent le
dynamisme hautement explosif
du volcanisme.
Les volcanites de la forêt
d’Ecouves se sont mises en
place très rapidement, dans un
environnement deltaïque au Nord
et marin au Sud. L’émission des
ignimbrites s’est exercée en lien
avec l’effondrement du toit de la
Les premiers dépôts cambriens torrentiels à fluvio-deltaïques, témoignent du démantèlement de chambre magmatique, lors de la
la chaîne cadomienne à travers un processus dénommé pénéplanation.
formation de la caldeira d’Ecouves.
La texture des ignimbrites indique
une température de mise en place
supérieure à 500°C.
Galets de très grande taille (cliché 1) Galets de petite taille (cliché 2) Sables grossiers avec graviers (cliché 3)
galets
graviers
galets
Frédéric Gresselin/DREAL BN Frédéric Gresselin/DREAL BN Frédéric Gresselin/DREAL BN
Les dépôts sont de plus en plus fins au fur et à mesure que diminuent l’altitude des reliefs et le pouvoir de transport des torrents et
des fleuves. À l’extrême base de la série cambrienne, le conglomérat se compose ainsi de galets de très grande taille (cliché 1). Ils
deviennent de plus en plus rares vers le haut de la série, remplacés par des galets de petite taille (cliché 2) puis par des graviers et des
sables grossiers (cliché 3).
17Profil environnemental de Basse -Normandie
Décembre 2015
| Les sous-sols et la géodiversité
Du Cambrien à la création de la chaîne de montagne
varisque : une microplaque située au large de l’Afrique
(de -540 à -320 millions d’années)
L’écriture du manuscrit est plus distincte, quelques
paragraphes restent cependant illisibles
et des pages sont arrachées de temps à autre.
Un des trilobites les plus célèbres
de Basse-Normandie : Asaphus, découvert lors
du creusement de la tranchée de chemin de
fer de Mortain
Une plate-forme sédimentaire au large
de l’Afrique, dans l’hémisphère Sud
La première transgression marine du Cambrien commence dans le Cotentin dès
-540 Ma. Les premiers dépôts, les schistes et grès de Carteret, contiennent la
faune la plus ancienne du Massif armoricain, éponges et hyolithes. Bientôt, les
fonds normands sont tapissés de dépôts bactériens et de stromatolithes. Mais
l’instabilité de la plaque armoricaine ne permet pas l’installation durable de cette
plate-forme carbonatée (fonds marins où se déposent les calcaires). La mer se
Valérie Guyot/DREAL BN - Université de Caen,
retire assez rapidement pour revenir petit à petit, du Cambrien à l’Ordovicien. laboratoire de géologie
?
Les stromatolithes se localisent au Cambrien inférieur dans les trois
provinces marines du Cotentin, de la vallée de l’Orne et du Maine.
D’après Doré, 1987
Définitions
0 30 km
Transgression marine :
Paléographie
envahissement des continents par
au Cambrien inférieur
la mer, dû à un affaissement des
terres émergées ou à une élévation
générale du niveau des mers.
Stromatolithe : formation rocheuse
calcaire formant des massifs en forme
de chou-fleur. Les stromatolites ou
stromatolithes signifient « tapis de
pierre » en grec. L’origine biologique
Stromatolithes
Calcaire et argiles silteuses Arkoses, Grès feldspathiques Valérie Guyot/DREAL BN - Université de Caen, des stromatolithes est avérée pour
Argiles, schistes et grès Socles émergés
Dolomies et calcaire dolomitiques Haut-fond à sédimentation réduite laboratoire de géologie
les roches récentes, ayant moins de
350 millions d’années. Elle est le
Le premier fossile à carapace à apparaître dans la région est un trilobite fait de micro-organismes, telles les
dénommé Bigotina. Cet organisme, découvert dans la falaise du Cap de Carteret cyanobactéries, qui précipitent le
(50) et daté du Cambrien inférieur, est peut-être le plus vieux fossile à squelette bicarbonate en carbonate de calcium.
externe du monde. Les plus anciens stromatolithes datent
de -3,5 milliards d’années.
Hyolithes : fossiles semblables à de
petits mollusques coniques.
18Position de la plaque Position de la plaque
armoricaine vers -530 Ma armoricaine vers -480 Ma
(tache jaune de l’Arc cadomien) (tache jaune au Sud de l’Océan rhéic)
Source : La Normandie (J. Le Gall et al., 2003) Source : La Normandie (J. Le Gall et al., 2003)
Cambrien - 530 Ma Ordovicien - 480 Ma
Équateur
Siberia
Équ
ate
ur
Siberia Laurentia
t us
ec
n iap Baltica
ie 30°
éa
n
om S
Oc
30
°S
Laurentia ad
cC Océ
Oc Baltica Ar an R
héic
éa
n 60
iap °
ec
tu
s Gondwana
Gondwana
Pôle Sud
Pôle Sud
Pendant 200 millions d’années, les conditions de la sédimentation
vont essentiellement rester littorales dans la région. La mer ne recouvre
définitivement l’Armorique qu’au cours de l’Ordovicien (-480 Ma). Du Cambrien
au Dévonien (-540 à -410 Ma), la plaque armoricaine demeure une province
marine située au large de l’Afrique (Gondwana) et, liée à cette dernière,
« voyage » à travers le monde.
La plaque armoricaine passe une grande partie de son histoire sous
les tropiques ou l’équateur. Jusqu’au Carbonifère, elle se positionne dans
l’hémisphère Sud faisant même une petite incursion près du pôle Sud, autour de
-440 millions d’années.
Mais vers -410 millions d’années, l’Armorique retrouve sa position tropicale.
La présence de récifs coralliens carbonatés dans la région de Baubigny (Manche)
en est une preuve indéniable.
Poussée progressivement par l’Afrique en direction du Nord, la plaque
cadomienne va de nouveau rentrer en compression, provoquant la création d’une
nouvelle chaîne de montagnes : la chaîne varisque (appelée anciennement
« hercynienne »). Le serrage varisque prend effet entre -360 et -320 Ma en
Basse-Normandie.
Position de la plaque Position de la plaque
armoricaine (tache jaune) armoricaine (tache jaune)
vers -380 Ma (Dévonien). vers -300 Ma (Carbonifère).
Source : La Normandie (J. Le Gall et al., 2003) Source : La Normandie (J. Le Gall et al., 2003)
Dévonien - 380 Ma Carbonifère - 300 Ma
Laurasla
Continent des vieux grès rouges
Océa
n Rhé Équ
ic ate Équ
ur ate
ur
Gondwana Gondwana
Pôle Sud
Pôle Sud Sandrine Héricher/DREAL BN
19Profil environnemental de Basse -Normandie
Décembre 2015
| Les sous-sols et la géodiversité
Les plis varisques (hercyniens) au large de
La création d’une nouvelle chaîne Vauville (photo des fonds marins pris par
sonar latar)
de montagnes : l’orogenèse varisque
À la fin de l’orogenèse varisque, la Basse-Normandie présente le maillage
structural qui l’organise encore de nos jours. Il se compose de deux lignes
directrices :
• la ligne varisque (ou hercynienne) Ouest-Nord-Ouest/Est-Sud-Est
• la ligne cadomienne Ouest-Sud-Ouest/Est-Nord-Est.
Les plis varisques s’observent à toutes les échelles : ils déforment les terrains Frédéric Gresselin/DREAL BN
précambriens, déjà abondamment plissés lors de l’orogenèse cadomienne,
et structurent les matériaux paléozoïques en de grands plis de longueur
d’onde déca-kilométrique. Ces plis disposent en leur sein de nombreux replis Galet cambrien déformé au cours de
secondaires. La matière est ainsi déformée parfois jusqu’au niveau du grain l’orogenèse varisque
sédimentaire qui la constituait à l’origine.
Le galet cambrien a été cisaillé (coupé en deux) par la pression s’exerçant sur la roche
et, entre les deux parties nouvellement formées, des cristaux de quartz gris surlignés de
rose et de la chlorite (verdâtre) ont recristallisé en cours de déformation.
Frédéric Gresselin/DREAL BN
L’o
ssa
t ure
her
cyn
ien
ne
Les
p lis h
erc
Discordance yni
ens
s
ien
adom nne
lis c omie
Les
p cad
ture
ssa
L’o
20Le relief actuel de la région s’articule autour des lignes de force héritées des orogènes cadomien et varisque
Lithothèque de Basse-Normandie
Synclinal de May Synclinal d’Urville
May-sur-Orne Laize-la-Ville Jacob-Mesnil
N Jurassique La Roche Blain S
Paléozoïque
Briovérien Briovérien
0 1 km
L’architecture géologique de la Basse-Normandie est héritée de son histoire. Le bâti briovérien, représenté en vert foncé, plissé lors de
l’érogénèse cadomienne, a été recouvert en discordance par les terrains paléozoïques (en vert clair). Pendant l’orogenèse varisque, les
assises paléozoïques sont déformées à leur tour par des plis plus ouverts. Ces plis redéforment le bâti cadomien. Après pénéplanation, la
mer jurassique a déposé petit à petit ses sédiments (en jaune), en discordance également. Certains reliefs paléozoïques comme à May-
sur-Orne, n’ont été recouverts que tardivement par la mer jurassique. Les dépôts jurassiques y sont déjà érodés.
Le magmatisme varisque
Les magmas émis lors de la formation de la chaîne varisque sont beaucoup
moins abondants que ceux produits pendant la période cadomienne. Le serrage
varisque est par ailleurs moins « violent » en Basse-Normandie que le cadomien.
Les plis qui en résultent sont ainsi beaucoup plus amples et ouverts.
? Définitions
Magmatisme intraplaque :
Dans la région, les premières déformations varisques sont enregistrées vers -360 magmatisme émis au cœur d’une
millions d’années. Elles s’accompagnent du soulèvement de la plaque, de son plaque tectonique par fusion
érosion et de la création de deux bassins sédimentaires (bassins de Laval et de partielle du manteau terrestre.
Montmartin-sur-Mer). Ils reçoivent les matériaux détritiques émis par l’érosion. Les laves produites possèdent une
signature géochimique particulière
Le manteau, bombé par cette déformation, se met à fondre très partiellement et qui les distinguent des laves émises
émet un magmatisme intraplaque. Tandis que des laves s’épanchent au Sud de par fusion de la croûte terrestre.
la Mancellia, un important champ filonien doléritique s’injecte entre Mayenne et
Saint-Lô. Dolérite : roche filonienne formée à
partir d’un magma basaltique.
À la fin de l’orogenèse, la fusion de la croûte armoricaine donne naissance à
des granites hyper-alumineux. Le granite d’Alençon, à deux micas, en est un
archétype. Il n’est connu à l’affleurement que sur quelques hectares. Aussi est-on
tenté de ne lui accorder que peu d’importance dans l’histoire régionale. Mais
sa signature géophysique s’étend sur une incroyable surface qui, en forme de
baïonnette, court d’Alençon à La Loupe, en Eure-et-Loir.
21Profil environnemental de Basse -Normandie
Décembre 2015
| Les sous-sols et la géodiversité
Le granite de Flamanville se met en place au Carbonifère vers -300 Ma. Il a Dolérite dans la région de La Hague
été formé plus profondément que celui d’Alençon et résulte d’un mélange de
deux magmas, l’un en provenance du manteau, l’autre formé dans la croûte
terrestre. Il prend naissance le long d’une ancienne faille du bâti cadomien qui
longe les côtes françaises de Barfleur à l’Aber Ildut, en Bretagne, en passant par
Ploumanac’h.
Le granite de Flamanville est un des joyaux de notre patrimoine. Les conditions
de son observation, le long du littoral, sont quasi-idéales. Des générations de
Françoise Gigot/Lithothèque de Normandie
chercheurs et d’étudiants viennent l’analyser. Alimenté par des filons s’injectant
dans la croûte terrestre depuis une chambre magmatique située en profondeur,
S’échappant de la chambre magmatique
le granite a gonflé en refoulant et cuisant son encaissant. Le Cap de Flamanville
et traversant des roches plus froides,
offre le spectacle de la « lutte » physique et chimique que se sont livrés deux le magma basaltique, à l’origine d’une
corps en « pleine bataille » : un magma chaud et son encaissant froid. Celui-ci, dolérite, cristallise assez rapidement,
composé de roches sédimentaires s’est, à travers sa température et sa rigidité, surtout sur les bordures du filon. Il arrive
opposé à l’intrusion. Le granite lui même est le théâtre de la lutte de deux qu’au cœur du filon, si ce dernier est
matériaux : un magma basique et un magma acide qui, incompatibles sur un plan suffisamment épais et que son magma
refroidit plus lentement, des cristaux
chimique, ont désorienté les processus de cristallisation des minéraux et forcé
apparaissent comme ici des cristaux
ces derniers à se protéger, les uns contre les jus acides, les autres contre les jus de plagioclase (en gris pâle). À partir
basiques. d’un même magma, selon la vitesse de
refroidissement, des roches grenues,
micro-grenues (filon) ou sans cristaux ou
presque (laves) sont formées.
Le granite de Flamanville Le granite de Flamanville au microscope
bordure blanche Restite au sein d’un bloc de granite
cœur rosâtre
Une restite
Frédéric Gresselin/DREAL BN Jacques Aubry/Lithothèque de Normandie
Afin de comprendre l’histoire de la terre, le géologue se penche sur le moindre indice.
Frédéric Gresselin/DREAL BN
Ce cristal rosâtre bordé de blanc, observé au sein du granite de Flamanville, a commencé
à cristalliser sous la forme d’un minéral acide dénommé orthose, riche en sodium et
en potassium (cœur rosâtre). Il a fini sa cristallisation sous la forme d’un minéral plus Au sein de la chambre magmatique du
basique, dénommé plagioclase, riche en calcium (bordure blanche). Or, lorsque un granite de Flamanville, le mélange entre
magma cristallise, le plagioclase apparaît normalement avant l’orthose. Si l’orthose a le magma acide et le magma basique
stoppé sa cristallisation au profit du plagioclase, c’est que le chimisme du magma a n’est par toujours parfait. Il subsiste
soudainement changé, devenant trop basique et trop riche en calcium pour que l’orthose des « restites » du magma basique qui
poursuive sa cristallisation. Ce changement provient du fait qu’un magma basique, se présentent sous la forme d’enclaves
formé dans le manteau terrestre, s’est injecté dans la chambre magmatique du granite noirâtres, d’aspect plus ou moins
de Flamanville alors que les processus de cristallisation étaient déjà engagés. D’une fantomatiques selon qu’elles ont été peu
anomalie de croissance d’un minéral, on en déduit que le granite de Flamanville est issu ou fortement ingérées par le magma
du mélange de deux magmas : un acide, un basique. acide.
22Les cornéennes Magma et cornéennes Littoral de la région de Flamanville (50)
magma s’injectant
dans les cornéennes
les roches
cuites à son
contact
le granite
cornéennes enclavées
dans le granite
le contact entre le granite
et son « encaissant »
Frédéric Gresselin/DREAL BN Frédéric Gresselin/DREAL BN
« Dures comme de la corne », les roches Le magma repousse les cornéennes à
cuites au contact immédiat du granite sa périphérie tout en s’y injectant. Il
sont appelées cornéennes. Certains « tente » d’en ingérer des enclaves. Trop
minéraux présents dans les cornéennes, froides, celles-ci sont très « indigestes »
comme la sillimanite, indiquent que la pour le magma. Contrairement aux
température de cuisson a dépassé 550 °C enclaves du magma basique, elles
en bordure de l’encaissant. présentent un bord franc démontrant
qu’elles n’ont pu être « ingérées ».
Frédéric Gresselin/DREAL BN
Altération en boule du granite de Flamanville
Injections de magma dans les cornéennes Injections de magma dans les cornéennes
liée au processus d’arénisation (50)
magma injecté dans les
cornéennes puis plissé par
le gonflement du granité
magma injecté dans les
cornéennes puis plissé par
le gonflement du granité
Frédéric Gresselin/DREAL BN Frédéric Gresselin/DREAL BN
Les injections de magma qui surviennent dans les cornéennes constituent des filons
initialement rectilignes. En s’injectant dans un encaissant plus froid, le magma filonien
cristallise, forme une roche qui finit par se déformer. Les injections les plus tardives sont
les moins déformées, telle celle de gauche. Les plis dans les cornéennes sont, au contact
du granite, tellement serrés qu’il est difficile de les diagnostiquer. Frédéric Gresselin/DREAL BN
23Profil environnemental de Basse -Normandie
Décembre 2015
| Les sous-sols et la géodiversité
Le cycle alpin (de -200 millions d’années à aujourd’hui)
L’orogenèse varisque prend fin en Basse-Normandie il y a
320 millions d’années environ, laissant place aux processus
d’érosion, de sédimentation et de distension. ? Définitions
Pénéplanation : formation d’une surface
topographique caractérisée par de faibles
pentes et des dépôts superficiels.
Erosion : phénomène résultant de
l’action de l’eau, des vents et de la
Le Brachiosaure Le Pliosaure
gravité qui provoque l’enlèvement
des couches supérieures des sols
La distension et la pénéplanation
Sédimentation : ensemble des
post-varisques processus par lesquels les particules,
transportées par un agent d’érosion
La distension et la pénéplanation dites « post-varisques » façonnent la plaque
(eau, vent, gravité) cessent de se
pendant près de 100 millions d’années et la préparent aux transgressions
déplacer et se déposent, devenant
marines du Jurassique. L’Armorique est désormais située au niveau de l’équateur.
ainsi des sédiments.
L’érosion des reliefs hercyniens génère de volumineux produits détritiques qui
s’épandent dans des dépressions et des bassins continentaux. Au Carbonifère, Distension : étirement de la
ces cuvettes sont le réceptacle d’une abondante matière organique émise croûte terrestre qui provoque son
par la flore locale (fougères arborescentes, conifères…). Elle donne naissance amincissement et sa rupture. La
aux futurs charbons du bassin de Littry (14) et de Plessis-Lastelle (50). La distension se matérialise généralement
Basse-Normandie constitue alors la partie occidentale du bassin houiller anglo- au niveau structural supérieur par
franco-belge. l’apparition de failles perpendiculaires
à la direction des forces de distension.
L’émission d’un volcanisme intraplaque accompagne les premières étapes de Les failles de distension sont des failles
la distension. Ce volcanisme est essentiellement émis dans le Cotentin où des typiques des zones de rift.
laves basiques viennent s’injecter dans les sédiments houillers de la région de
Carentan. C’est le dernier épisode volcanique survenu dans la région.
Fougère du Carbonifère
La pénéplanation de la chaîne varisque se poursuit tout au long du Permien et
du Trias (entre -300 et -200 millions d’années) sous un climat chaud et assez
sec. Pour décrire la paléogéograhie de l’époque, certains auteurs se réfèrent
aux paysages du Sud-Est américain. La Basse-Normandie est alors rattachée à
l’actuelle Amérique du Nord et se situe non loin de l’Afrique.
Valérie Guyot/DREAL BN
Université de Caen, laboratoire de géologie
Le bassin houiller de Basse-Normandie Charbon de Normandie
La Compagnie minière de Littry fut la première compagnie minière crée
en France, en 1747. Le gisement fut découvert en 1740 dans le cadre de la
prospection du fer pour une forge de Balleroy.
Mais le bassin houiller bas-normand n’a pas connu le même essor économique
que ceux de Belgique et du Nord de la France. Les veines de charbon, peu
nombreuses et peu épaisses, ont généré des volumes restreints de combustible.
Ses débouchés furent donc régionaux (fours à chaux, maréchaux-ferrants). Le
charbon bas-normand a cependant fourni le gaz d’éclairage de la ville de Paris
en 1860 (source : guide géologique Normandie-Maine). Valérie Guyot/DREAL BN
Université de Caen, laboratoire de géologie
24Magmatisme de la distension post-varisque
Paléogéographie de la Basse-Normandie vers -255 Ma
Source : Scotese, 1998 (www.scotese.com)
Late Permian 255 Ma
un filon de lamprophyre
Basse-Normandie
Mer des Sargasses
Ancient Landmass
Modern Landmass
Subduction Zone (triangles point in the
direction of subduction)
Sea Floor Spreading Ridge
La pénéplanation de la chaîne varisque s’effectue en Basse-Normandie sous un climat
Frédéric Gresselin/DREAL BN
aride équatorial. Les continents sont en brun, les océans en bleu et les mers en gris bleu.
D’après Scotese, 1998
Le magmatisme de la distension post-
varisque n’affleure qu’en de rares endroits
comme ici ce filon de lamprophyre dans
La transgression jurassique l’anse du Culeron (la Hague).
Vers -200 Ma, la région est une surface presque aplanie. Elle dispose alors d’un
relief peu différent de celui d’aujourd’hui et accueille ses premiers dinosaures. La surface de pénéplanation post-
varisque n’est pas régulière. Elle
présente des creux et des bosses selon
La surface de pénéplanation post-varisque la dureté des matériaux érodés. Très
durs, les grès dessinent souvent des
reliefs que la mer jurassique a recouverts
banc de calcaire tardivement. À l’aplomb de ces reliefs,
jurassique qui dessinaient au Jurassique des écueils,
des îlots ou des archipels, les calcaires
forme de la surface de Écueil
jurassiques sont souvent moins épais.
pénéplanation
C’est le cas ici à Villedieu-les-Bailleuls
grès paléozoïque (61) où un petit écueil se dresse parmi
les bancs calcaires du Jurassique.
Jacques Aubry/Lithothèque de Normandie
Poisson du Trias supérieur
? Définition
Pénéplanation : processus d’érosion
qui conduit à la formation de larges
espaces ne possédant que de faibles
dénivellations et de rares reliefs
résiduels.
Valérie Guyot/DREAL BN - Université de Caen, laboratoire de géologie
25Profil environnemental de Basse -Normandie
Décembre 2015
| Les sous-sols et la géodiversité
Marnes de Port-en-Bessin (14)
Environnement paléogéographique de la Basse-Normandie
vers -195 Ma (Jurassique inférieur)
Source : Scotese, 1998 (www.scotese.com)
Early Jurassic 195 Ma
Basse-Normandie
Mer des Sargasses Françoise Gigot/Lithothèque de Normandie
Les Marnes de Port-en-Bessin et le
Calcaire de Caen ont le même âge et
sont géographiquement très proches.
Leur différence de faciès s’explique
par leurs conditions de sédimentation :
Ancient Landmass littorale pour le calcaire de Caen et
Modern Landmass
domaine marin plus distal (et donc plus
Subduction Zone (triangles point in the
direction of subduction) profond) pour les marnes de Port-en-
Sea Floor Spreading Ridge
Bessin. En effet, le milieu littoral, trop
énergétique (houle, marée), ne permet
L’Armorique est une île située sous les tropiques au large de l’Afrique et de l’Amérique pas la sédimentation des argiles.
du Nord. Elle se positionne au cœur de l’ancien delta d’un immense fleuve, qui, au Trias,
Pinces d’Eryma bedelta, genre éteint de crus-
drainait le territoire compris entre l’Afrique et les deux Amériques. Ce fleuve la reliait à
tacés décapodes de la région d’Écouché (61)
la future Mer des Sargasses (Sa), située en amont hydraulique. Selon les périodes, la mer
armoricaine est sous l’influence des eaux chaudes de la Thétys (l’océan alpin) ou des
eaux froides de l’Océan arctique, via la Mer du Nord. D’après Scotese, 1998
Au Jurassique, l’Armorique est une île de grande taille que la mer recouvre
petit à petit. Elle est isolée du reste du Bassin anglo-parisien par un sillon sous-
Valérie Guyot/DREAL BN
marin, dénommé le « sillon marneux ». Les argiles produites par l’érosion Université de Caen, laboratoire de géologie
continentale viennent s’y déposer. Plus près des côtes, la sédimentation est plus Calcaire de Caen
carbonatée. Port-en-Bessin et sa falaise offrent un point d’analyse exceptionnel
des conditions de sédimentation régnant au cours du Bathonien dans le sillon
marneux. Au cours de la même période, plus près du rivage, se déposent les
sédiments calcaires de la future pierre de Caen (-165 Ma).
Le recouvrement marin s’effectue par impulsions, entrecoupées de
cycles régressifs. Les épisodes transgressifs (de recouvrement par la mer)
s’accompagnent d’une sédimentation plus argileuse. Lors des phases les plus
transgressives, la sédimentation devient plus argileuse y compris dans la région Françoise Gigot/Lithothèque de Normandie
de Caen. Fossiles de coraux à Mont-Canisy (14)
Les épisodes régressifs permettent à la plate forme carbonatée de se
réimplanter : le milieu marin, davantage soumis à l’influence des houles car
moins profond, devient trop agité pour que les argiles puissent s’y déposer.
Les sédiments se chargent alors en débris coquilliers et en carbonates. Ces
changements majeurs s’accompagnent même parfois de l’installation d’une
barrière de corail. Le Mont-Canisy, près de Deauville, est un très bel exemple
de récif corallien datant de cette époque. Les coraux fossiles, la faune et la flore
associées (algues, oursins, mollusques), y sont dans un remarquable état de
Françoise Gigot/Lithothèque de Normandie
conservation.
26Vous pouvez aussi lire