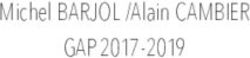SERVICE ÉDUCATIF DOSSIER PÉDAGOGIQUE - ACADÉMIE DE TOULOUSE
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
> Service éducatif
Dossier Pédagogique
Sans tambour ni trompette /
Cent ans de guerres [Chap.4]
Une exposition collective sur deux lieux - en partenariat avec la Ville de Tarbes
> Au Musée Massey - Musée International des Hussards, Tarbes
du 22.09.2017 > 07.01.2018
> Au Parvis scène nationale Tarbes-Pyrénées - centre d’art contemporain, Ibos
du 13.10.2017 > 13.01.2018
Giulia Andreani, Sammy Baloji, Léa Belooussovitch, David Brognon & Stéphanie Rollin, Morgane Denzler,
Léo Dorfner, Harald Fernagu, Charles Fréger, Agnès Geoffray, Marco Godinho, Lebohang Kganye,
Kapwani Kiwanga, Léa Le Bricomte, Sandra Lorenzi, Lucien Murat, Estefanía Peñafiel Loaiza,
Régis Perray, Michèle Sylvander, Erwan Venn
Vue de l’exposition au Parvis centre d’art contemporain (détail). Au premier plan : Régis Perray, Les Sols de Guerres, 1995-
2017. Images imprimées couleur, 180 x 1113 cm environ. Courtesy de l’artiste.UNE EXPOSITION À VISITER AVEC VOS CLASSES JUSQU’AU
> 07 JANVIER 2018 AU MUSEE MASSEY À TARBES
>13 JANVIER 2018 AU PARVIS À IBOS
Le projet d’expositions SANS TAMBOUR NI TROMPETTE - Cent ans de guerres est conçu comme une réflexion à la
commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Contre les célébrations mémorielles déconnectées
du présent, l’exposition s’inscrit dans le récit de l’Histoire en étirant celle que l’on appelle la Grande Guerre aux guerres
qui l’ont suivie et aux guerres actuelles qui sévisent partout dans le monde. La Der des Der a failli à ses promesses et les
guerres continuent de jaillir et de rythmer une histoire et une mémoire collective.
Mené tambour battant par la commissaire d’exposition indépendante Julie Crenn, SANS TAMBOUR NI TROMPETTE est un
projet itinérant et évolutif pensé en cinq chapitres développés de 2014 à 2018 dans différents lieux de différentes villes.
Chaque chapitre est consacré à une question en particulier. De Houilles à Metz, en passant par Caen et Bordeaux, les
artistes invités à collaborer à cette réflexion au long cours ont pu aborder des thèmes comme la commémoration et la
réparation (à Caen) ou la guerre comme phénomène social (à Bordeaux) par exemple.
En 2017, pour le quatrième chapitre, le projet prend ses quartiers à Tarbes, territoire emblématique s’il en est : terre
de passages et d’accueil proche de la frontière avec l’Espagne, ville de garnisons toujours actives, longtemps siège de
l’Arsenal, elle fut dotée de son haras national pour la production de chevaux de guerre au début du XIXème siècle par
Napoléon, et conserve également la maison natale du Maréchal Foch, le héros français de la Première Guerre mondiale.
L’exposition SANS TAMBOUR NI TROMPETTE se partage entre deux lieux symboliques de la ville : Au musée Massey, Musée
International des Hussards qui conserve le patrimoine de Tarbes à travers la magnifique collection des costumes de
Hussards et sa très belle collection de peintures et de sculptures datés du XVIème au XIXème siècles. Et au Parvis scène
nationale Tarbes-Pyrénées, dont la principale mission consiste à soutenir et à diffuser auprès des publics les plus larges la
création contemporaine qu’elle soit scénique, cinématographique ou plastique.
Au musée Massey, l’exposition aborde les questions du costume et de l’apparat guerrier, des corps et des objets à travers
des oeuvres qui font immersion dans les collections permanentes tout en dialoguant avec elles.
Au Parvis, c’est la question des archives qui est posée , ces fameuses sources, traces, écrits et images laissés par d’autres
avant nous et qui nous permettent de comprendre le monde d’aujourd’hui et envisager de quoi sera fait demain. Nous
verrons de quelle manière les artistes s’en apparent telle une véritable matière vivante.
Les élèves de l’école primaire pourront visiter l’exposition au musée Massey et l’exposition au Parvis dans le cadre du
Parcours « Qu’est-ce qu’un conflit ? ». Les enfants de CM pourront s’interroger, à partir d’un choix de spectacles et de films,
sur l’identification des conflits, qu’ils soient historiques ou familiaux, intimes ou sociaux.
Nous proposons aux élèves du collège et du lycée de découvrir l’exposition en deux temps en s’inscrivant aux deux
Parcours thématiques « Géographie du conflit » avec une sélection de films et de spectacles en interaction avec
l’exposition présentée au musée Massey et « La mémoire et l’archive » qui met en dialogue oeuvres cinématographiques
et scéniques avec l’exposition présentée au Parvis.
Il est bien sûr possible de visiter l’exposition et de participer aux ateliers en dehors des Parcours.
Le Service éducatif vous présente ce dossier comme une aide possible pour préparer votre visite scolaire, ainsi que
des pistes pédagogiques ciblées en relation avec l’exposition à explorer en classe.
La visite de l’exposition au Parvis que nous proposons à vos élèves est couplée d’un atelier de création. Cette
formule favorise une approche sensible et créative des oeuvres présentées dans l’ exposition.
Retrouvez le programme détaillé des activités organisées autour de l’ exposition en dernière partie de ce dossier.
La visite et son atelier de création, ainsi que les différents événements liés à l’exposition SANS TAMBOUR NI
TROMPETTE sont gratuits pour les scolaires et s’adaptent à tous les niveaux du CM à la terminale.
Réservation obligatoire au : 05 62 90 60 82 - centredart@parvis.netSOMMAIRE
1ère partie : Présentation de l’exposition p. 4
> San tambour ni trompette / Cent ans de guerres p. 5
2ème partie : En classe, préparer et approfondir la visite de l’exposition p. 15
> L’art de représenter la guerre p. 16
Bibliographie p. 36
3ème partie : Visites et ateliers proposés autour de l’exposition p. 37
> Pour les scolaires p. 38
> Pour le hors temps scolaire p. 40
Contacts : ................................................................................................................................ p. 411ère partie :
Présentation de l’exposition
Sans tambour ni trompette /
Cent ans de guerres
Vue de l’exposition au musée Massey - Musée International des Hussards de Tarbes (détail).
Entre les deux sulptures de la collection Beaux-Arts : Léa Le Bricomte, STUPA, 2016 Missile, support en bois tourné,
tige fileteée. 180 x 50 cm.Courtesy Youri Vincy, galerie Lara Vincy, Paris.Sans tambour ni trompette /
Cent ans de guerres
Le titre de l’exposition
L’expression «sans tambour ni trompette», que l’on peut dater du XVIIème siècle, nous vient du monde mlitaire mais s’est
aujourd’hui largement généralisée pour désigner toute action effectuée discrètement, voire secrètement. Autrefois,
les troupes militaires partaient à la bataille accompagnées de musiciens, percussions et cuivres principalement,
chargés à la fois de donner du rythme à la marche contre l’ennemi, mais aussi du courage et de la bravoure. Le
rassemblement des troupes vainqueures pouvait également être accompagnée d’une marche militaire. Mais la
retraite des factions vaincues se faisait rapidement et en silence, d’où l’expression «sans tambour ni trompette».
Aujourd’hui, alors que nous commémorons le centenaire de la Première Guerre mondiale, c’est surtout à la quetion
de la survivance des guerres partout dans le monde que s’attache Julie Crenn, la commissaire de l’exposition. Car
commémorer, c’est se souvenir ensemble d’événements passés dans le sens où ils fondent une identité collective et
permettent une vision pour la construction d’un monde harmonieux. Cela fait bien cent ans que la Première Guerre
mondiale a eu lieu, mais cela fait aussi cent ans que nous sommes en état de guerre permanent. Bien sûr, on aura
noté que le titre de l’exposition est paradoxal puisqu’en France cela fait 55 ans depuis la fin de la guerre d’Algérie, et
72 ans depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu’il n’y a pas eu de guerre dite «conventionnelle» et que nous
connaissons la plus longue période de paix de notre histoire. Mais cela n’est qu’un écran de fumée car la guerre est
largement répandue et omniprésente. Nous n’en sommes plus guère informés que par des écrans de télévision et
ces conflits nous apparaisent souvent irréels, presque abtraits.
Vue de l’exposition au Parvis (détail). Au
deuxième plan : Morgane Denzler, Ceux qui
restent 7, 8, 10, 12, 2012-2016 Impressions sur
puzzles, 52 x 40 cm chaque.
Courtesy Bendana I Pinel Art Contemporain,
Paris.Une exposition qui déroule les récits de l’Histoire Que ce soit au musée Massey ou au Parvis, les artistes réfléchissent chacun à leur manière à la portée so- ciale, politique et humaine de la guerre, abordée tour à tour soit d’un point de vue symbolique ou d’un point de vue critique. SANS TAMBOUR NI TROMPETTE est une manière de commémorer la première Guerre mondiale sans se cantonner à une seule guerre. En s’intéressant à différentes guerres (la Première et la Deuxième Guerre mondiale, guerre du Liban, guerre d’Algérie, guerres d’indépendance des états africains, Colonisation, Apartheid, migrations, terrorisme...) les vingt artistes de l’exposition développent plusieurs thématiques guerrières à travers la question du corps, de l’objet, du territoire, de la terre et de l’archive. Le œuvres nous permettent ainsi de penser le passé à par- tir du présent. De même, en tant que témoins ou passeurs, au Parvis comme au musée Massey, les artistes affirment un positionnement fort et un regard critique sur des évènements qui constituent notre présent. Ils puisent dans les archives, pubiques ou privées, les traces des conflits mais aussi dans un imaginaire symbolique lié à la guerre, proche ou lointaine. Ils partent à la rencontre des lieux, des images et des individus qui l’ont traversée ou qui la vivent aujourd’hui. SANS TAMBOUR NI TROMPETTE est une manière de lutter contre l’indifférence, l’ignorance et l’oubli en mettant en lumière la persitance des champs de bataille. Parce que l’Histoire doit être transmise dans sa totalité, la commémoration implique aussi une résistance et un engagement contre les récits mutilés. Nous vous proposons quelques clés de lecture des deux expositions présentées au musée Massey à Tarbes et au Parvis à Ibos à travers une sélection d’œuvres représentatives du captivant parcours que nous vous proposons de développer avec vos élèves (du cycle 3 à la terminale - l’accompagnement des expositions s’adapte au niveau des classes). > Le corps dans la guerre Certaines œuvres de l’exposition au Parvis et au Musée Massey proposent une réflexion sur la corporéité de la guerre. Ces œuvres nous permettent de repenser l’expérience guerrière, collective et intime, à travers l’apparat guerrier et le corps blessé notamment. Dan ce dossier, nous vous en présentons deux. Régis Perray, Les Sols de Guerres, 1995-2017. Images imprimées couleur, 180 x 1113 cm environ. Courtesy de l’artiste.
Dans l’exposition au Parvis, les élèves pourront découvrir un grand mur recouvert d’images imprimées, en couleur et en noir et blanc, donnant à voir des scènes de combat, de destruction, de désolation et de mort. Il s’agit d’un patcwhork monumental composé d’images de sources diverses que l’artiste a soigneusement choisies dans les livres d’histoire ou les magazines d’information. Des images qui entrent donc dans une histoire officielle de la guerre. De la Première Guerre Mondiale aux guerres contemporaines, d’ici ou ailleurs, tous les temps et tous les sols des guerres depuis une centaine d’années composent l’immense déroulé (plus de 13m de long !) d’une histoire qui n’en finit pas de se répéter. Chaque image récoltée patiemment et de manière méthodique par Régis Perray raconte une histoire. Des corps broyés, déchiquetés, blessés, des cartes marquées de frontières et de mouvements de bataille, des lignes de croix dans les cimetières, des lignes creusées dans les tranchées et la cavité béante des sols bombardés, les corps tendus des assaillants, ceux figés des morts, l’abandon parfois d’une main, la mine gauguenarde de ceux qui tiennent la victoire à bout de bras, les trait brisés que creuse la misère ou l’ombre du malheur à venir qui caresse le visage d’un être innocent... Tous les corps de la guerre apparaissent ici sur ce grand mur de la désolation, puisqu’il y a bien eu cent ans de guerres depuis la Première Guerre mondiale. Le Mur des Sols de Guerres se présente comme une constellation de champs de batailles où les sols sont marqués par les impacts des obus, où les bâtiments sont éventrés et où les hommes versent leur sang. Depuis vingt ans, Régis Perray récolte les images des sols traumatisés par la guerre. Une manière de fouiller les lieux en révélant des fragments de leurs histoires. Les corps et les sols entament ici une correspondance de formes et de mémoire. De la France à l’Egypte, en passant par la Pologne, le Kosovo, le Rwanda, La République Démocratique du Congo, l’Allemagne, la Syrie, la Palestine, Israël et les Etats-Unis, les sols comme les corps sont témoins des guerres qui les marquent profondément. Léa Le Bricomte, Red Cloud, 2017. Installation, veste militaire américaine (lanières en cuir, perles en bois, plumes, carapace de tortue, grelot, os), renard en bois recouvert de feuilles d’or, cartouches d’armes à feu, 160 x 65 cm (veste), 34 x 23 cm (renard). Courtesy de l’artiste
Dans l’exposition au musée Massey, les élèves découvriront un fascinant dialogue entre les œuvres contemporaines, installées ici de manière temporaire, avec les œuvres pérennes de la collection. La question du corps dans la guerre est très régulièrement convoquée dans ce lieu, précisément en lien avec les choix muséographiques de la collection des costumes des Hussards. Ces derniers, costumes d’apparat et de combat, sont présentés, à l’intérieur de deux grandes vitrines qui les protègent de toute altération extérieure, comme des enveloppes autour de corps absents, fantomatiques. Pas de visage, de cheveux, de pieds ou de mains qui perturberaient la lecture de l’art textile guerrier de ce prestigieux corps de combat. Les vêtements semblent se tenir au garde à vous et deviennent les seules reliques d’enveloppes charnelles aujourd’hui disparues. Il y a quelque chose qui perdure de l’âme et de la mémoire de ces rutilants guerriers d’autrefois. À côté de ces corps-fantômes, accoutrés de l’apparat guerrier d’une époque antérieure, l’artiste Léa Le Bricomte réalise deux installations de costumes militaires contemporains. Jouxtant la vitrine consacrée aux uniformes empanachés des Hussards du second Empire, Léa Le Bricomte présente Red Cloud, une veste militaire américaine mixée avec une parure amérindienne de plumes d’aigle suspendue au dessus d’un tapis de douilles de balles de carabine sur lequel trône une statuette de renard dorée à l’or fin. Ici encore, les corps fantômes des guerriers diparus à la guerre sont convoqués. L’artiste explore l’univers guerrier à travers des objets compris comme les vestiges de combats passé ou récents qu’elle récolte et collectionne afin de leur attribuer une nouvelle forme d’existence. Ici, Léa Le Bricomte a hybridé une veste militaire américaine avec une parure de plumes, de perles et de liens en cuir provenant d’une réserve indienne au Canada. Elle opère ansi à des croisements et à une créolisation non seulement des objets, mais aussi de leurs symboliques, de leurs histoires et de leurs portées sur un imaginaire commun. L’installation porte le nom du grand chef amérindien Red Cloud, contemporain des pièces textiles du second Empire conservées à l’intrieur de la vitrine du musée. En croisant deux pièces de l’apparat guerrier américain et américain natif, Léa Le Bricomte produit, telle une chamane, une véritable couture telle un talisman pacificateur, alliant en même temps une idee de prolifération guerrière (le douilles de balles de carabines) et un rapport primitif au combat (les plumes de la parure american native). L’artiste additionne et fusionne les antagonismes pour interpeller notre perception. La présence du renard recouvert de feuille d’or, assis sur un tapis de douilles de carabine qui peut symboliser les multiples combat de l’armée américaine contre les tribus indiennes à la conquête de nouveaux territoirs, souvent au profit de la recherche aurifère qui a enfiévré l’ensemble de ces vastes zones géographiques au XIXème siècle. En convoquant la figure animale dans cette installation, c’est bien la pulsion de vie qui est au cœur du dispositif, le jeu est envisagé comme une stratégie artistique et la paix, un de ses enjeux. > Les objets de guerre Nous pouvons appréhender les guerres à partir des objets qu’elles produisent : obus, balles, cibles, médailles, armes, artillerie lourde et légère, costumes, casques, divers nécessaires (transport,cuisine, entretien...), drapeaux, documents... D’où qu’ils viennent, les objets de guerre entretiennent aujourd’hui la mémoire des combats. Ils portent en eux une part de la grande Histoire comme de l’histoire intime de ceux qui les ont possédés et/ou fabriqués. Véritables reliques, ils permettent un autre regard sur la guerre. On connaît particulièrement ce que l’on appelle «l’artisanat de tranchée» ou «art des tranchées» ou encore «art du poilu», objets fabriqués lors des longues attentes dans les tanchées pendant la guerre de 14-18 afin de meubler le temps. À partir des douilles de balles, de têtes d’obus et shrapnels, les soldats ont fabriqué bon nombre d’objets de la vie courante comme des briquets, des couteaux, des tabatières, des encriers etc... Les objets de guerre, ce sont aussi ceux que l’on prend avec soi pour fuir, ce sont ceux de l’exil. Véritabes éléments- supports, ils marquent le déplacement tout en permettant de procéder à une archéologie des mémoires de l’exil et en exil.
Léo Dorfner, My life saved by rock’n’roll - Path of glory #2, 2017 Gravure sur casque, 25 x 30 x 30 cm. Courtesy de l’artiste. Au musée Massey comme au Parvis, les élèves pourront voir des casques de la Première Guerre mondiale. Un casque anglais et un casque français sont présentés aux Hussards, un casque français fait partie de l’exposition au Parvis. Ils font le lien entre les deux lieux. L’artiste Léo Dorfner les a recouvert de noms de groupes de rock des années 1970 à aujourd’hui. Procédant par grattage de la peinture d’origine, Léo Dorfner fait apparaître les logos bien connus des stars de la scène pop rock d’aujourd’hui. À la mémoire des jeunes soldats croupissant dans les tranchées pendant la seconde guerre mondiale, ceux-là même qui s’adonnaient à la pratique de la gravure sur douilles ou sur têtes d’obus en attendant le prochain coup de feu, Léo Dorfner fait appel à la fureur de vivre, à la dimension humaine, violente et insolente de la guerre. À travers les trois casques présentés dans l’exposition, l’artiste jette en même temps un pont spacio-temporel entre cette guerre d’hier dont il n’existe plus de témoins directs et la survivance de sa commémoration aujourd’hui.
Sandra Lorenzi, Aïeux, 2016 Installation in progress, objets divers, dispositif sonore, 250 x 300 x 300 cm. Courtesy de l’artiste. Quand on entre dans l’exposition au Parvis, la première oeuvre qui marque l’entrée est celle de Sandra Lorenzi, un assemblage étonnant d’objets divers qui prend les allures d’une barque, d’un radeau aussi bien que celle d’une mai- son sans toit, ni murs. Composée d’un empilement de palettes qui délimite un genre de plateau scénique, l’œuvre et composée de chaises sur lesquelles on peut s’asseoir. Un casque audio est à disposition. Il diffuse les témoignages de personnes qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale sur le sol tarbais que l’artiste a rencontrés en amont de l’exposition. Il s’agit de nos aïeux, ils donnent son nom à l’oeuvre. Les histoires simples ou poignantes se succèdent et les voix de ces personnes anonymes qui racontent leur enfance en temps de guerre nous traversent comme une rafale. Assis au cœur de l’œuvre, les objets se découvrent alors à notre présence ici. C’est comme si nous faisions un voyage dans le passé, alors que nous sommes bien ici , dans l’exposition du centre d’art du Parvis, au sein d’un hypermarché grouillant de monde et de bruits. Tous les éléments de la fuite, du départ précipité, de l’arrachement et de la detruction sont rasemblés ici. Le vieux vélo semble écrasé sous le poids de la valise qui a peine à fermer. Le tapis est recouvert de gravats, plus personne ne viendra y poser ses pieds nus dans la chaleur du foyer. La lampe à huile est éteinte et froide. Le torchon qui servait à sécher la vaiselle est resté pendu là, roide. Toutes les plantes sont mortes. Mais la lanterne posée au bout de la construction et la clé qui reste pendue à son crochet tout en haut du mat de ce radeau de fortune symbolisent peut-être un possible retour, un jour. Chaque objet est ici pensé par l’artiste comme une relique, porteuse elle-même d’une histoire personnelle qui croise et dialogue avec la grande Histoire. Il faut voir l’oeuvre de Sandra Lorenzi comme l’endroit d’une rencontre. Cette installation est une sorte d’espace vrillé où les sensations du visiteur peuvent être perturbées, entre une réalité de guerre vécue hier, le témoignage qu’on en fait et sa réception aujourd’hui.
> Territoires et géographies du conflit Les conflit, passés et actuels, participent à modeler les territoires terrestres et notre monde est ainsi parsemé de lignes de faille, de murs qui séparent et de frontières souvent invisibles mais bien réelles. La guerre est donc source de composition ou de recomposition de territoires vécus, de territoires appropriés, de territoires identitaires, de territoires sociaux et de territoires politiques. Certains artistes de l’exposition interrogent ces vecteurs de conflictualité. Morgane Denzler, Al Azraa Mariam, 2013 Impression numérique sur tissu, 600 x 400 cm.Courtesy de l’artiste et Bendana I Pinel Art Contemporain, Paris. Au musée Massey, dans l’aile droite de la partie consacrée à la collection Beaux-Arts, une immense voilure de plus de 6m de haut et tendue dans la salle dite «des Vierges», suspendue à la verrière. Il s’agit d’une photographie de l’artiste Morgane Denzler, imprimée sur voile et «monumentalisée», qui nous donne à voir un petit autel votif consacré à la Vierge du Liban. En 2010, Morgane Denzler séjourne à Beyrouth. Elle y découvre un pays et une ville marqué par plus de trente-cinq années de guerre civile. Des cicatrices et des traumas présents au quotidien, inscrits dans le bâti, les corps et les mémoires. Sans vainqueur de guerre, sans ministère de l’Education et comptant dix- huit communautés différentes, le territoire de Beyrouth est une véritable poudrière car cloisonné, voire verrouilé, par ces mêmes communautés religieuses. Chaque quartier est marqué par les immenses images des martyrs qui tapissent les facades des immeubles à plus de 6m de haut. Les entrées des quartiers chrétiens sont marqués par des autels votifs consacrés à la Vierge et cosntitués de toutes petites figurines d’à peine quelques centimètres. Morgane Denzler a photographié celui-ci à travers une vitre dans laquelle se reflète le quartier voisin, à quelque mètres de là et pourtant «ennemi». L’image agrandit à l’échelle des images des martyrs, l’image de la Vierge se fait spectaculaire, elle impose sa présence et instaure une relation physique avec le regardeur, de la même manière que cette Vierge du Liban dialogue avec les peintures religieuses de la collection permanente du musée Massey.
Estefania Peñafiel Loaiza, Un air d’accueil, 2013-2015 Photographies couleur, contrecollage sur aluminium, 60 x 90 cm, Courtesy de l’artiste. Au centre d’art contemporain du Parvis, une série de photographies de formats divers, montrent de vagues paysages énigmatiques aux atmosphères différentes de forêts ou de terres arides. Légèrement floues, elles semblent avoir été prises au dépourvu, vite fait et sans véritable soin. On ne comprend d’ailleurs pas le cadrage, car rien ne se passe à priori dans l’image, et le point de vue semble empêché par un halo noir qui « mange » une partie de l’image. En regardant mieux, on pourrait se dire que nous sommes en position de regardeur, mais caché, à l’abri derrière quelque chose, comme si nous regardions à travers un trou. L’artiste Estefania Peñafiel Loaiza nous place dans une certaine position, notre regard perce quelque chose. Dans cette série de photographies, Estefania Peñafiel Loaiza, qui travaille sur l’histoire des gens ordinaires, les sans grades et les sans noms, nous donne à voir les zones de passage et les frontières traversées chaque jour clandestinement par les migrants. Dans un premier temp, elle récupère des vidéos de surveillance placées à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, Israël et la Palestine entre autres. Ces caméras dissimulées ont pour but de surprendre et de traqueer les migrants clandestins en train de traverser ces zones de partage invisibles. L’artiste projette ces vidéos sur un mur et laisse l’objectif de son appareil photo ouvert pendant la durée de la vidéo, transformnt ainsi l’image mobile en image fixe. De ce fait, le corps s’estompent, on ne voit plus la personne en train de passer, les hommes sont devenus flous, fantomatiques, l’artiste leur donne une protection par l‘invisibilité, comme la cape magique dans Harry Potter. Ne restent plus sur l’image que nous regardons qu’un cadre noir attestant de la dissimulation de la caméra et un paysage banal un peu flou où le passage de l’immigré pourchassé n’est plus qu’une trace, qu’une ombre insaisissable. Quelles traces, quelles empreintes laisent donc les migrants, immigrants/émigrés, les exilés, les réfugiés, les expatriés, ceux qui sont toujours entre deux pays, entre deux cultures, ceux qui fuient la guerre et la misère, qui ne sont plus vraiment d’ailleurs et pas encore d’ici ? Plutôt que déracinés, ils poussent des racines partout où ils s’installent.
> Images et archives de guerre Conservés pour leur valeur historique, les documents d’archives représentent un véritable trésor patrimonial car ils permettent de retracer avec pécision ce qui s’est passé autrefois. Les documents archivistiques peuvent être textuels, photographiques, sonores, audiovisuels, cartographiques, artistiques et même informatiques. Les archives nous permettent de comprendre les conséquences de l’activité humaine sur la longue durée et de mieux envisager le devenir des sociétés humaines. Les archives nous engagent également à être conscient de la responsabilité de nos actes. Les oeuvres cinématographiques et littéraires s’inspirent en grande partie des archives qui sont des sources de création d’une richesse étonnante. Films et livres à succès, passés dans le domaine populaire, produisent à leur tour des images et des représentations de scènes et d’histoires d’époque différentes. Il en va ainsi pour les scènes de guerre dont nos représentations communes naissent de leur traitement au cinéma ou dans les romans. Comme par exemple la fameuse scène du débarquement dans le film Le jour le plus long de Ken Annakin, sorti en 1962 sur les écrans. Les archives sont donc à la source d’images qui deviennent des icônes. À l’inverse, les archives peuvent aussi produire des oeuvres qui ne donnent pas à voir directement des images mais interrogent leur nécessaire réactivation dans nos sociétés contemporaines. Harald Fernagu, Les cuirassés, 2017 Techniques mixtes, métal, bois. Courtesy de l’artiste. Au musée Massey, les élèves pourront voir une étonnante installation de l’artiste Harald Fernagu. Posée sur de longues voliges de bois elles-mêmes soutenues par des tréteaux, une armada de croiseurs et de destroyers de guerre nous fait face. L’artiste a choisi le medium de la maquette pour donner vie et consistance à cette flotille menacante. Harald Fernagu réactive ici un ouvenir d’enfance, sa première vision enfant, lorsqu’il arrivait chez ses grands-parents en Normandie par l’apparition d’ un immenss bateau de la seconde guerre mondiale, carcasse rouillée échouée sur une plage militaire, reliquat et véritable archive de tôle et d’acier de ce que fut le débarquement. Recréant, à l’échelle de la maquette et par le bricolage, avec toute sorte de métaux de rebus, cette scène issue en partie du cinéma du débarquement sur les plages de Normandie lors de la Deuxième Guerre mondiale, Harald
Fernagu nous invite à réflechir aux représentations de la guerre dans notre insconscient collectif, héritées, en partie, de l’industrie du cinéma. Posés sur des planches et des tréteaux, les bateaux guerriers sont immobiles, en ordre de marche, vers une guerre qu’ils n’atteindront jamais, sauf peut-être dans l’imaginaire du spectateur, de la même manière que les reconstitutions du débarquement au cinéma. Agnès Geoffray, Der Soldat ohne Namen, 2017 Textes tapuscrits sur soie, vitrine 90 x 120 x 205 cm. Courtesy de l’artiste. L’exposition au Parvis est consacrée à la question des archives de guerre et toutes les oeuvres émanent de cette réflexion, ce qui est, évidemment, passionnnant à creuser avec les élèves. Nous avons choisi de vous présenter dans cette partie du document plus spécialement l’oeuvre d’Agnès Geoffray qui réactive des documents de la Résistance lor de la Deuxième Guerre mondiale, considérés également comme des oeuvres à part entière. Car la nature des archives, ou encore leur statut, peut parfois être complexe. Posée sur une grande table vitrée, nous découvrons un assemblage de carrés et rectangles colorés, tous recouverts de textes en allemand tapés à la machine à écrire. Sorte de petits mouchoirs en soie, ils dessinent une sorte de cartographie. Agnès Geoffray s’est intéressée aux archives de l’artiste et écrivaine Claude Cahun (1894-1954), liée au mouvement surréalsite et engagée dans la Résistance pendant l’occupation allemande de l’ile de Jersey. Avec sa compagne Suzanne Malherbe, elle aussi artiste, Claude Chahun signe des poèmes et des tracts anti-nazis à destination des Allemands sous le nom de Der Soldat ohne Namen, ce qui signifie le Soldat sans nom. Ces feuilles volantes, ces petits billets, les deux artistes vont les glisser dans chaque interstice qui leur permet d’atteindre l’intimité des Allemands, dans leurs poches, leurs boîtes à gants, leurs besaces et cantines . Il s’agit d’informations censurées, de fausses nouvelles, de pseudo-confessions de soldats allemands désemparés. Arrêtées par la gestapo et condamnées à mort, les deux artistes résistantes seront finalement libéréesà la Libération. Agnès Geoffray réactive ces archives en les tapant à son tour sur des petits morceaux de soie colorée qu’elle dispose dans une vitrine, leur attribuant ainsi un aspect à la fois documentaire (tracts tapuscrits) mais aussi intime et précieux (la soie colorée).
2 ème partie : Préparer la visite de l’exposition Sans tambour ni trompette / Cent ans de guerres
L’art de représenter la guerre La guerre est un thème fondamental de l’histoire de l’art. Dès la Préhistoire, et plus précisément à partir du néolithique, l’art rupestre s’enrichit de nombreuses scènes de guerre et de combat. Donner à voir la guerre, en témoigner, innerve également toute l’histoire de l’art du théâtre et celle, plus récente, du cinéma. Dans l’art occidental, et dans l’ensemble des pratiques artistiques, les représentaions de la guerre sont innombrables. S’il existe bien plusieurs façons de représenter la guerre, de sa glorification à sa dénonciation en passant par sa réduction ou sa banalisation (la guerre « sert » de toile de fond), on se rend compte que depuis la fin du XIXème siècle et surtout avec la Première Guerre mondiale, elles tendent à critiquer les systèmes des Pouvoirs en place qui les nourrissent. Nous remarquerons cependant qu’aujourd’huil La photographie de presse renforce une certaine fascination pour la guerre qui se traduit par une surabondance d’images dans les médias : la guerre est photogénique. Nous verrons dans ce dossier comment, dans les arts plastiques, on est pasé, au cours des siècles, d’une représentation héroïque de la guerre à une représentation désenchantée des conflits humains. Afin d’appuyer notre présentation, nous nous intéresserons dans un premier temps au phénomène de guerre et à sa compréhension par les essayistes et philosophes. « Il ne doit pas y avoir de guerre » cassénait le philosophe allemand Emmanuel Kant en conclusion de sa « Métaphysique des mœurs, doctrine du droit » en 1797, condamnant définitivement la guerre par l’état de droit. En affirmant cela, Kant a bien conscience d’aller à rebours de toutes les évidences historiques. Au même moment, Joseph de Maistre dans ses « Considérations sur la France » écrit quant à lui : «Qu’on remonte jusqu’au berceau des nations, qu’on descende jusqu’à nos jours, qu’on examine les peuples dans toutes les positions possibles, depuis l’état de barbarie jusqu’à celui de civilisation la plus raffinée : toujours on trouvera la guerre. » À ces démonstrations de pensées contraires, on peut aussi citer le vieil adage populaire : « Si tu veux la paix, prépare la guerre. » Et on aura beau jeu d’objecter que préparer la guerre a surtout servi, jusqu’à présent, à faire la guerre. Nous verrons de quelle manière, ces pensées se retrouvent dans les oeuvres des artistes qui se sont intéressés au phénomène guerrier et, pour certains d’entre eux, à ses conséquences. Depuis la plus haute Antiquité, la guerre est l’image du fléau universel et du triomphe de la force aveugle. Elle possède cependant un symbolisme extrêmement important dans les sociétés humaines. En effet, d’une manière générale, la guerre a pour fin la destruction du mal, le rétablissement de la paix, de la justice et de l’harmonie, tant sur les plans cosmiques et social, que spirituel. Dans le boudhisme même, dont le pacifisme est bien connu, on retrouve le symbolisme guerrier notament à travers la figure du Boudha « guerrier qui brille dans son armure. »
> Scène de guerre, -10 000 ans av.J.C. Peinture rupestre, Libye. Cette magnifique peinture ornementale réalisée à partir d’ocre et d’hématite sur roche est caractéristique de l’art néolithique du Sahara alliant des représentations animales très réalistes et des figures antropomorphes souvent schématiques comme ici. Si les scènes de chasse sont encore à l’honneur au néolithique, les archéologues retrou- vent surtout des scènes pastorale et de guerre. L’âge de la pierre polie (-12 000 à - 3 000 ans av.J.C) marque les débuts de la sédentarisation et de l’agriculture. Les hommes composent des sociétés complexes et très organisées où l’on vit beaucoup plus vieux et où l’on compte plus de naissances. Paradoxalement, les guerres sont aussi plus nombreuse et déciment des populations entières. C’est au néolithique que l’on doit les premiers charniers de l’humanité. Avec la domestiquation des animaux, le développement de l’agriculture et l’institution de la sédentari- sation, la guerre semble être le principe fondateur de toutes les civilisations.
> Fresque du temple de Beit-el-Wali, -1240 ans av.J.C. British Museum, Londres Cette splendide fresque du temple de Beit-el-Wali en Nubie décrit l’expédition de Ramsès II (-1279-1212 av.J.C.) dans le Sud de l’Egypte. Dans la première partie de la fresque que vous pouvez voir ici, le pharaon est représenté sur son char en vainqueur, vaillant et indestructible. Il est d’ailleurs beaucoup plus grand que ses ennemis lybiens, représentés telles des fourmis, que les sabots de son cheval écrase et broie d’un seul mouvement. Vêtus de pagnes en peau de léopard, la peau noire, identiques les uns aux autres, ils ne sont plus que des poupées de chiffon piéti- nées et désarticulées. Dans la deuxième partie de la fresque, Ramsès II est représenté en souverain vainqueur recevant les présents des lybiens soumis qui déposent à ses pieds de l’or, des esclaves, des éléphants, une girafe, une gazelle, un léopard, des boeufs, des singes, des meubles et tissus de toutes sortes, des denrées alimentaires, etc... La guerre se fait pour l’entière possession de tous les biens et de leur exploitation. Ramsès II, bien connu pour avoir été un des grands conquérants de l’Antiquité, a régné plus de 66 ans. Son règne est marqué par de grandes cam- pagnes militaires décidées pour la recherche et la possessionn de mines d’or. La construction et l’ornementation des grands palais, temples, monuments funéraires de l’Egypte ancienne dont nous admirons aujourd’hui quelques beaux vestiges ont pu être possibles grâce à la guerre.
> Mosaïque de la bataille d’Alexandre, -200 ans av.J.C. Musée archéologie national de Naples. Haute de 5m82 et large de 3m83, cette moaïque de sol, découverte en 1831 à Pompéi dans la maison du Faune est une des plus remarquables compositions du IIème siècle av.J.C. Elle est fait de 1,5 millions de tesselles environ organisés en opus vermiculatum (technique de mosaïque antique qui forme des lignes sinueuses) de seulement quatre couleurs différentes : jaune, ocre, noir et blanc. Elle représente la bataille d’Alexandre le Grand (chef des Macédoniens) contre Darius III (roi des Perses). La scène représente le point d’acmé de la bataille, la charge décisive d’Alexandre qui provoque le désarroi et le chaos parmi les troupes ennemies. Surgissant de la gauche, l’armée d’Alexandre n’occupe qu’une petite partie de la composition, c’est l’armée de Darius en déroute qui s’étale sur les trois quarts de la surface. Cette composition dynamique provoque un mouvement quasi cinématographique. Les macédoniens pénètrent littéralement l’armée de Darius. Les nombreuses lances dressées par les Perses attirent notre regard sur le héro de la bataille, Alexandre. Ce dernier est représenté stoïque et fier, alors que Darius, pivotant sur lui même dans un mouvement désemparé, est affolé, comme déséquilibré. Il y a aussi dans cette scène de bataille, un élément qui nous est précieux en terme de repésentation de la guerre. Le conquérant Alexandre ne mène plus ses batailles sur un char, comme Darius. Lui, fait corps avec son cheval Bucéphale s’apparentant ainsi avec une figure mythologique, le centaure. Ici, il y a dualité dans la repésentation du conquérant. Le centaure symbolise la double nature de l’homme, l’une bestiale, l’autre divine. C’est sans doute aussi ce que l’on entend par la guerre : colère, surexitation virile, douleur et abomination des clans, des ethnies, des religions et des nations, cette activité universelle n’a pas moins une généalogie, des étapes et des métamorphoses. Si Darius repésente le monde ancien, Alexandre et incontestabelement l’homme nouveau, chevalier qui fait la guerre en domptant et maîtrisant les forces élémentaires.
> La Tapisserie de Bayeux, Scène 52 (La bataille d’Hastings), vers 1077 Broderie, 50 x 7000 cm. Musée de la Tapisserie de Bayeux. Voici une oeuvre magistrale de l’histoire de l’art et de l’Histoire, inscrite au registre Mémoire du monde par l’UNESCO en 2007. Composée telle une bande-dessinée en 58 scènes, cette tapisserie aux points d’aiguille décrit des faits historiques allant de la fin du règne du roi d’Angleterre Edouard le Confesseur (1064) à la bataille d’Hastings (1066) dont l’enjeu était le trône d’Angleterre conquis par le duc franc Guillaume de Normandie. Réalisée quelques années à peine après la conquête, cette inestimable broderie peut être vue comme une oeuvre de propagande à la gloire de Guillaume le Conquérant, car c’est le point de vue normand de l’histoire. Oeuvre didactique destinée à montrer au peuple la légitimité de l’invasion de Guillaume, sa légitimité au trône et le juste châtiment enduré par le comte Harold, l’autre prétendant au trône, représenté comme un fourbe et un parjure. Il s’agit bien d’un récit moralisateur, montrant le triomphe du Bien (le bon duc Guillaume) sur le Mal (incarné par le mauvais roi Harold). Les Normand sont représentés à cheval, ce qui symbolise leur supériorité. Alors que les Saxons sont à pieds, simples fantassins non préparés à la guerre. Les scènes de guerre sont soulignées d’une bordure inférieure envahie par les tableaux d’horreur qui accompa- gnent une bataille : cadavres parfois démembrés ou décapités, corps que l’on dépouille de leur armure, armes éparpillées etc... C’est une manière de traduire le débordement qui devait traduire la fureur des combats impossi- bles à contenir dans la zone du milieu de la tapisserie.
> Paolo Uccello, La bataille de San Romano, vers 1456 Triptyque, 2m x 3m chaque panneau environ, détrempe sur bois. National Gallery, Londres / muée du Louvre, Paris / galerie des Offices, Florence. Cette oeuvre très célèbre de la Renaissance italienne montre trois scènes d’une même bataille menée par les Florentins contre les Siennois et qui a eu lieu le 1er juin 1432 à San Romano. Le peintre exalte ici l’action militaire et politique de l’armée florentine, ainsi que la personnalité du condottiere, chefs d’armées de mercenaires payées par les riches républiques marchandes de ce qui n’est pas encore l’Italie. De nationalité différentes, ils mettent leur art de la guerre au service d’Etats voisins qui se disputent les marchés des routes de la soie et de bien d’autres marchandises encore. Les condottiere ne mènent pas de guerres sanglantes, ils misent sur des guerres pécunières qui peuvent leur rapporter beaucoup d’argent à tel point parfois que ces guerriers ont pu prendre le contrôle des villes qu’ils servaient par le simple fait qu’ils étaient devenus plus riches que les familles de marchands dominantes. C’est ainsi que s’ils rançonnent les habitants des pays vaincus (pratique héritée des guerres du Moyen-Âge mais seulement sur les grands princes), ils s’épargnent mutuellement. Il n’y a ainsi pas intérêt à faire des morts dans les lignes ennemies, au contraire. La guerre devient un démonstration de force et d’ingéniosité stratégique à l’image des tournois. Le peintre Paolo Uccello traduit cela par un brio certain qui imprègne chaque panneau de sa com- position. Cette scène de bataille ressemble plus à un étrange ballet d’automates et de chevaux de manège qu’aux réalités de la guerre.
> Albrecht Altdorfer, La bataille d’Issos, 1529 Peinture sur bois, 158, 4 x 120,3 cm. Musée de Pinakotek, Munich. Cette gigantesque scène de bataille représente la victoire d’Alexandre ke Grand sur le roi Darius en 333 avant J.C. Le peintre Albrecht Altorfer, se saisit de toutes les techniques de perspective mises au point à la Renaissance, mais en plus il s’ingénie à inscrire ses personnages dans un paysage. C’est en fait le premier peintre en Europe à pein- dre des forêts, des couchers de soleil, la mer, les ruines. Ici, la scène de bataille qui fourmille de personnages est comme engloutie par un paysage majestueux fait de montagne, de mer et de ciel. Les guerriers que l’on distingue à peine sont en fait littéralement avalés par la force de la nature. Si le soleil levant symbolise la jeunesse et l’impé- tiosité du nouveau conquérant Alexandre, qui représente la sagesse grecque et l’Occident, le croissant de lune qui semble disparaître en haut à gauche du tableau, symbolise quant à lui le vieux roi Darius et la chute de la prédomi- nence de l’Orient dans l’ordre politique du monde au XVIème siècle.
> Louis-Nicolas Van Blarenberghe, Combat de Melle remporté par le vicomte de Chayla, 1745 Gouache, série de la Guerre de succession d’Autriche. Château de Versailles. Le peintre lillois Louis-Nicolas Van Blarenberghe a suivi en direct la Guerre de succession d’Autriche (1740-1748) qui s’es déroulée en partie dans les environs de Lille. Il a ainsi réalisé toute une série de gouaches que l’on peut admirer encore aujourd’hui au château de Versailles retraçant les principales batailles de cette guerre de la France contre l’Autriche. Il s’agit d’une peinture faite sur le terrain, alors qu’avant le XVIIIème siècle, les peintres restent à l’atelier pour réaliser les scènes de bataille. Nous pouvons voir les manoeuvres des armées en litige d’après un point de vue surplombant la scène de la bataille de Melle. Nous ne sommes plus dans la confusion de l’attaque des macédoniens contre les perses montrée par Albrecht Altdorfer deux cent ans plus tôt, qui témoigne d’une bataille sanglante. Mais bien dans une sorte de ballet de troupes qui se déploient d’aprè une logique et une stratégie de terrain dans un paysage qui devient l’allié de celui des deux camp qui la maîtrise le mieux. C’est bien une bataille qui fait des morts et des dégats dans chacune des parties adverses, mais tout cela est maîtrisé par la logique de l’art de faire la guerre. Au XVIII ème siècle, l’artiste Louis-Nicolas Van Blarenberghe fait partie, en tant qu’artiste, des armées de Louis XV qui le distingue à ce titre en lui offrant un brevet de « peintre des batailles », ce qui fait de lui un personnage aussi haut placé à la cour que n’importe quel grand militaire de l’époque.
> Jacques-Louis David, Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard, 1802 Huile sur toile, 260 x 221 cm. Musée du Château de Versailles. Il existe cinq versions de ce tableau très célèbre du premier consul Napoléon Bonaparte lors du franchisement du col alpin du Grand-Saint-bernard par l’armée de réserve, épisode marquant le début de la seconde campagne d’Italie. Celui-ci est la deuxième version. Archétypes du portrait de propagande, les différents tableaux ont été reproduits dès cette époque sur des vases, de assiettes etc... On peut voir Bonaparte sur un cheval en uniforme de général en chef. De sa main gauche, il maîtrie sa monture en train de cabrer. En arrière-plan, des soldats qui ache- minent des canons gravissent la montagne. De sa main droite, Bonaparte montre au spectateur la voie à suivre. David était le peintre officiel de Napoléon. L’artiste choisit ici d’héroïser son modèle et les noms d’autres héros avant lui qui ont franchi les Alpes pour mener bataille, comme Hannibal ou Charlemagne, sont inscrits sur la roche au premier plan sous son propre nom. Le geste commande et montre la victoire. Le manteau rouge est un rappel de la cape d’Apollon, symbolisant le pouvoir, alors que la noble quiétude du visage fait référence à Alexandre sur Bucéphale. Bonaparte apparaît ainsi comme un des plus grands conquérants de tous les temps. Or, la réalité de cette campagne d’Italie a été beaucoup plus prosaïque car l’on sait que Napoléon a passé les Alpes à dos de mule et revêtu d’une redingote grise beaucoup plus propices, l’une et l’autre, à une telle ascension.
Vous pouvez aussi lire