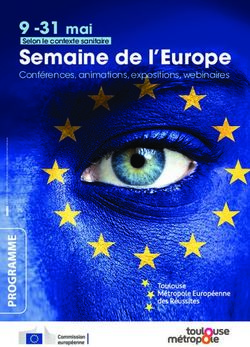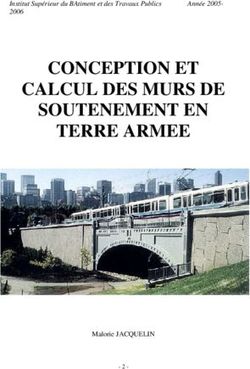Traduire le " vertige de l'expansion " - Sur Madame Bovary - OpenEdition Journals
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Flaubert
Revue critique et génétique
14 | 2015
Flaubert et l'Italie
Traduire le « vertige de l’expansion »
Sur Madame Bovary
Laura Santone
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/flaubert/2458
ISSN : 1969-6191
Éditeur
Institut des textes & manuscrits modernes (ITEM)
Référence électronique
Laura Santone, « Traduire le « vertige de l’expansion » », Flaubert [En ligne], 14 | 2015, mis en ligne le 15
décembre 2015, consulté le 04 février 2020. URL : http://journals.openedition.org/flaubert/2458
Ce document a été généré automatiquement le 4 février 2020.
Flaubert est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas
d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.Traduire le « vertige de l’expansion » 1
Traduire le « vertige de
l’expansion »
Sur Madame Bovary
Laura Santone
« Les beaux livres sont écrits
dans une sorte de langue étrangère »
(Marcel Proust)
Flaubert, 14 | 2015Traduire le « vertige de l’expansion » 2
1 « Je voudrais de grandes histoires à pic, et
peintes du haut en bas. Mon conte
oriental me revient par bouffées ; j’en ai
des odeurs vagues qui m’arrivent et qui
me mettent l’âme en dilatation »1 : ainsi
Flaubert écrit-il à sa Muse, Louise Colet, le
26 août 1853. Il est à l’époque en train de
travailler « à la Bovary », le roman qui lui
donne « des sueurs froides »2, mais dans
ces mots revient le projet d’un conte
oriental, longtemps caressé et jamais
abouti, où tout serait dissolution,
éblouissement, dilatation de la conscience
de soi. Toujours dans la même lettre, un
peu plus loin, en précisant ses principes
esthétiques, il continue :
Ce qui me semble, à moi, le plus haut dans
l’Art (et le plus difficile), ce n’est ni de
faire rire, ni de faire pleurer, ni de vous
mettre en rut ou en fureur, mais d’agir à la façon de la nature, c’est-à-dire de faire
rêver. Aussi les très belles œuvres ont ce caractère. Elles sont sereines d’aspect et
incompréhensibles. Quant au procédé, elles sont immobiles comme des falaises,
houleuses comme l’Océan, pleines de frondaisons, de verdures et de murmures
comme des bois, tristes comme le désert, bleues comme le ciel. Homère, Rabelais,
Michel-Ange, Shakespeare, Goethe m’apparaissent impitoyables. Cela est sans fond,
infini, multiple. Par de petites ouvertures on aperçoit des précipices ; il y a du noir
en bas, du vertige3.
2 Le travail d’écriture du roman catalyse, c’est évident, une plus ample réflexion sur le
statut de la prose, dont il définit les enjeux par le biais d’un langage métaphorique
décliné “verticalement”, sur l’axe d’un vertige. Suivant l’exemple magistral des
hommes de génie du passé, il s’agira, en fait, pour sa langue d’écrivain, de la faire
couler « à pic », « du haut en bas » ; « sans fond », cette langue devra éclairer des
« précipices » ; « infini et multiple », elle fera rêver, et tout en traversant le « noir », le
« vertige », elle déploiera cette beauté qui rend les œuvres « bleues comme le ciel ». Le
« bleu » vient ainsi connoter la couleur de ce regard impersonnel qui devra réaliser la
« vue profonde », la « pénétration de l’objectif »4, à savoir ce « labeur atroce » de
l’écriture et du style que Barthes désignera, très significativement, comme « vertige de
l’expansion »5.
3 Cela dit en guise de prémisse, je voudrais revenir avec cet article sur le « labeur », non
moins « atroce », qu’est tout travail de traduction dans la recherche, toujours
renouvelée, d’une texture énonciative susceptible de restituer le rythme, le style et les
“voix” de la construction originale du texte, et je me pencherai, en particulier, sur
quatre traductions italiennes de Madame Bovary. Il s’agira, plus précisément, de
reprendre ces traductions et de les mettre « sur le même plan » 6 dans la perspective
d’une trajectoire comparée, pour observer comment chacun d’elles, dans ses
énonciations singulières, a recherché – et trouvé - des effets de sens voués à recréer
dans une « langue étrangère » les effets de sens et la beauté propres de l’original. Je
mettrai donc en dialogue avec le texte original La Signora Bovary de Diego Valeri, parue
en 1936 et jugée à l’époque « un des plus beaux livres en italien des dernières années » 7,
Flaubert, 14 | 2015Traduire le « vertige de l’expansion » 3
et Madame Bovary traduit par Oreste Del Buono (1965), Maria Luisa Spaziani (1997) et,
plus récemment, par Sandra Teroni (2004).
4 Le point d’ancrage à partir duquel je développerai mon analyse comparée sera le
« bleu », la couleur qui traverse, en l’enveloppant, toute la vie d’Emma Bovary ; couleur
qui va au-delà du langage, jusqu’à ses interstices – ses « précipices » -, ouvrant sur les
bords de l’indicible. Présence chromatique sillonnant le visible et l’invisible à la fois, le
bleu donne à la matière les teintes de la rêverie et creuse le langage avec des effets de
vertige, en créant des points d’orgue qui coïncident avec des ruptures, des suspensions,
des silences, voire avec l’éclatement du sujet de conscience absorbé dans des moments
narratifs qu’on peut qualifier d’ordre « pictural »8.
5 La sélection des passages que je vais analyser a été guidée par un critère qu’on pourrait
appeler métaphorique et que j’aime expliciter avec les mots de Flaubert lui-même : il
s’agira d’un ensemble de phrases qui dans le livre « s’agitent […] comme les feuilles
dans une forêt, toutes dissemblables en leur ressemblance » 9. Un ensemble dont le
premier passage choisi sera, tout en obéissant à une règle intrinsèque à la métaphore 10,
celui qui fait fonction d’intersection sémio-lexématique par rapport au corpus
constitué. C’est le moment où Emma, après avoir lu la lettre de Rodolphe, bouleversée
par son départ monte au grenier et songe au suicide, se tenant au bord du vide, contre
l’embrasure de la fenêtre :
Emma poussa la porte et entra. Les ardoises laissaient tomber d’aplomb une chaleur
lourde, qui lui serrait les tempes et l’étouffait ; elle se traîna jusqu’à la mansarde
close, dont elle tira le verrou, et la lumière éblouissante jaillit d’un bond. En face,
par-dessus les toits, la pleine campagne s’étalait à perte de vue. En bas, sous elle, la
place du village était vide ; les cailloux du trottoir scintillaient, les girouettes des
maisons se tenaient immobiles ; au coin de la rue, il partit d’un étage inférieur une
sorte de ronflement à modulations stridentes. C’était Binet qui tournait 11.
6 Cette partie du texte se déploie, de part en part, selon la dimension de la verticalité, ce
qui construit aussi la texture du rythme par un jeu articulé autour d’un mouvement
isotopique d’expansion qui trouve sa mesure dans l’unité propositionnelle de clôture
« C’était Binet qui tournait », dont le profil intonatif fortement scandé sur des effets de
rimes internes en /e/ ouvert reproduit, en la redoublant, la tension d’ouverture vers
l’infini qui marque les énoncés. Mais voyons, maintenant, comment intervient la
traduction en transférant en italien ce moment du texte.
Sospinse la porta ed entrò. Il tetto d’ardesia lasciava cadere a piombo un calore
pesante che le serrava le tempie e la soffocava; si trascinò fino all’abbaino, tirò il
catenaccio dell’imposta, e allora la luce abbagliante si versò dentro, di colpo.
Davanti a lei, sopra i tetti, la campagna si stendeva a perdita d’occhio. Sotto, la
piazza del villaggio era vuota; le piastre dei marciapiedi scintillavano, le banderuole
delle case stavano immote; dall’angolo della via, da un piano inferiore, si levò una
specie di ronzio con modulazioni stridule. Era il tornio di Binet 12.
Spinse quella porta, entrò. L’ardesia del tetto lasciava cadere a piombo un pesante
calore che le chiudeva le tempie in una morsa, le strozzava il respiro sulle labbra; si
trascinò sino all’abbaino chiuso, tirò il catenaccio, la luce le sgorgò contro, l’accecò.
Davanti a lei, di là dai tetti, la campagna si estendeva a perdita d’occhio. In basso,
sotto di lei, la piazza del villaggio era deserta, le lastre dei marciapiedi luccicavano,
le banderuole delle case se ne stavano immote; dall’angolo della strada, da un piano
inferiore, si levò un ronzio stridulo, il tornio di Binet 13.
Spinse la porta, entrò. Scendeva dal tetto d’ardesia un’afa densa che le attanagliava
le tempie e la soffocava. Si trascinò fino all’abbaino chiuso, tirò il chiavistello e fu
investita di colpo da una luce abbagliante. Là davanti, oltre la distesa dei tetti,
l’aperta campagna si stendeva a perdita d’occhio. Sotto di lei, laggiù, la piazza del
Flaubert, 14 | 2015Traduire le « vertige de l’expansion » 4
paese era vuota, scintillavano i ciottoli del marciapiede, immobili le banderuole
delle case. All’angolo della strada, da una finestra più bassa uscì una specie di ronzio
modulato e stridulo. Era Binet affaccendato al suo tornio 14.
Spinse la porta ed entrò. Dal tetto di ardesia cadeva a piombo un caldo pesante che
l’afferrava alle tempie e la soffocava; si trascinò fino all’abbaino chiuso, tirò il
lucchetto, e di colpo la luce irruppe, accecante. Davanti, oltre i tetti, si stendeva a
perdita d’occhio l’aperta campagna. In basso, sotto di lei, la piazza del paese era
vuota; i ciottoli luccicavano, le banderuole delle case erano immobili; all’angolo
della strada, da un piano inferiore, partì come un russare dalle modulazioni
stridule. Era il tornio di Binet15.
7 Tout en partant du texte de Diego Valeri, il est aisé de constater que, si d’un côté les
quatre traductions examinées ré-énoncent avec des choix tout aussi efficaces la
verticalité que l’original exprimé par des verbes à valeur circonstancielle tels que
« tomber d’aplomb », « jaillit d’un bond », « il partit d’un étage inférieur », et par des
adjectifs dénotant l’attrait de la perpendicularité, tels que « lourde », « éblouissante »,
« immobiles », il n’en va pas de même pour le mouvement d’expansion qui passe par
cette même verticalité en conférant au texte un surplus de profondeur. Et cela à partir
de la conjonction « et », supprimée par Oreste del Buono et Maria Luisa Spaziani.
Comme l’avait déjà souligné Proust en 1920 dans son célèbre article sur le style de
Flaubert, « la conjonction “et” n’a nullement dans Flaubert l’objet que la grammaire lui
assigne. Elle marque une pause dans une mesure rythmique et divise un tableau. […]
C’est comme l’indication qu’une autre partie du tableau commence, que la vague
refluante, de nouveau, va se reformer »16. Or, dans notre cas, cette conjonction signale
exactement le viatique qui doit mener aux “tableaux” qui vont se succéder, en donnant
à l’écran de la représentation verbale une respiration de plus en plus intense, soit la
« mesure rythmique » de cette « vague refluante » qui coule sans contours et sans
limites, et dont l’effet ne se perd pas dans les traductions de Diego Valeri et Sandra
Teroni. Effet que Flaubert enchaîne, significativement, au rythme qui module la phrase
de clôture, « C’était Binet qui tournait », rendu par les deux traducteurs par « Era il
tornio di Binet », énoncé qui, s’il ne peut pas recréer, physiologiquement, le jeu subtil
des rimes internes, d’un autre côté il reproduit, en revanche, la netteté d’une phrase
« qui se tient droit », « debout », « tout en courant »17 - ce que le bruit incessant du tour
réalise au niveau iconique et acoustique. Mais cet effet va se perdre dans les traductions
d’Oreste Del Buono et Maria Luisa Spaziani, qui affaiblissent visiblement la prégnance
rythmique de l’original. Le premier, en reconfigurant les frontières de ce “tableau”
avec suppression du point final et de l’imparfait, marques évidentes d’une scansion
processuelle qui est ainsi interrompue ; la seconde, en ajoutant un adjectif,
« affaccendato », qui provoque une brusque rupture du rythme même au niveau
typographique.
8 Mais avançons dans la lecture pour en venir au moment où le « bleu du ciel » éveille en
Emma le vertige de l’être, son attrait vers l’infini :
Elle jetait les yeux tout autour d’elle avec l’envie que la terre croulât. Pourquoi n’en
pas finir ? Qui la retenait donc ? Elle était libre. Elle s’avança, elle regarda les pavés
en se disant :
– Allons ! allons !
Le rayon lumineux qui montait d’en bas directement tirait vers l’abîme le poids de
son corps. Il lui semblait que le sol de la place oscillant s’élevait le long des murs, et
que le plancher s’inclinait par le bout, à la manière d’un vaisseau qui tangue. Elle se
tenait tout au bord, presque suspendue, entourée d’un grand espace. Le bleu du ciel
l’envahissait, l’air circulait dans sa tête creuse, elle n’avait qu’à céder, qu’à se laisser
Flaubert, 14 | 2015Traduire le « vertige de l’expansion » 5
prendre ; et le ronflement du tour ne discontinuait pas, comme une voix furieuse
qui l’appelait18.
9 Les traductions :
Gettava gli occhi intorno, col desiderio che la terra crollasse. Perché non farla
finita? chi la tratteneva? Essa era libera. Si fece avanti, e guardò il selciato, dicendo
a se stessa:
“Andiamo! Andiamo!”
Il raggio luminoso che saliva direttamente dal basso attirava il peso del suo corpo
verso l’abisso. Le pareva che il suolo della piazza oscillando si alzasse lungo i muri, e
che l’impiantito s’inclinasse sul davanti, come una nave in tempesta. Ella si teneva
sull’orlo estremo, quasi sospesa, circondata da un grande spazio. L’azzurro del cielo
la penetrava, l’aria circolava nella sua testa vuota: non aveva che da cedere, da
lasciarsi prendere. E il ronzio del tornio non cessava un momento, come una voce
furiosa che la chiamasse19.
Si girava gli occhi intorno con il desiderio che l’intera terra crollasse. Perché non
farla finita? Chi poteva trattenerla in vita? Non c’erano più legami che contassero.
Si sporse, guardò il selciato, si disse:
“Basta! basta!”
Il riflesso luminoso che saliva dal basso risucchiava il peso del corpo verso l’abisso.
Le pareva addirittura che il suolo si alzasse oscillando dalla piazza lungo i muri, che
l’impiantito si inclinasse in avanti sotto i suoi piedi come il ponte di una nave in una
tempesta. Era finita proprio sull’orlo, quasi sospesa, un immenso spazio la
circondava. L’azzurro del cielo la invadeva, nella sua testa squarciata si dilatava
l’aria, non aveva che da cedere, lei, che da lasciarsi portare; e fosse smesso un
attimo quel ronzio del tornio, la voce furiosa che la chiamava 20.
Buttava lo sguardo tutt’intorno desiderando che la terra sprofondasse. Perché non
farla finita? Chi poteva trattenerla? Era libera. Si sporse, fissò il selciato:
“Un po’ di coraggio, via!”
Il raggio luminoso che saliva dritto dal basso attirava verso l’abisso il peso del suo
corpo. Le pareva che il suolo della piazza oscillante risalisse lungo i muri, e che il
pavimento s’inclinasse verso l’esterno come nel beccheggio di una nave. Lei stava lì,
proprio sul bordo, come sospesa, avvolta nell’immensità dello spazio. L’azzurro del
cielo la penetrava, l’aria circolava nella cavità della testa, non aveva che da cedere,
da lasciarsi prendere. E il ronzare del tornio si ostinava, come il furioso richiamo di
una voce21.
Volgeva lo sguardo tutt’intorno con un forte desiderio che la terra crollasse. Perché
non farla finita? Chi la tratteneva? Era libera. Si sporse, guardò il selciato dicendosi:
– Via! Via!
Il raggio luminoso che saliva dritto dal basso attirava verso l’abisso la massa del suo
corpo. Le pareva che il suolo oscillante della piazza si alzasse lungo i muri e che
l’impiantito s’inclinasse da una parte, alla maniera di un vascello che beccheggi.
Stava proprio sull’orlo, quasi sospesa, immersa nello spazio. L’azzurro del cielo la
invadeva, l’aria le circolava nella testa vuota, non aveva che da cedere, lasciarsi
prendere; e il ronzio del tornio non si interrompeva, come una voce furiosa che la
chiamasse22.
10 Partant du constat que ce passage se développe au fil d’un parallélisme isotopique que
Flaubert établit entre le sème de la verticalité et le sème de l’expansion, il est
intéressant de voir comment les traductions traitent cette configuration du texte. Il est
aisé de noter qu’elles conservent, toutes les quatre, ce parallélisme, mais avec des
variantes importantes :
– amplification du sème de l’expansion chez Oreste Del Buono et Sandra Teroni, qui
privilégient des choix lexicaux axiologiquement soudés à l’occurrence du verbe
« envahir », verbe-pivot qui caractérise à la fois la « vague » de l’infini et le sentiment
Flaubert, 14 | 2015Traduire le « vertige de l’expansion » 6
d’évasion d’Emma. Les deux traducteurs conservent « l’azzurro del cielo la invadeva »,
énoncé avec lequel Oreste Del Buono met en résonance l’adjectif « squarciata » – au lieu
de « vuota » – ainsi que la locution verbale « lasciarsi portare » – au lieu de « lasciarsi
prendere », et non moins la décision d’éliminer l’adverbe « directement », alors que
Sandra Teroni, de son côté, essaye de rendre plus tangible le raptus d’Emma, sa figure
de sujet hors de soi, « fondu dans la couleur »23, en optant pour l’adjectif « immersa » –
au lieu de « circondata » ;
– amplification du sème de la verticalité chez Diego Valeri et Maria Luisa Spaziani, où
l’occurrence du verbe « penetrare » – « l’azzurro del cielo la penetrava » –, associée au
choix de couper en deux énoncés la phrase finale avec ajout d’un point final et
suppression du point-virgule font que l’envahissement par le vide qu’éprouve Emma
renvoie à la trajectoire d’une chute, la chute – verticale – d’un corps lourd tendu vers
l’abîme et “percé” de part en part, d’en haut comme d’en bas, par « le bleu du ciel ».
11 Et la chute en tant qu’expérience d’un vertige se concrétise par la suite au moment où
le « bleu du ciel » revient dans un détail apparemment fugace, mais qui en réalité se
révèle intimement lié à la « trame verticale »24 du roman :
Tout à coup, un tilbury bleu passa au grand trot sur la place. Emma poussa un cri et
tomba roide par terre, à la renverse25.
12 Voilà comment nos traducteurs restituent cet énoncé :
D’improvviso un tilbury turchino passò al gran trotto per la piazza. Emma gettò un
grido, e cadde riversa, tutta d’un pezzo, per terra26.
D’improvviso un tilbury turchino passò al gran trotto per la piazza. Emma gettò un
grido, cadde riversa, a corpo morto27.
All’improvviso un tilbury azzurro passò a gran trotto sulla piazza. Emma gettò un
grido e piombò riversa a terra28.
A un tratto un tilbury blu attraversò al gran trotto la piazza. Emma gettò un grido e
cadde riversa per terra, a corpo morto29.
13 Conformément au texte original, les quatre traductions conservent la force verticale
que Flaubert inscrit dans « roide » et « cri » pour désigner la « chute » d’Emma, et le
choix unanime de rendre « poussa un cri » par « gettò un grido » produit en ce sens une
connotation très forte tant au niveau sémique qu’au niveau figuratif et lexical. Le verbe
« gettò », en fait, encore plus que le français « poussa », marque l’extension même de
l’isotopie de la verticalité, et crée un lien très actif avec l’écriture en tant que fond et
surface du texte. Tout à fait différent, en revanche, est le choix de traduction pour le
segment « un tilbury bleu » : Diego Valeri et Oreste Del Buono optent pour « un tilbury
turchino », Maria Luisa Spaziani pour « un tilbury azzurro », Sandra Teroni pour « un
tilbury blu ». Les traductions re-dessinent autour du « bleu » un paradigme
chromatique dont les nuances, apparemment insignifiantes, déterminent des écarts par
rapport à la construction de la texture originale. Si Diego Valeri et Oreste Del Buono
semblent vouloir corriger avec « turchino » ce qui littéralement est « azzurro », eux, à
bien y regarder, captent les pulsions les plus profondes du texte. Car « turchino »,
cristallisant une certaine opacité30, crée des correspondances avec « bleuâtre »31,
couleur également récurrente dans le roman et dans la vie d’Emma, à partir des
« tourbillons bleuâtres » qui montent au son de l’Angélus, en passant par l’« immensité
bleuâtre » qui l’entoure lors de son élan lyrique après avoir réalisé d’avoir un amant,
jusqu’aux « fumignons bleuâtres » qui accompagnent le cortège de son enterrement.
14 Mais il y a plus. Le choix de « turchino » ne va pas sans activer, toujours par contiguïté
chromatique et sémantique à la fois, une relation sous-jacente avec « âpre », l’épithète
Flaubert, 14 | 2015Traduire le « vertige de l’expansion » 7
qui introduit dans le roman la première occurrence du « bleu » associé au « ciel ». Il
s’agit du passage où Emma s’achemine vers la demeure de la mère Rollet où sa fille
Berthe a été mise en nourrice, c’est un jour de grosse chaleur, elle se sent fatiguée et
demandera à Léon, croisé dans la rue, de l’accompagner. Le “tableau” qui prépare cette
rencontre est le suivant :
Il était midi ; les maisons avaient leurs volets fermés, et les toits d’ardoises, qui
reluisaient sous la lumière âpre du ciel bleu, semblaient à la crête de leurs pignons
faire pétiller des étincelles. Un vent lourd soufflait. Emma se sentait faible en
marchant ; les cailloux du trottoir la blessaient ; elle hésita si elle ne s’en
retournerait pas chez elle, ou entrerait quelque part pour s’assoir 32.
15 Tout comme les suffixes en –âtre, avec lesquels se soude par allitération, « âpre », qui
dans le roman constitue un hapax, trouve son corrélat dans « bleuâtre », les deux
adjectifs répandant sur le bleu son cône d’ombre, ses grains d’opacité, ce qui s’avère
aussi au niveau phonico-acoustique autour des occlusives sourdes qui articulent vers
l’“arrière”, au niveau uvulaire, les deux couples /pr/ et /tr/. Voyons, alors, comment
les traductions prennent en charge ce segment du texte :
Era mezzodì; le case avevano le persiane chiuse, e i tetti di ardesia, che lustravano
sotto l’aspra luce del cielo azzurro, parevano sprigionar scintille dalle creste dei
loro colmigni. Soffiava un vento pesante. Camminando, Emma si sentiva debole; le
selci del marciapiede la ferivano. A un certo punto esitò, incerta se dovesse tornare
indietro, o entrare in qualche casa per sedersi33.
Era mezzogiorno: le case avevan le imposte chiuse, e i tetti di ardesia che
luccicavano sotto la violenta luce del cielo azzurro parevano sprigionare scintille
dalla cresta dei comignoli. C’era un vento pesante. Emma si sentiva così debole a
camminare; le selci del marciapiede la ferivano; si fermò, incerta se tornarsene a
casa o entrare da qualche parte e sedersi34.
Era mezzogiorno. Le case avevano le persiane accostate, e i tetti di ardesia, lucenti
sotto la luce cruda del cielo azzurro, sembravano sprigionare scintille dalla cima dei
comignoli. C’era un vento soffocante. Camminando, Emma si sentiva debole; i
ciottoli del sentiero le facevano male; non sapeva se ritornarsene a casa o entrare a
sedersi da qualche parte35.
Era mezzogiorno; le case avevano le imposte chiuse, e i tetti di ardesia, che
brillavano sotto la luce cruda del cielo azzurro, sembravano sprigionare scintille
dalla punta dei comignoli. Soffiava un vento pesante. Emma faceva fatica a
camminare; i ciottoli del marciapiede le facevano male; esitò se tornare a casa o
entrare a sedersi da qualche parte36.
16 « Aspra », « violenta », « cruda » : trois adjectifs marqués par le sème de la violence,
mais le choix de Diego Valeri de traduire le segment « mot à mot » en maintenant
« aspra », présente l’avantage de recréer la relation, d’ordre sensoriel, que le texte
original établit avec l’agonie d’Emma dans la troisième partie du roman. La « saveur
acre » de l’arsenic, contenu dans une bouteille « en verre bleu », renverra en fait, par
un glissement métonymique rétrospectif, exactement à cette « lumière âpre du ciel
bleu » qui dans la deuxième partie est censée rendre encore plus sensible le « vent
lourd » qui semble couper le souffle à Emma.
17 « Ouvre la fenêtre…j’étouffe », seront, de façon symptomatique, le mots d’Emma à
Charles sous l’effet de « cet affreux goût d’encre » qu’elle sent dans sa bouche, alors
qu’un « froid de glace » commence à la parcourir et des gouttes de sueur apparaissent
« sur sa figure bleuâtre », « qui semblait comme figée dans l’exhalaison d’une vapeur
métallique »37. « Âpre » se révèle ainsi être, dans l’appareil formel de la représentation
flaubertienne, le noyau déclencheur d’un jeu combinatoire de reflets réciproques qui
doivent miroiter dans le roman et dont « aspra » saisit pleinement, contrairement à
Flaubert, 14 | 2015Traduire le « vertige de l’expansion » 8
« violenta » ou « cruda », la configuration “picturale” en tant que configuration
axiologique des mouvances dessinant – colorant – la psychologie de l’héroïne.
18 Il me semble alors pertinent, en clôture de mon corpus, de proposer, au fil de ce
miroitement foisonnant à la fois les dimensions de la profondeur et de l’expansion, le
passage où Flaubert décrit le moment d’extase passionnel d’Emma, après la promenade
à cheval dans la forêt avec Rodolphe. On pourra y constater que l’occurrence de
« bleuâtre », combinée au verbe « entourer », prépare précisément l’expansion de cette
courbe axiologique qui devra articuler, dans la deuxième partie du roman, la vision
vertigineuse de l’héroïne, le bouleversement d’une conscience qui, « entourée d’un
grand espace », montre son attrait pour le vide en se tenant « au bord », sur le fond du
« bleu du ciel [qui] l’envahissait ».
19 Mais lisons :
Elle se répétait : « J’ai un amant ! j’ai un amant ! » se délectant à cette idée comme à
celle d’une autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder enfin ces
joies de l’amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans
quelque chose de merveilleux où tout serait passion, extase et délire ; une
immensité bleuâtre l’entourait, les sommets du sentiment étincelaient sous sa
pensée, et l’existence ordinaire n’apparaissait qu’au loin, tout en bas, dans l’ombre,
entre les intervalles de ces hauteurs38.
20 Et voici les traductions :
Ella si ripeteva: «Ho un amante! un amante!”, compiacendosi di quest’idea come
d’una nuova pubertà sopraggiunta. Ora avrebbe avuto, finalmente, quelle gioie
dell’amore, quella febbre di felicità di cui aveva disperato. Entrava in un mondo
meraviglioso, dove tutto doveva essere passione, estasi, delirio; la circondava una
immensità azzurrina; le vette del sentimento scintillavano sotto il suo pensiero; e la
vita ordinaria non appariva che in lontananza, giù giù, nell’ombra, negli intervalli
di quelle altezze39.
Si ripeteva: “Ho un amante! Un amante!” appassionandosi a un simile pensiero
come nell’idea di una nuova pubertà. Dunque avrebbe posseduto le famose gioie
dell’amore, la febbre di felicità di cui aveva disperato. S’inoltrava in un’era
meravigliosa in cui tutto sarebbe stato tempesta dei sensi, estasi, delirio;
un’immensità celeste la circondava, le cime del sentimento scintillavano nella sua
mente, l’esistenza normale le appariva ormai così lontana, in basso, nell’ombra, tra i
vuoti di quelle altezze40.
Si ripeteva: “Ho un amante! un amante!”, deliziandosi dell’idea, come a quella di
una nuova pubertà. Avrebbe dunque posseduto quelle gioie amorose, quella febbrile
felicità di cui aveva perso la speranza. Entrava in uno spazio magico dove tutto
sarebbe stato passione, estasi, delirio. Una glauca immensità l’avvolgeva, le vette
del sentimento rifulgevano sotto il suo pensiero, l’esistenza quotidiana non
appariva che laggiù, in lontananza, nell’ombra, negli intervalli di quelle cime 41.
Si ripeteva: “Ho un amante! un amante!”, deliziandosi dell’idea come a quella di una
nuova pubertà. Avrebbe finalmente posseduto quelle gioie dell’amore, quella febbre
di felicità di cui aveva perso ogni speranza. Entrava in qualcosa di meraviglioso
dove tutto sarebbe stato passione, estasi, delirio; l’avvolgeva un’immensità celeste,
nei suoi pensieri scintillavano le vette del sentimento, e l’esistenza normale le
appariva ormai lontana, laggiù in basso, nell’ombra, tra gli intervalli di quelle
cime42.
21 Avec le choix de traduire « immensité bleuâtre » par « immensità celeste », Oreste Del
Buono et Sandra Teroni donnent l’impression d’affaiblir, d’une part, la spécificité et
l’intensité picturales recherchées par Flaubert, et de perdre de vue, d’autre part, le fait
que le segment constitue un lieu de convergence d’un système de relations
sémantiques. Ce qui, en revanche, n’échappe pas à Diego Valeri et Maria Luisa Spaziani,
Flaubert, 14 | 2015Traduire le « vertige de l’expansion » 9
qui rendent, respectivement, « immensità azzurina » et « glauca immensità », à savoir
deux tonalités qui restituent la valeur de « décomposition » matérique que Flaubert
accorde à « bleuâtre », adjectif « ombré », qui a fonction de faire coïncider l’altération
de la lumière avec l’altération d’une conscience en voie de dissolution. Et qui dans le
« bleu du ciel » va réaliser, par intimité mimétique, la « décomposition » du sujet
absorbé par l’espace qui l’entoure, désir de ce « vertige essentiel » 43 de l’être qui ouvre
l’écriture au vertige d’une expansion infinie, à cette « hermétique continuité du style »
que Proust ne manquait pas de signaler dans son hommage à l’écrivain 44.
22 Encore Proust : « Mais nous les aimons ces lourds matériaux que la phrase de Flaubert
soulève et laisse retomber avec le bruit intermittent d’un excavateur […] Heureux ceux
qui sentent ce rythme obsesseur »45. Et où l’image de l’excavateur qui creuse le sol en
soulevant et en laissant retomber les « lourds matériaux » convoque, significativement,
cet axe vertical, paradigmatique, qui est constitutif de la création poétique ; axe sur
lequel le mot se configure en tant que cavum, abyssos dont la “masse” verbale, se
réalisant sous forme de “masse” matérique, se manifeste par contaminations, par
dilatations, par propagations multiples – par bruits intermittents et obsesseurs.
23 Diego Valeri semble faire écho aux observations de Proust, en 1936, lorsque dans son
« Introduzione » à La Signora Bovary, après avoir expliqué au lecteur « les difficultés de
la lettre », il en venait à expliciter les affres du style :
[…] trattandosi di tradurre uno scrittore-artista della forza e della esasperata
coscienza di Flaubert, il vero scoglio è lo stile, il vero pari è di tenere la propria
prosa nel tono dell’originale, di riprodurre in qualche modo quella meravigliosa
scrittura tra ironica e tragica, familiare ma grave, con venature liriche e interne
vibrazioni d’odio, d’amore, di pietà, di sdegno: quella forma così complessa e così
una, che il Flaubert, naturalmente portato agli eccessi verbali, si conquistò con
tanto studio e tormento, mortificandosi ed esaltandosi al tempo stesso nel rigore
del limite46.
24 L’écho rebondit dans les notions de ton, vibration, dans le constat de cette forme
complexe et unique qui représente, pour le traducteur, le véritable « écueil » de son
travail. Si, comme le dit Mounin, toute traduction est « l’épreuve de l’étranger », les
traductions de Madame Bovary ici examinées sont l’exemple de la traduction en tant que
« texte en mouvement » selon la conception de Meschonnic47. Elles mettent à l’épreuve,
d’un côté, la beauté de cette « langue étrangère » qui, d’après Proust, appartient aux
« beaux livres », et elles démontrent, de l’autre, que la traduction, en marquant un des
multiples moments d’un texte « en mouvement », est l’image du « jamais fini » 48, le
reflet de ce qui peut continuellement recommencer dans un va-et-vient qui se modifie
« à travers le bougé d’un texte »49. La traduction ainsi conçue permet alors, et nous
l’avons constaté tout au long de notre parcours, de récrire à chaque fois, de façons
différentes, les vibrations de l’écriture, les (en)jeux de la prose au fil des gradations du
style, soit la couleur étrangère de cette « beauté grammaticale », et « qui n’a rien à voir
avec la correction », que Proust louait dans le style flaubertien. Ce qui fait de la
traduction cette « chimie merveilleuse »50 qui permet qu’un texte ne s’immobilise
jamais, qu’il bouge entre le même et l’autre, qu’il circule en passant par des al-chimies
re-dosant, en la renouvelant, l’énergie du texte original.
25 « Il faut laisser la pédale prolonger le son »51, écrivait toujours Proust en se référant au
rythme qui devait accompagner la lecture d’un roman de Flaubert ou de Balzac : nous
ne sommes pas loin, à bien y écouter, de tout exercice de traduction, où il faut « laisser
la pédale » afin de prolonger, avec la vie du texte, la vie même du langage. Dans le
Flaubert, 14 | 2015Traduire le « vertige de l’expansion » 10 passage d’un texte à l’autre, dans le décentrement d’une langue à l’autre, la force de la traduction est alors celle d’ouvrir l’original à l’énergie créatrice de l’écriture et du langage, et de découvrir, derrière le sens, « que ça marche, que ça coure, que ça fulgure »52. NOTES 1. Gustave Flaubert, Correspondance, édition établie, présentée et annotée par Jean Bruneau, t. II, Gallimard, Paris, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980, p. 416. 2. Comme il l’avoue à Louise Colet dans sa lettre du 29-30 janvier 1853. Ibid., p. 243. 3. Ibid, p. 417. C’est l’auteur qui souligne. 4. « Le relief vient d’une vue profonde, d’une pénétration de l’objectif ; car il faut que la réalité extérieure entre un nous, à nous en faire presque crier, pour la bien reproduire », recommande Flaubert à Louise Colet le 7 juillet 1853 (c’est l’auteur qui souligne). Ibid., p. 377. 5. Roland Barthes, « Flaubert et la phrase », dans Œuvres complètes, édition établie et présentée par Eric Marty, t. II, 1966-1973, Seuil, Paris, 1994, p. 1381. 6. D’après la perspective comparée appliquée à la traduction par Ute Heidmann, qui considère la comparaison différentielle comme un « outil heuristique » à partir duquel mettre en œuvre les différences entre l’original et le(s) texte(s) traduit(s), pour en dégager « un rapport d’égalité » – vs rapport hiérarchique – et rendre ainsi « l’impossible synonymie » que le traducteur expérimente « comme positive, comme un espace d’investigation fécond ». Voir « Mettre les différences en dialogue », dans Silvio Guindani et Jenaro Talens (éds), Carrefour d’Europe. Une approche interdisciplinaire dédiée à Philippe Braillard, Academia Bruylant, Louvain, 2010, p. 77-84. Voir aussi, sur la notion de traduction comparée, Silvana Borutti & Ute Heidmann, La Babele in cui viviamo. Traduzioni, riscritture, culture, Bollati Boringhieri, Torino 2012. 7. Ainsi Pietro Pancrazi en 1957 dans son article « La signora Bovary ottant’anni dopo », dans Italiani e stranieri, Mondadori, Milano, 1957, p. 351. 8. Je reprends ici intentionnellement Jacques Neefs, qui associe le personnage d’Emma à un « moment pictural » du roman, soit à un « moment de vision » qui fait du personnage « un être de pure visibilité diffuse », tout en marquant « un seuil de l’existence narrative de celui-ci ». Dans « Silhouettes et arrières-fonds », Études françaises, 1, 2005, p. 58. 9. À Louise Colet le 7 avril 1854 : « Il faut que les phrases s’agitent dans un livre comme les feuilles dans une forêt, toutes dissemblables en leur ressemblance ». Flaubert, Correspondance, op. cit., t. II, p. 545. 10. « La métaphore extrapole, elle se base sur une identité réelle manifestée par l’intersection de deux termes pour affirmer l’identité des termes entiers. Elle étend à la réunion des deux termes une propriété qui n’appartient qu’à leur intersection », souligne le Groupe µ dans Rhétorique générale, Larousse, Paris, 1970, p. 107. 11. Flaubert, Madame Bovary, édition présentée et annotée par Jacques Neefs, Librairie Générale Française, « Classiques de Poche », Paris, 1999, p. 318. 12. Flaubert, La Signora Bovary, trad. it. Diego Valeri, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1951 [1936], p. 246. 13. Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Oreste Del Buono, «I grandi libri», Garzanti 1986 [1965], p. 167. Flaubert, 14 | 2015
Traduire le « vertige de l’expansion » 11 14. Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Maria Luisa Spaziani, Introduzione di Albert Thibaudet, con una nota di Charles Baudelaire, « Oscar classici Mondadori », Mondadori, Milano, 2001 [1997], p. 227-228. 15. Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Sandra Teroni, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma, 2004, p. 246. 16. Marcel Proust, « À propos du “style” de Flaubert », dans Essais et articles, Gallimard, Paris, 1971, p. 287 ; c’est moi qui souligne. 17. L’allusion est, évidemment, à ce que Flaubert écrivait à Louise Colet le 13 juin 1852 : « J’aime les phrases nettes et qui se tiennent droites, debout tout en courant, ce qui est presque une impossibilité. L’idéal de la prose est arrivé à un degré inouï de difficulté ; il faut se dégager de l’archaïsme, du mot commun, avoir les idées contemporaines dans leurs mauvais termes, et que ce soit clair comme du Voltaire, touffu comme du Montaigne, nerveux comme du La Bruyère et ruisselant de couleur, toujours ». Flaubert, Correspondance, op. cit., t. II, p. 105. 18. Flaubert, Madame Bovary, op. cit., p. 319. 19. Flaubert, La signora Bovary, trad. it. Diego Valeri, op. cit., p. 247. 20. Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Oreste Del Buono, op. cit., p. 167. 21. Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Maria Luisa Spaziani, op. cit., p. 228. 22. Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Sandra Teroni, op. cit., p. 246. 23. Comme le remarque encore Neef, « Silhouettes et arrières-fonds », op. cit., p. 58. 24. C’est Stefano Agosti qui, en se référant à Madame Bovary, parle de « trame verticale, analogue à celle d’une partition de musique », pour la distinguer de la « trame horizontale » postulée par Léon Bopp. Voir Stefano Agosti, Tecniche della rappresentazione verbale in Flaubert, Il Saggiatore, Milano, 1981, p. 49-50. 25. Flaubert, Madame Bovary, op. cit., p. 321. 26. Flaubert, La signora Bovary, trad. it. Diego Valeri, op. cit., p. 248. 27. Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Oreste Del Buono, op. cit., p. 168. 28. Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Maria Luisa Spaziani, op. cit., p. 230. 29. Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Sandra Teroni, op. cit., p. 248. 30. Comme le veut son étymologie, qui reconduit la couleur turquoise à la composition minérale de la «pierre turque», une variété de phosphate dure et semi-opaque, dite de vieille roche. 31. Et dont le suffixe -âtre, comme l’observe très justement Bruna Donatelli, marque chez Flaubert « une idée de métamorphose », « un état physiologique de décomposition (celui des cadavres) ou le trait distinctif d’un personnage ». Voir « Bleuâtre », dans Dictionnaire Flaubert, sous la direction de Gisèle Séginger, Champion, Paris (à paraitre). 32. Flaubert, Madame Bovary, op. cit., p. 175. 33. Flaubert, La Signora Bovary, trad. it. Diego Valeri, op. cit., p. 118. 34. Gustave Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Oreste Del Buono, op. cit., p. 76. 35. Gustave Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Maria Luisa Spaziani, op. cit., p. 103. 36. Gustave Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Sandra Teroni, op. cit., p. 114. 37. Mais tout aussi symptomatiques sont en ce sens les mots de l’aveugle qui passe en bas, sur le trottoir, et qui de sa voix rauque – voix “opaque”, “âpre” – chante : « Souvent la chaleur d’un beau jour / Fait rêver fillette à l’amour […] Il souffla bien fort ce jour-là / Et le jupon court s’envola » (Flaubert, Madame Bovary, op. cit., p. 472). 38. Flaubert, Madame Bovary, op. cit., p. 266. 39. Flaubert, La signora Bovary, trad. it. Diego Valeri, op. cit., p. 198-199. 40. Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Oreste Del Buono, op. cit., p. 133. 41. Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Maria Luisa Spaziani, op. cit., p. 180-181. 42. Flaubert, Madame Bovary, trad. it. Sandra Teroni, op. cit., p. 196-197. 43. Je renvoie ici à un très bel article de Francis Marmande, qui ajoute Madame Bovary aux lectures qui entrent en résonnance avec Le Bleu du ciel di Georges Bataille. Voir « Le vertige Flaubert, 14 | 2015
Traduire le « vertige de l’expansion » 12 essentiel », dans Jacqueline Risset (éd), Bataille. Il politico e il sacro, Liguori editore, Napoli, 1987, p. 21. 44. Proust, « À propos du style de Flaubert », op. cit, p. 284. 45. Ibid., p. 290. 46. Flaubert, La Signora Bovary, trad. it. Diego Valeri, op. cit., p. 14-15 ; c’est l’auteur qui souligne. 47. Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, Paris, 1999. 48. «Ainsi une traduction n’est-elle qu’un moment d’un texte en mouvement. Elle est même l’image qu’il n’est jamais fini». Ibid., p. 342. 49. Ibid., p. 174. 50. Métaphore que j’emprunte à Flaubert lui-même, qui dans la lettre à Louise Colet du 6 novembre 1853 écrivait : « Absorbons l’objectif et qu’il circule en nous, qu’il se reproduise au dehors, sans qu’on puisse rien comprendre à cette chimie merveilleuse. Notre cœur ne doit être bon qu’à sentir celui des autres. Soyons des miroirs grossissants de la vérité externe ». Dans Correspondance, op. cit., t. II, p. 463. 51. Proust, « À propos du style de Flaubert », op. cit., p. 290. 52. « J’ai fait cette semaine trois pages et qui, à défaut d’autre mérite, ont au moins de la rapidité. Il faut que ça marche, que ça coure, que ça fulgure […] », ainsi Flaubert à Louise Colet le 25 février 1854. Flaubert, Correspondance, op. cit., t. II, p. 525. RÉSUMÉS Au fil d’une approche comparée mettant en relation quatre traductions italiennes de Madame Bovary, cet article analyse, au travers des différents choix opérés par les traducteurs, le « vertige de l’expansion » qui traverse l’écran de la représentation verbale du roman en y inscrivant un degré de profondeur qui se déploie sur l’axe de la verticalité. Les passages choisis s’articulent autour du paradigme que convoque la couleur « bleue », présence chromatique qui enveloppe, avec toutes ses gradations, la vie d’Emma. En suivant les éditions italiennes et en regardant au plus près ces textes « seconds », on réalise que la traduction peut être « un moment d’un texte en mouvement » (Meschonnic), pratique d’une energeia fécondant l’écriture et le langage lui-même. With a comparative approach connecting four Italian translations of Madame Bovary, this article analyzes, through the translators’ various choices, the “expansion vertigo” that pervades the novel’s verbal representation by inscribing a depth that unfolds on the verticality axis. The selected passages are structured around a paradigm that evokes the color “blue”, a chromatic presence that in all its shades envelops Emma’s life. Looking at the Italian editions and studying more closely these “secondary” texts, we realize that a translation can be “a moment of a text in motion” (Meschonnic), an experience of an energeia fertilizing writing and even language. AUTEUR LAURA SANTONE Università Roma Tre Flaubert, 14 | 2015
Vous pouvez aussi lire