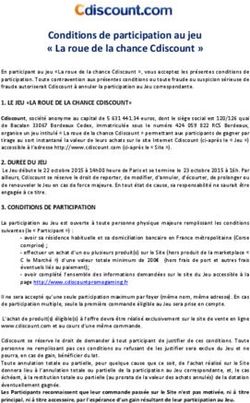Vaccination post-exposition - Pr Jean Beytout Fac de médecine - CHU de Clermont-Ferrand
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Situations rencontrées • Exposition individuelle à un risque infectieux que la vaccination permet d’éviter. • Exposition de l’entourage à une maladie contagieuse (interhumaine). • Utilisation de la vaccination dans un contexte épidémique installé ou menaçant.
Tétanos Rage
Blessure d’origine animale • Mr M..., 45 ans, à l’occasion de son parcours de jogging, est mordu au mollet par le chien d’un passant. La plaie est profonde et saigne. • Le propriétaire du chien n’est que de passage dans la région mais précise que son chien est régulièrement vacciné. Rassuré, Mr M... ne lui demande ni son nom ni son adresse. • Mr M... n’est – bien sûr – pas vacciné contre la rage, a été bien vacciné enfant mais son dernier rappel anti-tétanique remonte à plus de 20 ans.
Immunoprophylaxie du tétanos • 1) aucune • 2) simple injection d’une dose d’anatoxine tétanique (si possible associée à valence diphtérie, tétanos et coqueluche). • 3) double dose d’anatoxine (...) • 4) anatoxine + 250 U d’immunoglobulines spécifiques. • 5) anatoxine + 500 U d’immunoglobulines spécifiques.
Prévention du tétanos sur plaie
Antécédents Plaies à risque Plaies à risque
vaccinaux faible élevé
Vacc. complète Rien Rien
Der. inject.10 ans (250 U SC ou IM)
Vacc. incomplète. Rappel + sérum Rappel + sérum
(250 U SC ou IM) (500 U SC ou IM)
Vacc. absente ou Rappel + sérum Rappel + sérum
incertaine (1dose) (2 doses)Réponse • Plaie à haut risque tétanique, • Vaccination complète mais dernière injection ancienne... • Réponse 3 : un rappel antitétanique + 250U d’immunoglobulines antitétaniques.
Conduite à tenir pour la prévention
de la rage.
• 1) Rien. Pas de rage en France. Chien
vacciné.
• 2) Envoyer Mr M... au Centre antirabique,
• 3) Simple dose de vaccin antirabique,
• 4) Double dose de vaccin antirabique,
• 5) Vaccin antirabique + immunoglobulines
spécifiques.Conduite à tenir pour la prévention
de la rage. Réponses
• 1) Non. Ces 2 raisons ne sont pas
suffisantes. On ne peut avoir le moindre
doute.
• 2) Oui. Le centre antirabique est le seul
habilité à décider et à instaurer le
traitement.
• 3) Possible. Protocole Essen.
• 4) Préférable. Protocole Zagreb.
• 5) Non. On a le temps de se retourner.Méningococcie invasive
Infection invasive à méningocoque (IIM) Circonstances : méningite, purpura fulminans. • Critères de diagnostic: isolement et identification du méningocoque par culture à partir des hémocultures, du LCR, d’une biopsie d’une lésion cutanée, de la gorge ou par PCR (LCR, Sang, biopsie) • Identification du sérogroupe: B, C, W135, Y. • Génotypage pratiqué au centre de référence.
Infection invasive à méningocoque • Parmi les sérogroupes suivant: – A, – B, – C, – W135, – Y • lesquels sont le plus souvent en cause en France? Précisez les, par ordre de fréquence décroissante.
Réponse Dans l’ordre : 1. B (60% des cas), 2. C (30% des cas), 3. W135 (5 à 10%) 4. Y (1 à 5%) 5 et 6 A et X exceptionnels.
Infection invasive à méningocoque • La prévention des cas secondaires peut être assurée de manière immédiate par une antibioprophylaxie orale (ciprofloxacine ou rifampicine) des sujets contacts. • La pratique d’une vaccination a le même objectif et, en plus, celui de contribuer à limiter la diffusion d’une souche épidémique en assurant une immunité à long terme des sujets vaccinés.
Infection invasive à méningocoque • Parmi les méningocoques des sérogroupes suivants: – A, – B, – C, – W135, – X – Y Lesquels sont accessibles à un vaccin?
Réponse • A : plusieurs vaccins sont disponibles. • B : vaccins disponibles vis-à-vis de certaines souches. Nouveaux vaccins en préparation. • C: plusieurs vaccins disponibles. • W135: plusieurs vaccins. • X: pas de vaccin. • Y: plusieurs vaccins.
Vaccins méningococciques • Parmi les vaccins suivants 1. Vaccin A+C polysaccharidique 2. Vaccin A+C conjugué, 3. Vaccin C conjugué, 4. Vaccin B conjugué, 5. Vaccin ACW135Y polysaccharidique 6. Vaccin ACW135Y conjugué lesquels sont disponibles aujourd’hui en France? Dans quelles indications sont-ils conseillés?
Réponses 1. Vaccin A+C polysaccharidique : disponible, indications de plus en plus réduites. 2. Vaccin A+C conjugué: non disponible. 3. Vaccin C conjugué: disponible, indiqué dans les IIM à méningocoque C. 4. Vaccin ACW135Y polysaccharidique : disponible; réservé aux enfants de 2 à 11 ans. 5. Vaccin ACW135Y conjugué: 2 vaccins disponibles - Menvéo* AMM > 2 ans, - Nimenrix* AMM > 1an. Remarques: • l’indication des vaccins tétravalents conjugués vient d’être étendue aux enfants et nourrissons. • Un vaccin B est disponible vis-à-vis de certaines souches (normandes); des vaccins actifs sur une proportion élargie de souches est en préparation.
Vaccination méningococcique post-exposition
• Parmi les personnes suivantes de l’entourage d’un
jeune de 18 ans en internat atteint d’une IIM
lesquelles sont candidats à l’antibioprophylaxie +
vaccination ?
a) Parents vivant sous le même toit,
b) Camarades de classe,
c) Pensionnaires mangeant à la même table,
d) Pensionnaires partageant le même dortoir,
e) Personnes ayant été dans la même boîte de nuit,
f) Personnes qui ont voyagé dans le même wagon,
g) Personnel soignantVaccination entourage • Antibioprophylaxie + vaccination pour : a) Parents vivant sous le même toit, Oui b) Camarades de classe, Pas systématique c) Pensionnaires mangeant à la même table, Oui d) Pensionnaires partageant le même dortoir, Oui e) Personnes ayant été dans la même boîte de nuit, Pas systématique f) Personnes qui ont voyagé dans le même wagon, Pas systématique. g) Personnel soignant Pas systématique.
Définition des sujets contacts Existence d’un contact avec les sécrétions oropharyngées d’un sujet infecté Facteurs indispensables à la transmission: • La proximité: distance < 1m entre la personne infectée et une personne réceptrice. • La durée du contact: en dehors d’un contact bouche-à- bouche, la probabilité de transmission des sécrétions oropharyngées augmente avec la fréquence et la durée du contact. • L’irritation de la muqueuse du sujet infecté peut provoquer la toux et la projection des particules salivaires infectantes. Circulaire DGS du 23/10/06 / prophylaxie des infections invasives à méningocoque.
Personnes justifiant une prophylaxie
• Personnes vivant avec le malade, flirts, intimes, réunions
familiales, sports de contact.
• En crèche, halte-garderie: tous les enfants et le personnel.
• En centres de vacances: amis intimes et sujets ayant
partagé la chambre.
• En milieu scolaire:
– Avant l’école élémentaire: tous les enfants de la classe.
– A partir de l’école élémentaire: les voisins de classe
• Collectivités avec adultes:
– Personnes ayant eu un contact étroit et prolongé (ex: en boîte de
nuit, ne concerne pas l’ensemble des personnes ayant participé à la
soirée)
– Personnel impliqué dans les soins de proximité: bouche à bouche,
intubation, aspiration sans masque protecteur
– Personnes ayant pris le même moyen de transport (avion, bus, train)
> 8h : les occupants des sièges directement voisins.Vaccination méningocoque Dans quel délai précédant l’apparition des premiers signes de la méningococcie situez-vous les contacts justifiant antibioprophylaxie + vaccination? • A) Les 3 jours précédents, • B) La semaine qui précède, • C) Les 10 jours qui précèdent, • D) Le mois qui précède.
Vaccination autour d’un cas de méningococcie
Dès lors que le méningocoque est identifié comme
appartenant à un sérogroupe (A, C, Y ou W135)
contre lequel un vaccin existe, une vaccination
est recommandée le plus rapidement possible et
dans un délai maximum de 10 jours après le
début, en parallèle à la chimioprophylaxie.
Elle n’est proposée qu’aux sujets contacts qui se
retrouvent de façon régulière et/ou répétée dans
l’entourage proche du malade, c’est à dire sa
communauté de vie: la famille, les personnes
vivant sous le même toit, les amis, les voisins de
classe...
Remarque : il n’y a pas de contre-indication connue à la
vaccination, pas même la grossesse.
Circulaire DGS du 23/10/06 / prophylaxie des infections invasives à méningocoque.Coqueluche
Définition de cas • Infection due à une bactérie dont la toxine (pertussique) provoque une toux par quintes avec reprise en chant du coq caractéristique. Cette toux est intense, traumatisante, persistante (plusieurs semaines). • Détermine des complications et des formes graves (apnées, mort par asphyxie ou encéphalopathie) surtout chez le jeune nourrisson qui la cible privilégiée des mesures de prévention. • Le diagnostic doit être confirmé par détection de l’antigène de Bordetella par PCR sur prélèvement naso-pharyngé.
Prévention autour d’un cas De quels moyens disposons nous: • A) Isolement type « gouttelettes », • B) Antibioprophylaxie, • C) Immunoglobulines spécifiques anti- toxine pertussique, • D) Antisepsie rhino-pharyngée, • E) Vaccination anticoquelucheuse.
Prévention autour d’un cas • A) Isolement type « gouttelettes » : garder la chambre en période contagieuse; masque simple pour le patient, masque « canard » pour le personnel. • B) Antibioprophylaxie (par azithromycine), • C) Immunoglobulines spécifiques antitoxine : non! • D) Antisepsie rhino-pharyngée : non! • E) Vaccination anticoquelucheuse pour tous les sujets contacts dont la dernière injection de la valence coqueluche remonte à plus de 8 ans (5 ans?).
Coqueluche : prévention de sa
transmission
• La transmission de la coqueluche se fait d’un
malade qui tousse à une (des) personne(s) non
immunisée(s) de son entourage familial, ou de la
collectivité ou il vit (école, lieu de travail).
• Une enquête est à mener pour dépister cas
index et secondaires, effectuer les prélèvements
au moment opportun pour confirmer le
diagnostic. Elle permettra de traiter précocement
les nouveaux malades, et, par là, de réduire le
risque de transmission ainsi que de prendre les
autres mesures d’isolement et de prévention des
nouveaux cas.Vaccination autour d’un cas • Il n’est pas certain que la vaccination puisse enrayer l’installation d’une coqueluche mais il se pourrait que la contamination n’ait pas encore eu lieu... • Vacciner le plus tôt possible tous les sujets contacts n’ayant pas reçu d’injection du vaccin coquelucheux depuis moins de 5 ans, enfant, adolescent ou adulte... • Le vaccin dTPca (Repevax* ou Boostrix Tetra*) peut être pratiqué même à un sujet qui a reçu un vaccin dTPolio (Revaxis*) jusqu’à 1 mois auparavant.
Rapport relatif à la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche.
Conseil supérieur d’hygiène publique de France. 22/09/2006Rougeole
Contagiosité de la rougeole • La rougeole est une infection virale hautement contagieuse. Sa transmission se fait surtout par voie aérienne à partir des secrétions naso-pharnygées, et plus rarement par des objets contaminés. • La phase de contagiosité commence la veille de l’apparition des premiers symptômes, soit cinq jours avant le début de l’éruption, et s’étend jusqu’à au moins 5 jours après le début de l’éruption.
De quels moyens disposons-nous pour réduire la transmission de la rougeole? • A) Isolement aérien • B) Traitement antiviral • C) Immunoglobulines • D) Antibioprophylaxie • E) Vaccination
Moyens pour réduire la transmissibilité de la
rougeole.
• A) Isolement aérien : OUI, bien sûr ! La
transmissibilité de la rougeole est très élevée et
justifie un isolement strict + port de masque.
• B) Traitement antiviral : NON ! Indisponible.
• C) Immunoglobulines. OUI ! Efficace jusqu’à > 1
semaine avec un sujet contagieux. Réservé à
certaines indications.
• D) Antibioprophylaxie. NON! Mais un
antibiothérapie curative est souvent nécessaire au
moindre signe de surinfection.
• E) Vaccination. OUI ! Efficace, même 2 à 3 jours
après un contact avec un sujet en phase
contagieuse.Immunoprévention contre la rougeole après
exposition
• Sa place devrait désormais être limitée si...
– la couverture vaccinale des enfants reste aussi
élevée avec une dose et s’accroît avec 2 doses.
– le rattrapage recommandé chez les jeunes adultes
est bien pratiqué.
• Le risque de persistance de cas sporadiques
de rougeole et/ou d’épidémies dans certaines
régions est lié au refus de la vaccination dans
certains groupes opposants aux vaccinations
ou à des importations.Varicelle
Varicelle • Maladie virale éruptive caractérisée par des vésicules. • Très contagieuse et survenant habituellement tôt dans la vie. • Habituellement bénigne elle peut être à l’origine de complications respiratoires et constitue une menace pour les femmes enceintes et les immunodéprimés.
Caractéristique et utilisation du
vaccin contre la varicelle
• A) Vaccin vivant atténué,
• B) Nécessite 2 injections,
• C) Inutile pour plus de 50% des adultes de
plus de 25 ans,
• D) Applicable à la femme enceinte en fin
de grossesse,
• E) Efficace jusqu’à une semaine après le
contact présumé.Réponse • A) Vaccin vivant atténué: vrai! • B) Nécessite 2 injections : vrai! la vaccination complète des adultes et des adolescents comporte 2 doses. • C) Inutile pour plus de 50% des adultes de plus de 25 ans: vrai! • D) Applicable à la femme enceinte: non! Virus vivant et potentiellement tératogène. • E) Efficace jusqu’à une semaine après le contact présumé: faux! Seulement 3 jours!
Hépatite A
PRINCIPAUX MODES DE TRANSMISSION DE L’HEPATITE A
Situation clinique
• Marc, 4 ans, est fébrile depuis 5 jours,
jaune depuis 2 jours. Le diagnostic
d’hépatite A est confirmé par la détection
d’IgM anti-HA.
• Il est le dernier enfant d’une famille
nombreuse; vivent sous le même toit, 1
frère, 1 sœur, sa mère (enceinte), son
père, sa grand-mère.
• Marc fréquente l’école maternelle de son
quartier.Peut-on envisager de protéger son
entourage?
Quelle est la bonne réponse parmi les suivantes:
• 1) C’est trop tard! Les contacts ont déjà été
contaminés.
• 2) Injection IM d’immunoglobulines spécifiques.
• 3) Injection IV immunoglobulines polyvalentes.
• 4) Injection immédiate d’une dose de vaccin HA
• 5) Injection immédiate d’une double dose du
vaccin HA.Réponse • Réponse 1: il est possible que certains des contacts soient déjà contaminés, mais une immunoprévention reste possible par immunoglobulines ou vaccination. • Réponse 2: nous ne disposons pas d’immunoglobulines spécifiques. • Réponse 3: les immunoglobulines polyvalentes standard constituent une immunoprévention dont l’efficacité a été démontrée par la pratique. Mais, le titre des Ac dans les Ig standard diminue. • Mais (Réponse 4) l’injection d’une dose standard de vaccin s’est avérée d’efficacité comparable et de pratique plus aisée (Victor NEngJMed 2008). • Doubler la dose de vaccin (réponse 5) n’a aucun intérêt immédiat.
Qui vaccinez-vous en 1ère intention • A) Son frère âgé de 12 ans, • B) Sa sœur âgée de 1 an ½. • C) Sa mère 36 ans enceinte. • D) Son père (40 ans) qui a séjourné en Afrique lors de son service militaire. • E) Son grand-père 70 ans. Et à qui pratiquez vous une sérologie préalable?
Réponse • Le grand frère (A), la petite sœur (B) sont candidats à la vaccination. • La vaccination peut être pratiquée à la femme enceinte exposée (C) • Le père a déjà été exposé et a probablement été vacciné (D). • Le grand-père appartient à une génération où la grande majorité sont immunisés (E). Un contrôle sérologique peut être pratiqué aux 2 derniers.
Vaccination autour d’un cas La vaccination des personnes de l’entourage familial d’un patient atteint d’hépatite A (ou vivant sous le même toit que le cas) est recommandée. • A pratiquer le plus tôt possible et dans un délai maximum de 14 jours suivant l’apparition des signes cliniques du cas. • Pour les personnes –nées après 1945, –jamais vaccinées contre l’hépatite A, –sans antécédent connu d’hépatite A, –n’ayant pas séjourné dans un pays de forte endémicité, …vacciner sans examen sérologique préalable. • Dans les autres cas, un examen sérologique est justifié (s’il ne retarde pas trop la décision)…
Hépatite B
Hépatite B • Vacciner les personnes exposées par les différents modes de transmission – Sexuelle, – Sang (hémodialysés) – Transmission materno-fœtale. • Vaccination le plus tôt possible; éventuellement associée à l’injection d’immunoglobulines sur un autre site.
Indications à la vaccination post-exposition
Calendrier vaccinal 2010. BEH 2010; 14 – 15; 121-72Conclusion • La vaccination autour d’un cas est une pratique justifiée pour prévenir le développement d’une infection problématique par sa gravité et/ou sa contagiosité chez les sujets contacts d’un patient atteint d’une infection à transmission respiratoire, digestive ou sexuelle... • Le recours à cette pratique est liée à la connaissance du cas index, à l’estimation des personnes exposées dans le délai de contagiosité et à la rapidité de l’instauration de la vaccination. • Elle ne saurait remplacer une véritable prévention fondée sur l’application de la vaccination par anticipation.
Vous pouvez aussi lire