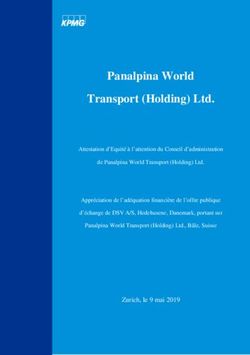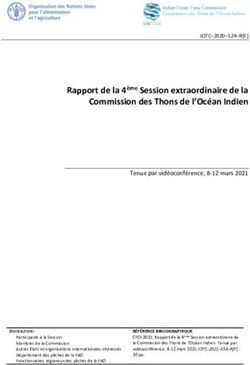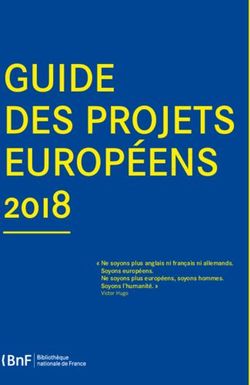VARIÉTÉS 5 Un cas d'école pour le droit international : le détournement d'un vol commercial par le Belarus et les réactions européennes - Tendance ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
VARIÉTÉS
5 Un cas d’école pour le droit international :
le détournement d’un vol commercial
par le Belarus et les réactions européennes
Arnaud de Nanteuil
professeur à l’université Paris Est Créteil
Résumé
Le détournement d’un vol commercial par le Belarus au mois de mai 2021 et les
sanctions adoptées par l’Union européenne en réaction soulèvent un certain nombre de
questions en droit international. Au-delà des discours politiques simplistes, il semble
important d’en proposer une analyse dépassionnée. Une approche détaillée de la question
montre que, si la situation n’est pas si simple qu’il y paraît, la contrariété du
détournement au droit international ne laisse guère place au doute si bien que les
sanctions européennes semblent juridiquement fondées. En conséquence, des pistes de
règlement pacifique du différend doivent être explorées, afin d’éviter que la situation,
déjà très tendue, ne dégénère à court ou moyen terme.
Summary
In May 2021, the forced landing of a commercial flight in Belarus led to the adoption
of several sanctions by the European Union. This situation raises several questions as a
matter of international law. This article thus addresses the main international legal issues
surrounding the situation. A detailed analysis shows that the matter is not as simple as it
may seem at first. However, the article demonstrates that it is highly likely that Belarus
has breached international law. Therefore, the EU sanctions can be considered to have
legal merit. As a consequence, the article analyses the possible means of pacific settlement
of the dispute, which are of core importance considering the high level of tension between
the parties.
J.D.I. - © LexisNexis SA - Juillet-Août-Septembre 2021918 VARIÉTÉS 1 – La géopolitique a ses raisons que la raison juridique ignore parfois. L’incident du vol 4978 de Ryanair survenu au mois de mai 2021 vient le rappeler utilement, en illustrant à quel point le droit international peut se trouver instrumentalisé et malmené, surtout dans le contexte d’une guerre froide renouvelée entre l’Union européenne et le Belarus, très largement soutenu par Moscou 1. Cet épisode est aussi une manière de rappeler le rôle fondamental en même temps que la raison d’être du droit international, dont bien des disciplines se trouvent convoquées ici : le droit aérien bien sûr, mais aussi la question des espaces, celle de la lutte contre le terrorisme et même le droit du recours à la force. Il ne paraît donc pas inutile de tenter de démêler ce qui est licite, ce qui ne l’est pas, et ce qui se situe quelque part entre les deux. Les faits sont relativement simples : le 23 mai 2021, le vol Ryanair 4978 parti d’Athènes (Grèce) à destination de Vilnius (Lituanie) était détourné par les autorités biélorusses alors qu’il survolait le territoire du Belarus. L’appareil, affrété par une filiale polonaise de la compagnie Ryanair (il était donc immatriculé en Pologne), fut escorté par un avion de chasse jusqu’à son atterrissage forcé à Minsk. Les passagers furent brièvement débarqués avant de pouvoir remonter à bord à l’exception notable de cinq d’entre eux : le journaliste biélorusse Roman Protassevitch et sa compagne, Sofia Sapéga, ainsi que trois membres des services secrets biélorusses chargés précisément de poursuivre et d’arrêter celui-ci 2. Roman Protassevitch est une figure reconnue de l’opposition au président Alexandre Loukachenko, dont l’autoritarisme est régulièrement souligné par des organismes internationaux indépendants et dont le régime est connu pour ne pas être particulièrement sensible à la question du respect des droits humains 3. Pour justifier ce détournement, le pouvoir biélorusse indiquait avoir reçu une alerte à la bombe de la part du Hamas qui aurait menacé de faire exploser l’appareil en réaction au soutien (prétendument) affiché par l’Union européenne à Israël dans le cadre d’une flambée de violence dans la bande de Gaza, sans qu’aucune preuve de cette menace ne soit apportée. Le 24 mai, l’Union européenne adoptait d’ailleurs un certain nombre de sanctions contre le Belarus, dont l’interdiction faite aux vols européens de survoler son territoire aérien et l’interdiction aux compagnies biélorusses de traverser l’espace aérien européen (et d’utiliser les aéroports), justifiant cette interdiction par l’acte de « piraterie » orchestré par Minsk. Cet incident s’inscrit dans le contexte plus large de relations largement détériorées entre l’Union européenne et la Russie, soutien inconditionnel du pouvoir biélorusse. Mais il est intéressant de voir qu’au-delà des enjeux 1. Sur les relations entre l’Union européenne et le Belarus, V. D. Ventura, Les atermoiements de la relation entre l’Union européenne et la Biélorussie en 2020 : AFDI 2020. – Nous emploierons ici le terme de « Belarus » qui correspond au nom officiel de l’État employé par les Nations Unies. La pratique française va plutôt dans le sens inverse toutefois, V. à cet égard les indications figurant sur le site Internet de l’ambassade de France à Minsk : https ://by.ambafrance.org/2-Toponymie-Belarus-ou-Bielorussie. 2. Le Monde, 24 mai 2021. – Sur le sort particulier de l’opposant R. Protassevitch, V. infra. 3. V. parmi d’autres, la résolution 46/20 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU (24 mars 2021), A/HRC/46/L.19, condamnant les violences consécutives aux élections présidentielles du mois d’août 2020 et appelant à l’organisation d’un scrutin libre. Revue trimestrielle © LexisNexis SA - J.D.I.
UN CAS D’ÉCOLE POUR LE DROIT INTERNATIONAL : LE DÉTOURNEMENT D’UN VOL
COMMERCIAL PAR LE BELARUS ET LES RÉACTIONS EUROPÉENNES 919
géopolitiques, le droit international est invoqué par chacune des parties (et de
leurs alliés) au soutien de leurs positions. Côté biélorusse, le pouvoir ne cesse de
marteler la conformité de son action aux « règles internationales » compte tenu
du risque de « terrorisme » dont il avait été avisé. Cette position est largement
avalisée par la Russie, qui ne manque jamais une occasion de dénoncer
« l’ingérence » des Européens dans la politique de son allié. Côté européen, c’est
l’acte de « piraterie » de Minsk qui est invoqué pour justifier un certain nombre
de sanctions, dans une logique semblant inspirée du droit des contre-mesures
bien connu du droit international de la responsabilité 4. Le droit international
est donc invoqué de part et d’autre mais pour justifier une position éminemment
politique dont les enjeux dépassent très largement le seul incident du 23 mai
2021. Au-delà du fait lui-même, ce sont donc en réalité un certain nombre de
questions plus structurelles qui se posent, à la fois sur la possibilité pour un État
de détourner et de forcer à l’atterrissage un vol commercial traversant son espace
aérien et sur les sanctions possibles en cas d’illicéité de cette dernière action.
Au-delà de l’escalade verbale, le droit international a son mot à dire mais la
situation est, sur le plan juridique, plus complexe et subtile que ce que le discours
politique manichéen semble suggérer. Or, au regard du niveau de tension
atteint, le droit international est sans aucun doute le premier des paramètres à
prendre en compte si l’on souhaite éviter que la situation ne dégénère. On se
posera donc la question de savoir si le détournement pouvait être justifié (I)
avant de voir quel fondement il serait possible de trouver aux réactions
européennes (II) et quelles perspectives existent en termes de règlement
pacifique de la situation (III).
À titre liminaire, on précisera que le présent propos se concentre sur la
question du détournement de l’appareil et non sur le traitement réservé à
l’opposant R. Protassevitch, qui est une question différente. S’agissant de ce
dernier, la contrariété au droit international pourrait être établie sur deux
fondements : d’une part, le sort réservé à R. Protassevitch en détention est
susceptible de constituer, sous réserve que les preuves en ce sens soient établies,
une violation de la prohibition des traitements inhumains ou dégradants prévue
par le droit international des droits de l’homme 5 ; d’autre part la simple
arrestation pour des motifs politiques est a priori contraire à l’obligation de
respecter le pluralisme des opinions et au principe suivant lequel « nul ne peut
être inquiété pour ses opinions » 6, surtout sous l’autorité d’un chef d’État élu au
terme d’un scrutin dont la régularité est plus que douteuse 7. Il semble donc que
4. La question est en réalité plus subtile et rend nécessaire la recherche du fondement juridique de ces mesures
en droit international, V. II.
5. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 7. – Le Pacte a été ratifié par le Belarus le
12 novembre 1973, il est entré en vigueur internationalement le 23 mars 1976.
6. Pacte, art. 19.
7. L’article 25 du Pacte dispose ainsi que « tout citoyen a le droit et la possibilité [...] de voter et d’être élu, au
cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression
libre de la volonté des électeurs ». – Sur l’irrégularité supposée des élections, V. parmi d’autres, Conseil des
droits de l’homme de l’ONU, 24 mars 2021, rés. 46/20 A/HRC/46/L.19. – Ainsi que la résolution
A/HCR/45/L.1 du Comité des droits de l’homme des Nations unies du 17 septembre 2020 par laquelle le
Comité « Regrette que le Gouvernement bélarussien n’ait pas rempli ses obligations en ce qui concerne le
J.D.I. - © LexisNexis SA - Juillet-Août-Septembre 2021920 VARIÉTÉS
la situation spécifique de R. Protassevitch soit susceptible de constituer par
elle-même une violation des obligations internationales du Belarus – mais il est
fort probable qu’il en aille de même du détournement de l’appareil à bord
duquel il se trouvait.
I. – LE DÉTOURNEMENT D’UN APPAREIL COMMERCIAL SANS RAISON VALABLE :
UN ACTE DE « PIRATERIE » ?
2 – Le terme de « piraterie » a rapidement été employé par les chancelleries
occidentales pour qualifier l’acte du gouvernement biélorusse et sans doute
n’est-ce nullement un hasard. Ce terme est en effet lourd de sens en droit
international puisqu’il constitue une infraction pénale reconnue (B). Son
emploi constitue donc assurément une réponse aux tentatives du Belarus de
justifier son action au regard des règles internationales relatives à la navigation
aérienne (A).
A. – La délicate justification du détournement au regard des règles de droit
aérien
3 – Le survol d’un territoire par un aéronef civil n’est pas une activité
entièrement libre. Par principe, le survol sans autorisation constitue ainsi une
violation de souveraineté territoriale de l’État survolé et donc un acte interna-
tionalement illicite 8. La convention de Chicago relative à l’aviation civile
internationale, instrument de référence en la matière à laquelle le Belarus est
partie, rappelle d’ailleurs à son article 6 qu’« [a]ucun service aérien régulier ne
pourra survoler ou desservir le territoire d’un État contractant s’il ne possède une
permission expresse ou une autre autorisation dudit État » 9. Il n’existe donc pas de
liberté de l’air comme il existe une liberté de la haute mer 10. Toutefois, il n’est
pas question de soutenir qu’une autorisation de survol aurait fait défaut dans le
cas du vol de Ryanair : il s’agissait en effet d’un vol régulier géré par une
compagnie européenne reconnue et, du reste, le Belarus n’a à aucun moment
invoqué une quelconque interdiction de survol de son territoire pour justifier
son geste. Les raisons invoquées par Minsk sont d’une toute autre nature et
relèvent d’une prétendue menace imminente pour la sûreté de l’appareil 11. Il est
établi que l’aéronef fut détourné alors qu’il s’apprêtait à entrer dans l’espace
aérien lituanien lorsque le président Loukachenko prit la décision de faire
droit de chaque citoyen de voter et d’être élu au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel
et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs, conformément, entre autres,
aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe b) de l’article 25 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques ».
8. CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/
États-Unis), fond : Rec. CIJ, p. 14, § 251.
9. Le texte de la convention est accessible notamment au JO 3 et 4 juin 1947, n° 130, p. 5091. – Ce principe
est jugé fondamental et constitue même la pierre angulaire du droit international aérien, V. V. Correia,
L’Union européenne et le droit international de l’aviation civile : Bruxelles, Bruylant, 2014, 976 p., p. 43.
10. O. Cachard, Le transport international aérien de passagers : La Haye, Publications de l’Académie de droit
international, 2015, 289 p., p. 28.
11. Le Monde, 26 mai 2021.
Revue trimestrielle © LexisNexis SA - J.D.I.UN CAS D’ÉCOLE POUR LE DROIT INTERNATIONAL : LE DÉTOURNEMENT D’UN VOL
COMMERCIAL PAR LE BELARUS ET LES RÉACTIONS EUROPÉENNES 921
décoller un avion de chasse pour le dérouter 12. Cette justification pose un
double problème du point de vue du droit international aérien 13. D’une part,
celui de sa crédibilité – mais qui renvoie à des considérations essentiellement
factuelles – (1°) et d’autre part, celui de la mesure dans laquelle cette
circonstance, même si elle était établie, pourrait avoir justifié la réaction du
Belarus (2°).
1° L’existence d’une menace : un point factuel à trancher
4 – On passera rapidement sur le premier point, qui est une question relevant
des faits, et donc de la preuve. Il serait malvenu de se livrer à des conjectures,
d’autant que le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI) réuni en urgence le 27 mai 2021 a annoncé l’ouverture d’une « enquête
factuelle » destinée à faire la lumière sur ces événements et déterminer si le
Belarus s’est ou non rendu coupable d’une violation du droit international. C’est
là une réaction directe à une demande formulée par les membres européens du
Conseil de sécurité des Nations Unies à ce qu’une enquête urgente soit
diligentée. Il n’y a pas eu de réunion formelle de celui-ci, probablement en raison
du fait que la situation ne présentait pas de caractère d’urgence absolue (la
plupart des passagers et l’appareil ayant été autorisés à quitter le Belarus) mais
peut-être aussi parce qu’un projet de résolution se serait sans doute heurté au
risque de veto russe, compte tenu du fait que la Russie (comme la Chine) s’est
par ailleurs opposée à la décision du Conseil de l’OACI d’ouvrir une enquête
internationale 14. Celle-ci doit porter essentiellement sur la justification avancée
par le Belarus et il ne fait pas de doute que le rôle de l’OACI sera absolument
central dans cette affaire 15. On pourrait penser que la conclusion sera simple :
soit la réalité de l’alerte à la bombe est établie et la réaction biélorusse est justifiée
au regard du droit international, soit le caractère fictif de la première est prouvé
et l’illicéité en découle automatiquement. En réalité, il faut sans doute être plus
nuancé.
2° L’absence de justification du détournement en droit international
5 – Pour les besoins de la cause, plusieurs hypothèses doivent être envisagées,
étant entendu qu’elles sont toutes tributaires du résultat de l’enquête factuelle.
Nous passerons donc en revue les différentes possibilités, dans le cas où l’enquête
parviendrait au constat d’un risque pour la sûreté ou la sécurité de l’appareil
pouvant justifier un détournement 16.
12. T. d’Istria, Le détournement d’un avion de ligne et l’arrestation de l’opposant Roman Protassevitch par la
Biélorussie suscitent une forte émotion : Le Monde, 24 mai 2021.
13. Pour une première analyse, coïncidant très largement avec les propos qui suivent, V. P. Dupont, Regards sur
le déroutement du vol Ryanair FR4978 par la Biélorussie : Dalloz actualité, 3 juin 2021.
14. H. Jouan, Avion détourné par la Biélorussie : l’OACI devrait remettre un premier rapport d’enquête d’ici
à la fin de juin : Le Monde, 28 mai 2021.
15. P. Dupont, Regards sur le déroutement du vol Ryanair FR4978 par la Biélorussie : Dalloz actualité, 3 juin
2021.
16. On distingue généralement en droit aérien la « sécurité », qui porte sur la prévention des accidents aériens
de la « sureté », qui porte sur la prévention et la répression des actes illicites commis contre les aéronefs ou les
J.D.I. - © LexisNexis SA - Juillet-Août-Septembre 2021922 VARIÉTÉS
En admettant d’abord que la réalité de l’alerte à la bombe soit établie, sans
doute la réaction biélorusse pourrait-elle être justifiée en droit international. Le
protocole de Montréal de 1984, auquel le Belarus a adhéré le 24 juillet 1984, est
ainsi venu modifier la convention de Chicago pour y ajouter un article 3 bis, aux
termes duquel : « Les États contractants reconnaissent que chaque État, dans
l’exercice de sa souveraineté, est en droit d’exiger l’atterrissage, à un aéroport désigné,
d’un aéronef civil qui, sans titre, survole son territoire ou s’il y a des motifs
raisonnables de conclure qu’il est utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la
présente Convention » 17. Or, un doute sérieux sur la présence d’une bombe à
bord d’un appareil constitue sans nul doute une circonstance incompatible avec
les buts de la convention dans la mesure où tout usage de la force à l’aide d’un
aéronef civil constitue en soi un acte internationalement illicite 18. Dès lors, la
position de Minsk pourrait se justifier de ce point de vue.
Mais à cette première justification, une seconde semble être venue s’ajouter et
jeter le trouble sur la cohérence de la position biélorusse. L’arrestation de
l’opposant Roman Protassevitch, qualifié à sa sortie de l’avion de « terroriste »,
tend certes à montrer que l’opération était cousue de fil blanc, mais révèle aussi
peut-être une volonté de renforcer juridiquement le motif de l’intervention. Le
pouvoir biélorusse semble en effet sous-entendre que le détournement aurait pu
être justifié par la nécessité d’appréhender un individu soupçonné de se livrer à
des activités terroristes. Même si cette justification n’a pas été ouvertement
avancée mais simplement suggérée, et en passant outre la très grande propension
des dictatures à qualifier de terroristes les opposants politiques, il y a là un point
qui pourrait être intéressant à relever. En admettant donc, arguendo, que
R. Protassovitch soit effectivement impliqué dans des activités terroristes, cela
permettrait-il de rendre l’opération licite au regard du droit international ? Rien
n’est moins sûr en réalité. Si, en effet, la lutte contre le terrorisme est
évidemment une cause légitime nécessitant la coopération de l’ensemble des
États, elle ne saurait justifier n’importe quelle réaction unilatérale. Ainsi la
stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU, adoptée par l’assemblée générale en
2006, insiste largement sur le devoir de coopération entre les États dans ce
contexte 19 : le préambule du texte insiste ainsi sur la nécessité de « réponses
globales, coordonnées et cohérentes aux niveaux national, régional et international »
et plusieurs de ses dispositions mentionnent l’impératif de coordination entre les
États 20. Le caractère unilatéral de la mesure en question ici semble donc fort peu
compatible avec ces exigences générales. Pour agir en pleine conformité avec le
aéroports, V. O. Cachard, Le transport international aérien de passagers : La Haye, Publications de
l’Académie de droit international, 2015, 289 p., p. 28.
17. Art. 3bis, 2°. – Le texte consolidé est disponible sur le site de l’OACI ss la cote 7300/9.
18. Même si la question a pu faire débat, il ne fait aucun doute que la nature civile d’un aéronef n’exclut pas
nécessairement qu’il puisse être employé comme une arme : les attentats du 11 septembre 2001 n’ont pas
posé de difficulté à cet égard quant à la qualification de l’utilisation des aéronefs comme agression armée au
sens de la Charte des Nations Unies, J.-J. Verhoeven, Les étirements de la légitime défense : AFDI 2002,
p. 49-80, spéc. p. 55.
19. AG ONU, rés. 60/288, 8 sept. 2006.
20. V. les pt II.3, II.4, II.5, II.13, II.16, II.17, III.1, III.4 du plan d’action annexé à la Résolution, insistant
sur l’importance et les modalités de la coopération internationale.
Revue trimestrielle © LexisNexis SA - J.D.I.UN CAS D’ÉCOLE POUR LE DROIT INTERNATIONAL : LE DÉTOURNEMENT D’UN VOL
COMMERCIAL PAR LE BELARUS ET LES RÉACTIONS EUROPÉENNES 923
droit international, le Belarus aurait en effet eu la possibilité de laisser l’avion
atterrir à Vilnius en demandant à la Lituanie d’appréhender l’individu à sa sortie
de l’appareil : les deux États sont en effet partie à une convention bilatérale sur
l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, entrée en vigueur le 11 juillet
1993 21. En ce sens, appréhender directement l’appareil peut clairement
apparaître comme étant une mesure disproportionnée, quand bien même son
objectif pourrait être légitime. Or, les exigences de nécessité et de proportion-
nalité sont clairement imposées par la convention de Chicago telle qu’amendée
en 1984 dans le cas où un État forcerait un aéronef étranger à atterrir sur son
territoire 22. Au demeurant, il est difficile d’admettre que, lorsqu’un État dispose
d’un choix entre plusieurs mesures pour atteindre le même but et décide de ne
pas recourir à celle qui est la moins attentatoire aux droits des autres États, ce
choix soit conforme au principe de proportionnalité. Dès lors, quand bien
même l’opposant Protassovitch pourrait être qualifié de terroriste (ce qui est plus
que douteux), cette seule circonstance ne permettrait pas de justifier la réaction
de Minsk.
On pourrait encore, à l’extrême limite, envisager le recours à la convention de
Tokyo adoptée dans le cadre de l’OACI en 1963 (et ratifiée par le Belarus le
3 mai 1988 avec formulation d’une réserve), qui prévoit la possibilité de mesures
exceptionnelles en cas d’infraction pénale commise à bord de l’appareil ou de
comportements de nature à mettre en danger sa sécurité 23. En pareil cas, si la
convention rappelle avant tout le principe de la compétence de l’État d’imma-
triculation – dans le prolongement des principes de la convention de Chicago –
elle prévoit également la possibilité pour l’État dont le territoire aérien est
survolé d’intervenir, ou pour le commandant de bord de solliciter un atterrissage
d’urgence. La convention s’applique précisément, suivant son article 1er, « (a)
aux infractions aux lois pénales ; (b) aux actes qui, constituant ou non des
infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l’aéronef ou de
personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord ».
En théorie, il pourrait donc être envisageable d’invoquer cette convention mais
les conditions pour cela, qui sont autant d’obstacles potentiels, sont nombreuses
et rendent cette perspective assez peu réaliste.
D’abord, il faut évidemment parvenir à démontrer que la situation à bord
relevait de l’une des situations décrites à l’article 1er. C’est là une question de fait
mais qui nécessitera une preuve claire sans laquelle la convention ne serait tout
simplement pas applicable et ne pourrait donc être invoquée comme fondement
juridique. Certains témoignages font ainsi état d’une bagarre qui aurait été
21. Cette information est tirée du site officiel du gouvernement biélorusse dont une page est spécifiquement
dédiée aux accords liant l’État : http://law.by/international-treaties/ [consulté le 28 mai 2021].
22. L’article 3 bis, 1 prévoit en effet que « Cette disposition ne saurait être interprétée comme modifiant de
quelque manière que ce soit les droits et obligations des États en vertu de la Charte des Nations Unies ». Or,
l’on sait que celle-ci impose en tout état de cause un usage proportionné de la force lorsque celui-ci est
autorisé. V. not. CIJ, avis, 8 juill. 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires : Rec. CIJ,
p. 226, § 41. – V. également P.-M. Dupuy et Y. Kerbrat, Droit international public : Dalloz, coll. Précis,
15e éd., 2020, p. 877.
23. Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, Tokyo, 14 sept.
1963 : RTNU, vol. 704, p. 219.
J.D.I. - © LexisNexis SA - Juillet-Août-Septembre 2021924 VARIÉTÉS
déclenchée à bord par les agents des services secrets biélorusses, ce qui pourrait
éventuellement justifier l’enclenchement des possibilités offertes par la conven-
tion de Tokyo. Encore faudrait-il pour cela que le degré de violence soit tel qu’il
ait été de nature à compromettre la sécurité à bord. Et si tel est le cas, le
détournement aurait dû être sollicité par l’appareil, ce qui a priori n’a pas été le
cas.
Ensuite, l’article 4 de la convention de Tokyo donne aux États qui ne sont pas
l’État d’immatriculation une compétence limitée et très encadrée. Il prévoit ainsi
que « Un État contractant qui n’est pas l’État d’immatriculation ne peut gêner
l’exploitation d’un aéronef en vol en vue d’exercer sa compétence pénale à l’égard
d’une infraction commise à bord » que dans certains cas particuliers. On voit déjà
qu’il ne s’agit que de pouvoir « exercer sa compétence pénale », qui n’implique pas
nécessairement le pouvoir de détourner l’appareil. En outre, les cas mentionnés
par l’article sont eux-mêmes étroitement circonscrits : l’État qui n’est pas l’État
d’immatriculation ne peut exercer sa compétence pénale que si l’infraction a
produit un effet sur son territoire, si elle a été commise par ou contre l’un de ses
ressortissants, si elle compromet sa sécurité, si elle constitue une violation du
droit aérien national ou si l’exercice de cette compétence est nécessaire à cet État
pour respecter ses obligations internationales. Pour autant qu’une infraction
pénale soit démontrée, il faudrait donc au surplus prouver qu’elle répond à l’une
de ces exigences. Or, rien en l’état des informations disponibles ne semble aller
dans ce sens.
Enfin, les pouvoirs donnés au commandant de bord sont eux-mêmes très
étroitement encadrés. Sans entrer ici dans le détail, on peut se contenter
d’indiquer que l’esprit général de ces dispositions est de donner au commandant
lui-même le pouvoir de solliciter un atterrissage d’urgence, dans des conditions
spécifiques 24. Cela pourrait se justifier en cas de bagarre à bord mettant en
danger la sécurité des passagers. Mais il est en l’occurrence établi qu’aucune
sollicitation de ce type n’a été formulée par le vol Ryanair 4978 : c’est la présence
d’un avion de chasse à proximité qui a contraint l’appareil à se dérouter. Sous
réserve donc de la preuve contraire, mais qu’il semble très difficile d’établir,
aucun des motifs de la convention de Tokyo ne devrait pouvoir être invoqué par
le Belarus dans cette affaire.
Dans ces conditions, on peine à voir comment le détournement de l’appareil
pourrait être justifié en droit international. Sauf à ce que l’aéronef n’ait pas
disposé d’autorisation de survol, aucune raison valable ne semble recevable. S’il
n’existe pas de droit de libre passage de principe, celui-ci devrait être considéré
comme acquis dès lors que l’autorisation est délivrée et que les conditions
prévues par celle-ci sont respectées. C’est probablement cela qui a conduit
24. La disposition pertinente est essentiellement l’article 8 (1) de la convention, qui dispose : « 1. Lorsque
le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a accompli ou est sur le point d’accomplir à
bord un acte visé à l’Article 1er, paragraphe 1 (b), il peut débarquer cette personne sur le territoire de tout
État où atterrit l’aéronef pour autant que cette mesure soit nécessaire aux fins visées à l’Article 6, paragraphe
1 (a) ou (b) ». Les fins mentionnées à l’article 6, paragraphe 1 sont les suivantes : « (a) pour garantir la
sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord ; (b) pour maintenir le bon ordre et la discipline à
bord ».
Revue trimestrielle © LexisNexis SA - J.D.I.UN CAS D’ÉCOLE POUR LE DROIT INTERNATIONAL : LE DÉTOURNEMENT D’UN VOL
COMMERCIAL PAR LE BELARUS ET LES RÉACTIONS EUROPÉENNES 925
l’Union européenne à riposter d’abord sur le plan du discours juridique avant de
réagir dans une perspective plus économique.
B. – Le détournement de l’appareil comme acte internationalement illicite
6 – Il semble bien que le détournement de l’appareil de Ryanair, faute de
trouver une justification valable, soit illicite au regard des règles internationales
applicables à la navigation aérienne. Mais la question peut se poser d’une
qualification autre, qui pourrait justifier des réactions particulières. La qualifi-
cation comme acte de piraterie, en ce qu’elle est une infraction pénale
internationale, pourrait ainsi permettre l’enclenchement de poursuites contre
des individus si elle était retenue (1°) alors que la qualification de recours à la
force prohibé pourrait justifier une saisine du Conseil de sécurité des Nations
Unies (2°). Si toutefois la première peut peut-être se justifier, la seconde semble
plus délicate.
1° Le détournement comme « acte de piraterie » ?
7 – Invoquer la « piraterie » pour qualifier la réaction biélorusse est sans aucun
doute pour les pays occidentaux une manière de renverser la situation en
s’affichant du bon côté du droit international. Face à l’insistance de Minsk à
affirmer la conformité de son action au droit international, l’Union européenne
a ainsi riposté en accusant le Belarus de s’être lui-même livré à un comportement
relevant d’une incrimination de droit pénal international : le 31 mai 2021, le
commissaire Th. Breton qualifiait ainsi l’incident de « piraterie d’État » 25. Ce
terme, évidemment, est tout sauf anodin du point de vue du droit international.
Or, précisément, sa pertinence en l’espèce n’est pas une absolue certitude : le fait
qu’il puisse s’agir d’un acte illicite au regard du droit international ne suffit pas
nécessairement à en faire un acte de piraterie.
La piraterie constitue historiquement la première des infractions pénales
reconnues par le droit international, dans le domaine de la navigation maritime,
et dispose même d’un fondement coutumier indiscutable 26. En matière
aérienne, il existe trois infractions liées à la piraterie, qui s’inscrivent globalement
dans le prolongement de ces règles anciennes 27. La première est une transposi-
tion pure et simple du droit de la mer et découle de la convention de Montego
Bay de 1982, qui définit la piraterie comme tout « acte illicite de violence ou de
détention ou toute déprédation [...] à des fins privées » 28. Cette définition semble
au fond peu adaptée au cas d’espèce car, si l’on admet que l’opération n’avait
d’autre but que de neutraliser un opposant politique, cette fin ne saurait être
assimilée à une « fin privée ». En outre, il ne semble pas qu’il y ait eu d’acte de
violence ou de déprédation mais tout au plus une détention temporaire de
l’appareil. Cette détention temporaire pourrait d’ailleurs être à rapprocher de la
25. Le Figaro, 1er juin 2021. Le terme avait été employé par de nombreux responsables politiques et jusqu’au
secrétaire général de l’OTAN.
26. P. Daillier, M. Forteau et A. Pellet, Droit international public : Paris, LGDJ, 8e éd., 2009, p. 780.
27. P. Daillier, M. Forteau et A. Pellet, Droit international public : Paris, LGDJ, 8e éd., 2009, p. 780.
28. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 déc. 1982 : RTNU, vol. 1834,
n° 31863, art. 100 à 107.
J.D.I. - © LexisNexis SA - Juillet-Août-Septembre 2021926 VARIÉTÉS
deuxième infraction : la capture illicite d’aéronef, introduite dans le droit
international par la convention de La Haye du 16 décembre 1970 29. Cette
dernière, toutefois, n’est applicable qu’à la capture réalisée par une personne « à
bord d’un aéronef en vol », à l’exclusion des détournements réalisés par d’autres
aéronefs 30. Cette convention n’est donc pas applicable à la présente affaire. Mais
il existe une troisième infraction, prévue par la Convention de Montréal du
23 septembre 1971 relative à la répression des actes illicites dirigés contre la
sécurité de l’aviation civile. Toutefois, cette convention ne porte que sur les actes
conduisant à détruire ou à endommager un appareil ou des infrastructures de
transport, ce qui ne correspond pas davantage à la situation d’espèce. Peut-être
cependant pourrait-on envisager une référence à l’article 1, e qui incrimine la
communication, en connaissance de cause, de fausses informations 31. Or, cette
hypothèse a été précisément pensée pour sanctionner une « fausse alerte à la
bombe », à l’instar de ce qui semble s’être produit dans cette affaire 32. S’il était
établi que le détournement de l’appareil à la suite de la communication de cette
information erronée a « compromis la sécurité » de l’appareil, l’infraction pourrait
se trouver caractérisée. La référence au terme générique de « piraterie » n’est
donc pas forcément à exclure, même si l’absence d’atteinte à l’intégrité de
l’appareil et de ses passagers pourrait conduire à l’écarter.
2° Le détournement comme recours à la force prohibé par l’article 2, § 4
de la Charte de l’ONU ?
8 – La question qui demeure toutefois, au regard de ce qui précède, est celle de
la qualification juridique exacte du détournement. Si cet acte ne peut être justifié
en droit international mais ne constitue pas pour autant nécessairement un acte
de piraterie, son illicéité demeure incertaine. Sans doute pourrait-on cependant
régler la question en référence au protocole de Montréal de 1984 venu modifier
la convention de Chicago. Le texte de l’article 3 bis introduit à cette occasion
indique ainsi que « chaque État doit s’abstenir de recourir à l’emploi des armes
contre les aéronefs civils en vol ». De manière générale d’ailleurs l’objectif de cet
amendement est clairement de prohiber tout usage de la force contre les aéronefs
civils : il fut en effet adopté à la suite de la destruction d’un avion de ligne coréen
par l’Union soviétique en 1983. Même si a priori l’usage de la force contre un
aéronef était déjà prohibé par le droit international, le protocole est venu préciser
la teneur de cette interdiction 33. On constatera toutefois un certain décalage
entre les termes de l’article 3bis et le droit international général. Ainsi l’article 2,
29. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, La Haye, 16 déc. 1970 : RTNU 1973,
n° 12325.
30. G. Guillaume, La convention de la Haye du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite
d’aéronefs : AFDI 1970, p. 35-61, p. 41.
31. « Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, [...] e)
communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en
vol ».
32. R.-H. Mankiewicz, La convention de Montréal (1971) pour la répression d’actes illicites dirigés contre la
sécurité de l’aviation civile : AFDI 1971, p. 855-875, spéc. p. 860.
33. J.-C. Piris, L’interdiction du recours à la force contre les aéronefs civils : l’amendement de 1984 à la
convention de Chicago : AFDI 1984, p. 711-732, not. p. 715.
Revue trimestrielle © LexisNexis SA - J.D.I.UN CAS D’ÉCOLE POUR LE DROIT INTERNATIONAL : LE DÉTOURNEMENT D’UN VOL
COMMERCIAL PAR LE BELARUS ET LES RÉACTIONS EUROPÉENNES 927
§ 4 de la Charte des Nations Unies prohibe le « recours à la force » là où le
protocole interdit « l’emploi des armes ». La substitution des termes n’est
évidemment pas due au hasard, et aurait pu laisser craindre que certains emplois
de la force non armée ne tombent pas sous le coup de l’interdiction fixée par
l’article 3bis. Toutefois, ce dernier vient préciser que « Cette disposition ne saurait
être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les droits et
obligations des États en vertu de la Charte des Nations Unies », ce qui doit être
compris comme une manière d’harmoniser les deux prohibitions 34. En un mot
donc, ce qui est prohibé au titre de l’article 2, § 4 de la Charte l’est également
contre les aéronefs civils en vertu de l’article 3bis de la convention de Chicago. Il
n’est toutefois pas certain que cela clarifie grandement les choses au regard de
l’ampleur des débats ayant entouré (et entourant toujours) la définition du
recours à la force prohibé par le droit international 35.
Appliqué au cas d’espèce, l’ambiguïté du concept de recours à la force prohibé
se retrouve pleinement. Il est clair qu’il y a eu contrainte, par un appareil
militaire : deux éléments qui pourraient rapprocher l’action d’un usage de la
force interdit. Il semble en effet que la prohibition de l’article 2, § 4 vise
uniquement la contrainte militaire, comme c’était le cas ici, et non celle qui est
réalisée par d’autres moyens 36. Mais dans le même temps une violation de
l’article 2, § 4 suppose un certain degré de coercition et tout acte, même
impliquant des appareils militaires, ne saurait être ainsi qualifié 37. Si par le
passé, lorsqu’une situation d’interception d’un aéronef civil s’est présentée,
certains États ont semblé considérer qu’il s’agissait d’un recours à la force
prohibé, le Conseil de sécurité n’est jamais parvenu à rassembler les vues de ses
membres permanents sur ce point pour parvenir à une position claire 38. En
l’occurrence, l’absence de victime, le fait que l’appareil ait été autorisé à
redécoller au bout de quelques heures et l’absence de dommage matériel sensible
(sans tenir compte ici de la situation de l’opposant appréhendé, qui est une
question différente) peut donc conduire à penser qu’il ne s’agit pas d’une
rupture de l’article 2, § 4 de la Charte. Au demeurant, il n’y a pas eu en l’espèce
d’usage de la force mais tout au plus une menace de celui-ci, à travers la présence
d’un avion militaire. Or, l’on sait que la menace est prohibée par principe au
même titre que l’usage mais qu’elle ne l’est que lorsqu’il est établi qu’elle est
réelle et imminente 39. En l’espèce, il ne semble pas que le Belarus ait eu la
moindre intention de détruire l’appareil : aucune menace n’a été proférée en ce
sens, un seul avion de chasse est intervenu, et une telle destruction aurait
constitué pratiquement une déclaration de guerre à l’Europe occidentale à
34. J.-C. Piris, L’interdiction du recours à la force contre les aéronefs civils : l’amendement de 1984 à la
convention de Chicago : AFDI 1984, p. 721-722.
35. V. en règle générale sur cette question, O. Corten, Le droit contre la guerre : Paris, Pedone, 3e éd., 2020,
904 p.
36. J. Combacau et S. Sur, Droit international public : LGDJ-Lextenso, 13e éd., 2020, p. 671.
37. O. Corten, Le droit contre la guerre : Paris, Pedone, 3e éd., 2020, p. 127 et s.
38. V. Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 1985-1988, chap. XI, p. 430.
39. CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/
États-Unis), fond : Rec. CIJ, p. 14. – V. également, O. Corten, Le droit contre la guerre : Paris, Pedone,
3e éd., 2020, p. 184 et s.
J.D.I. - © LexisNexis SA - Juillet-Août-Septembre 2021928 VARIÉTÉS
laquelle le Belarus n’a aucun intérêt. Par hypothèse, une destruction de l’aéronef
aurait sans aucun doute constitué un usage de la force prohibé 40 mais, a
contrario, le simple détournement suivi d’une libération rapide ne relève
probablement pas de cette qualification. Qu’il y ait eu contrainte est un fait,
qu’il y ait eu usage de la force prohibé par la Charte des Nations Unies est donc
beaucoup plus douteux.
En conclusion, il est sans doute possible de considérer que le détournement de
l’aéronef n’était pas justifié en droit international et constitue une violation des
règles de droit aérien fixées par la convention de Chicago. Peut-être peut-on aller
jusqu’à le qualifier de piraterie, ou en tout cas d’interférence illicite dans
l’aviation civile internationale – dans les deux cas il peut s’agir d’une infraction
pénale internationale. En revanche, le seuil requis pour constituer une menace
ou un emploi de la force prohibé ne semble pas franchi. Il n’empêche que
l’illicéité internationale de l’intervention biélorusse semble acquise, ce qui est
particulièrement important pour comprendre comment la réaction européenne
s’intègre elle-même dans le giron de la légalité internationale.
II. – LES SANCTIONS EUROPÉENNES : FONDEMENTS ET JUSTIFICATIONS
9 – Les sanctions adoptées par l’Union européenne s’inscrivent dans une
politique globale d’adoption de sanctions par Bruxelles depuis quelques années
(A), ce qui n’empêche pas de rechercher le fondement précis des mesures ici
adoptées contre le Belarus (B).
A. – Le cadre général des sanctions adoptées par l’Union européenne
10 – Dès le 24 mai 2021, le Conseil européen saisissait le Conseil de l’Union
de la question afin qu’il adopte des mesures précises de sanction, en particulier
l’interdiction de traverser l’espace aérien européen par les compagnies biélo-
russes (ainsi que l’interdiction d’utiliser les aéroports européens) et déconseillait
fortement aux compagnies européennes de traverser l’espace aérien du Bela-
rus 41. Les compagnies aériennes européennes ont donc été contraintes de revoir
en urgence leurs plans de vols pour les (nombreuses) liaisons entre l’Europe
occidentale et la Russie ou certains pays d’Asie. Les principales victimes
demeurent toutefois les compagnies aériennes biélorusses, privées d’une grande
partie de leurs destinations européennes et dont les déplacements sont singuliè-
rement compliqués – la conséquence principale en étant probablement une
diminution de leur activité et donc de leurs recettes, réduisant d’autant les
recettes fiscales de l’État. Ces sanctions sont une réaction immédiate à
l’événement du 23 mai 2021 mais elles s’inscrivent dans le contexte d’un arsenal
bien plus vaste : Minsk se trouve sous le coup de sanctions européennes depuis
plusieurs années et plus encore depuis les élections présidentielles d’août 2020
dont le résultat n’est pas jugé sincère et qui furent suivies de violences orchestrées
40. J. Dutheil de La Rochère, L’affaire de l’accident du Boeing 747 de Korean Airlines : AFDI 1983,
p. 479-772, p. 757 et s.
41. Concl. de la réunion extraordinaire du Conseil européen des 24 et 25 mai 2021, 25 mai 2021 :
EUCO/5-21, p. 2-3.
Revue trimestrielle © LexisNexis SA - J.D.I.UN CAS D’ÉCOLE POUR LE DROIT INTERNATIONAL : LE DÉTOURNEMENT D’UN VOL
COMMERCIAL PAR LE BELARUS ET LES RÉACTIONS EUROPÉENNES 929
par le régime dans les mois qui ont suivi le scrutin 42. Ces sanctions sont
elles-mêmes fondées sur une décision de 2012 établissant le cadre général des
sanctions à l’égard du Belarus, au regard des nombreuses violations du droit
international (notamment en matière de droits de l’homme) dont il s’est rendu
coupable 43.
Au-delà du cas particulier du Belarus, l’Union européenne a adopté d’assez
longue date un certain nombre de sanctions contre plusieurs États ou individus.
S’agissant de politique étrangère, l’institution principalement compétente est en
bonne logique le Conseil de l’Union, qui a adopté en 2004 des « principes de
base » concernant le recours aux sanctions 44. Le premier de ces principes affirme
clairement que la politique de sanctions doit avoir pour but de « maintenir et de
rétablir la paix et la sécurité internationales conformément aux principes de la charte
des [Nations Unies] », les États membres rappelant leur préoccupation de
« remplir les obligations qui [leur] incombent en vertu de la charte » de l’ONU. La
volonté européenne est donc, sans le moindre doute, de s’intégrer à la légalité
internationale. Du reste, la question de la licéité des sanctions européennes se
pose depuis assez longtemps, aussi bien au regard du droit international
économique que du droit international général 45.
Globalement, il semble que le fondement juridique des réactions de l’Union
européenne à l’égard d’un État puisse être triple en droit international : soit il
s’agit de mettre en œuvre une décision du Conseil de sécurité ; soit il s’agit de
mesures inamicales mais non illégales, dans une logique de rétorsion ; soit encore
il s’agit de mesures intrinsèquement illicites mais adoptées en tant que
contre-mesures, ce qui permet d’en exclure l’illicéité 46. Il est possible d’écarter
d’emblée la première hypothèse puisque le Conseil de sécurité ne s’est pas réuni
au sujet de l’incident et qu’en tout état de cause, toute velléité de sanction au sein
de cette enceinte risquerait de se heurter au veto de la fédération de Russie. Les
42. Trois séries de sanctions ont été adoptées à la suite de ces événements : Conseil, 2 oct. 2020, Décision
d’exécution (PESC) 2020/1388 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures
restrictives à l’encontre de la Biélorussie : JOUE n° L 319, 2 oct. 2020, p. 1. – Conseil, 6 nov. 2020,
Décision d’exécution (PESC) 2020/1650 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des
mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie : JOUE n° LI 370, 6 nov. 2020, p. 9. – Conseil, 17 déc.
2020, Décision d’exécution (PESC) 2020/2130 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant
des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie : JOUE n° LI 426, 17 déc. 2020, p. 14. – V.
également, D. Ventura, Les atermoiements de la relation entre l’Union européenne et la Biélorussie en
2020 : AFDI 2020.
43. Conseil, 15 oct. 2012, Décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la
Biélorussie : JOUE n° L 285, 17 oct. 2012.
44. Doc. 10198/1/04, 7 juin 2004.
45. V. M. Kamto, Les communautés européennes et les sanctions internationales : Rev. québécoise de droit
international, vol. 8-2, 1993, p. 265-288, spéc. p. 280 et s. – Certains développements relatifs à la base
juridique en droit communautaire sont en partie dépassés (mais en partie seulement, les bases de la politique
étrangère européenne ayant été fixées par le traité de Maastricht en 1992) mais les analyses en droit
international demeurent pertinentes. Pour une approche plus récente, V. M. Kamto, Europe intégrée et
sanctions internationales : des Communautés européennes à l’Union européenne : African Journal of
International and Comparative Law, vol. 7-3, 1995, p. 557.
46. A. Pellet, Les sanctions de l’Union européenne, in M. Benlolo-Carabot, U. Candas, E. Cujo, Union
européenne et droit international, Mél. en l’honneur de Patrick Daillier : Paris, Pedone, 2012,
p. 431-455, p. 436.
J.D.I. - © LexisNexis SA - Juillet-Août-Septembre 2021Vous pouvez aussi lire