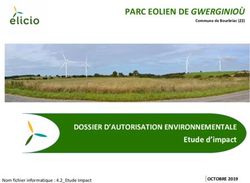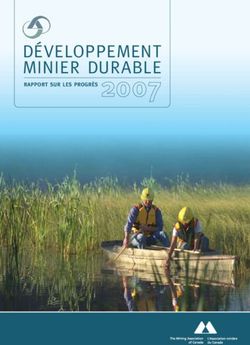Voyage d'étude - Madagascar - MS Management du Développement Durable
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Voyage d’étude – Madagascar MS Management du Développement Durable Ce document présente le voyage d’étude à Madagascar réalisé par la promotion 2008 du Mastère Spécialisé en Management du Développement Durable. Il a été rédigé par l’ensemble des étudiants. HEC – Mastères Spécialisés 1 rue de la Libération 78351 Jouy en Josas cedex
Remerciements
L’ensemble des étudiants du Mastère en Management du Développement Durable de
HEC, promotion 2008, tient à remercier chaleureusement les personnes suivantes :
Nos sponsors
La SNCF, qui au travers de Monsieur Olivier Menuet, Directeur Délégué Achats Durables
et solidaires et intervenant à HEC, nous a apporté un soutien financier indispensable
pour la réalisation de la totalité de notre programme.
Maître Yvon Martinet, dont le cabinet d’avocats a accepté d’apporter une contribution
significative au financement de notre voyage.
TAC Financial, qui a travers Monsieur Thierry Apotheker, Managing Director et
intervenant à HEC, a bien voulu contribuer financièrement à la réalisation de notre
projet.
Les personnes qui nous ont apporté une aide précieuse dans l’organisation du
voyage
Monsieur Solofo Rashoarahona, CEDS‐France, sans les conseils et contacts duquel
l’organisation du voyage aurait été impossible.
Mademoiselle Emilie Pleuvret, GRET, qui a pris sur son temps personnel pour nous
aiguiller dans la sélection des projets à visiter ainsi que sur les aspects logistiques du
voyage.
Le Professeur Pascal Chaigneau, CEDS‐Paris, qui nous a soutenu dans notre projet de
voyage à Madagascar et nous a mis en relation avec Monsieur Solofo Rashoarahona.
Monsieur Rivo Ratsiharovala, dont l’aide logistique a permis la visite du projet IDEES
dans la région de Fianaransoa.
2 VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR Les intervenants rencontrés sur place
Philippe Jarry et Fifi, CARE
Roderick, REEF DOCTORS
Mark Freudenberger, ERI
Le Père Pedro
Denis Castain, AFD‐Madagascar
Qu’ils trouvent ici l’expression de notre sincère reconnaissance et soient assurés que
l’aide, les conseils et les enseignements qu’ils nous ont apportés ont, chacun de leur
façon, contribué à faire de notre voyage une expérience inoubliable et enrichissante qui
a renforcé la vocation des étudiants dans la voie du développement durable.
VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR 3Sommaire Remerciements.................................................................................................................. 2 Introduction....................................................................................................................... 5 Déroulement du voyage..................................................................................................... 7 Jour 2 : présentation de la société QMM ............................................................................ 9 Jour 3 : randonnée à Lokaro ............................................................................................. 14 Jours 2 et 3’ : les projets de CARE à Ranomafana.............................................................. 16 Jour 4 et 5 : Ifaty .............................................................................................................. 22 Jour 7 : balade dans l’Isalo ............................................................................................... 26 Jour 8 : transfert entre Ranohira et Fianarantsoa ............................................................. 30 Jour 9 : dons de matériels scolaires et visite de projet d’adduction d’eau......................... 35 Jour 9’ : visite du projet ERI.............................................................................................. 38 Jour 9’’et 13 : le programme Nutrimad............................................................................. 48 Jour 11 : rencontre avec le père Pedro ............................................................................. 52 Jour 11 : présentation du GRET ........................................................................................ 55 Jour 12 : petit déjeuner avec le Jeune Patronat Malgache (JPM) ...................................... 58 Jour 12 : visite de PlaNet Finance ..................................................................................... 61 Jour 12 : visite de la ferronnerie de Dieudonné ................................................................ 63 Jour 12 : conférence débat dans les studios de RTA.......................................................... 65 Conclusion ....................................................................................................................... 70 Annexe 1 : articles du journal malgache L’Express sur le débat à RTA ............................... 71 Annexe 2 : témoignages personnels ................................................................................. 73 4 VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR
Introduction
Le voyage d’étude est un des moments forts de la scolarité des étudiants des Mastères
Spécialisés d’HEC : il permet de confronter les enseignements théoriques reçus au cours
de l’année à une expérience pratique sur le terrain. D’autre part, il participe d’une
certaine façon à la pérennisation du réseau formé par la promotion en plongeant les
étudiants dans un contexte propice à l’élaboration de liens interpersonnels forts. Il a été
financé en grande partie par un pot commun alimenté par les revenus des missions en
entreprise effectuées par les étudiants, mais aussi par les dons des entreprises
partenaires.
Le choix de la destination de ce voyage, Madagascar, n’est pas anodin pour des étudiants
du Mastère Spécialisé en management du développement durable. En effet, de par sa
géographie et son histoire, ce pays en voie de développement cristallise un grand
nombre de problématiques abordées cette année :
Assurer un développement économique qui profite à tous : le PNUD situe
Madagascar au 143ème rang du classement basé sur son indice de développement
humain et les inégalités sociales au sein de la population malgache sont très
marquées ;
Concilier économie et préservation de l’environnement : Madagascar possède un
environnement exceptionnel, sa biodiversité et ses ressources naturelles non
renouvelables constituent un potentiel économique riche, mais elles sont
actuellement menacées par les activités humaines.
Ces défis de développement commencent à être relevés par la population locale, les
entreprises, le gouvernement, les ONGs et les institutions internationales qui tentent de
travailler de concert sur beaucoup de projets. Ce voyage est l’occasion pour nous, futurs
acteurs du développement durable, d’approcher des initiatives novatrices et constitue
ainsi une expérience indéniablement formatrice.
Ce document a pour but de rapporter les faits marquants du voyage : visites de projets,
excursions, rencontres, etc. Il a été rédigé par l’ensemble des étudiants de la promotion
et son contenu suit la chronologie du circuit.
VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR 5Déroulement du voyage
La Figure 1 présente les déplacements effectués jour après jour à Madagascar. Plus en
détails, le circuit s’est déroulé ainsi :
Jour 1 : départ de l’aéroport Paris Charles de Gaulle à 10h30. Nous sommes arrivés à
Antananarivo (Tananarive) aux alentours de 22h, accueillis par l’agence de voyage
puis transférés en bus jusqu’à l’hôtel.
Jour 2 : de nouveau transfert en bus jusqu’à l’aéroport d’Antananarivo (Tananarive)
afin de prendre un vol intérieur vers Taolagnaro (Fort Dauphin). Sur place, le groupe
s’est séparé en deux : 21 personnes sont restées sur place et 11 personnes sont
parties en 4x4 au village de Ranomafana, à 85 kms au nord de Taolagnaro (Fort
Dauphin). Le premier groupe a assisté le soir à une présentation des projets de la
société d’extraction minière QMM dans leurs locaux de Taolagnaro (Fort Dauphin).
Le deuxième groupe, après 5 à 6 h de trajet, a passé la nuit dans une auberge de
brousse de Ranomafana.
Jour 3 : pour le premier groupe, cette journée a été l’occasion d’effectuer une
excursion jusqu’à la baie de Lokaro.
Jour 3’ : pour le deuxième groupe, visite des différents chantiers soutenus par l’ONG
CARE dans les environs de Ranomafana. Retour en fin d’après‐midi à Taolagnaro
(Fort Dauphin).
Jour 4 : transfert vers l’aéroport de Taolagnaro (Fort Dauphin) pour prendre un vol
intérieur vers Toleara (Tulear). Sur place, visite du centre de la ville puis transfert en
bus jusqu’à Ifaty, un village de pêcheurs situé à environ 60 kms au nord‐ouest de
Toleara (Tulear). Le soir, à l’hôtel, nous avons suivi l’intervention de l’ONG Reef
Doctors.
Jour 5 : le matin, nous avons profité des activités proposées par l’hôtel afin de
découvrir le lagon et la barrière de corail : baptêmes de plongée, sorties en pirogue,
etc. L’après‐midi, certains en ont profité pour jouer au football avec la population
locale, d’autres pour visiter les forêts de baobabs aux alentours.
Jour 6 : transfert vers le village de Rahonira en récupérant la fameuse RN7 à partir
de Toleara (Tulear). Après environ 200 kms de route, nous sommes arrivés à
destination en faisant une halte au centre d’interprétation du massif d’Isalo.
VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR 7 Jour 7 : journée randonnée dans le massif de l’Isalo.
Jour 8 : transfert vers Fianarantsoa en passant par le village d’Ambalavao. Visite de
l’atelier de fabrication de papier Antemoro ainsi que du vignoble.
Jour 9 : séparation en trois groupes :
- le premier groupe est parti suivre l’avancement des projets d’adduction
d’eau potable de l’association IDEES ;
- le deuxième est allé rencontrer Mark Freundenberger du projet ERI puis
s’est rendu sur le terrain voir les actions menées dans le cadre de ce
projet ;
- enfin le troisième a visité un restaurant pour bébés et divers points
d’intervention du programme Nutrimad à Fianarantsoa.
Jour 10 : transfert vers Antananarivo (Tananarive) en passant par Ambositra, dont
nous avons visité le centre artistique, et par Antsirabe.
Jour 11 : visite du village du Père Pedro et après‐midi libre. Le soir à l’hôtel,
intervention de Mathieu Le Corre, chargé de mission au GRET au sein de la section
consacrée à l’accès aux services essentiels.
Jour 12 : conférence de l’association des jeunes entrepreneurs malgaches à l’hôtel
pendant le petit déjeuner. Ensuite, nous avons pu visiter les locaux de Planet
Finance, assister à la présentation de leurs projets à Madagascar et visiter une
manufacture soutenue par leurs actions de micro finance. L’après‐midi, trois
étudiants de la promotion ont participé à un débat sur les enjeux du développement
durable à Madagascar enregistré dans les studios de la télévision RTA (chaine
privée) et organisé notamment par le CEDS. Le reste des étudiants a assisté au débat
en tant que spectateurs.
Jour 13 : le matin, visite des locaux du GRET et présentation du programme
Nutrimad. Ensuite, nous avons pu visiter le marché de la digue, consacré à l’artisanat
malgache.
Jour 14 : décollage à 00h50 de l’aéroport d’Antananarivo (Tananarive) et arrivée à
Paris Charles de Gaulle à environ 11h.
8 VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCARJour 2 : présentation de la société QMM
A Taolagnaro (Fort Dauphin), le samedi 3 mai 2008.
C’est en fin d’après‐midi que nous est présentée la société QIT Madagascar Minerals
(QMM) par son responsable de la communication et son responsable du développement
durable. La société, détenue à 80% par le groupe québécois Rio Tinto1 et à 20% par
l’Etat malgache, a pour mission d’extraire du sable minéralisé contenant de l’ilménite et
de petites quantités de zircon. Le bioxyde de titane extrait de l’ilménite permet la
fabrication de pigments blancs. Ce matériau se retrouve dans des produits tels que la
peinture, le plastique, le textile, le papier, les cosmétiques et l’alimentation.
Ce projet d’exploitation
minière est stratégique
pour l’Etat malgache.
En effet, il se situe dans
une zone très enclavée
et éloignée des centres
d’activité du pays et,
étant donné les
investissements en jeu,
son impact sera
considérable sur la
région, aussi bien au Figure 2 : le projet QMM
niveau économique que
social et environnemental. Fort Dauphin est une petite ville d’environ 40 000 habitants.
Alors que la mine n’est pas encore en exploitation, ce projet a déjà provoqué
d’importants bouleversements avec l’arrivée massive d’étrangers venus travailler sur le
projet, et l’afflux de populations, alléchées par les nombreuses perspectives d’emplois.
1 Rio Tinto est un des leaders mondiaux dans le domaine de l’exploration, de l’exploitation et de la
valorisation des ressources minérales de la terre telles que les diamants, l’ilménite, le fer, le zinc, l’argent,
etc.
VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR 9Le gisement d’ilménite de cette zone est énorme : lorsqu’elle sera en activité, cette mine
représentera 10% du minerai exploité dans le monde.
L’historique du projet
QMM a démarré sa recherche géologique dans la région de Fort Dauphin en 1986. Ce
n’est qu’en 1998 que Rio Tinto QMM et l’Etat malgache ont signé une convention
d’établissement qui définit les principaux droits et obligations des deux parties pendant
toute la durée du projet, qui doit durer 25 ans. En 1998, Rio Tinto QMM a entrepris des
études d’impacts sociaux et environnementaux afin d’obtenir le permis d’exploitation
environnemental nécessaire à l’exploitation légale du site. Cet agrément a été octroyé
par l’Etat malgache en 2001 et a ainsi vu le groupe Rio Tinto investir massivement le site
afin de commencer les extractions à partir d’octobre 2008. L’objectif est d’extraire
environ 750 000 tonnes d’ilménite par an sur un site d’une superficie de plus de 2 000
hectares situé à 12 km de Fort Dauphin.
Les infrastructures
Afin de pouvoir exploiter le minerai et l’exporter dans les meilleures conditions, QMM
mène depuis 2006 d’importants travaux d’infrastructures. Le montant total de ces
investissements est estimé à 585 M$, dont 35 M$ financés par la Banque mondiale. Ces
infrastructures comprennent notamment :
Le nouveau port maritime en eau
profonde d’Ehoala qui permettra
à QMM d’exporter ses minerais,
notamment jusqu’en Amérique
du nord. Les investissements
nécessaires à la construction de
ce port s’élèvent à plus de 145
M$, dont 75% financés
directement par QMM. Le port,
qui devrait être achevé en 2009, Figure 3 : port maritime d’Ehoala en construction. En arrière
plan, la route qui fait le tour de la ville, construite par QMM.
deviendra le premier du pays. Il
10 VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCARrespectera les normes américaines ISPS2 et facilitera ainsi les échanges
internationaux de Madagascar, qui, aujourd’hui, ne dispose pas d’infrastructures
maritimes de ce type. L’Etat malgache sera propriétaire du port qui sera géré par une
filiale de QMM créée spécifiquement pour cela. D’après QMM, ce nouveau port
d’Ehoala devrait bénéficier aux producteurs locaux de langoustes, sisal, letchis qui
pourront plus facilement exporter leur production.
L’aménagement d’une zone industrielle est également prévu à côté du port et de
l’aéroport. C’est QMM qui est chargée d’amener l’eau et l’électricité dans cette zone
d’activité. Pour ce faire, elle va construire une centrale thermique au fioul lourd ainsi
qu’une station de traitement de l’eau.
QMM a également investi localement dans des infrastructures routières qui seront
ouvertes au reste de la circulation afin de faciliter le transport de ses diverses
matières premières. Une route reliant les installations minières au port d’Ehoala a
ainsi été construite.
L’Union Européenne a apporté des financements au gouvernement malgache pour
l’aménagement de la route, actuellement en très mauvais état, entre Tananarive et
Fort Dauphin3. Les travaux n’ont cependant pas encore commencé.
Des études d’impacts sociaux et environnementaux du projet ont été réalisées par QMM.
Les impacts sociaux
Sur le volet social, l’accent a été mis sur le dialogue avec les différentes parties prenantes
afin de minimiser les impacts négatifs. Dans un premier temps, des études ont permis
d’identifier les communautés directement concernées par le projet. C’est le cas par
exemple des villages de pêcheurs situés dans la zone du nouveau port et qui ont dû être
déplacés. Une indemnisation financière leur a été versée et une nouvelle zone de pêche
leur a été attribuée. Selon QMM, ces compensations ont permis dans certains cas la
création de petites entreprises locales. QMM a également apporté son soutien financier à
2 International Ship and Port Security (ISPS) est un code adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2
de la Conférence des gouvernements contractants à la Convention internationale destiné à assurer la
sécurité des installations portuaires ainsi que des navires.
3 La durée du trajet routier devrait ainsi passer de 72 heures aujourd’hui à 30‐36 heures.
VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR 11la construction d’une école primaire ainsi que la création d’un centre de formation
professionnelle.
L’implantation de QMM a un impact économique important dans la région de Fort
Dauphin. Les salaires offerts par la société, largement supérieurs à la moyenne de la
région, ont provoqué une hausse globale des prix. Ils sont source de tensions car ils
détournent la main d’œuvre des activités locales qui ne peuvent rivaliser avec cette
multinationale.
Les impacts environnementaux
QMM a réalisé une étude d’impact sur la biodiversité car le site d’exploitation s’étend sur
2000 ha actuellement recouverts de forêts. Le procédé d’extraction d’ilménite et de
zircon est très particulier et devrait, selon QMM, limiter au maximum les impacts
environnementaux. Il se décompose en deux phases :
Une première usine, flottant sur un lac artificiel, fore le sol sur 15 mètres de
profondeur pour extraire le mélange sable + minerais. Cette usine avance au fur et à
mesure des forages. Le sable, rejeté après l’extraction des minerais, est récupéré
pour reconstituer, derrière l’usine, le paysage précédemment abîmé.
Une deuxième usine, fixe, est utilisée pour extraire le zircon de l’ilménite. Pour ce
faire, QMM utilise les différentes propriétés physiques des deux minéraux en faisant
appel à un procédé électromagnétique. Aucun processus chimique n’est utilisé lors
de ces deux étapes, ce qui limite les impacts environnementaux.
Figure 4 : processus d’exploitation de l’ilménite
12 VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCARQMM a créé une zone de conservation environnementale pour protéger les espèces
endémiques de la zone. Pour faire face à la déforestation dont souffre depuis longtemps
la région, elle propose aux populations locales des projets d’agriculture diversifiée et la
plantation d’arbres à croissance rapide.
QMM fait beaucoup d’efforts pour communiquer sur sa politique sociale et
environnementale. L’existence même de ce site d’informations, au cœur de Fort
Dauphin, en est la preuve. Outre les aspects positifs de cette politique au niveau local, les
porte‐parole de QMM nous ont clairement dit que c’était également une manière pour la
société de se démarquer de ses concurrents afin de faciliter l’obtention de droits
d’exploitation des richesses minières de Madagascar. En effet, avec le renchérissement
du coût des matières premières dans le monde, la concurrence est rude pour se
positionner sur les meilleurs sites.
PIC
Le projet des Pôles Intégrés de Croissance (PIC), financé par la Banque mondiale, a pour
objectif d’améliorer le climat des affaires à Madagascar afin d’attirer de nouveaux
investisseurs. 70% du budget est alloué à l’amélioration des infrastructures (port
d’Ehoala, route au nord de Fort Dauphin, route ceinture nord à Nosy Be, etc.), largement
insuffisantes dans tout le pays. Le PIC finance également des projets de réseaux
d’alimentation en eau et en électricité, et réhabilite des centres professionnels pour faire
face aux enjeux économiques du pays.
Ces pôles ont été mis en place en 2005, il donc encore trop tôt pour en mesurer les
impacts. Il est intéressant de noter que, pour bénéficier d’une aide du PIC, les
investisseurs (étrangers ou malgaches) doivent se conformer aux exigences de la
« Charte Verte » de la Banque mondiale, facilitant ainsi les projets à dimension
écologique. Le budget du PIC a récemment été rallongé de plus de 40M$ par la Banque
mondiale, témoignant ainsi de l’intérêt qu’a l’institution envers le PIC.
MyLan Cao & Baptiste Delchambre
VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR 13Jour 3 : randonnée à Lokaro
A Taolagnaro (Fort Dauphin), le dimanche 4 mai 2008.
Nous sommes partis dans la matinée en
bus pour rejoindre un lac bordé d’une
végétation luxuriante. Après avoir
embarqué sur des zodiacs, nous avons
traversé une zone de mangroves, qui
d’après nos guides, abritent des crocodiles
que nous n’avons malheureusement pas
pu apercevoir. Nous avons poursuivi notre
chemin en 4X4 jusqu’à un village de Figure 5 : transfert en zodiac
pécheurs d’où nous avons réellement
débuté notre marche.
La marche n’est pas difficile et les paysages
traversés absolument magnifiques : de
vertes collines avec, en arrière plan, la mer
d’un bleu turquoise bordée de palmiers.
Après avoir fait une pause baignade sur
une plage au paysage tout aussi idyllique,
nous avons continué notre chemin à pied.
Au loin, perchés sur des rochers, nous
Figure 6 : paysage de Lokaro avons aperçu des pêcheurs dont l’équilibre
ne semblait pas perturbé par la force des rouleaux qui s’abattaient sur eux… Très
impressionnant. Soudain, surgit de l’autre côté de la colline la baie de Lokaro,
somptueuse dans ses dégradés de bleu et de vert, balayée par la mer à l’écume blanche.
14 VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCARFigure 7 : la baie de Lokaro Figure 8 : un pêcheur
Arrivés au village de pécheurs, nous avons pris un bateau pour traverser un étroit bras
de mer et rejoindre la presqu’île qui sépare l’océan indien du lac Ambavarano. C’est là
que nous attendaient trois malgaches qui nous ont servi, en toques de cuisinier, un
délicieux pique‐nique. Cette ballade s’est terminée par un coucher de soleil depuis nos
zodiacs sur le chemin du retour. En résumé, une journée magnifique dans un petit coin
de paradis.
Figure 9 : l’équipe « Lokaro »
MyLan Cao & Baptiste Delchambre
VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR 15Jours 2 et 3’ : les projets de CARE à Ranomafana A Tolagnaro (Fort Dauphin) et Ranomafana, les samedi 3 et dimanche 4 mai 2008. Arrivée à l’aéroport de Tolagnaro (Fort Dauphin) Nous voici arrivés sur le petit aéroport de Fort Dauphin. Plus que 5 minutes et nous serons partis pour 2 jours de trip en brousse avec CARE. Enfin, 5 minutes après la « criée » aux sacs au comptoir « bagages » de l’aéroport, où les propriétaires des bagages sont appelés un par un pendant…45 minutes ! Nos affaires récupérées, nous sortons de l’aéroport et rencontrons « Fifi et Dédé », nos deux principaux accompagnateurs de CARE. Immédiatement, nous embarquons dans quatre pick‐ups 4X4 pour aller déjeuner à Fort‐Dauphin. Le court trajet nous permet de prendre connaissance avec cette ville industrielle dont l’économie repose sur le futur projet minier géant entamé par la société canadienne QMM. On peut voir notamment une route goudronnée flambant neuve menant à ce qui sera le nouveau port d’embarquement des minerais. Premier vrai repas malgache au dessus de la superbe baie de Fort‐Dauphin. Nous goûtons avec délice aux brochettes de zébu, aux crevettes au poivre vert, au thon frit…et à la fameuse « Three Horses Beer » (THB), que nous aurons l’occasion de re‐goûter à de nombreuses reprises pendant le séjour. Visite de cultures vivrières et utilisation de pompe à pédale à Maromitsioky Après 30 minutes de « tape‐cul » (le début d’une longue série) sur la piste, nous faisons une première halte dans un hameau pour voir l’application concrète d’un projet de cultures vivrières encadré par CARE. Un paysan nous montre sa parcelle, qui ressemble à un grand potager (moins d’un ha au total) et lui permet désormais d’assurer la subsistance de toute sa famille grâce à l’assistance de départ que CARE lui a apporté. En effet, grâce à l’amélioration de ses pratiques culturales et à l’achat à crédit d’une « pompe d’irrigation à pédale », il peut désormais cultiver avec succès une grande variété de légumes (carottes, courgettes, navets, concombres, tomates, etc.) qu’il vend sur les marchés locaux, mais aussi à SODEXHO, voire à des hôtels de luxe à Antananarivo. 16 VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR
Dans ce type de projets, CARE intervient à quatre niveaux différents :
1. Apport gratuit d’intrants au début des cultures (= ~ « capital de départ »)
2. Programme de financement de matériel agricole (pompe à pédale)
3. Aide technique via le passage régulier de techniciens agronomes
4. Aide à la commercialisation des denrées produites (stands sur les marchés, mise
en relation avec des acheteurs professionnels, etc.)
Dans le cas de l’installation de pompes d’irrigation à
pédale, le forage vers la nappe est payé à 100% par
CARE, qui offre également 40% du prix de la pompe. Les
60% restants (soit environ 80€) sont prêtés au paysan
pour finaliser son achat. Ce dernier rembourse ce prêt
en 3 ou 4 mensualités, sur environ 6 mois.
Compte tenu des résultats probants de ce programme,
CARE emploie un animateur régional pour trouver de
nouveaux paysans motivés par l’expérience. De 36
pompes installées en 2007, on est maintenant passé à 74 Figure 10 : pompe d’irrigation
financée par CARE
pompes prévues en 2008.
Trajet vers RANOMAFANE
Nos pick‐up traversent tour à tour plusieurs villages, avec à chaque fois un cortège de
mains levées et de rires d’enfants. Nous ne pouvons qu’être surpris par leur nombre,
bien supérieur à celui des adultes que nous croisons. Nos guides nous expliquerons par
la suite que les femmes peuvent donner naissance dès l’âge de 14 ans et avoir parfois
jusqu’à 14 enfants !
Nous passons également devant de magnifiques Tsingy, sortes d’arêtes rocheuses tout
droit sorties de terre. Après plusieurs heures de plaine, nous arrivons à la lisière de la
forêt. La température se refroidit, sous les effets combinés de la voûte verte qui nous
surplombe et du déclin du soleil. Nous avions jusque là l’autorisation de siéger dans la
remorque du pick‐up, chose qui nous est à présent interdite car les moustiques ne nous
laisseraient aucune chance à la nuit tombée !
VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR 17Nous croisons encore quelques marcheurs attardés au bord des routes à la nuit tombée et nous retrouvons ensuite la plaine pour les dernières heures de trajet. Gîte et repas Nous arrivons vers 19H30 à l’hôtel de brousse de Ranomafane. Nous sommes agréablement surpris par la présence de lits, de moustiquaires et de colonies d’abeilles endormies sous le toit du bâtiment, ce qui paraît‐il porte chance ! Pas d’électricité à Ranomafane, c’est donc à la bougie que nous passons à table, après que la maîtresse de maison ait versé de l’eau sur nos mains pour nous les laver ! Le repas est constitué de riz (évidemment), mais aussi de spaghettis, de poulet et de ce qu’on nous présentera comme du porc mais qui ressemblait furieusement à du… chat (nous ne saurons Figure 11 : dîner à la bougie à Ranomafana jamais) ! Oranges et bananes en dessert, et « eau de riz » en boisson. Celle‐ci est légèrement jaune, a un goût de riz brûlé et remplace avantageusement (et économiquement) le thé ou le café, avec l’avantage d’être plus sûre (car bouillie) sur le plan de l’hygiène. Après ce festin « aux chandelles », nous quittons nos adorables serveurs en leur souhaitant une bonne nuit (il faut dire qu’il est déjà… 20h45 !!). Bistrot à Ranomafane Afin d’endiguer notre soif de découverte, nous nous mettons en quête de quelques breuvages locaux. S’en suit alors une mission commando pour trouver de la « Three Horses Beer » qui nous mènera, après quelques détours, au bar local, une espèce de cabane en planches éclairée à la bougie ! Notre arrivée fait sensation, la sono est installée (une voiture garée à l’extérieur dont l’autoradio fait office de juke‐box) et nous voilà tous attablés pour déguster notre petite bière. Le taulier poussera même la gentillesse jusqu’à nous faire profiter de ses talents de joueur de Ukulélé, une soirée mémorable ! 18 VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR
Culture vivrière Jean‐Claude et Martine
Après un petit déjeuner constitué de riz et de crêpes, nous voilà repartis en 4X4 pour
visiter de nouveaux projets.
La rencontre de Jean‐Claude et Martine tout d’abord. Ce couple malgache nous annonce
que sur les huit enfants qu’ils ont mis au monde, seuls trois ont pu survivre à la
malnutrition. Grâce au projet CARE, ils peuvent aujourd’hui améliorer leurs conditions
de vie en se nourrissant et en vendant une partie de leur production diversifiée de
légumes. Outre la désormais traditionnelle pompe à pédale, un bac à semis complète les
outils apportés par CARE. Et, dixit Martine, depuis qu’ils ont diversifié leur nourriture,
ses enfants sont « plus forts et plus robustes ». Elle n’a plus perdu un seul enfant depuis
l’arrivée de CARE... Nous ne pouvons qu’être profondément touchés de ce témoignage et
de l’attention toute particulière qui nous est portée : nous devrons chacun donner notre
prénom avant de pouvoir partir !
Culture de rente en forêt
Notre étape suivante est un
village de brousse dans lequel
CARE aide des paysans à
développer une agriculture de
rente en forêt. Notre arrivée
provoque de véritables
attroupements dans le village,
car comme nous l’explique Fifi,
aucun « Vazaha» ne vient jamais
dans ces contrées reculées.
Après dix minutes de marche Figure 12 : exploitation d’agroforesterie aidée par CARE
dans les rizières, nous nous retrouvons dans une exploitation agricole forestière… qui
ressemble vraiment à une forêt. Ce n’est que grâce à nos guides et au paysan
propriétaire du lieu que nous comprenons que chaque plante ou arbre qui pousse ici
n’est pas là par hasard. Grâce aux conseils techniques de CARE, le propriétaire plante en
effet (à des distances soigneusement respectées) différentes espèces végétales
compatibles et formant différentes strates plus ou moins baignées de lumière. Grâce aux
VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR 19différentes cultures (sorgho, vanille, jacquier, café, gingembre, manioc, oranges, etc.), il y a du travail et des récoltes (donc des revenus) toute l’année. De plus, CARE fait de nouvelles tentatives de cultures qui pourraient s’avérer prometteuses : Ylang‐Ylang (parfums), cacao, etc. Avant de repartir, deux villageois nous font la surprise d’une démonstration de lutte malgache (qui ressemble à un mélange de sumo et de lutte gréco‐romaine), puis nous discutons avec les personnes présentes du mode de vie en brousse, des techniques de construction des maisons en terre (sans cuisson), du séchage des cacahuètes… Passionnant ! Riziculture en aval du barrage Avant dernière étape de la journée : la visite des rizières en aval du barrage construit par CARE. L’approche se fait en traversant en 4x4 des étendues herbeuses magnifiques et sauvages, des marigots et des ponts… dont l’un cèdera sous le poids d’un des véhicules (ce qui nous permettra de vivre une séquence de dépannage « Camel Trophy » mémorable). Une fois sur place, les techniciens de CARE nous expliquent comment ils peuvent aider les agriculteurs à tripler (riziculture améliorée) voire à quintupler (riziculture intensive) leurs rendements de riz. Dans le cas de la riziculture améliorée, il s’agit essentiellement d’apprendre aux agriculteurs à espacer correctement les plans afin qu’ils poussent mieux. Et pour la riziculture intensive, on va jouer en plus sur la régulation de l’irrigation des rizières, l’âge des pousses plantées et sur les apports d’engrais nécessaires. On va alors permettre deux récoltes par an, avec des rendements allant jusqu’à 6 tonnes à l’hectare, là où le mode de culture « classique » ne permet habituellement de récolter que 1,2 tonnes à l’hectare en moyenne. Barrage CARE et fin du trip Nous arrivons enfin dans un petit village où nous attend une balade de près d’une heure dans la plaine afin d’atteindre un barrage servant l’irrigation de toutes les rizières avoisinantes. Le périple commence par la traversée d’un pont suspendu à 8m du sol dont certains garderont longtemps le souvenir ! 20 VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR
Une fois arrivés sur le barrage, nos guides nous expliquent que la rivière est détournée
artificiellement pour alimenter les différents bassins rizicoles. Le gain de productivité
est tel que les agriculteurs réduisent les parcelles nécessaires et cessent ainsi de
déboiser les collines qui bordent la vallée. En effet, des pans entiers sont nus et les
arbres les plus proches restent sur les cimes. Les locaux les plus âgés nous expliquent
alors qu’ils ont connu ces montagnes entièrement boisées…
Figure 13 : barrage financé par CARE
Une dernière séance d’au revoir plus tard, un peu de manioc pour la route et nous voilà
de retour dans nos chars mécaniques. Les fesses commencent à souffrir, les dos aussi
mais les paysages sont tellement extraordinaires que tout le monde a le sourire dans
notre équipage. Les dernières heures de routes sont interminables tant nous piaffons
déjà d’impatience de retrouver nos camarades pour pouvoir échanger sur les
merveilleux jours que nous avons passés chacun de notre côté !
Bruno Pireyn & Stéphane Tromilin
VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR 21Jour 4 et 5 : Ifaty
A Ifaty, les lundi 5 et mardi 6 mai 2008.
En ce troisième jour de voyage, nous passons d'Ouest en Est, et quittons les rivages de
l'Océan Indien pour ceux du Canal du Mozambique. Après un court voyage en avion,
nous débarquons à Toliara (Tulear), où nous nous ravitaillons dans le grand marché qui
occupe le centre‐ville, avant de partir pour Ifaty, village balnéaire situé à 30 km au nord
de la ville et auquel nous conduit une piste poussiéreuse. C'est là que nous avons rendez‐
vous le soir même avec l'ONG Reef Doctors, qui vient nous parler de sa mission de
préservation du récif de corail bordant le lagon.
Cette ONG, créée en 2000 par Roderick Stein‐Rostainga, a trois domaines
d’interventions : la conservation, la science et l’éducation. Ces trois aspects se
conjuguent étroitement dans l’approche que privilégie Reef Doctors : la préservation du
récif de corail de la baie de Ranobe à Ifaty repose sur une étude scientifique du milieu
mais elle ne peut réussir sans éduquer les populations de pêcheurs dont les besoins
doivent être pris en compte.
Les objectifs de l’ONG sont au nombre de quatre:
Effectuer de la recherche sur la santé du récif de corail de la baie de Ranobe et
surveiller son écosystème ainsi que la pêche artisanale associée.
Promouvoir et participer à l’éducation des communautés locales, des activités
commerciales et des touristes concernant la fragilité des récifs coralliens, comment
les protéger et quels sont les bénéfices que peuvent apporter une pêche durable
ainsi qu’un tourisme responsable.
Aider à la conservation des écosystèmes locaux à travers des projets de gestion de la
côte menés par les communautés locales comme des zones marines protégées et des
zones de pêche durable.
Aider la communauté locale à explorer des modes de vies alternatifs et en
développant des sources de revenus plus diversifiées.
La principale menace qui pèse sur la baie est l’augmentation de la population locale et
l’arrivée de nouveaux pêcheurs qui fait baisser le stock de poissons. Les pêcheurs
22 VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCARdoivent donc aller pêcher plus loin et plus longtemps, ce qui est difficile et risqué en
raison de la fragilité des pirogues, et ce qui entraîne une surexploitation des mêmes
sites. Les poissons sont pêchés de plus en plus jeunes, ce qui a pour conséquence une
diminution de la taille moyenne des poissons pêchés. Si l’on ajoute à cela le recours au
poison, à la dynamite ou l’usage de moustiquaires pour remplacer les filets, ainsi que le
non respect des espèce protégées, on comprend qu’il s’agit d’une pêche non durable qui
menace tout le milieu naturel, le stock halieutique, et donc la sécurité alimentaire des
familles du littoral.
D’autres risques menacent la baie et son récif corallien :
Le réchauffement climatique : son impact est surveillé même s’il semble faible pour
le moment.
La déforestation : ses effets sont plus sensibles et elle concerne la mangrove
exploitée pour le bois de chauffe par les familles mais aussi la forêt située au nord de
la baie et qui est menacée par la construction d’une mine. Or si cette forêt disparaît, il
y a un risque majeur de sédimentation dans la baie, ce qui serait très dommageable
pour le corail. De plus, l’exploitation de la mine et le transport du minerai exigent la
construction d’infrastructures pour lesquelles plusieurs options sont envisagées :
• la construction d’une route ;
• la réalisation d’un canal creusé au cœur de la baie ;
• la construction d’un pipeline jusqu’à une zone où les fonds marins plus
profonds permettraient un transport par bateau.
Une étude d’impact a été réalisée par l’entreprise minière mais elle a consisté en
seulement deux plongées dans cette zone à l’écosystème aussi complexe que fragile. Les
Reef Doctors s’emploient donc à faire du lobbying auprès des autorités malgaches pour
que ce soit le projet le moins menaçant pour l’environnement qui soit adopté.
Les autres activités de l’ONG concernent, entre autres, l’accueil d’éco‐volontaires
apportant leur aide pour les activités scientifiques et notamment des relevés de données
en plongée qui permettent l’étude des fonds marins et de la diversité des poissons.
Les Reef Doctors emploient également des malgaches pour la réalisation d’une étude
socio‐économique visant à évaluer l’impact de la pêche sur la population de poissons.
VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR 23Ces collaborateurs effectuent des enquêtes de terrain auprès des pêcheurs : ils pèsent la
pêche par pirogue et quantifient la prise en terme de biomasse. C’est un protocole qui
marche bien.
D’autres expérimentations ont connu moins de succès :
Une tentative de pose de capteurs pour mesurer la croissance du corail s’est soldée
par un échec.
La construction de récifs artificiels pour faire venir les poissons n’a également pas
réussi à ce jour.
Parmi les autres programmes menés par l’ONG :
La restauration et la conservation de la mangrove qui est en mauvais état et dans
laquelle les Reef Doctors replantent des arbres.
La réalisation d’un curriculum de l’environnement à destination des instituteurs qui
utilisent cet outil pédagogique pour éduquer les enfants à la préservation du milieu
naturel.
L’organisation d’activités éducatives avec les enfants : les kids clubs du dimanche où
l’on fait des jeux de ballons mais où l’on apprend également l’écriture et le calcul, où
l’on organise des concours de ramassage de piles sur la plage.
Le financement de cours d’anglais et de français et l’achat de livres et de stylos pour
les enfants de l’école primaire.
Le soutien au commerce local du miel d’épineux par la vente de bocaux à prix
coûtant aux femmes qui récoltent le miel habituellement commercialisé dans de
vieilles bouteilles en plastique.
La commercialisation de farine acheminée de Tuléar afin de remplacer le riz pilé qui
prend beaucoup de temps pour sa préparation.
Ces actions sociaux éducatives permettent de lever la pression sur la barrière de corail
en détournant une partie de la population de la pêche et en permettant aux enfants de se
former pour d’autres métiers.
24 VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCARLes plongées dans le lagon effectuées le lendemain matin par une partie du groupe nous
ont permis de saisir l'enjeu de ce programme de préservation du récif : les coraux
semblent fragilisés et les poissons sont assez peu nombreux. My‐Lan, qui a plongé dix
ans plus tôt sur cette même barrière de corail, constate avec amertume
l'appauvrissement de la vie marine dans cette zone où une grande variété d'espèces
cohabitait il y a quelques années encore.
Figure 14 : excursion plongée
C'est une autre espèce menacée qui fait l'objet des excursions organisées l'après‐midi :
la tortue, qui fait l'objet d'un autre programme de conservation mené par une
association de sauvegarde de l'environnement. Le "Village des Tortues" accueille et
soigne les tortues du sud du pays dont huit cents spécimens vivent sur place !
La journée s'achève par une ballade dans la forêt de baobabs située derrière le village
d'Ifaty : se confronter à ces géants dont le plus grand fait 13 mètres de circonférence
donne à chacun d'entre nous la mesure de sa place dans la nature, une place en réalité
bien plus petite que celle que l'homme tend aujourd'hui à s'octroyer.
Catherine Wolff Février
VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR 25Jour 7 : balade dans l’Isalo A Ranohira, le mercredi 7 mai 2008. Notre balade dans le parc de l’Isalo a été précédée par une nuit au motel, dans la petite ville de Ranohira. Et notre arrivée sur notre lieu de repos a été précédée par une traversée de Ilakaka, la ville des Saphirs. Découverte effectuée à la tombée de la nuit et subrepticement à travers la fenêtre du car. Ilakaka a la mauvaise réputation de posséder les vices de toute ville développée et orientée vers l’exploitation d’une ressource rare comme les pierres précieuses : bagarres, violence, climat d’insécurité. Nous nous contentons donc d’observer de la fenêtre les groupements d’hommes à la tombée du soir, pesant avec intérêt les petits cailloux si précieux de saphir. L’atmosphère y est très différente du Sud et d’ailleurs à Madagascar, notamment en raison de la forte communauté indo‐pakistanaise, attirée par les commerces mais aussi lors de la ruée vers les saphirs. L’atmosphère est également marquée par l’ethnie dominante de la région, les Baras. Traditionnellement pasteurs, éleveurs historiques de zébus, les Baras présentent un fonctionnement de société très particulier, si fortement marqué par l’élevage de leur bétail que l’on parle à l’égard de la culture Bara de « civilisation du bœuf », le zébu partageant tous les moments de la vie de l’homme, de sa naissance à sa mort. A titre d’exemple, la pratique du vol de zébu marque un temps fort du mariage traditionnel Bara. Lorsqu’un jeune Bara souhaite se marier, il se doit d’aller voler plusieurs zébus dans le village voisin, montrant ainsi sa bravoure et son courage, et l’intérêt d’un mariage. Afin de rééquilibrer les cheptels entre villages voisins, il est de tradition que lorsqu’un jeune Bara du village A vole des zébus d’un village B, les années suivantes, les jeunes générations du village B iront voler le village A, sorte de juste retour des choses. Le guide nous explique pourtant que cette pratique, équilibrée au temps des vols « amateurs », qui représentaient en réalité un jeu plus qu’un défi dangereux, déstabilise petit à petit les villages Bara en raison de la professionnalisation des voleurs de zébus. Ceux‐ci, de plus en plus souvent équipés d’armes à feu, ont développé des techniques qui leur permettent de voler de grandes parts du bétail. Même si les voleurs sont aussi des Baras, puisque cette pratique découle de leur tradition, la condition d’éleveur est de plus 26 VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR
en plus difficile, et l’on voit apparaître progressivement dans les paysages sauvages des
Baras de timides cultures d’ignames, de patate douce, de riz ou de manioc.
La région de l’Isalo est très particulière du point de vue des paysages car elle présente
un aspect désertique qui rappelle les grandes plaines africaines s’étendant à perte de
vue et ornés sporadiquement de quelques arbres biscornus.
Le parc de l’Isalo, situé dans la région de
Fianarantsoa, à environ 600 km au sud‐
ouest d’Antananarivo, s’étend sur plus de
80 000 hectares. Le massif de l’Isalo est
constitué de trois couches géologiques
principales, reconnaissables à l’œil nu
grâce à leur couleur. Ces couches
sédimentaires datant du jurassique
procurent au parc une beauté
Figure 15 : paysage parc Isalo (1)
exceptionnelle et une variété de paysages
marquée, les formations lunaires alternant avec des oasis de fraîcheur telles que le
Canyon des makis ou la Piscine naturelle, halte méritée du voyageur rompu. Le relief
ruiniforme, la présence de tombeaux placés sur les sommets des formations rocheuses,
la découverte des lémuriens ainsi que l’arrivée dans le site magique de la piscine
naturelle font des randonnées dans l’Isalo une activité des plus étonnantes.
Figure 16 : paysage parc Isalo (2)
VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCAR 27Notre groupe s’était réparti, pour la
randonnée, sur trois parcours
différents. Néanmoins les impressions
furent relativement similaires puisque
proches de l’émerveillement,
notamment avec la baignade dans la
Piscine naturelle et l’observation des 3
espèces lémurien présentes dans le
parc : les Makis ou Cattas (queue
rayée noire et blanche), Sifakas ou
propithèques de verreaux et lémurs
couronnés.
Figure 17 : piscine naturelle du parc Isalo
Madagascar est en effet l’un des rares endroits au monde, avec le Brésil et la République
Démocratique du Congo, présentant une diversité aussi large de lémuriens, famille bien
particulière de primates à distinguer du singe et de l’homme, même si nombre de
théories présenteraient l’homme comme descendant du lémurien plus que du singe.
Notre groupe a eu l’immense plaisir de découvrir trois des plus de trente espèces de
lémuriens présentes à Madagascar, et ce en un espace de temps très réduit, contribuant
à une atmosphère ludique d’observation silencieuse et de prises de vues innombrables.
Les Sifakas sont d’ordinaire difficiles à observer, mais la période d’accouplement les
avait peut‐être poussés à s’aventurer en terrain plus découvert afin de s’alimenter. Les
Sifakas sont parfois appelés les « lémuriens Vazahas », les Malgaches comparant avec
humour le pelage blanc du lémurien avec la peau pâle des Occidentaux.
28 VOYAGE D’ETUDE – MADAGASCARVous pouvez aussi lire