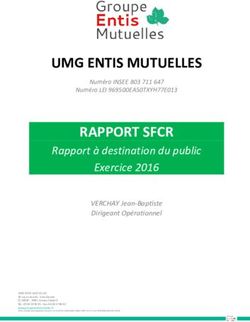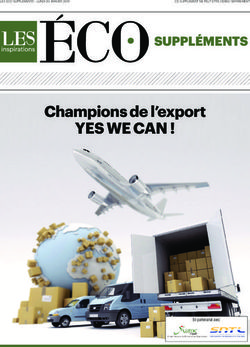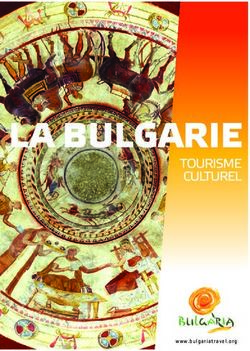ANNUAIRE MAROCAIN DE LA STRATÉGIE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
ANNUAIRE MAROCAIN
DE LA STRATÉGIE ET DES RELATIONS
INTERNATIONALESAnnuaire Marocain de la Stratégie et des Relations Internationales
Directeur de l’AMSRI
Abdelhak Azzouzi
Co-directeurs de l’AMSRI
Asmaâ Alaoui Taib / Abdallah Harsi / Mohamed Fakihi
Comité scientifique
Abdelhak Azzouzi / Asmaâ Alaoui Taib / Mohamed Fakihi / Abdallah Harsi / Hakima Mountassir /
Mounia Slighoua / Mouna Mesdouri / Brahim Benjelloun Touimi / Abdelilah Fountir / Danielle Cabanis /
Hassan El Mossadek / Andre Cabanis / Mohammed Kabbaj / Fathia Bennis / Abdelhadi Tazi / Burhan
Ghalioun / Farès Abdelarim / Ahmed Lahlimi Alami / Abdellah Bin Ali Al Khatib / Driss Guerraoui /
Mohammed Larbi Messari / James Hollifield / Robert Jordan / Enrique Mugica Herzog / Khalifé Kazem /
Catherine de Wenden / Said Laouandi / Abdelouahed Ourzik / Mohammed Fatih Naciri / Mohamed
Darif / Manar Slimi /Makinouchi Haruko / Khalid Azab / Abdallatif Youssef al Hamad / Jean Louis
Reiffers / Saad Kettani / Mohammed El Yagoubi / Francesco Spano / Fadel Al Rabii / Sabah Yassine /
Madhi Al Khames / Amine Mahfoud / Mohamed Abassi / Cleopatra Lorintiu / Jaime Gama / Charles
Christopher / Jean Marie Crouzatier / Phillipe Raimbault / Francois Paul Blanc / Nadira el Guermai /
Idriss Yazami / Lola Bañon Castellón / Serigne Diop / Ahmed Aldersh / Amadou Lamine Sall / Mohamed
Cherkaoui / Boucetta Boudchiche / Omar Hilal / Brian Calfano / Leila Hanafi / Aziz Hasbi / Menouar
Alem / Pierre Bonte / Abdelhamid el Ouali / Kamal Mesbahi / Émile Sahliey / Mamdouh Aker/ Charles
Anthony Smith / Said Al Lawandi
Comité de traduction
Abdelhak Azzouzi / Asmaâ Alaoui Taib / Mohamed Fakihi / Abdallah Harsi / Hakima Mountassir /
Mounia Slighoua / Mouna Mesdouri / Hamid kjidaa / Mohamed Ouakrim / Lola Banon / Zhor Lhouti /
Maroussia Issoumour / Hakima Kirami / Mohamed Abassi / Omar Hilal / Mohamed Allali / Abdelmajid
Khadad / Abdelali Quarqori / Abdeljebar Boukili / Siham Kinani / Abdelmajid Khdad / Abdelkader
Lachkar / Mohamed Benhlal / Abderrahim Salmani / Direction des études et des prévisions financières,
Ministère de l’Economie et des Finances / Banque du Maroc / BMCE Bank / James Hollifield /Bahanou
Akabouch / Ali Azeriah / Aouatif Raissouli / Sadik Rddad / Jilali Saib
Comité de relecture de la traduction finale en trois langues
Abdelhak Azzouzi / Asmaâ Alaoui Taib / Mohamed Fakihi / Abdallah Harsi / Brian Calfano / Mohamed
Ouakrim
Conception graphique
Saâd Tadlaoui
L’AMSRI est publié par le Centre Marocain Interdisciplinaire des Etudes Stratégiques et
Internationales, association d’utilité publique (décret N° 2.11.250 du 18 mai 2011) avec le concours de
l’Agence de Développement des Provinces du Sud, et le soutien du groupe Ahmed Jamai, la BMCE Bank,
la Ville de Fès, la Région de Fès-Boulmane, le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger, Le
Groupe Anas Sefrioui, La Fondation Hermès pour la paix, Maroc Export.
CMIESI, B.P. 8622, Atlas, 30 001 Fès, Maroc. www.cmiesi.maA
ANNUUAIRRE M
MAROOCAIIN
DE
E LA STRAATÉGIE ET DES
D
REL
LATIO
ONS
TERN
INT NATIO
ONAALES
2012
2
Tomee 1INTRODUCTION
PAR
ABDELHAK AZZOUZI
L’Annuaire Marocain de la Stratégie et des relations Internationales voudrait
concourir à la reconnaissance d’une doctrine marocaine dans le domaine de la
science politique et des relations Internationales, alors que les travaux en la matière
au Maroc sont très rares. Le pluralisme académique, la diversité intellectuelle, la
multiplication des approches, les débats pratiques et théoriques sont en effet
essentiels pour la vitalité de n’importe quelle discipline. Regrouper les experts,
rassembler les spécialistes, confronter les tendances, tels sont les objectifs initiaux
de ce travail. L’AMSRI a une vocation généraliste. Il s’intéresse à la science
politique au Maroc et ailleurs, à la science économique ainsi qu’aux relations
internationales dans toutes leurs dimensions, politiques, stratégiques, culturelles,
etc.
L’AMSRI rassemble des analyses savantes, des articles académiques, des rapports,
des statistiques, des chronologies rédigées dans un esprit pluridisciplinaire par des
universitaires, des diplomates de renom, de grands économistes, des banquiers, des
chercheurs, des décideurs, des experts marocains ou étrangers. Il est désolant de
voir nos collègues anglo-saxons (surtout ceux des Etats-Unis et de la Grande
Bretagne) dans les universités comme dans les centres de décision souffrir par
exemple du manque d’une littérature conséquente et savante sur le Maroc. La
production est soit arabophone ou francophone la plupart du temps. Qui plus est, il
n’y a aucun recueil, annuaire, ou ouvrage publiés annuellement et qui retracent par
l’écrit savant, même en arabe ou en français, les sujets divers, en liaison avec les
événements de l’année de référence, mais aussi avec des thèmes plus permanents,
regroupés sur une base thématique. L’AMSRI essaye de combler ce vide et
constitue en la matière une publication sans équivalent dans la littérature
arabophone, francophone et anglophone.
Ce n’est pas une tâche aisée, pour un centre de recherche d’éditer un recueil ou un
annuaire en trois langues simultanément. A notre connaissance aucun centre de
recherches ou organisme ne le fait. Il se pourrait que le travail soit traduit. Mais la
plupart du temps par d’autres organismes avec un grand décalage. Ainsi en est-il
par exemple du rapport annuel de L’Institut International de Recherche sur la Paix
de Stockholm (SIPRI) qui est un institut indépendant de recherche sur la paix et lesABDELHAK AZZOUZI conflits qui porte une attention particulière aux problématiques liées au contrôle des armements et au désarmement. Le rapport financé par le parlement suédois est traduit en arabe par exemple par le Centre for Arab Unity Studies de Beyrouth. La formule d’un Annuaire reste une tradition francophone, avec ces précédents illustres que constituent l’Annuaire Français de Droit International et l’Annuaire Français des Relations Internationales. Cependant, l’AMSRI aspire à aller au-delà de la conception francophone pour embrasser les vertus de la méthodologie épistémologique du monde anglo-saxon particulièrement américaines. Car, il va sans dire que les revues scientifiques citées le plus fréquemment sur le marché international sont américaines. Je pense à World Politics, International Organization, International Security, International Studies Quartely (accompagné de la Mershon Studies Review). Il est de même pour les revues dont le contenu porte sur des méthodes ou des thèmes particuliers : pour des approches quantitatives et/ou inspirées de la théorie des jeux, The Journal of Conflict Resolution et International Interaction, sur les questions de sécurité, Scurity Studies, sur l’éthique, Ethics and International Affairs. L’AMSRI s’inspire de cet ensemble comme celui des publications américaines destinées à un public plus large mais n’échappent pas à la règle : Foreign Affairs qui a fêté cette année quatre-vingt-dix ans d’existence, Foreign policy et Orbis. D’où d’ailleurs, au-delà des articles savants dans ce volume, les rapports et les différentes banques de données. La production française reste aussi très faible par rapport à celle des Etats-Unis. La taille du marché universitaire américain, le nombre des politistes internationalistes, le soutien des fondations, le nombre des éditeurs, les interactions avec les décideurs politiques font que le centre de gravité est situé bel et bien aux Etats-Unis. Cela explique le nombre de décideurs marocains qui ont contribué dans ce volume et notre volonté d’entreprendre l’exploration systématique des faits et des évènements par l’utilisation de plusieurs compétences. En outre, comme le souligne Pascal Vennesson1, la question des relations entre les dynamiques politiques internes et internationales aux Etats-Unis est l’une des plus stimulantes, et nombre de notions, de théories, et d’enquêtes empiriques développées dans l’étude des relations internationales lui apportent des éléments de réponse tout à fait stimulants. Ces éléments et autres sont le principal poteau indicateur de l’AMSRI qui aidera le décideur marocain et étranger, le chercheur, l’universitaire, l’étudiant, les institutions financières, les experts dans le monde entier à trouver leur voie. De même, il sera juste de créer un lien solide entre les spécialistes universitaires, les 1 Pascal Vennesson, « Les relations internationales dans la science politique aux Etats-Unis », Politix, n°41, 1998, pp. 176-194. 6
INTRODUCTION
experts avec les décideurs politiques et ceux dans le domaine de l’international. Les
relations qu’ils entretiennent aux Etats-Unis sont très anciennes. Woodrow Wilson
était un politiste et le produit singulier d’Harvard qu’est Henry Kessinger, a occupé
des positions clés à la Maison Blanche. L’interaction, personnelle et intellectuelle,
entre le champ universitaire et le champ politique est plus forte aux Etats-Unis
qu’en Europe. On le constate bien dans la pensée et les liens des membres
américains et européens associés au CMIESI avec le champ politique national de
leur pays. Ceux des chercheurs américains sont plus forts et réguliers. En Europe ce
lien est quasi inexistant. Pour nous aussi, il s’agit de relever ce décalage dans le cas
marocain et essayer de combler le fossé (bridge the gap) qui séparerait des milieux
jugés de plus en plus étrangers l’un à l’autre.
L’AMSRI aspire à être un précédent où se retrouvent les experts de toutes les
disciplines concernées, dans la mesure où elles comportent un objet national ou
international. Il a en effet vocation, à manifester la présence des universités
marocaines, de leurs centres de recherches et de leurs chercheurs dans un domaine
où ils sont dispersés et la plupart du temps isolés. La table des matières de ce
volume témoigne de la richesse de l’université marocaine qui regorge d’une pléiade
de spécialistes érudits. Cependant, comme nous l’avons signalé, disposer d’un
vivier d’universitaires ne signifie pas retenir une conception fermée de la recherche.
Au contraire. L’AMSRI demeure ouvert à un grand nombre d’experts extérieurs,
soit qu’ils appartiennent à des centres de recherches non universitaires (des
centraliens, des polytechniciens, etc.), soit qu’ils proviennent de milieux
professionnels (des diplomates, des décideurs politiques, des hauts fonctionnaires,
des parlementaires, des syndicalistes, etc.). Il n’y a pas de contradiction, mais une
réelle complémentarité entre des recherches universitaires savantes qui respectent
la scientificité académique et les rapports et conclusions concrets que l’on peut
retirer de l’expérience, du regard différent et de la connaissance personnelle de
domaines spécialisés. C’est une véritable gymnastique intellectuelle et une
combinaison que l’AMSRI s’efforce de réaliser. Ne courait-on pas le risque en
préservant dans la lecture traditionnelle des évènements, d’illustrer l’allégorie dont
Alfred Grosser aimait à illustrer ses cours, celle du passant dans la nuit qui cherche
une clé sous un réverbère :
-« Êtes-vous sûr qu’il faut bien chercher là ? » – « Non…mais là c’est éclairé.
Ailleurs je n’y vois rien… ».
7ABDELHAK AZZOUZI
Car avant tout, l’AMSRI est adressé à un public large et diversifié : les
universitaires et leurs étudiants que ce soit aux Etats-Unis, en Grande Bretagne, en
France ou au Canada, au Maroc ou en Algérie ou ailleurs (puisque l’AMSRI est
publié simultanément en trois langues), les chercheurs, les observateurs que sont
les journalistes spécialisés, mais aussi les praticiens de la science politique et des
relations internationales – diplomates, hauts fonctionnaires internationaux,
membres des ONG, parlementaires, chefs d’Etats et leurs conseillers, thinks tanks,
centres d’analyses et de prospectives, banques mondiales, institutions
internationales. Il va sans dire que le choix des problématiques et de
questionnement abordés est destiné à fournir à un large public des études de
référence et originale qui leur permettront de trouver annuellement la quintessence
des débats en cours et des informations correctes et précises relatives à leur
domaine d’étude ou d’expertise. L’AMSRI souhaite assurer la complémentarité de
la recherche académique et de la pratique politique, internationaliste,
gouvernementale, administrative et associative.
Même dans la recherche académique que présentent certains articles de ce
volume, nous avons tenu à ce que les travaux soient inscrits dans une
transdisciplinarité maîtrisée. C’est ainsi que suite à Josepha Laroche2, nous nous
sommes inscrits par exemple dans la lignée de ceux qui pensent qu’il ne peut y
avoir de recherche en science politique qui n’intègre la dimension internationale, et
ce, quel que soit l’objet et quel que soit le champ de spécialisation envisagée
(politique locale, sociologie politique, science administrative, analyse des politiques
publiques, histoire des idées). De même, il est insensé de mener des travaux en
matière des relations internationales sans recourir au territoire et à la science
politique. En d’autres termes, la discipline des relations internationales ne saurait se
priver de la méthodologie, des concepts et des travaux de la science politique.
On peut même dire que les relations internationales risqueraient de ne pas exister
car elles font partie intégrante de la science politique. Je suis tout à fait d’accord
avec Josepha Laroche lorsqu’elle écrit qu’il est erroné de croire que l’on peut traiter
les relations internationales à part : la dimension internationale est constitutive de
toute science sociale du politique. Toute méconnaissance de cette donnée tant
sociale que scientifique aurait pour effet :
-soit d’amputer, de mutiler la recherche en science politique et donc de l’appauvrir
2Josepha Laroche, « Science politique et relations internationales », dans Olivier Philippe (sous la dir.), La science politique, une et
multiple, Paris, l’Harmattan, 2004, p. 207.
8INTRODUCTION
-soit de réduire la discipline des relations internationales à n’être qu’un vague
conglomérat de données empirico-descriptives, journalistiques et hétéroclites au
statut aussi suspect qu’indéterminé….3.
La montée en puissance de nouveaux acteurs et de nouvelles formes inédites de la
diplomatie justifie non seulement la transdisciplinarité mais la mise en œuvre d’une
sociologie wébérienne appliquée à l’international. « Une sociologie compréhensive
des relations internationales que Max Weber n’a certes pas lui-même réalisé mais
pour laquelle il nous a laissé de précieux outils conceptuels. Norbert Elias l’avait
d’ailleurs déjà recommandé en son temps lorsqu’il évoquait les transformations de
l’équilibre -nous-je- et qu’il définissait la politique internationale contemporaine
comme étant, tout à la fois, l’œuvre d’une société mondialisée d’individus aux
réseaux plus denses que jamais et un ensemble d’Etats en interdépendance
croissante. En soulignant ainsi cette totale intrication de l’individu à la société et
celle de l’interne à l’international, Elias fut l’un des premiers à mettre l’accent sur le
paradoxe, souvent évoqué depuis, d’un développement conjoint des
particularismes et de la globalisation4 ».
On peut citer ici un autre exemple. Le travail de l’historien et celui du politiste ou
de l’internationaliste ne doit pas être distancié. La science politique se définit entre
autres comme la conviction profonde que les phénomènes sociaux sont
comparables et qu’une théorie générale est possible alors que l’histoire suivant la
définition de l’historien allemand Leopold Ranke ne se répète jamais5. Chaque
guerre, chaque révolution serait donc unique avec des causes spécifiques. Les
révolutions arabes en 2011 en témoignent. Chaque pays a ses propres spécificités.
La transitologie a trouvé sa portée mais la consolidologie tarde dans certains pays
(Egypte, Libye, etc.). Qui plus est, la science politique occidentale n’était pas
généreuse avec le monde arabe. Elle l’enfermait pendant des décennies dans un
autoritarisme éternel le situant en dehors de l’histoire. Les évènements successifs en
2011 ont surpris les politologues et les experts occidentaux les plus doués. La
combinaison immédiate entre le travail de l’historien et le politiste trouvera ici toute
sa dimension pour combler les failles des uns et des autres. Il existe une zone grise,
des théories intermédiaires où une coopération entre les deux disciplines est des
plus salutaires. Simultanément, écrire l’histoire juste est irréaliste6. Raymond Aron
3 Ibid. p. 208
4 Ibid. p. 217. Voir aussi Norbert Elias, La société des individus, Paris, Fayard, 1991 (1939).
5 Leopold Ranke, « On the Character of historical science », dans Georg Igger et all., (éds.), The theory and Practice of history,
Indianapolis, Boobs-Merril, 1973, pp. 36-38.
6 Thomas Lindemann, « Histoire et relations internationales », dans Olivier Philippe, op.cit.
9ABDELHAK AZZOUZI n’avait-il pas écrit à juste titre : « Il suffit d’imaginer l’historien essayant de raconter de la même façon ce qui s’est passé dans toutes les consciences de tous les soldats qui ont livré la bataille d’Austerlitz pour s’apercevoir que tous les livres qui ont été écrits sur toutes les époques de l’histoire de l’humanité, comptent probablement moins de pages qu’en exigerait ce récit impossible7 ». Comme le remarque Thomas Lindemann l’opposition entre science politique et histoire n’est donc pas celle de la théorie et de la description mais plutôt celle de l’explication généraliste et de l’explication particulariste. Nous avons bien suivi ce raisonnement dans la rubrique consacrée à la question du Sahara. Les vingt et un auteurs de cette rubrique ont dépassé l’histoire événementielle, tout en mettant en avant le poids des sciences juridiques, des structures, les forces profondes – telles que les forces économiques et les mentalités, les tractations régionales en passant par la culture, l’anthropologie pour comprendre et analyser les faits. Cela ne veut pas dire que nous avons ignoré l’histoire. Au contraire, nous l’avons abordée mais sous un angle où la discipline joint les autres branches des sciences sociales pour éviter l’extrémisme disciplinaire. Nous pouvons aller très loin dans l’analyse et dire que dans certains de ces articles, il y a une omniprésence d’enquêtes empiriques. Or en épluchant les ouvrages les plus célèbres en France en relations internationales, on observe qu’il y a peu d’enquêtes empiriques. Nous dirions la même chose de l’école américaine où les auteurs les plus savants comme Kenneth Waltz, Joseph Nye, Robert Keohane ou Robert Jervis sont appréciés en raison de leur réflexion théorique. On leur reproche de ne pas connaitre les ouvrages de première main, les ouvrages historiques. Dans cette rubrique sur le Sahara nous avons bien dissipé des contre-sens, des stéréotypes et nous avons mis en exergue la force du raisonnement loin de celui du simple historien qui se désintéresse de l’actualité et du politiste qui en est souvent le prisonnier. Démarquer la science politique de l’histoire uniquement par son sujet plus actuel risquerait de faire du politiste un journaliste un peu plus sophistiqué8. L’AMSRI évite cette lacune. Dans un ouvrage récent que nous avons écrit avec le Pr. André Cabanis9 (dont les grandes lignes ont été reprises par ce volume et nourries par d’autres contributions savantes), nous avons pu sortir de l’extrémisme de la discipline et réussir le pari de combiner entre le politique et le juridique. Nous avons refusé que l’analyse soit 7Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1967, p. 508. 8Thomas Lindemann, op.cit. 9 Abdelhak Azzouzi et André Cabanis, Le Néo-constitutionnalisme marocain à l’épreuve du printemps arabe, Paris, L’harmattan, novembre 2011. 10
INTRODUCTION
uniquement placée sous le signe de la pure science politique, ou simplement
conduite selon les canons de la simple technique juridique. C’est l’intérêt et la
difficulté de l’exercice que de vouloir faire appel aux deux méthodes, sans sacrifier
aucune et sans se contenter d’une simple juxtaposition. Pour comprendre et décrire
le champ politique marocain, l’on doit mettre en œuvre une juxtaposition de
démarches qui ont fourni la base de notre ouvrage sur « le Néo-constitutionnalisme
marocain à l’épreuve du printemps arabe » et l’actuel volume de l’Annuaire
Marocain de la Stratégie et des relations Internationales (voir les deux rubriques du
pôle 3 de l’AMSRI dirigées scientifiquement et intelligemment par les professeurs
Abdallah Harsi et Mohamed Fakihi) et le dernier article de la première rubrique du
pôle 1 ainsi que les deux parties de l’ouvrage sur le Néo-constitutionnalisme
marocain).
L’étude du printemps arabe célébré par beaucoup et redouté par quelques-uns, est
en tous cas générateur d’une mise en cause radicale des anciens équilibres institutionnels.
L’étude et la description de l’exceptionnalisme marocain à travers par exemple la
nouvelle loi fondamentale dont il s’est doté, est présentée comme une réponse aux
nouveaux défis politiques, originale notamment par la forme monarchique du régime.
En même temps, elle se veut en phase avec les tendances les plus modernes en
honneur dans le monde complexe des nouvelles formes de l’ingénierie
constitutionnelle, cette dernière traversée de toutes sortes de courants et de modes.
Le constituant marocain a puisé chaque fois que cela lui a paru nécessaire dans ce
que ses protagonistes eux-mêmes qualifient de « boite à outils » mais sans être dupe
des fausses nouveautés ou des transformations périlleuses. On aurait pu imaginer
de traiter ces deux éléments, d’ordre politologique et de type juridique, de façon
simultanée dans une description mêlant les attentes plus ou moins clairement
formulées par la population des pays arabes et les nouveaux articles introduits dans
le texte constitutionnel de 2011. On conviendra qu’il y aurait de l’artificiel dans
cette démarche dans la mesure où les modes de fonctionnement du politique et du
juridique sont différents et puisqu’un texte constitutionnel a d’abord un caractère
national, même si son adoption peut être mise en rapport avec des événements
internationaux de grande ampleur.
Pour autant, les liens à travers le dialogue des différentes disciplines sont réels. On
les a intégrés et soulignés chaque fois que cela a paru indispensable et nul doute
que le lecteur saura débusquer des influences croisées entre le développement dans
tous les pays arabes, le Maghreb et particulièrement au Maroc d’une vie politique
11ABDELHAK AZZOUZI de plus en plus active et un renouveau institutionnel accordant une large place au multipartisme au Maroc. Cela dit, restant toujours dans la nécessité du rapprochement entre les différentes disciplines, et plus particulièrement entre celle de l’historien et celle du politiste, nous avons essayé d’éviter les dénaturalisations des phénomènes. Nous exigeons du politiste de l’AMSRI à ce qu’il prenne en considération la dimension temporelle de ses analyses, sinon il commettra l’erreur de croire éternellement les choses qui sont en fait transitoires. De la même façon, une démarche totalement historique contribue à dénaturer les choses. Il est aussi normal par exemple que pour un historien, les facteurs aléatoires comme l’habilité diplomatique d’un homme d’Etat déterminent en grande partie la politique internationale. Les historiens et les sociologues n’ont jamais ignoré que le décideur-monarque, chef de l’Etat ou du gouvernement, vit entouré de conseillers, de courtisans et de ministres et qu’il ne décide pas tout seul. Des hommes ou des appareils lui transmettent des informations, d’autres hommes ou appareils traduisent ses ordres ou les trahissent. Comme le note le célèbre Raymond Aron, il y a quelques siècles, les favorites (ou favoris) passaient souvent pour des inspirateurs du prince et les historiens n’hésitaient pas pour autant à parler de la politique de la France ou de l’Angleterre, comme si ces entités ressemblaient à des personnes et agissaient à leur manière. Cette apparente contradiction se résout d’elle-même si l’on veut bien y réfléchir. Les Etats – les acteurs du système interétatique – sont gouvernés selon des méthodes différentes, depuis le permanent dialogue américain entre la Maison- Blanche et le Congrès jusqu’à l’absolutisme hypnotique de Hitler. Mais le Führer lui-même devait sa connaissance du monde extérieur à d’autres ; à d’autres il laissait la responsabilité d’accomplir ses volontés. D’un autre côté, le Président des Etats-Unis, quelles qu’aient été ses hésitations, ses conférences avec ses collaborateurs, les résistances du congrès, a finalement envoyé en Europe, au cours des années 1917-1918, des millions d’hommes et au Vietnam en 1965 un corps expéditionnaire de plus d’un demi-million d’hommes. Il en va de même pour Bush fils dans sa guerre contre Saddam et celle contre les talibans en Afghanistan. La structure d’un Etat organisé est telle que les décisions prises au sommet déclenchent une série d’effets, le plus souvent non prévus par les responsables, à supposer que l’on puisse les identifier. A l’heure présente, le décideur, qu’il soit le Président des Etats-Unis ou le Politburo au Kremlin, dépend non pas tant d’individus (conseillers ou favoris) que de bureaucraties, ou, si l’on préfère, 12
INTRODUCTION
d’organisations complexes dont chacune a ses intérêts propres en rivalité avec
d’autres10.
Cependant, le politiste accorde son attention exclusive aux facteurs impersonnels
comme la configuration du pouvoir ou le régime politique. Davantage de théories
sur « les frictions humaines » serait donc souhaitable et réfuterait les décideurs
accusant les universitaires de fournir des connaissances inutilisables11. Pour s’élever
au niveau de la théorie, nous n’avons jamais méconnu le rapprochement et le
dialogue entre l’historien et le politiste, entre l’économiste et le juriste (voir le pôle
sur l’économie marocaine dirigé avec brio par le Professeure Asmaa Aaloui Taib), le
spécialiste de la culture et l’anthropologue, etc. Comme le remarque Bertrand
Badie, « le recours à la culture, à l’anthropologie et à l’histoire suggère la revanche
de la connaissance individualiste sur la connaissance universalisante, le retour à ce
que Robert Nisbet appelle le concert singulier, aux dépens de l’universel abstrait12».
Le premier pôle de l’AMSRI essaye de corréler les différentes disciplines pour
étudier sans se dissoudre dans un éclectisme sans consistance, ou dans un
syncrétisme artificiel, la portée de la diplomatie marocaine à travers l’étude des
intérêts nationaux du Maroc par rapport au nouveau système international, les
relations du Maroc avec certains espaces régionaux comme l’Union européenne, les
Etats Unis, l’Afrique, l’Espagne, avec certaines organisations internationales, etc.
Nous avons analysé en recourant à une transdisciplinarité maitrisée la question du
Sahara marocain dans tous ses aspects avec des perspectives et des études
empiriques. Cela dit nous avons intégré dans ce pôle les avancées démocratiques et
l’exceptionnalisme politique marocain par rapport à son contexte régional et arabe.
Nous partons du principe que le lien interne/externe est déterminant. Comme le
note Aziz Hasbi dans ce volume, le Maroc a, comme tous les Etats, des intérêts qu’il
déclare vouloir défendre et ne cesse de le clamer. Mais il fait partie du groupe
d’Etats qu’on ne peut classer ni parmi les puissances capables d’imposer leur
volonté aux autres Etats et dicter les règles qui influent sur le système international,
ni parmi ceux qui critiquent la situation internationale et peuvent obtenir la réforme
des normes qui permettent aux superpuissances d’établir les règles du jeu. Il
appartient donc à la catégorie des Etats qui subissent celles-ci et tentent tant bien
que mal de profiter des contradictions entre les grands et des opportunités que
permet le système économique international, qui est plus ouvert et plus intégré que
10 Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 2004 (1962), p. X-XI
11 Ibid.
12 Bertrand Badie, Politique Comparée, Paris, PUF, 1990, p. 25.
13ABDELHAK AZZOUZI le système politique interétatique. Pour ce faire, le pays se donne une identité d’Etat démocratique et un rôle de pays légaliste, ouvert et attractif. Sa démarche favorise plutôt la séduction que la contrainte. Celle-ci n’est envisagée que modérément et en cas d’atteinte aux intérêts considérés comme « vitaux », tels que la survie de l’Etat, de la monarchie, la violation de l’intégrité territoriale, une agression étrangère caractérisée contre les populations, etc. En d’autres termes, le Maroc fait partie des pays qui essayent de consolider l’identité d’un Etat démocratique et intégrer le système international en se basant sur cette force universelle qu’est la démocratie bien enracinée par rapport aux autres pays voisins et arabes. Il s’agit d’une force en elle-même face à l’absence des moyens de puissances (par exemple économiques et militaires). L’article sur « le printemps arabe et l’exceptionnalisme marocain : Autour des jeux d’interaction et des arrangements institutionnels entre les Etats et les forces politiques dans les pays du Maghreb. A la racine de l’herbe » s’inscrit dans cette volonté de montrer le lien entre l’interne et l’externe dans la défense des intérêts nationaux du Maroc sur le plan régional et international. Le Maroc, faute de ressources naturelles énormes comme le pétrole – qui achète la paix sociale dans la majorité des pays arabes pétroliers-, n’aura pas cette position aujourd’hui sur la scène mondiale s’il n’avait pas grimpé les échelons en matière de démocratie et de libéralisation économique. Le processus récent au Maroc intervenu dans le cadre du printemps arabe et à la suite du discours historique du monarque du 09 mars 2011, conduit à contester les vieilles pratiques autoritaires au nom des valeurs de liberté et de bonne gouvernance. Elle est fondée sur une étude comparative avec les pays arabes et les trois principaux pays du Maghreb avec une recherche des tenants et des aboutissants du mouvement populaire ayant démarré avec la révolution du Jasmin. Pour analyser ces événements, nous avons déterminé la part d’explication attribuable aux stratégies des acteurs, notamment des élites politiques au pouvoir, mais aussi des forces d’opposition ou, en tous cas de contestation. Elles se déploient sous l’influence d’un certain nombre de contraintes, tels les héritages institutionnels ou encore les clivages partisans si bien que l’on peut parler de « stratégies encadrées par les contraintes ». Se traduisant par des phénomènes de chevauchements, d’interactions, de tractations, d’attentes… elles produisent des résultats inattendus et incertains. Cela s’inscrit donc, à la suite de Joseph Schumpter et de Robert Dahl, dans le consensus relatif à la définition procédurale de la « démocratisation » qui met l’accent sur les arrangements institutionnels. L’extension du champ de la participation et de la représentation politiques par 14
INTRODUCTION
l’introduction de nouveaux mécanismes comme le bicamérisme et à travers le choix
des modes de scrutin, est très révélatrice du fonctionnement des institutions
représentatives. Ces dernières influent largement sur les dynamiques dans
lesquelles les acteurs sont engagés et contribuent à expliquer la portée et les limites
du printemps arabe. Il faut replacer ce dernier dans le cadre plus général du
phénomène de contestation dont les gouvernements autoritaires sont, depuis
quelques années, l’objet dans cette partie du monde notamment. Parfois, ce fut par
une intervention militaire extérieure, comme en Irak que le dictateur a été renversé
et l’on a pu constater les incertitudes liées à une telle procédure, telle que les
populations ne sauraient s’approprier aisément les changements politiques.
Ailleurs, les transformations sont le résultat soit de révolutions populaires comme
en Tunisie et en Egypte, voire en Syrie, soit d’un pacte politique comme au Maroc.
Le parti pris d’ouverture sur le comparativisme incite à utiliser les grilles
d’explication de Philippe Schmitter et Terry Lynn Karl, spécialistes des
democratizations studies. A partir des investigations qu’ils ont conduites en
Amérique latine et ailleurs dans le monde, ils observent quatre types de transition :
par révolution, par imposition, par pacte et par réforme. A leurs yeux et à nos yeux
(les évènements actuels dans les pays arabes en témoignent), seule la transition par
pacte est susceptible de conduire à une démocratie solide. Ce pacte est
naturellement parachevé par d’autres variables comme le constitutionnalisme et la
tenue des élections libres et concurrentielles. De tels procédés politiques
aboutissent, pour paraphraser Adam Przeworski, à institutionnaliser l’incertitude et
à permettre aux acteurs d’agir dans un cadre stable dans lequel ils peuvent
défendre leurs propres intérêts. Appliqués aux trois pays du Maghreb central, ces
méthodes anglo-saxonnes conduisent à comparer les itinéraires politiques de
chaque Etat, avec en Tunisie une forme de « dynastie républicaine » qui a été
confrontée à la révolution du Jasmin tandis qu’en Algérie, c’est un « despotisme
collégial » qui permet au système de se maintenir, conforté par la crainte de voir
ressurgir les affrontements récents qui ont déchiré le pays. Si l’on peut parler ici
d’exception marocaine, ce n’est pas pour en dresser un portrait idéalisé mais au
contraire pour rappeler le long cheminement qui aboutit à ce que les partis
d’opposition, sollicités par la monarchie, finissent par accepter de participer aux
responsabilités de l’exercice du pouvoir. Désormais, chacun s’emploie à mettre en
place des arrangements institutionnels susceptibles de répondre aux promesses de
libéralisation politique. L’idée de pacte politique évoquée plus haut sert de fil
directeur aux tentatives d’explications. Ce pacte était absent dans la Tunisie de Ben
Ali. En Algérie, il est soumis au bon vouloir de l’armée.
15ABDELHAK AZZOUZI Ce pacte politique donne une crédibilité à la politique étrangère du Maroc menée par ses mécènes et pourra avoir plus de portée si ce potentiel est utilisé aussi à bon escient par les différents acteurs de ce pacte politique (sur le plan international) à commencer par les partis politiques (on parlera de la diplomatie partisane) sans oublier la diplomatie parlementaire, la diplomatie économique (effet de stabilité) et enfin celle de la société civile. Les études savantes intégrées dans les rubriques et pôles de l’AMSRI s’inscrivent dans un cadre d’analyse qui intègre une transdisciplinarité maîtrisée et dépasse les cloisonnements académiques les plus rigides. Mais il brille par le nombre d’informations considérables qui ne figurent toujours pas dans les exercices académiques français comme l’Annuaire Français des Relations Internationales, Critique Internationale, Cultures et conflits, Politique africaine et la Revue Internationale des Sciences Sociales, ou la lignée que la section d’études internationales (SEI) de l’Association française de science politique (AFSP) inscrit depuis une date récente son action. Il s’agit dans le cadre de l’AMSRI d’une véritable banque de données qui servira, parallèlement aux études sérieuses qu’il offre, des données brutes et nettes pour d’autres recherches (rapports, chronologies, etc.), sans lesquelles on ne peut progresser dans les analyses, les jugements ou les raisonnements. Compétitivité, audace dans la recherche et vigueur des arguments sont les fondements de l’entreprise intellectuelle de l’AMSRI. Sa publication simultanée en trois langues souligne l’originalité du travail et sa dimension mondiale. Une conception souple des canons de la scientificité permet d’éviter d’assécher l’imagination et conduire à des impasses. L’on peut conclure que l’AMSRI dans son premier volume est conforme au mode de présentation standardisé des publications de référence. Il reste à mercier tous ceux nombreux qui ont accepté rapidement et intelligemment de contribuer à la rédaction et la préparation de ce premier volume – co-directeurs de l’AMSRI les Professeurs Asmaa Alaoui Taib, Abdallah Harsi et Mohamed Fakihi qui ont passé avec moi des jours et des nuits à concevoir, à corriger, à rédiger, à traduire ou à recorriger les traductions en arabe, en français et en anglais de l’AMSRI. Ils méritent de partager avec moi les honneurs ainsi que tous les membres actifs du CMIESI. Nous avons aussi une grande dette à l’égard du comité scientifique, du comité de traduction, du comité de parrainage et de sponsoring, dans un domaine où l’on ne vit que de ses différences. Leurs qualités humaines, leur amitié, leur disponibilité ont entretenu en nous une très grande envie de continuer. Je tiens enfin à remercier les auteurs de l’AMSRI et la qualité de 16
INTRODUCTION
leur concours. Cela montre que l’AMSRI répond à un besoin, et qu’il peut
s’appuyer désormais sur un réseau très diversifié d’experts.
17Vous pouvez aussi lire