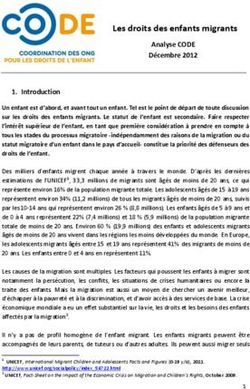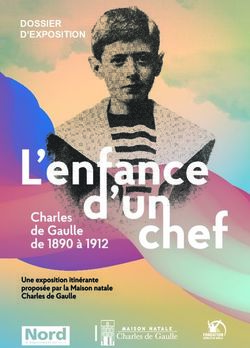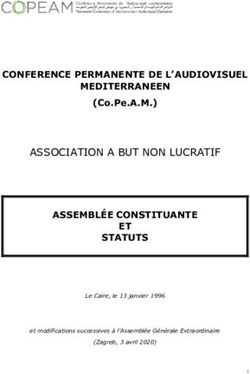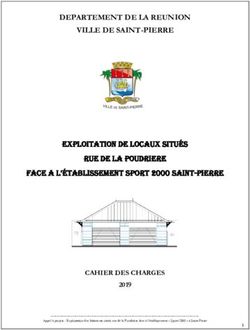Barthes lecteur de Malraux : une occultation terroriste par Julien Dieudonné
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Barthes lecteur de Malraux : une occultation terroriste
par Julien Dieudonné
(Université Paris III - Sorbonne Nouvelle)
La récente biographie qu’Olivier Todd a consacrée à Malraux(1) a
rencontré en France et dans les pays francophones un accueil critique,
plus exactement médiatique (tant, précisément, la réception a manqué de
recul critique) hors du commun. En France, la plupart des suppléments
littéraires des grands quotidiens (Libération, Le Figaro, Le Monde)
comme des hebdomadaires d’information (Le Nouvel Observateur,
L’Express, Le Point, Marianne), et jusqu’à la sacro-sainte et désormais
feue émission de télévision Bouillon de culture de Bernard Pivot, lui ont
consacré couvertures, articles de première page, dossiers ou émission
spéciale. C’était, en général, pour se féliciter d’une opération de
démystification réussie et saluer les révélations (pourtant minces) sur les
mensonges, inventions et délires mythomaniaques de l’écrivain
panthéonisé en 1996 — sans que l’on prenne trop la peine, ni de
mesurer l’apport réel du travail du biographe après les livres de Robert
Payne, Jean Lacouture ou Curtis Cate(2) , ni de relever les nombreuses
erreurs, insinuations, ou manipulations qui émaillent le livre. Bref, tout
s’est passé comme si l’ouvrage de Todd levait un tabou, et permettait
qu’enfin et au grand jour éclate une imposture : l’imposture d’un faux
grand homme, dont les rendez-vous réguliers avec l’Histoire auraient
été autant de fiascos, et surtout d’un faux grand écrivain, dont la
création serait surestimée. Car les griefs de Todd envers Malraux ne
s’arrêtent ni à l’homme, ni même à l’homme politique : ils touchent à
l’œuvre même, dont ne subsistent, au terme de la biographie, que
pochades d’adolescent, romans au mieux à demi ratés, écrits sur l’art
amphigouriques et mémoires, fussent-elles Antimémoires, falsifiées.
À cet obstiné déboulonnage, il s’est trouvé bien peu de voix pour
répondre en dehors de l’étroit cercle des spécialistes, forcément suspect
de partialité. C’est que l’opération a trouvé dans le milieu intellectuel et
universitaire un terrain d’avance favorable : la figure de Malraux, celle
de l’écrivain comme celle de l’homme, y jouit, au moins depuis la mort
de l’auteur en 1976, d’une singulière désaffection.
A celui qui voudrait comprendre les raisons d’une révulsion siconstante, il a semblé que les quelques propos que Barthes consacre à
Malraux pouvaient offrir une manière de précipité particulièrement
instructif. Lorsque Barthes lit Malraux, l’on retrouve en effet entremêlés
deux griefs, l’un politique, l’autre rhétorique, qui ne sont pas étrangers à
la désaffection contemporaine, ni aux anathèmes du dernier biographe
en date.
Le premier constat est déjà fort révélateur : c'est celui de la
maigre présence, pour mieux dire : de la quasi absence de Malraux, dans
les textes de Barthes. Sur les 3700 pages des Œuvres complètes(3) , on
ne compte qu'un seul texte réellement consacré à Malraux et seulement
douze mentions de son nom, la plupart dans le cadre d'entretiens.
Lorsqu'elle est incluse dans un livre ou un article, la mention n'apparaît
qu'au détour d'une note. Présence littéralement marginale : visiblement,
pour Barthes, l'œuvre de Malraux ne compte pas — plus exactement : ne
compte plus. Car cette occultation masque un déni. C'est que Barthes n'a
pas toujours été, si l'on ose dire, si “ malruçophobe ”. Dans un entretien,
“ Critique et autocritique ”, publié dans Les Nouvelles littéraires le 5
mars 1970, il évoque ses lectures de jeunesse :
A ce moment-là [vers 1936], je n'avais pas d'approche véritable vers
la littérature. Les écrivains contemporains que je connaissais,
c'étaient les grands noms : Gide, Valéry ; ou alors ceux qui arrivaient
dans une sorte d'atmosphère d'avant-garde : Malraux ou Céline, par
exemple." (II 988).
L’on notera que l'aveu ne se fait pas sans réserve. Cette “ sorte
d'atmosphère d'avant-garde ” laisse supposer qu'y entre une part de
supercherie. D’ailleurs Barthes prend soin d'ajouter : “ Adolescent, j'ai
été un très grand lecteur, sinon un très bon lecteur ; après, j'ai moins lu.
” (ibid.) Mauvais lecteur : autre façon de dire lecteur de mauvaises
littératures ?
Mais l'on parlait d'un texte, un seul, consacré à Malraux. Il s'intitule “
Opinion sur André Malraux ”. Il a été écrit à l'occasion de la mort
d'André Malraux et publié dans Le Nouvel Observateur, le 23 novembre
1976. Il fait une ligne et demie. L’on nous pardonnera de le citer
intégralement :Ce qui me dépaysait en lui, c'est que j'avais l'impression qu'il était
intelligent par hasard. (III 453)
C'est laconique. On ne peut même pas dire que ce soit poli. C'est une
façon comme une autre d'évacuer les livres.
Mais voici Barthes critique. Pas n'importe où. Aux Lettres Nouvelles,
temple de la nouvelle critique. Dans le numéro 8, le 22 avril 1959,
Barthes affronte le Ministre de la Culture. Malraux vient de lancer sa
réforme des Théâtres nationaux. Le projet est ambitieux. Pas assez. Sous
le titre “ Tragédie et hauteur ”, voici ce qu’écrit Roland Barthes :
Par l'écart des prétentions et des décisions, la dernière réforme des
Théâtres nationaux a quelque chose d'encore plus bouffon que les
autres. (I 814)
Le ton est polémique. Malraux, écrit Barthes, “ parle le langage
de la révolution totale, tout cela pour faire jouer un peu plus Racine et
Claudel, un grand écrivain catholique et notre classique le plus choyé ”
(Ibid.). Et, poursuit-il, pour mettre à la tête des théâtres Nationaux des
administrateurs et des artistes “ formés, promus dans ce même régime et
cette même esthétique qu'ils ont charge de liquider au nom d'une
nouvelle idée de la culture ” (ibid.). Barthes conclut sa diatribe : “ On ne
peut contenter M. Kemp et la révolution : il faut choisir. Malraux a
choisi M. Kemp. ” (I, 814).
Nous sommes au cœur du problème à la fois politique et générationnel
que pose Malraux après-guerre. Le problème, c'est son gaullisme dans
une France où les intellectuels et la nouvelle critique se piquent de
marxisme, où l'Université prépare son mai 68. Un gaullisme d’autant
plus scandaleux qu’il est celui de l’ex-champion d’une littérature
engagée avant l’heure, celui du contempteur du colonialisme
indochinois, du militant anti-fasciste, du romancier du Temps du mépris
et du fondateur de l’Escadrille Espaða. Bref, le problème de Malraux,
c’est moins encore son gaullisme que son revirement : sa trahison. Aussi
est-il rejeté avec violence dans le camp des réactionnaires.
L’on retrouve aujourd’hui ce grief politique, mais renversé. C’est
désormais moins le gaullisme de Malraux qui suscite la suspicion et la
condamnation que son compagnonnage communiste des années trente
ou son entrée, jugée tardive, dans la Résistance. Olivier Todd, dans un
chapitre intitulé “ Les camarades soviétiques ”, parvient ainsi (au prix
d’une manipulation des dates des interventions de l’écrivain et d’unereconstitution douteuse des événements(4) ) à faire de celui qui, au
premier Congrès des écrivains soviétiques de Moscou, en août 1934, ose
dénoncer le dogme du réalisme socialiste et affirmer le droit
imprescriptible de l’artiste à créer hors de toute doctrine idéologique, un
zélateur de Staline. Mais pour avoir changé de figure ou de couleur, le
grief demeure identique : il s’agit toujours de masquer une œuvre
derrière un personnage publique et, au nom d’une axiologie de ses
prises de position publiques qui fluctue au gré des époques, de
condamner unanimement l’œuvre et la personne.
Bien sûr, ce rejet, quand il se fait, comme chez Barthes, au nom
du marxisme, n'est pas toujours simple. Car Malraux est malgré tout
l'auteur de L'Espoir. Lucien Goldmann ne s'y trompe pas lorsque, dans
son ouvrage Pour une sociologie du roman, qui paraît en volume en
1964, il choisit L'Espoir pour illustrer sa thèse, d'obédience marxiste. Il
en fait l'exemple même de ces romans à héros problématique dont les
valeurs qualitatives se heurtent à “ une société productrice pour le
marché ”, où les valeurs d'usage disparaissent au profit des valeurs
d'échange. L'Espoir est le modèle aussi d'un roman où “ les véritables
sujets de la création culturelle sont les groupes sociaux et non pas les
individus isolés ”. Bref, pour Goldmann, Malraux est l'auteur d'un grand
roman marxiste, fût-ce malgré lui.
Lorsque Barthes rend compte de l'ouvrage de Goldmann, dans "Les
deux sociologies" (France Observateur, 5 décembre 1963), c'est sur le
ton de l'éloge. Mais comment concilier cet éloge et l'embarrassante
promotion au rang de modèle des romans de Malraux ? Barthes s'en tire
par un adjectif.
Dans les romans à héros problématique […], il y a coïncidence
directe, immédiate, entre la structure économique et la structure
romanesque, entre l'inauthenticité du monde où vit le héros et le règne
tout-puissant d'une économie où les valeurs d'échanges (“ réifiantes ”)
ont supplanté les valeurs d'usage, auxquelles le créateur et son héros
restent pourtant attachés ; de Stendhal au premier Malraux, ce type de
romans correspond bien au développement de la bourgeoisie, mais n'est
nullement l'expression de la conscience collective bourgeoise. (I 1148)
Ainsi y aurait-il un premier Malraux, heureusement révolutionnaire ;
mais un second honteusement réactionnaire.
Il y a plus : l’existence embarrassante du second justifierétrospectivement que soit mis au soupçon la sincérité ou la fiabilité du premier. Revenons à “ Tragédie et hauteur ”, le texte que Barthes consacre à la réforme des Théâtre nationaux. L'on y surprend en effet comment Barthes glisse d'un point de vue politique à un point de vue rhétorique, et comment la disqualification de la figure de l’écrivain peut gagner jusqu’au premier Malraux en empruntant le masque d’un grief rhétorique. Car une fois remise en cause la sincérité des velléités révolutionnaires du Ministre, toutes les protestations d'ambition révolutionnaire, et plus fortes et plus insistantes elles sont, sont lues comme autant de signes d'un verbalisme qui cherche à dissimuler sous une rhétorique progressiste des ambitions de mainteneur, des visées de réactionnaire. Le texte de Barthes ne cesse de dénoncer dans le discours du Ministre un “ alibi ”, de fustiger une “ économie astucieuse ” (I 815). Malraux, explique Barthes, se contente d’emboucher la "trompette de l'humanisme où [il] reste imbattable" (I, 814-815). Le point de vue de Barthes sur la rhétorique de Malraux est donc celui d'un terroriste, au sens que Paulhan a donné à ce terme dans ses Fleurs de Tarbes, toujours prêt et prompt à voir dans les mots de l'autre, la trace d'un verbalisme. Il faut jouer haut et grand, proclame Malraux. Délit de formalisme rétorque Barthes : La hauteur est une vertu d'écriture, un drapé d'âme, ici l'alexandrin, là le castillanisme des passions. […] On définit [la Tragédie] uniquement comme un ton, une façon décorative d'articuler les sentiments. (I, 815) Dès lors, lorsque Barthes aborde (rarement) l'écrivain Malraux, c'est pour le rejeter de la même façon dans le camp des mainteneurs, des dinosaures d'une littérature dépassée. C'est le thème du grantécrivain, le plus récurrent dans les propos de Barthes sur Malraux. Dans un entretien donné au Figaro le 27 juillet 1974, “ Roland Barthes contre les idées reçues ”, Barthes affirme : La littérature a été un objet défini historiquement par un certain type de société. La société changeant, inéluctablement, soit dans un sens révolutionnaire, soit dans un sens capitaliste, la littérature (au sens institutionnel, idéologique et esthétique que nous donnions naguère à ce mot) passe : elle pourra ou s'abolir complètement ou modifier à tel point ses conditions de production, de consommation et d'écriture, bref sa valeur, qu'il faudra bien en changer le nom. Que reste-t-il déjà des formes de l'ancienne littérature ? Quelques modes de discours, des maisons d'édition, un public fragile, infidèle, miné par la culture de masse, qui n'est pas littéraire : les grands mainteneurs de littérature s'éloignent : Aragon et Malraux disparus, il
n'y aura plus de "grands écrivains". (III 72)
Barthes revient sur cette notion dans un entretien avec Maurice
Nadeau (“ Où/ou va la littérature ? ”) :
On constate un abandon, en quelque sorte national et social, de la
grande littérature et de son mythe. […] Du mythe de l'écrivain
également, car actuellement, aucun écrivain ne tient la place que
tenaient des gens comme Valéry, comme Gide, comme Claudel, même
comme Malraux à cette époque. (III, 64) (5)
Selon Barthes, Malraux appartient donc à une ère de la littérature qui est
au mieux en train de pourrir, au pire déjà morte. Le grantécrivain, la
figure du maître à penser n'a plus lieu d'être. Il doit donc être l'objet
d'une défétichisation, que Barthes définit comme l'entreprise propre de
son geste critique, comme ce qu'il a retenu de ses maîtres, Marx et
Sartre :
Ce qu’ils m’ont apporté essentiellement l’un et l’autre (je crois du reste
que c’est ce qui les réunit, peut-être même la seule chose qui les réunit),
c’est un développement aigu du pouvoir critique que j’appellerai, d’une
façon plus prétentieuse, mais plus juste aussi, le pouvoir de “
défétichisation ”, l’énergie sans cesse en alerte pour défétichiser les
valeurs, les idoles, les rites de l’institution sociale. (II, 989)
Mais Sartre ? N’est-il pas précisément, durant ces années 70, avec
Aragon et Malraux, l’exemple même du grantécrivain engagé ? Pour
Barthes, Sartre échappe à son statut en ce qu'il incarne moins la figure
dépassée du grantécrivain que son incarnation ironique. C’est ce qu’il
confie à Jacques Chancel dans un entretien qui date de 1975 :
Il y a un homme qui fait la charnière, qui se situe justement au point de
désagrégation historique de la littérature, c'est Sartre. Parce qu'au fond il
a tenu et tient encore cette sorte de leadership de la culture et de la
littérature ; mais comme précisément son œuvre même se définit comme
une destruction du semblant littéraire, de la prose littéraire, par là même,
il a contribué puissamment à la destruction du mythe littéraire. (III, 345-
346).
Sartre occupe donc une position double : à la fois dernière incarnation et
fossoyeur du grantécrivain — défétichisateur de lui-même.
Mais revenons à Malraux, et franchissons avec Barthes l'ultimeétape de l'occultation défétichisante : si Malraux est un mainteneur, c’est qu’il appartient à un temps de l'écriture révolu et maintient de ce fait aussi des formes de littérature dépassées. On glisse du personnage du grantécrivain à une pratique de l'écriture qui lui est associée et qu'on pourrait définir comme une confiance dans le langage, ou, en terme sartrien, l'exercice d'une écriture littéraire de la bonne conscience. En 1957, dans “ Le Mythe aujourd'hui ”, appendice à ses Mythologies, Barthes évoque son Degré zéro de l'écriture : mise au jour de “ la subversion de l'écriture ”, du dévoilement propre à la modernité littéraire (que Barthes fait remonter à Flaubert) de l'écriture “ comme signifiant ”, comme “ acte radical par lequel un certain nombre d'écrivains ont tenté de nier la littérature comme système mythique ” (I 702). Or une note vise précisément à rejeter Malraux hors de cette révolution de la littérature moderne : il y a bien un style Malraux, et donc une conscience du travail d'écriture comme jeu sur le signifiant, mais la note précise : Le style est une substance sans cesse menacée de formalisation : d'abord il peut très bien se dégrader en écriture : il y a une écriture-Malraux, et chez Malraux lui-même. (I 701) L'on retrouve l'accusation de formalisme, mais déplacée du discours à l'écriture, de l’homme à l’œuvre. Alors, quel mythe substituer à celui du grantécrivain ? Où est la littérature, si elle a déserté son champ traditionnel ? Où va la littérature après la rupture épistémologique de la modernité ? Qui est, pour Barthes, véritablement écrivain ? C’est celui dont le “ texte […] fait éclater les contraintes de la lisibilité classique, c'est-à-dire les textes que la plupart d'entre nous déclarent illisibles, mais qui, à partir du moment où l'on essaie de réinventer une façon de lire devient un texte exemplaire, parce que c'est précisément un texte où le signifié, comme nous le disions tout à l'heure, est expulsé vraiment à l'infini, et où demeure simplement un réseau extrêmement proliférant de signifiants." (II, 994). Barthes reconnaît dans cette définition un texte et un écrivain : c'est Sollers. Dans Sollers écrivain, en 1979, à propos de H et de son mode de lecture, Barthes écrit : Le texte s'offre à des lecteurs qui ne vivent pas dans le même temps de lecture (même s'ils sont biographiquement contemporains). Certains veulent lire H comme un roman (et ils sont déçus) ; d'autres sont dans l'avant-garde de 1930 ; d'autres se mettent enfin postulativement dans l'avenir (même si, demain, ce ne sera pas ce texte-là), en sachant que cet avenir n'est pas seulement progressif et qu'il comporte dialectiquement des retours, des contretemps : un lecteur de Dante ou de Rabelais est
sans doute plus proche de H qu'un lecteur de Malraux. (III, 959)
Voici définitivement sonnée l’exclusion de Malraux hors du
champ d’une littérature moderne et de son œuvre hors de la littérature
présente, c’est-à-dire non pas seulement contemporaine, mais qui fasse
écho aux préoccupations de langage de la modernité. Voici sonné son
rejet dans une conception référentielle de la littérature, du côté du
signifié : soumise à la relation d'évènements, à la transmission d'idées.
Pas du côté du signifiant et de sa jouissance.
Ce rejet est l’une des clefs de la désaffection universitaire
contemporaine pour l’œuvre malrucienne. Celle-ci a en partie raté le
coche de la nouvelle critique et de la linguistique moderne, et de ses
traductions théoriques universitaires des années soixante et soixante-dix
: sémiologie, poétique du texte et narratologie. Aujourd'hui encore,
quand un poéticien s'intéresse à Malraux(6) , c'est pour tenter, à partir de
l'exemple de La Condition humaine, de construire le modèle d'une
poétique des valeurs. L'attention est une nouvelle fois détournée vers le
sens, le signifié, ou pire : le message. Il faut dire que la critique
universitaire malrucienne n'a pas toujours combattu cette affiliation de
l'œuvre de Malraux à une littérature du référent avec suffisamment de
vigueur : soit qu'elle ait pris le parti du grand écrivain et du grand
homme contre ses contempteurs quitte à verser dans une direction
hagiographique ; soit qu'elle ait souvent commencé par lire les textes
malruciens d'un point de vue thématique, historique ou philosophique. Il
lui appartient encore, mais le travail est en cours(7) , d'extraire l'œuvre
malrucienne du purgatoire où le terrorisme textuel de la nouvelle
critique l'a rejetée et de dévoiler avec force la modernité poétique des
textes et l’ensemble de ce que l’œuvre a à nous dire sur certains des
enjeux de la littérature moderne et contemporaine.
1-Olivier Todd, André Malraux, une vie, Paris, Gallimard, 2001. (...
2-Robert Payne, André Malraux, Paris, éditions Buchet/Chastel, 1973 et
(nouvelle édition complétée), 1996 ; Jean Lacouture, André Malraux. Une vie
dans le siècle 1901-1976, Paris, Seuil, 1973 ; Cutis Cate, André Malraux, Paris,
Flammarion, 1994.(...
3-Roland Barthes, Œuvres complètes, Paris, Seuil, t. 1 : 1993, t. 2 : 1994, t. 3 :
1995. Toutes nos citations renvoient aux trois tomes de cette édition,
respectivement abrégé I, II et III.(...
4-Voir Jean-Pierre Morel, “ Le Congrès de Moscou (1934) ”, à paraître dans
Malraux, d’un siècle l’autre, actes du colloque de Cerisy-la-Salle 24-31 août2001, Paris, Gallimard et Julien Dieudonné, “ Pensée sur l’art et engagement politique chez André Malraux : les discours des années 30 et le réalisme socialiste ”, à paraître dans L’Ecole des Lettres, numéro spécial Malraux, novembre 2001.(... 5-Barthes y revient encore dans un entretien avec Jacques Chancel le 17 février 1975 (III 345), dans "Préface-entretien à Littérature occidentale", R. Laffont, 1976 (III, 429)(... 6-Vincent Jouve, Poétique des valeurs, Paris, Seuil, 2001.(... 7-L’on peut renvoyer le lecteur aux travaux de Henri Godard et de Jean-Claude Larrat sur la conception de la littérature malrucienne, de Jacques Lecarme sur l’apport malrucien à une théorie et à une pratique de l’autobiographie. (...
Vous pouvez aussi lire