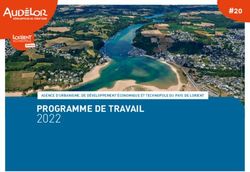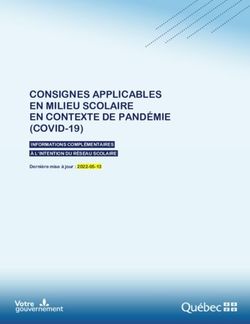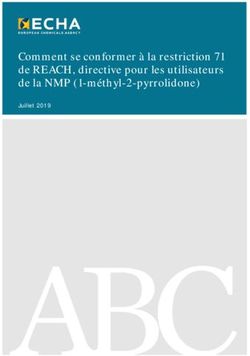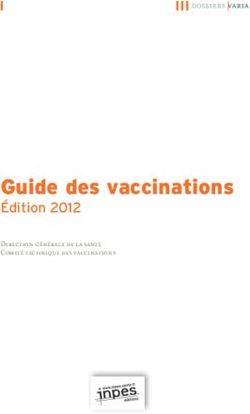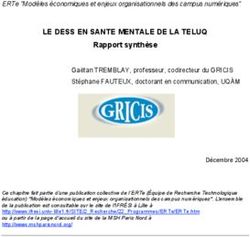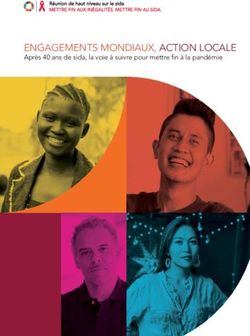Conjoncture 2020-2021 dans un contexte de pandémie - Conseil confédéral 23 et 24 septembre 2020 - CSN
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Conjoncture 2020-2021
dans un contexte de pandémie
Conseil confédéral
23 et 24 septembre 2020Table des matières
Préambule ........................................................................................................................................................5
1. Économie, finances publiques et travail .............................................................................................. 9
• Environnement .............................................................................................................................................. 10
• Sécurisation du revenu ............................................................................................................................... 11
• Santé et sécurité du travail........................................................................................................................ 12
• Le télétravail en accéléré ........................................................................................................................... 13
• Perspectives d’action – économie, finances publiques et travail .............................................. 15
2. Services publics ........................................................................................................................................... 17
• Santé et services sociaux ............................................................................................................................ 17
• Services de garde, milieu scolaire et enseignement supérieur .................................................. 19
• Négociations du secteur public ............................................................................................................... 20
• Perspectives d’action – services publics .............................................................................................. 22
3. Vie syndicale en temps de COVID-19 .................................................................................................. 23
• Perspectives d’action – vie syndicale .................................................................................................... 25
Un mouvement en action ....................................................................................................................... 27
Annexe 1 - État des travaux .................................................................................................................. 29Préambule Personne n’aura vu venir l’ampleur de cette crise. Elle aura eu le mérite, s’il s’en faut, de mettre au jour les nombreuses failles que la société québécoise a laissées s’infiltrer, lentement mais sûrement, au sein de notre tissu collectif. Qu’on pense aux conditions salariales des préposé-es aux bénéficiaires et de l’ensemble des salarié-es du secteur public, à l’ingérence maligne du privé dans les centres pour aînés, au manque de protection engendré par le travail atypique ou encore aux inégalités sociales révélées par la crise, celle-ci aura tout autant démontré les limites de ce modèle québécois soumis au virage néolibéral des trente dernières années que la pertinence de nos revendications au cours de cette même période. La nature de cette crise est double : d’abord une crise sanitaire qui, pour être maîtrisée, doit laisser place à des mesures qui chamboulent l’un des aspects les plus profonds de nos vies : les rapports humains. Les mesures de confinement et de distanciation affectent de larges pans de nos vies sociales, économiques et psychologiques, tout en forçant une révision de plusieurs aspects du travail. La crise est ensuite économique. En fonction de la mise sur pause de l’économie – en avril, c’est plus de 40 % de l’économie québécoise qui fut arrêtée, aux dires du ministre des Finances – des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs ont perdu leurs revenus habituels. C’est en fonction de cette double réalité que nous avons dû, dans un premier temps, articuler nos actions : exiger des mesures de protection sanitaire au travail et exhorter les différents paliers de gouvernement à mettre en place des mesures de protection financière pour les travailleuses et les travailleurs affectés par l’arrêt de leur secteur d’activité ou encore, faut-il se rappeler, forcés à se confiner en raison de la maladie. Ce sont les travailleuses et les travailleurs qui ont dû encaisser de plein fouet les impacts de la crise : hausse importante du taux de chômage; chute substantielle des revenus; suspension de pans entiers des conventions collectives pour celles et ceux visés par les arrêtés ministériels; expérimentation forcée du télétravail alors que les écoles et les services de garde sont fermés; risques accrus en matière de santé et de sécurité, certains ayant succombé à la maladie après l’avoir contractée dans leur milieu de travail. Comme toute crise, celle que nous traversons exacerbe de multiples formes d’inégalités. Les études de prévalence démontreront que les femmes, les familles à faible revenu ou issues des communautés culturelles et les personnes les plus vulnérables auront été plus touchées, tant du point de vue sanitaire que financier. Non seulement la crise renforce les fractures sociales, elle en fait également apparaître de nouvelles. Les Québécoises, dont un grand nombre sont des femmes de différentes origines ethnoculturelles, sont fortement majoritaires au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Elles sont plus nombreuses en première ligne et, de ce fait, plus touchées par la contagion. Plus nombreuses à toucher un bas salaire, elles sont sujettes à une charge mentale plus importante, d’autant plus qu’elles sont nombreuses à être cheffes de famille
6 – Analyse de la conjoncture présentée au conseil confédéral de septembre 2020
monoparentale ou proches aidantes. Et comme il a été tristement constaté, l’isolement
provoqué par les mesures de confinement a accentué les problèmes de violence domestique.
La situation du Québec est pour le moins paradoxale : objectivement, nous sommes la
province canadienne la plus touchée par la COVID-19. En termes de cas confirmés et du
nombre de décès, nous flirtons avec les pires endroits touchés de toute la planète. Pourtant,
faut-il le rappeler, nous sommes aussi l’un des endroits à déconfiner le plus rapidement.
Malgré ces contradictions, force est de constater que le gouvernement de François Legault
trône impérialement en tête des sondages. Le taux de satisfaction à son endroit continue de
rivaliser avec les scores de l’ancien bloc soviétique. Si des élections avaient lieu aujourd’hui,
près d’un électeur sur deux voterait pour la CAQ, selon les derniers sondages.
Que l’on soit en accord ou pas, on ne peut ignorer une telle réalité. Les Québécoises et les
Québécois, nonobstant les nombreux écueils rencontrés, sont majoritairement satisfaits de
la gestion de crise de François Legault et de son équipe. Nous devons prendre la pleine
mesure de ce constat dans l’élaboration de nos réflexions et de nos stratégies d’action.
La rentrée politique à Québec sera marquée par la mise à jour économique du gouvernement,
prévue pour novembre, et par le dépôt annoncé d’une nouvelle mouture du projet de loi no 611
visant la relance économique du Québec. Autant d’occasions pour nous de mettre en avant
nos revendications et notre vision d’une sortie de crise juste, verte et équitable pour
l’ensemble de notre société.
La droite est restée, un temps, silencieuse au sujet de ce qu’elle considère sûrement en privé
comme une orgie de mesures keynésiennes, particulièrement à Ottawa. Force est aussi
d’admettre que le milieu des affaires, mal placé pour se plaindre, fut particulièrement bien
choyé en temps de crise par le gouvernement de Justin Trudeau. Néanmoins, une fois les
premiers mois passés, nous voyons déjà poindre les ténors de la droite réclamer le retour des
plus rapides à l’équilibre budgétaire.
Le couronnement d’Erin O’Toole à la tête du Parti conservateur viendra certainement
renforcer ce mouvement d’opposition aux politiques généreuses des libéraux et du gouffre
déficitaire entraîné. Minoritaire, Justin Trudeau devra également tenir compte d’un nouvel
élan de concertation des provinces, qui réclament à raison une augmentation des transferts
fédéraux pour corriger le désinvestissement d’Ottawa au regard de l’explosion des coûts du
système de santé. Le premier ministre canadien aura aussi à mettre en place, rapidement, les
ajustements depuis longtemps réclamés à l’assurance-emploi, dont les graves lacunes ont été
largement démontrées, une fois de plus, par la pandémie.
1 Loi visant la relance de l’économie du Québec et l’atténuation des conséquences de l’état d’urgence sanitaire
déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19.Analyse de la conjoncture présentée au conseil confédéral de septembre 2020 – 7 Bien évidemment, les inquiétudes sont vives à l’approche du 3 novembre, date à laquelle le peuple américain aura à décider si le grand délire de Donald Trump doit être reconduit pour quatre nouvelles années. L’exercice même de ce droit démocratique fondamental paraît périlleux : le vote postal, rendu nécessaire par la crise (et auquel les électeurs démocrates ont plus fortement recours que ceux du camp républicain), est déjà largement dénoncé par un président pyromane laissant ouvertement planer des doutes quant à la validité du scrutin. Nul ne peut ignorer que le discours nationaliste, protectionniste et ouvertement xénophobe du président est parvenu à séduire de larges pans des classes ouvrières américaines. Les conséquences sur l’économie canadienne sont directes, notamment sur l’industrie métallurgique et l’industrie forestière. Vivement un changement de régime. Les prochains mois seront marqués par les aléas de notre adaptation collective à cette nouvelle normalité qui régulera nos vies sociales, particulièrement dans nos milieux de travail. De nombreuses transformations sociales et économiques sont à prévoir : qu’on pense à une réforme du réseau de la santé et des services sociaux, à l’adoption intensivement forcée du télétravail ou encore aux réflexions engendrées par la mise sur pied de programmes de sécurisation de revenus, plusieurs de ces transformations sont déjà en cours. Alors que nous avons à nous réjouir de certaines d’entre elles, d’autres pourraient avoir pour effet de précariser les conditions de travail et de vie – ces deux concepts n’ayant jamais été aussi imbriqués qu’au cours des dernières semaines – des travailleuses et des travailleurs qui forment la CSN. Nous devons nous y préparer. Notre défi sera de les conjuguer aux idéaux qui nous animent pour faire du Québec une société plus juste, plus digne et plus égalitaire.
1. Économie, finances publiques et travail Il est encore beaucoup trop tôt pour évaluer à quel rythme la relance économique s’effectuera. Au-delà de cette incertitude, une réalité indéniable demeure : le monde entier est confronté à sa pire crise économique depuis celle des années 1930. Contrairement aux récessions auxquelles nous sommes habitués, celle-ci a la particularité de voir juxtaposées une chute substantielle de la production à une diminution tout aussi importante de la demande. Bien que les gouvernements n’aient pas lésiné sur les programmes d’aide aux entreprises, aux travailleuses et aux travailleurs, aux étudiants et aux groupes plus vulnérables, le confinement et la chute de revenu des ménages ont un impact considérable sur leur niveau de consommation. Selon les estimations, le PIB mondial pourrait reculer jusqu’à 6 % en 2020. En comparaison, le ressac de la crise de 2008 n’avait été que de 0,1 %. Au Canada, même si les hypothèses de rebond rapide pour les deux derniers trimestres de 2020 se concrétisaient, le recul pourrait tout de même atteindre 8 % pour l’année complète. Une sévère récession. Les conséquences de cette crise sont tout aussi diversifiées que dramatiques : sur l’emploi, sur la croissance des inégalités, sur la capacité des ménages à stimuler la reprise et, bien sûr, sur les finances publiques. Il est d’ores et déjà évident que certains secteurs ne pourront, à court et à moyen terme, reprendre leurs activités comme avant. C’est le cas de la restauration, du secteur touristique, de la culture et du transport aérien. La crise aura également plombé des secteurs déjà en difficulté, notamment celui des médias. Du jour au lendemain, le Québec est passé d’un état de rareté et de pénurie de main-d’œuvre à un taux de chômage très élevé – atteignant 17 % au Québec en avril, il s’est résorbé à 8,7 % en août. Il est impossible pour l’instant de prédire pendant combien de temps nous serons confrontés à cette situation, mais la démographie québécoise – notamment la stabilité de sa population en âge de travailler – nous porte à croire qu’une diminution du taux de chômage sera possible sans que la création d’un nombre important de nouveaux emplois ne soit nécessaire. Cependant, il devient évident que de nombreux emplois d’avant-crise ne seront jamais retrouvés et qu’une vaste transformation du marché de l’emploi – voire du travail lui-même – s’opérera au cours des prochains mois et des prochaines années. L’accès au savoir et aux compétences deviendra crucial et, à cet effet, les programmes de formation continue et à l’emploi devront être adaptés. Les pénuries de certains équipements (notamment ceux nécessaires au fonctionnement du réseau de la santé), la réorientation de certaines productions nationales et l’apparition de nouvelles contraintes en matière de transport remettent en question l’État-monde tel qu’il s’est cristallisé par la poussée mondialisatrice des 30 dernières années. On peut certes se réjouir des initiatives d’achat local et de la prise de conscience citoyenne des efforts collectifs à encourager pour soutenir la relance. Il faudra toutefois voir de quelle façon l’économie du
10 – Analyse de la conjoncture présentée au conseil confédéral de septembre 2020 Québec pourra tirer son épingle du jeu dans la reconfiguration des échanges internationaux, dont dépendent plusieurs de nos industries. En plus des nombreux choix quant aux secteurs et aux stratégies de relance à privilégier, le gouvernement aura de nombreux choix à faire relativement à la gestion des finances publiques. Le déficit, qui pourrait atteindre 15 milliards de dollars dès cette année, pèsera lourd dans les décisions de Québec. Alors que le gouvernement clame d’un côté ne pas vouloir avoir recours aux politiques d’austérité pour le résorber, le ministre des Finances indique toutefois qu’il faudra « rapidement » s’attaquer à la dette. Il nous apparaît évident que les transferts au Fonds des générations – que nous demandions déjà de reconsidérer, notamment depuis l’atteinte anticipée des objectifs initialement poursuivis – doivent maintenant être suspendus afin d’octroyer au gouvernement la marge de manœuvre nécessaire pour pallier l’importante baisse des revenus de l’État et la nécessité de consolider les services publics pour sortir de la crise. La lutte contre les paradis fiscaux ne saurait être une fois de plus ignorée par Québec, encore moins dans le rapport de force qu’il tente de créer avec les provinces envers Ottawa, qui détient d’importants leviers en la matière. L’échec du projet de loi no 61 aura eu le mérite de mettre au clair la vision du boys’ club régnant à Québec : mise en place de pouvoirs démesurés bafouant toute forme de contrôle parlementaire et de reddition de comptes publique, saccage des règles environnementales et d’octroi de contrats publics – sans parler que les travailleuses, premières victimes de la crise, était largement ignorées par une accélération de projets d’infrastructures qui bénéficieront surtout aux travailleurs masculins. La CSN et nos alliés syndicaux avons fermement critiqué cette vision réductrice et dépassée du développement économique. Rendus publics en juin dernier, nos travaux portant sur la relance seront poursuivis et adaptés en fonction du nouveau projet de loi qui sera présenté par la nouvelle présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel – qui aura également à trouver réponse aux nécessaires améliorations des conditions salariales et de travail du secteur public. Environnement L’année 2020 devait être l’année de l’environnement au Québec. Le dernier budget du gouvernement, dévoilé quelques heures avant le début de la crise, prévoyait d’importantes sommes dédiées à la lutte contre les changements climatiques dont les modalités devaient être dévoilées, dans les semaines suivantes, par le ministre Benoit Charette. La crise aura-t-elle tout changé? Lors d’un discours prononcé à l’occasion d’une conférence virtuelle sur le climat, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a appelé les pays à tout mettre en œuvre pour « promouvoir une reprise verte » après la pandémie.
Analyse de la conjoncture présentée au conseil confédéral de septembre 2020 – 11 De nombreux intervenants craignent toutefois que la pandémie ne relègue la lutte contre les changements climatiques en fin de liste des priorités. Déjà, l'industrie pétrolière fait pression sur le gouvernement pour quémander son soutien financier. L’augmentation de l’offre de transport en commun devra être un axe important des projets d’infrastructures qui seront proposés pour la relance. Est-ce que le projet du tramway de Québec sera maintenu et son échéancier devancé? Est-ce que le gouvernement va maintenir le projet de construction du 3e lien à Québec et une partie de son financement à même le Fonds vert? Le gouvernement se doit de développer également des projets structurants axés sur l’achat local et sur la sécurité et la souveraineté alimentaires. De nouvelles habitudes citoyennes, particulièrement en matière d’aménagement du territoire en milieu urbain, doivent être soutenues afin de permettre une meilleure mobilité durable. Il serait toutefois illusoire de croire que du strict point de vue environnemental, la crise n’aura été que « bénéfique ». Certes, nombreux sont ceux qui se réjouissent de la chute considérable de notre consommation d’hydrocarbures. Mais on constate également certains reculs en matière d’habitudes comportementales, principalement dus au contexte particulier que nous vivons : utilisation accrue de matériel jetable, retour au suremballage des produits de consom- mation et apparition de la crainte des transports en commun, lieux de contamination potentiels. Sécurisation du revenu L’arrêt d’une bonne partie de l’économie aura démontré les profondes lacunes des mesures de soutien apportées aux travailleuses et aux travailleurs en temps normal. La nécessité d’élargir les modalités d’accès à l’assurance-emploi ou encore la création de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) auront été révélatrices de la fragilité économique des ménages, notamment ceux reposant sur les revenus des travailleuses et des travailleurs autonomes. On ne pourra faire l’économie, dans les mois à venir, d’une réforme en profondeur des mesures de protection du revenu, particulièrement en revoyant les modalités du programme d’assurance-emploi. De plus, jamais nous n’aurons autant réalisé à quel point de nombreuses activités économiques essentielles reposaient sur les bas salarié-es de notre société. Voir les employeurs consentir, parfois unilatéralement, des augmentations salariales pour les salarié-es de la chaîne alimentaire ou des commerces au détail, pour ne nommer que ces secteurs, en témoigne – tout comme les critiques patronales envers la PCU, qui affecterait leur capacité d’embaucher des salarié-es, dont nous ne nous émouvrons pas. Cette situation n’aura révélé qu’une chose : le salaire minimum se doit d’être augmenté significativement, pas à coups de quelques dizaines de cents. Nous l’avons dit, de nombreux emplois d’avant-crise ne reviendront pas : certaines entreprises auront fermé, d’autres en auront profité pour en tirer une cure minceur alors que des secteurs entiers, notamment en culture et en tourisme, ne retrouveront pas la normale avant quelques années. Dans ce contexte, il sera particulièrement essentiel de suivre avec attention
12 – Analyse de la conjoncture présentée au conseil confédéral de septembre 2020 tout ce qui a trait à la formation professionnelle. En plus des travaux menés à la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), nous aurons à nous assurer que des modalités financières appropriées seront apportées aux travailleuses et aux travailleurs désirant réorienter leur vie professionnelle pour affronter les répercussions de la crise. Il y a une réelle possibilité que certaines transformations qui avaient déjà cours se voient accélérées par la crise de la COVID-19. C’est le cas notamment en matière de transition énergétique et de transition numérique des milieux de travail. Le risque est grand de constater une accentuation des inégalités en fonction d’un accès inéquitable aux connaissances, aux compétences et aux qualifications. Voilà pourquoi nous devrons accompagner nos syndicats pour faire en sorte que les membres de la CSN affectés plus durement par la crise puissent avoir accès aux formations qualifiantes et transférables liées aux changements technologiques afin de privilégier le maintien en emploi ou encore aux programmes leur permettant de se repositionner avantageusement au sein d’un marché du travail en profondes mutations. Nous devrons également rester vigilants quant aux possibles répercussions, à moyen et à long terme, en matière de précarisation du travail post-COVID. Nombreux sont les employeurs qui chercheront à réduire leurs dépenses au cours des prochains mois, que ce soit en réduisant leur nombre d’employés ou en tentant de resserrer leurs frais fixes. L’expérience accélérée du recours au télétravail pourrait rendre désuets beaucoup d’espaces locatifs et transférer vers les salariés les coûts reliés aux espaces et aux équipements de travail. Le risque de précarisation du travail, notamment pour le personnel professionnel et administratif, est réel et nous devrons y veiller. Encore une fois, les femmes auront été plus sévèrement touchées par la crise actuelle. Les pertes d’emplois ont particulièrement touché les postes précaires et à temps partiel, où les femmes sont nettement surreprésentées. Il nous faudra procéder à une analyse différenciée selon les sexes afin de bien mesurer les impacts et d’apporter une réponse appropriée aux défis particuliers que les travailleuses auront à relever au cours des prochains mois. Santé et sécurité du travail Depuis le début de la crise, ce sont tous nos milieux de travail qui ont été confrontés à la nécessité de s’adapter afin de réduire au minimum les risques de contagion. Le secteur de la santé et des services sociaux a été particulièrement affecté, parfois de façon dramatique. Nous avons dû multiplier les interventions pour nous assurer de la sécurité sanitaire de nos membres, tant auprès des employeurs que des ministères concernés. Dans le réseau de la santé et des services sociaux, l’accès aux équipements de protection individuelle a été particulièrement problématique et le demeure. Encore aujourd’hui, malgré l’absence de consensus scientifique sur les modes de transmission du nouveau coronavirus – par gouttelettes uniquement ou également par voie aérienne – le ministère de la Santé et des Services sociaux refuse toujours d’octroyer au personnel des CHSLD et des soins à domicile les masques N-95. Comme quoi les pénuries d’équipements constatées ne peuvent tout expliquer.
Analyse de la conjoncture présentée au conseil confédéral de septembre 2020 – 13 La situation fut aussi très préoccupante dans d’autres secteurs. On peut comprendre le désarroi du boss de la binerie du coin, mais la lenteur d’une société d’État comme la SAQ à mettre en place les dispositions nécessaires à la protection de son personnel laisse pantois. D’autres employeurs majeurs au Québec, notamment dans le secteur de l’abattage de viande, ont dû être sévèrement sermonnés pour avoir négligé d’adapter leurs chaînes de production à la nouvelle réalité. La santé et la sécurité au travail demeurent une bataille quotidienne pour bon nombre de nos syndicats. Bien entendu, nous aurions préféré une présence plus soutenue de la part des inspecteurs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans les milieux de travail. Rappelons que nous réclamons depuis longtemps un ajout d’effectifs à l’inspectorat de la CNESST. Si les ressources étaient déjà insuffisantes avant la crise, il est illusoire de penser qu’elles auraient été en mesure de répondre aux défis entraînés par la COVID-19. C’est pourquoi nous avons accueilli plutôt positivement le redéploiement de fonctionnaires d’autres services gouvernementaux pour appuyer le travail de la CNESST en matière de prévention. Le paritarisme étant à la base de l’esprit de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, nous avons toutefois dénoncé le fait que les syndicats ne soient pas consultés par ces ressources supplémentaires dans leur travail de prévention. Chaque milieu de travail comportant ses propres réalités, nous devrons, au cours des prochains mois, faire l’inventaire et la promotion des meilleures pratiques en matière d’adaptation de l’organisation du travail en raison de la pandémie, et ce, selon les différents secteurs d’activité. Le printemps 2020 devait voir le ministre du Travail, Jean Boulet, déposer un projet de loi en matière de santé et sécurité au travail. La pandémie aura retardé cette réforme, attendue de toute part. Les consultations préalables ont été menées, les textes législatifs seraient prêts à être déposés – ne manque que la volonté du Conseil des ministres de procéder. Les aléas de la pandémie ont certes requis notre attention immédiate, mais nous devons garder en tête les raisons fort légitimes pour une réforme en profondeur d’un régime de santé et de sécurité du travail n’ayant pas été modifié depuis plus de 30 ans. En ce sens, nous devrons maintenir la pression au cours des prochaines semaines pour forcer le gouvernement à saisir les parlementaires sur les modifications devant être apportées à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le télétravail en accéléré Les répercussions des mesures sanitaires mises en place provoquent inévitablement une remise en question du travail lui-même. Le télétravail en est, certes, l’illustration la plus éloquente. Même les employeurs les plus réfractaires à l’idée ont dû s’y rabattre, par obligation. Le mot d’ordre quant à la poursuite, autant que possible, du télétravail comme composante essentielle du déconfinement forcera l’obligation du monde du travail à s’adapter à cette réalité.
14 – Analyse de la conjoncture présentée au conseil confédéral de septembre 2020 Bien que certains puissent ressentir l’exaspération du travail à domicile (particulièrement lorsque confrontés à la conciliation famille-travail imposée alors que les écoles et les services de garde étaient fermés), de nombreux travailleurs et travailleuses ont largement embrassé cette possibilité et adopté ce nouveau mode de vie. Les impacts sur le transport et les heures de pointe pourraient contribuer à un changement dans notre rapport au temps (de vie, de travail, de loisirs). La possibilité de plus en plus grande d’intégrer pleinement le télétravail dans nos vies, jumelée à la volonté de réduire notre empreinte écologique, chamboulera notre rapport au travail et de multiples aspects qui façonnent nos identités professionnelles. Enfin, il est à noter que ce ne sont pas tous les travailleurs et les travailleuses qui sont égaux au regard de la possibilité du télétravail. En effet, l’accès à cette forme de travail diverge fortement d’un secteur à l’autre : en général, les professionnels ont pu s’y convertir beaucoup plus facilement que les travailleurs d’usine ou les salarié-es des commerces au détail, pour résumer grossièrement. Le confinement et le recours au télétravail « lorsque possible » auront ainsi fait naître de nouvelles formes d’inégalités sociales. Plusieurs études en cours aux États-Unis tendent à démontrer que les bas salarié-es, forcés de se rendre physiquement à leur lieu de travail en raison de la nature de celui-ci et n’ayant d’autre choix que d’utiliser les transports en commun, ont été statistiquement plus exposés au virus que les classes mieux nanties. Plus près de nous, la forte prévalence du virus dans les quartiers de Montréal-Nord, de Parc- Extension et d’Hochelaga-Maisonneuve se passe d’explications.
Analyse de la conjoncture présentée au conseil confédéral de septembre 2020 – 15
Perspectives d’action – économie, finances publiques et travail
Nous commençons à peine à mesurer les conséquences de cette crise économique
entraînée par la pandémie. Les effets sur les revenus des ménages, sur les
finances publiques et sur les droits fondamentaux du travail pourraient être
catastrophiques.
Certes, certains reculs sont à prévoir. Mais la crise nous offre également l’occasion
de mettre de l’avant une société plus juste, plus digne et plus égalitaire. Plus que
jamais, nous devons nous porter à la défense des travailleuses et des travailleurs
en ciblant les perspectives suivantes :
• Poursuivre le travail d’analyse sur les finances publiques du Québec et
développer, notamment avec les autres centrales syndicales, une plateforme
de revendications tenant compte de la nécessité de suspendre les transferts au
Fonds des générations et de lutter contre les paradis fiscaux;
• Développer des analyses sectorielles portant sur les transformations du
marché du travail et les besoins subséquents en matière d’accès à la formation
professionnelle;
• Appuyer nos syndicats dans leurs stratégies pour contrer les effets négatifs des
transformations technologiques des milieux de travail qui pourraient être
accélérées par la crise, dont les transitions énergétique et numérique,
notamment en favorisant l’accès aux formations qualifiantes et transférables
et aux programmes de repositionnement professionnel;
• Procéder à une analyse différenciée selon les sexes des conséquences de la
crise et développer les outils appropriés;
• Se réapproprier et adapter, au besoin, la politique industrielle de la CSN en
fonction des bouleversements que nous vivons présentement;
• Maintenir notre présence au sein du Front commun pour une transition
énergétique pour forcer le gouvernement à s’attaquer réellement à la crise
climatique, particulièrement dans un contexte de relance;
• Accentuer nos représentations politiques visant à renforcer les mesures de
protection du revenu et les dispositions législatives, notamment en ce qui a
trait au salaire minimum et au télétravail;
• Documenter les changements aux diverses formes d’inégalités sociales et leurs
impacts sur les femmes, les bas salariés, les communautés socioculturelles et
autres minorités;
• Maintenir notre travail de prévention en matière de santé et de sécurité du
travail, rendre disponibles des analyses sectorielles sur les meilleures
pratiques et faire la promotion des mesures de soutien en matière de santé
psychologique au travail;16 – Analyse de la conjoncture présentée au conseil confédéral de septembre 2020
• S’assurer que les travailleuses et les travailleurs aient accès, dans l’ensemble
de leurs milieux de travail, aux mesures de protection appropriées, notamment
pour les personnes vulnérables présentant des conditions particulières; exiger
des autorités publiques, notamment la CNESST et la Santé publique, qu’elles
appliquent le principe de précaution quant aux modes de transmission du virus;
• Développer des balises encadrant les problèmes rencontrés en matière de
télétravail ainsi que des clauses types pouvant appuyer les négociations de nos
syndicats sur cet enjeu.2. Services publics Autant ils n’auront démontré à ce point leur pertinence et leur acuité, jamais leurs nombreuses incohérences n’auront été aussi exposées au grand jour. En matière d’adaptation à l’une des pires crises du Québec, nos services publics ont, à maints égards, failli à la tâche, et ce, tant en santé qu’en éducation. Santé et services sociaux La crise a mis en évidence, une fois de plus, les graves lacunes entraînées par les réformes hospitalo-centristes successives qui ont marqué le réseau de la santé et des services sociaux au cours des dernières décennies. Afin de libérer les 7 000 lits nécessaires en centre hospitalier pour faire face à un possible débordement, les autorités ont littéralement déplacé des centaines de personnes hospitalisées vers les CHSLD, où aucune mesure particulière n’avait initialement été prise – avec les résultats dramatiques que l’on connaît. Maintes fois constaté, le décalage manifeste entre les informations dévoilées lors des points de presse quotidiens du premier ministre et celles rapportées sur le terrain a illustré, d’une aberrante façon, la centralisation des pouvoirs des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et le manque flagrant de communication entre la tête et la base, la première ayant cette frustrante habitude d’ignorer les signaux de détresse envoyés par la seconde. Chaque crise fait ressortir les lacunes et les contradictions inhérentes à tout système, soit. La réforme Barrette prend cependant aujourd’hui toute la mesure de sa disconvenance et de son incohérence. Jamais les profondes lacunes de cette réforme, particulièrement l’hyper- centralisation des pouvoirs, n’auront été aussi exposées. Quand le premier ministre s’étonne lui-même, en conférence de presse, qu’il n’y ait aucun patron dans un CHSLD, c’est qu’il y a un réel problème en termes d’autonomie de gestion des différents établissements du réseau. Mais au-delà de la direction locale des établissements, c’est la question de la gouvernance des CIUSSS et des CISSS et de leur capacité à déployer les ressources appropriées pour chacune de leurs missions (qu’on pense à la santé publique, à la jeunesse ou à la santé mentale, notamment) qu’il faudra collectivement analyser. La population du Québec semble, en effet, prendre connaissance de la pertinence d’une direction largement négligée au fil des années : celle de la santé publique. Les nombreuses compressions budgétaires et les multiples abolitions de postes qui ont visé les équipes de prévention au fil des ans – sans parler de la suppression pure et simple des agences de santé et de services sociaux – ne sont pas étrangères à l’ampleur de la contamination qui, pourrait-on croire, aurait pu être atténuée si le financement de la santé publique avait été stable et constant. C’est avec le sinistre récit du CHSLD Herron que le Québec tout entier a découvert la vraie réalité de la privatisation directe des soins de santé aux aînés : salarié-es sous-payés, abandon des résidents à leur sort, querelle entre les gestionnaires et le CIUSSS responsable de sa supervision – sans parler du trouble passé criminel de ses propriétaires.
18 – Analyse de la conjoncture présentée au conseil confédéral de septembre 2020 La situation générale du réseau au cours des dernières années nous avait démontré les limites d’un système qui fonctionne au maximum de ses capacités. Quand le recours au temps supplémentaire devient la norme en matière de gestion, quand les affichages de postes sont rarement comblés, lorsque le nombre d’absences du travail pour cause de maladie (d’ordre psychologique, la plupart du temps) ne cesse de grimper, quand on sous-traite au moins offrant le sort des personnes âgées, quand on coupe année après année le financement des organismes communautaires, il y avait déjà lieu de se demander si le réseau de la santé et des services sociaux n’était pas sur le point d’imploser. Nous y sommes. Rémunération non compétitive, surcharge de travail, manque de reconnaissance du personnel, autant de raisons qui ont rendu fort peu attrayantes les conditions de travail du réseau. À la moindre pression exercée sur le réseau (sans vouloir minimiser l’ampleur de la crise), c’est l’hécatombe. Les problèmes accumulés de rareté de la main-d’œuvre ont poussé le gouvernement dans ses derniers retranchements, soit le recours à l’armée canadienne et à des primes unilatéralement décidées. Le recours aux agences de placement, qui ont tenté de profiter de la crise en augmentant outrageusement leurs tarifs, aura également amplifié la crise, le personnel d’agence se retrouvant malgré lui à agir en tant que vecteur de transmission du virus entre différents établissements. Le recours aux nombreux arrêtés ministériels (tant en santé qu’en éducation, par ailleurs) a eu pour effet de suspendre des pans entiers des conventions collectives du secteur public. Alors que la situation particulièrement chaotique dans les zones chaudes pouvait justifier aux yeux de certains l’utilisation de ces décrets, ceux-ci ont toutefois augmenté de façon démesurée les pouvoirs des gestionnaires locaux, les plus malins ne se privant pas d’en tirer bénéfice au-delà des besoins engendrés par la crise. Les deux premières années d’un gouvernement de la CAQ nous auront appris à quel point les lubies du premier ministre peuvent faire office de raison d’État. Il est inquiétant d’entendre le premier ministre rappeler chaque jour que son projet de maisons des aînés répond directement aux lacunes observées dans les différents centres d’hébergement du Québec : des chambres individuelles, de la climatisation, plus d’espace pour le personnel et les bénéficiaires, de meilleurs soins – l’eldorado de la vieillesse, à en croire M. Legault. Encore faudra-t-il pouvoir tirer le ticket chanceux pour y accéder. Sachant très bien que la transition prendra de nombreuses années, il sera impératif pour le gouvernement d’intervenir urgemment pour rehausser les conditions de vie des centres d’hébergement existants. Le gouvernement a lancé une vaste opération de recrutement et de formation pour pourvoir les 10 000 postes de préposé-es aux bénéficiaires vacants avant même le début de la crise. Alors que nous réclamons depuis des lunes la consolidation des postes dans le secteur public, il est pour le moins étonnant de voir le premier ministre enfin réaliser que seulement 35 % des salarié-es du secteur public, environ, détiennent des postes réguliers à temps plein. Il faut croire que l’agilité de gestion offerte par un bassin d’employés précaires et à temps partiel aura démontré ses inévitables limites en temps de crise. Si le gouvernement veut être sérieux dans la poursuite de son objectif de pourvoir les postes vacants, il ne pourra toutefois se
Analyse de la conjoncture présentée au conseil confédéral de septembre 2020 – 19 limiter aux seuls préposé-es aux bénéficiaires ni se limiter aux seules conditions salariales de ceux-ci. Tant en santé qu’en éducation, les difficultés d’attraction et de rétention de la main- d’œuvre dépassent largement ce seul enjeu. Devant les nombreuses voix s’étant élevées pour exiger une commission d’enquête sur les conditions d’hébergement des aînés, le gouvernement a mandaté la commissaire à la santé et au bien-être, Johanne Castonguay, d’examiner la performance du réseau de la santé et des services sociaux pendant la crise, particulièrement en ce qui a trait à la situation des CHSLD. Il n’y a aucun doute que nous serons appelés à nous prononcer sur l’ensemble des failles qui auront été violemment révélées par la crise et sur les améliorations qui doivent être apportées. À cet égard, notre plateforme Vieillir dans la dignité, pour ne nommer que celle-ci, retrouve toute sa pertinence. Services de garde, milieu scolaire et enseignement supérieur Il peut a priori sembler étonnant de constater la réserve dont a fait preuve le présent gouvernement dans ses attaques envers l’ancien titulaire de la Santé, Gaétan Barrette, d’autant plus que ce dernier a fait fi de toute forme de pudeur dans ses (très nombreuses) interventions dans les médias. La circonspection du gouvernement envers la réforme Barrette peut toutefois un peu mieux se comprendre à la lumière de ce qui se passe dans le réseau de l’éducation. Depuis l’élection d’un gouvernement caquiste en octobre 2018, les commissions scolaires avaient su apporter une critique éclairante des directions que Jean-François Roberge entendait donner à son ministère. A-t-on entendu une Catherine Harel-Bourdon depuis le début de la crise? Bien sûr que non, les commissions scolaires ayant été abolies tout juste avant l’éclosion de la pandémie. Force est de constater que les nouvelles directions régionales auront été totalement muettes, du moins publiquement, à l’égard de l’organisation des services de garde d’urgence, des mouvements de personnel gérés à coups d’arrêtés ministériels, du manque d’équipements de protection individuelle et de l’improvisation générale du ministère de l’Éducation. L’absence de reddition de comptes directe auprès de la population – des rôles autrefois remplis par les commissaires scolaires – a cruellement fait défaut. Les premiers mois de la crise auront révélé toute l’incohérence du ministre Jean-François Roberge ainsi que la désorganisation au sein de son cabinet. Après avoir envoyé les enseignantes et les enseignants « en vacances », il a dû les enjoindre à poursuivre les activités pédagogiques sans aucune forme d’appui logistique. Les « discussions » préalables à l’adoption d’arrêtés ministériels se résumaient à des séances d’information totalement contradictoires, convoquées à la dernière minute. Les problèmes de pénurie de main-d’œuvre ont été largement exposés dans le réseau de la santé au printemps dernier. Avec la rentrée des dernières semaines, c’est maintenant au tour des établissements scolaires : de nombreuses classes se retrouvent sans enseignant titulaire et le manque d’éducatrices en services de garde a fait éclater le concept de bulle-classe sur lequel toute la stratégie du gouvernement semble reposer. On déplore, dans de nombreuses
20 – Analyse de la conjoncture présentée au conseil confédéral de septembre 2020 écoles, le manque de personnel attitré à l’entretien ménager, sur qui repose tous les efforts de désinfection des classes et autres locaux. Le transport scolaire demeure problématique, tant par l’absence de distanciation que du peu d’empressement de certains transporteurs à installer les parois de protection nécessaires à la sécurité des conductrices et des conducteurs. Alors que, déjà, plus d’une centaine d’établissements scolaires et collégiaux ont été en proie à des cas positifs, la situation devra être suivie de près. La crise aura eu pour effet de nous démontrer, encore une fois, à quel point le ministre Roberge semblait beaucoup plus accaparé – pour ne pas dire exclusivement – par l’éducation au préscolaire, au primaire et au secondaire que par le reste des mandats dont il a la responsabilité. Le silence quasi permanent sur l’enseignement collégial et universitaire, rompu en catastrophe pour exiger une reprise des cours en mode non présentiel, témoigne de ce qu’on pourrait qualifier d’intérêt plutôt bancal, pour ne pas dire de désintérêt total. Souhaitons que la récente nomination de Danielle McCann comme titulaire exclusive du ministère de l’Enseignement supérieur pourra changer les choses. D’autant plus que certains gestionnaires d’établissements collégiaux et universitaires rêvent d’utiliser la crise actuelle pour imposer leur vision du développement d’une « formation à distance », sans prendre en considération les conditions nécessaires pour sa mise en place. Cette pression pour l'élaboration de tels types de formation, qui s’exerçait déjà avant la pandémie, ne doit pas nous empêcher de poursuivre notre réflexion afin de bien distinguer l’enseignement à distance de l’enseignement contraint au mode non présentiel en raison d’impératifs sanitaires. Les sérieuses limites de ce dernier ont démontré qu’en aucun cas, la crise ne devrait servir de prétexte pour pérenniser une telle forme d’enseignement. Négociations du secteur public C’est avec une certaine surprise que le milieu syndical a accueilli l’appel du premier ministre à régler rapidement la question du renouvellement des conventions collectives du secteur public, dont les travaux s’étaient à peine amorcés à l’automne. Quiconque connaît le premier ministre sait à quel point celui-ci abhorre cet incontournable exercice, et ce, depuis ses années de ministre au sein d’un gouvernement péquiste. Mais au point de profiter de la crise pour expédier en deux temps trois mouvements la plus complexe des négociations collectives? Notre réponse ne se fit pas attendre : notre priorité n’était plus à la négociation accélérée, mais bien aux réponses que nous devions collectivement apporter à la crise. Les consignes de la santé publique en matière de confinement et de distanciation rendant irréaliste toute forme de consultation auprès de nos syndicats, penser que nous pourrions régler sur un coin de table, en quelques jours, des contrats de travail de plus de 500 000 salarié-es de l’État relevait de l’utopie. Voilà pourquoi la CSN, tout comme la CSQ, demandait une prolongation de 18 mois des conventions collectives. De son côté, la FTQ a manifesté un certain intérêt à régler rapidement les conventions, craignant les coffres vides du Trésor au détour de la crise.
Vous pouvez aussi lire