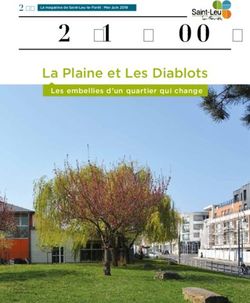Dossier de demande d'autorisation environnementale unique Etude de Dangers - RYB - Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (38) 2019-03-18 ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Dossier de demande d’autorisation environnementale unique Etude de Dangers RYB – Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (38) 2019-03-18
Référence R003-1613247EVE-V02
Fiche contrôle qualité
Intitulé de l'étude Dossier de demande d’autorisation environnementale unique – Etude de Dangers
Destinataire du document NOVELIGE
Site RYB – Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (38)
Interlocuteurs Pascal Lecuelle
Adresse 34 rue Antoine Primat – CS 60261 – 69100 VILLEURBANNE
Email pascal.lecuelle@vinci-construction.fr
Téléphone/Mobile 04.72.78.10.48 / 06 71 22 28 61
Numéro de projet 1613247
Date 2019-02-18
Superviseur Eric Vedel f.pansa@tauw.com
Relecteur Hervé DUVAL h.duval@tauw.com
Rédacteur(s) Eric VEDEL e.vedel@tauw.com
Coordonnées
Tauw France - Agence de Lyon Siège social – Agence de Dijon
120 avenue Jean Jaurès Parc tertiaire de Mirande
69 007 Lyon 14 D Rue Pierre de Coubertin
Téléphone : 04 37 65 15 55 21000 Dijon
Téléphone : 03 80 68 01 33
Email : info@tauw.fr Fax : 03 80 68 01 44
Email : info@tauw.fr
Tauw France est membre de Tauw Group bv –
www.tauw.com Représentant légal : Mr. Eric MARTIN
Gestion des révisions
Version Date Statut Pages Annexes
02 2019-02-18 Commentaires RYB / Novelige 100 -
01 2019-02-06 Création du document 101 -
Référencement du modèle : DS 88 21-11-11
3/100Référence R003-1613247EVE-V02
Table des matières
1 Introduction ................................................................................................................................ 8
Contexte de l’étude ............................................................................................................ 8
Objectifs de l’étude............................................................................................................. 9
Méthodologie de l’étude de dangers ................................................................................ 11
Documents de référence .................................................................................................. 14
2 Description et caractérisation de l’environnement ................................................................... 15
Localisation de l’établissement ........................................................................................ 15
Environnement anthropique – description des activités humaines .................................. 18
Environnement naturel ..................................................................................................... 21
Risques naturels .............................................................................................................. 26
Synthèse de la sensibilité de l’environnement ................................................................. 28
3 Description des installations et de leur fonctionnement .......................................................... 29
Description des procédés de fabrication .......................................................................... 29
Process de fabrication...................................................................................................... 32
Matières premières .......................................................................................................... 34
Produits finis ..................................................................................................................... 34
Installation connexes et utilités ........................................................................................ 35
4 Identification et caractérisation des potentiels de dangers ...................................................... 38
Méthodologie retenue ...................................................................................................... 38
Retour d’expérience (accidentologie)............................................................................... 39
Identification des potentiels de dangers ........................................................................... 44
Recensement des potentiels de dangers ......................................................................... 58
Réduction des potentiels de dangers ............................................................................... 61
Caractérisation des potentiels de dangers ....................................................................... 63
Cartographie des potentiels de dangers .......................................................................... 74
Synthèse des potentiels de dangers ................................................................................ 78
5 Organisation de la sécurité et description des moyens d’intervention et de protection ........... 80
Mesures organisationnelles ............................................................................................. 80
Mesures de prévention..................................................................................................... 81
Mesures de protection contre les agressions d’origine naturelle ..................................... 84
Mesures de protection contre l’incendie........................................................................... 86
4/100Référence R003-1613247EVE-V02
Mesures de protection contre un déversement accidentel............................................... 93
Moyens d’intervention ...................................................................................................... 94
6 Analyse des risques ................................................................................................................ 95
Généralités ....................................................................................................................... 95
Notions de base ............................................................................................................... 95
Analyse Préliminaire des Risques - APR ......................................................................... 96
7 Conclusion ............................................................................................................................. 100
5/100Référence R003-1613247EVE-V02
Figures
Figure 1 Etablissement RYB - Périmètre ICPE
Figure 2 Localisation du site – fond de carte 1 / 25 000e
Figure 3 Plan sur fond cadastral
Figure 4 Grands axes de communication – Commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
Figure 5 Installations industrielles voisines du site RYB
Figure 6 Rose des vents - station de Grenoble-Saint-Geoirs
Figure 7 Gamme de produits fabriqués par RYB
Figure 8 Marqueur ELIOT
Figure 9 Extrudeuse – coupe de principe
Figure 10 Tableau récapitulatif des règles de stockage des produits par catégorie
Figure 11 Localisation des potentiels de dangers – Atelier d’extrusion
Figure 12 Localisation des potentiels de dangers – Silos de granulés de PE
Figure 13 Localisation des potentiels de dangers – Parc extérieur de produits finis
Figure 14 Cartographie – PhD1 : Incendie généralisé de l’atelier d’extrusion
Figure 15 Cartographie – PhD4 : Incendie au niveau des silos de granulés de PE
Figure 16 Cartographie – PhD5 : Incendie du parc extérieur de stockage de produits finis
Figure 17 Ouvrages séparatifs coupe-feu – plan de localisation
Figure 18 Stockage de produits sur parc extérieur – ilotage
Figure 19 Poteau incendie – localisation
Tableaux
Tableau 1 Echelle des classes d’intensité – APR
Tableau 2 Grille de criticité
Tableau 3 Parcelles cadastrales occupées
Tableau 4 Masses d’eau souterraine concernées par le projet
Tableau 5 Températures moyennes mensuelles en °C sur la période 1971-2008 sur la station
de Grenoble-Saint-Geoirs
Tableau 6 Hauteur moyenne des précipitations mensuelles en mm sur la période 1971-2008
sur la station de Grenoble-Saint-Geoirs
Tableau 7 Fréquence des vents par vitesse - Station de station de Grenoble-Saint-Geoirs
(Source météo France)
Tableau 8 Lignes d’extrusion – capacités des lignes
Tableau 9 Unités de réfrigération – caractéristiques
Tableau 10 Causes d’accidents – stockage de matières plastiques
Tableau 11 Dangers intrinsèques liés aux matières premières
Tableau 12 Dangers intrinsèques liés aux produits finis ou semi-finis
Tableau 13 Dangers intrinsèques liés aux carubrants pour chariots de manutention
Tableau 14 Dangers intrinsèques liés aux déchets NON dangereux
Tableau 15 Produits de décomposition thermique (notamment en cas d’incendie)
Tableau 16 Comportement des produits vis-à-vis des phénomènes de boil-over classique et
boil-over en couche mince (BOCM)
Tableau 17 Liste des potentiels de dangers
6/100Référence R003-1613247EVE-V02
Tableau 18 Réduction des potentiels de dangers
Tableau 19 Seuils d'intensité des effets sur les hommes
Tableau 20 Seuils d'intensité des effets sur les structures
Tableau 21 Liste des modélisations de phénomènes dangereux
Tableau 22 Définition des combustibles et de la zone en feu – PhD1
Tableau 23 Dispostions constructives – PhD1
Tableau 24 Résultats intermédiaires – PhD1
Tableau 25 Définition de la zone en feu – PhD1
Tableau 26 Définition des combustibles et de la zone en feu – PhD4
Tableau 27 Résultats intermédiaires – PhD4
Tableau 28 Distances d’effets – PhD4
Tableau 29 Définition des combustibles et de la zone en feu – PhD5
Tableau 30 Résultats intermédiaires – PhD5
Tableau 31 Distances d’effets – PhD5
Tableau 32 Synthèse des potentiels de dangers
Tableau 33 Formalisation des mesures organisationnelles – procédures / consignes
Tableau 34 Désenfumage des locaux
Tableau 35 Extinction automatique
Tableau 36 Bilan des besoins en eau incendie
Tableau 37 Bilan des besoins en eau incendie
Tableau 38 Tableau d’Analyse Préliminaire des Risques
7/100Référence R003-1613247EVE-V02
1 Introduction
Contexte de l’étude
La société RYB projette de déménager son activité de fabrication de tuyaux en matières plastiques
du site de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38) sur un nouveau site à implanter sur la même
commune.
Adresse : avenue Louis Blériot - ZAC Grenoble Air Parc
38590 SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
Ce nouveau site relèvera du régime de l’autorisation au titre des ICPE et nécessitera le dépôt d’un
dossier de demande d’autorisation environnementale.
TAUW France a été mandaté par la société RYB pour l’élaboration du Dossier de Demande
d’Autorisation Environnementale Unique indispensable à la réalisation du projet.
En application de l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement, le dossier de demande
doit comporter « 10° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du
présent article ».
8/100Référence R003-1613247EVE-V02
Objectifs de l’étude
La présente étude a pour objet de réaliser l’étude de dangers du site projeté par la société RYB à
l’adresse suivante : avenue Louis Blériot - ZAC Grenoble Air Parc - 38590 SAINT ETIENNE DE ST
GEOIRS.
Article D181-15-2 du Code de l’Environnement
« III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état
des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par
l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3.
Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le
pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel
sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire
doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan
particulier d'intervention.
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des
accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques
significatifs.
Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et
méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris
dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de
substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris
en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les
mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident
majeur. »
Une étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant pour
caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques d’une installation ou d’un groupe
d’installations, autant que technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que leurs
causes soient intrinsèques aux substances ou matières utilisées, liées aux procédés mis en
œuvre ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation.
Cette étude est proportionnée aux risques présentés par l’établissement. La méthode utilisée a
été adaptée à la nature et à la complexité de ces risques.
Le soin apporté à leur analyse et à la justification des mesures de prévention, de protection et
d’intervention est d’autant plus important que les conséquences des accidents possibles sont
graves pour les personnes exposées ou l’environnement.
9/100Référence R003-1613247EVE-V02
L’étude précise l’ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre à l’intérieur de
l’établissement, qui réduisent le risque à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement à un niveau
jugé acceptable par l’exploitant. Elle présente l’organisation générale qui permet le maintien de cette
maîtrise des risques ainsi que la détection et la correction des écarts éventuels. Elle doit être
conforme à l’arrêté du 29/09/05 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
Pour les établissements comportant au moins une installation classée répertoriée à l’annexe 1 de
l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 (« Seveso seuil bas ou seuil haut »), l’étude de dangers doit par
ailleurs contenir un document décrivant la politique de prévention des accidents majeurs dans lequel
l’exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l’application de cette politique.
Le site RYB n’étant concernée par l’annexe1 de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014, et ne
sera pas concernée par les obligations applicables aux installations relevant du régime
Seveso Seuil Bas.
Fondée sur les principes d’amélioration continue du niveau de sécurité des installations, et instruite
par l’inspection des installations classées, l’étude de dangers est fondée sur l’analyse des risques.
10/100Référence R003-1613247EVE-V02
Méthodologie de l’étude de dangers
Présentation de la méthode
L’étude est réalisée conformément aux prescriptions ministérielles en vigueur. Le synoptique de la
méthodologie globale adoptée est donné dans la Figure 1.
Description de Description des installations
l’environnement extérieur
Enjeux vulnérables Nature des activités
Collecte des
données Sources d’agression externes Caractéristiques des
d’entrée équipements
Organisation de la sécurité
Retour d’expérience / accidentologie
Caractérisation
des dangers Identification des potentiels de dangers
Réduction des dangers à la source
Evaluation préliminaire des risques
Intensité des effets dangereux
Risques Accidents majeurs
maîtrisés
Analyse des Analyse Détaillée des Risques (ADR)
risques
Cotation PCIG probabilité,
gravité, intensité et
cinétique (AM 29/09/05)
Mesures de réduction envisageables
Justification du niveau de risques
Configuration finale des installations
Figure 1 Etablissement RYB - Périmètre ICPE
Description du contexte de l’étude
La description de l’environnement du site permet d’établir le contexte d’implantation de l’installation
en mettant notamment en évidence les éléments à protéger et les éléments extérieurs constituant
des sources potentielles d’agressions.
La description de l’établissement précise les éléments techniques et fonctionnels permettant
d’appréhender le fonctionnement des installations, les flux de matières correspondant et
l’organisation de l’établissement. Elle détaille la politique de gestion des risques de l’exploitant en
insistant sur les principes généraux de sécurité, les mesures de maîtrise des risques mises en place,
les moyens d’intervention disponibles, la formation des opérateurs et le programme de maintenance
/ test des équipements de sécurité.
11/100Référence R003-1613247EVE-V02
Caractérisation des dangers
Les potentiels de danger de l’établissement sont identifiés et recensés à partir de l’analyse d’un
bureau d’études en charge de la rédaction de l’étude, afin de caractériser l’ensemble des situations
pouvant conduire à l’apparition des potentiels de dangers des installations. L’approche est basée
sur les sous-ensembles suivants :
Dangers liés aux propriétés intrinsèques des produits mis en œuvre dans les installations :
o Stockage,
o Gestion des stocks (manutention, opération de dépotage, reprise des réceptacles, etc.),
o Transfert matières sur le site (canalisation, transfert produits par chariot, par citerne,
etc.),
Dangers liés aux incompatibilités entre produits et emballements réactionnels,
Dangers liés aux caractéristiques des équipements,
Dangers liés aux conditions opératoires pouvant conduire à une situation dégradée
(température ou pression élevée, …),
Dangers liés aux risques naturels (externes à l’établissement),
Dangers liés aux utilités,
Retour d’accidentologie dans le domaine et retour d’expérience de l’exploitant.
Analyse de risque
A partir des potentiels de dangers identifiés, l’APR (Analyse Préliminaire des Risques) vise à
identifier pour chaque élément dangereux les différentes situations de dangers susceptibles de
survenir et de conduire à l’exposition de cibles à un phénomène dangereux. L’analyse, réalisée en
groupe de travail, cherche à identifier les causes et conséquences des situations de dangers ainsi
que les mesures de sécurité associées.
L’étude de dangers est conduite selon le principe de proportionnalité en fonction des risques et de
la vulnérabilité des intérêts à protéger. L’analyse préliminaire conduit à la hiérarchisation des
phénomènes dangereux. Pour ce faire, le critère d’évaluation retenu est l’intensité des effets
dangereux. À ce stade, une première cotation de l’intensité des phénomènes dangereux mis en
évidence est réalisée sans prise en compte des barrières de sécurité. L’échelle retenue (Tableau
1) permet de sélectionner les scénarii d’accidents dits « majeurs » nécessitant une analyse
approfondie et une amélioration en priorité.
Tableau 1 Echelle des classes d’intensité – APR
Echelle Intensité des effets dangereux
Forte intensité du phénomène, effets létaux
4
à l'extérieur du site Effets dangereux hors site
Intensité limitée du phénomène, effets (accidents majeurs)
3
irréversibles à l'extérieur du site
Effets dominos possibles ou atteinte des
2
équipements de sécurité sur site
Effets localisés, absence d'effets dominos, Effets dangereux sur site
1 pas atteinte des équipements de sécurité
sur site
12/100Référence R003-1613247EVE-V02
L’analyse détaillée correspond à une évaluation approfondie des scénarii d’accidents majeurs
identifiés lors de la phase préliminaire. Elle permet de caractériser les scénarii d’accidents majeurs
en probabilité, cinétique, intensité et gravité conformément aux échelles harmonisées de l’arrêté du
29 septembre 2005.
Cette étape s’appuie sur un examen détaillé des performances des barrières de sécurité (efficacité,
temps de réponse, niveau de confiance, …) et intègre la démonstration de la pérennité de la
maîtrise des risques par le biais de l’organisation de la sécurité au sein de l’établissement.
La finalité est de démontrer le niveau de maîtrise des risques en présentant les mesures de
réduction du risque mises en œuvre par l’exploitant et de vérifier que celles-ci sont adaptées aux
risques et sont suffisamment performantes. La réflexion portant sur l’amélioration de la sécurité est
conduite de manière itérative, le cas échéant, de nouvelles mesures de réduction des risques
peuvent être proposées.
La grille de criticité proposée dans le Tableau 2 est basée sur le couple probabilité-gravité des
scénarii d’accidents majeurs. Rappelons, que cette grille d’appréciation de la démarche de maîtrise
des risques d'accidents majeurs est issue de la circulaire du 10 mai 2010, relative aux
établissements dits SEVESO : grille de criticité avec des seuils d’acceptabilité pour les sites AS.
Tableau 2 Grille de criticité
Occurrence du phénomène dangereux
E D C B A
MMR rang 2
Gravité des 5 (1)
conséquences MMR rang 1 MMR rang 2
4
sur les
3 MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2
personnes
exposées au 2 MMR rang 1 MMR rang 2
risque MMR rang 1
1
Avec : Risque acceptable.
Risque non acceptable.
MMR* : mesures de maîtrise des risques (réexamen périodique) :
Rang 2 : si le nombre d’évènements situés dans des cases MMR rang 2 est > 5, le
risque est considéré comme non acceptable, et il convient de mettre en œuvre des
mesures complémentaires de maîtrise du risque.
(1) : dans le cas d’un nouveau site, l’exploitant doit mettre en œuvre des mesures
techniques complémentaires permettant de conserver le niveau de probabilité E en
cas de défaillance de l’une des mesures de maîtrise du risque.
13/100Référence R003-1613247EVE-V02
Remarques : les échelles retenues pour l’évaluation de la gravité et de la probabilité utilisées dans
la matrice d’acceptabilité sont celles de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
Documents de référence
Les principaux documents de référence utilisés dans le cadre de la mise à jour de l’étude de
dangers sont :
le Code de l’environnement – Livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
», notamment les articles L511-1 et L512-2 (partie législative) et R512-3 à R512-10 (partie
réglementaire) ;
la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages ;
l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumis à
autorisation ;
l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations
classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement
;
le guide relatif aux principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études de dangers
des installations classées soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique. Décembre
2006 ;
la circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 4 mai 2007 relatif au porter à la connaissance « risques
technologiques » et « maîtrise de l’urbanisation » autour des installations classées ;
la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de
dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de
la loi du 30 juillet 2003 ;
l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides
inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de
la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
le rapport d’étude Ineris DRA-2006-P46055-CL47569. Formalisation du savoir et des outils
dans le domaine des risques majeurs (DRA-35). Méthodes d’analyse des risques générés par
une installation industrielle - Omega 7. MEDD, 2006 ;
le rapport d’étude Ineris DRA-15-148940-03446A – Formalisation du savoir et des outils dans
le domaine des risques majeurs (EAT-DRA-76) –Etude de dangers d’une installation classée.
Omega 9. INERIS, 01/07/2015 ;
le rapport Ineris DRA 34 – Intégration de la dimension probabiliste dans l'analyse de risques ;
le rapport D1C de juillet 2004 et ses annexes – Projet ARAMIS ;
le résumé des travaux du groupe de travail sur la fréquence des évènements initiateurs
d’accidents et disponibilité des barrières de protection et de prévention – ICSI – 11 juillet 2006.
14/100Référence R003-1613247EVE-V02
2 Description et caractérisation de l’environnement
Localisation de l’établissement
Situation géographique
Le projet sera implanté sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs dans le
département de l’Isère, à environ 1,9 km au nord du centre-ville.
Projet nouveau site RYB
Figure 2 Localisation du site – fond de carte 1 / 25 000e
Source : Géoportail (extrait de la carte IGN)
Le site est délimité géographiquement par les éléments suivants :
Au Nord : des terrains agricoles ;
Au Sud : des terrains appartenant au Grenoble Air parc partiellement aménagés (Signs Europa,
Milolog), puis la route départementale n°119 qui relie l’autoroute A48 à la route départementale
n°519 au niveau de la commune de Saint-Siméon-de-Bréssieux ;
A l’Ouest : des terrains appartenant au Grenoble Air parc en attente d’aménagement et
actuellement à usage agricole ;
A l’Est : un terrain de 9,7 ha abritant une centrale photovoltaïque exploitée par la société
Voltalia.
Situé en zone rurale, l’habitat environnant est éloigné et l’habitation la plus proche (ferme du chemin
de Patou) est à 650 mètres au Sud.
15/100Référence R003-1613247EVE-V02
Situation cadastrale
Le site du projet aura une superficie totale de 61 059 m² (soit environ 6,1 ha), et disposera d’une
réserve foncière de 24 084 m² au Nord du site, exclu du périmètre du site pour l’instant.
Le détail des parcelles concernées par le site potentiel étudié et par l’implantation finale du projet
est présenté dans le Tableau 3, leur localisation est présentée dans la Figure 3.
Tableau 3 Parcelles cadastrales occupées
N° parcelle Section Commune Superficie cadastrale
27 ZE Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 2 431 m²
28 ZE Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 7 395 m²
29 ZE Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 3 295 m²
33 ZE Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 1 587 m²
34 ZE Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 6 209 m²
35 ZE Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 3 913 m²
36 ZE Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 29 720 m²
30 et 173 ZE Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs Emprise partielle – 6 059 m²
Figure 3 Plan sur fond cadastral
16/100Référence R003-1613247EVE-V02
Topographie du site
La commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs appartient à l’entité géographique nommée « Plaine
de Liers, Bièvre et Valloire ». Ce territoire s’organise autour de plaines agricoles situées à une
altitude d’environ 400 m. Les reliefs sont de types collinaires. Ils sont occupés par des massifs
forestiers comme ceux de Bonnevaux et de Chambaran. C’est dans cet espace où alternent les
paysages collinaires et ceux des plaines agricoles, que s’inscrit la commune de Saint-Etienne de
Saint-Geoirs.
Cet ensemble géographique a été formé par l’avancée d’une des langues du glacier de l’Isère au
quaternaire. Le terrain visé par le projet d’aménagement s’inscrit dans cette plaine, à une altitude
comprise entre 390 et 400 m NGF.
Définition de l’aire d’étude
Par analogie avec la définition des aires d’étude retenue dans le cadre d’une étude d’impact, l’aire
d’étude correspond à l’étendue géographique potentiellement soumise aux effets du projet.
Les distances d’effets sont fonctions de la nature des installations projetées sur le site et sont
déterminées dans le cadre de la présente étude.
D’après par notre retour d’expérience sur des installations similaires, nous retenons un rayon de
100 mètres autour du site. Les zones maximales des effets associés aux phénomènes dangereux
présentés par les installations projetées sont circonscrites à l’aire d’étude retenue.
17/100Référence R003-1613247EVE-V02
Environnement anthropique – description des activités humaines
Zones habitées
Le projet sera implanté sur une zone d’activités à vocation économique exempt de toute habitation.
Les premières habitations sont éloignées à plus de 675 mètres au Sud du site.
Etablissements recevant du public
Il n’y a aucun établissement recevant du public dans la zone d’étude.
Le premier établissement recevant du public est la salle de sport « Aérosport » à environ 800 mètres
à l’Ouest. A noter que l’aéroport Grenoble-Isère est éloigné de plus de 1,1 km à l’Ouest du site du
projet.
Voies de communication
L’accès au site se fera par l’avenue Louis Blériot au sud et comprendra une entrée et une sortie.
Projet nouveau site RYB
Légende :
Zone d’étude
Route(s) à double-voies
Route(s) départementale(s)
Figure 4 Grands axes de communication – Commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
Source : IGN
18/100Référence R003-1613247EVE-V02
Routes nationales :
La commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs ne dispose d’aucune route nationale.
Voiries départementales :
La commune du Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs dispose de 3 voiries départementales :
la D119, traversant la commune d’Est en Ouest. Elle est à double-voie et permet de rejoindre
l’autoroute A48 du plus à l’Est ; Il s’agit de la route départementale la plus proche du site,
elle tangente la zone d’étude au sud ;
la D514 à 250 m à l’Est du site, elle relie la ville de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs celle de la
Flette et rejoint la route de Lyon ;
les D 518 et 519c qui permettent de relier la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs aux
communes voisines à l’Est (sillans) et à l’Ouest (Brézins).
Voiries communales :
Les transports routiers de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs s’organisent autour d’un réseau communal
maillés desservant l’ensemble du territoire de la commune avec des zones de franchissement plus
difficiles : la route départementale D119, l’ancienne voie ferrée et la zone de l’aéroport de Grenoble
Alpes Isère.
Autoroute :
L’autoroute la plus proche du site est l’A48, surnommée « l'Autoroute du Dauphiné », située à
environ 10 km à l’est du site.
Voies ferrées :
La commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs était traversée par l’ancienne ligne ferroviaire de
Saint-Rambert-d'Albon à Rives qui reliait vallée du Rhône (ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-
Charles) à la préfecture du département de l'Isère. Elle n’est plus exploitée que entre Saint-
Rambert-d'Albon et Beaurepaire où subsiste un trafic de céréales et d'engrais et à proximité de
Beaucroissant où elle dessert une carrière.
Aérodrome :
L'aéroport de Grenoble Alpes Isère est situé sur la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs à
plus de 200 m au Nord du site. Cet aéroport, anciennement appelé Grenoble-Isère et Grenoble-
Saint-Geoirs, est un aéroport desservant la métropole de Grenoble et le département de l'Isère dont
les stations de sports d'hiver à forte notoriété.
Le trafic 2017 a été de 345 128 passagers classant l'aéroport à la 34ème place nationale.
19/100Référence R003-1613247EVE-V02
Environnement industriel
La commune du Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs n’est pas concernée par la présence d’un plan de
prévention des risques technologiques (PPRT).
D’après la recherche dans la base de données des Installations Classées au titre de la Protection
de l’Environnement (ICPE), il n’y aucune autre installation présente à l’intérieur de la zone d’étude.
Le site le plus proche recensé dans cette base de données est celui de Knauf Industrie Est à 200
m à l’Ouest.
Les activités industrielles dans la zone d’étude sont localisées en Figure 5.
Optimat’R
(maintenance
machines spéciales)
Centrale
photovoltaïque
VOLTALIA
Signs Europa Milolog
(logistique spécialisée) (logistique)
Figure 5 Installations industrielles voisines du site RYB
Source photographie aérienne : Géoportail
Environnement urbain – Plan Local d’Urbanisme
La commune du Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé
le 12 juillet 2006 et modifié en 2015 et 2018. Le site est actuellement en zone UIz dédiée aux
activités économiques de la ZAC Grenoble Air-Parc.
La compatibilité du projet avec le règlement du PLU de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs est détaillée
dans l’étude d’incidence environnementale (rapport R002-1613247EVE intégrée au présent
dossier).
Le projet RYB sera conforme aux prescriptions du PLU.
20/100Référence R003-1613247EVE-V02
Transport de Matières Dangereuses
D’après le site Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr/), la commune de Saint-Etienne-de-
Saint-Geoirs est traversée d’Est en Ouest par une canalisation de transport de gaz naturel éloignée
à plus de 600 mètres au Sud du site qui est en dehors de la zone d’étude.
Environnement naturel
Milieux naturels protégés
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se définit par
l’identification d’un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont
été identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel.
On distingue deux types de ZNIEFF :
Les ZNIEFF de type I qui correspondent à des sites précis d’intérêt biologique de grande valeur
écologique (floristique et faunistique ou d’habitats)
Les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels qui se distinguent de la moyenne du territoire
régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d’artificialisation plus faible. Ces
zones peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.
Il n’y a pas de ZNIEFF dans la zone d’étude.
La ZNIEFF la plus proche du site RYB correspond aux « Prairies de l’aéroport de Saint Etienne-de-
Geoirs » qui sont à 250 mètres au Nord du projet.
Zones humides
Les zones humides sont définies comme étant des étendues de marais, de fagnes, de tourbières,
d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante,
douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse
n’excède pas six mètres.
Les zones humides concernées doivent avoir une importance internationale au point de vue
écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique.
D'après le portail des zones humides "Auvergne Rhone Alpes", la zone humide la plus proche est
à 1,4 km au sud, le long du ruisseau des marais.
Il n’y a pas de zone humide dans la zone d'étude.
Réseau Natura 2000
Les objectifs du réseau Natura 2000 sont :
D’assurer la pérennité ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des
habitats naturels, des habitats d’espèces de la Directive « Habitats » et des habitats
d’espèces de la Directive "Oiseaux",
21/100Référence R003-1613247EVE-V02
De contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable en cherchant à concilier au
sein des sites qui le composeront les exigences écologiques des habitats naturels et des
espèces en cause avec les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les
particularités régionales et locales.
Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de zones protégées d’où l’homme doit être exclu, ils
doivent être des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte qu’ils puissent préserver leurs
richesses patrimoniales et leur identité en maintenant les activités humaines.
Il n’y a pas de site Natura 2000 dans la zone d'étude.
Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude correspond à la Zone Spéciale de
Conservation «Tourbière du Grand Lemps » (FR8201728) située à 7,8 km au Nord-Est du site
d’étude.
Autres zones naturelles
Le site RYB n’est concerné par aucune de ces zones naturelles :
Arrêté de Protection de Biotope,
Réserve naturelle,
Parc naturel régional.
Géologie
D’après la carte géologique du secteur (source : Infoterre, BSS), le site est localisé au cœur de
l’entité géologique de la Plaine de la Bièvre-Valloire. Il s’agit d’un secteur caractérisé par une
géologie simple, et présentant des formations de type alluvionnaires. Une seule entité géologique
est représentée sur cette zone : dépôts würmiens fluvioglaciaires.
FGya2 : alluvions fluvioglaciaires des basses terrasses
Ce terrain est constitué de cailloutis à galets et de petits blocs plus ou moins roulés, pouvant
contenir quelques blocs plus volumineux mais émoussés. L’ensemble est compris dans une matrice
sablo-graveleuse bien lavée.
Cette structure découle du remaniement de la moraine par les eaux de fusion glaciaires.
Les alluvions fluvio-glaciaires se sont déposées en terrasses échelonnées latéralement et
verticalement, remplissant des chenaux ou vallées mortes, naissant dans des ravinements étroits
correspondant aux alignements morainiques successifs. L’épaisseur de ces alluvions est comprise
entre 15 et 30 mètres sur le secteur de la plaine.
Compte-tenu du contexte géomorphologique, la lithologie est considérée comme homogène,
régulière et d’après le point BSS001WNVS (forage d’eau) situé à environ 350 mètres à l’Est du site
d’étude, la lithologie est constituée des lits de marnes plus ou moins argileux jusqu’à une profondeur
d’environ 40 mètres (source : Infoterre, BSS).
Le niveau de la nappe est identifié à une profondeur comprise entre 360 et 370 m NGF, ce qui
correspond à une profondeur de 30 à 40 m.
22/100Référence R003-1613247EVE-V02
Hydrogéologie
Le site d’étude est concerné par deux masses d’eau souterraines superposées.
Tableau 4 Masses d’eau souterraine concernées par le projet
Code de la Nom masse d’eau Objectif / Etat quantitatif Etat chimique
masse d’eau Etat actuel
FRDG303 Molasses miocènes du Bas Etat actuel Bon (2009) Mauvais (2009)
Dauphiné
entre les vallées de l'Ozon et de la Objectif bon état 2015 2021
Drôme + complexes morainiques
FRDG219 Alluvions de la Plaine de Bièvre- Etat actuel Bon (2009) Mauvais (2009)
Valloire
Objectif bon état 2015 2021
La nappe superficielle des « alluvions de la Plaine de Bièvre-Valloire » est alimentée :
- par son propre impluvium,
- par les versants molassiques et les cours d’eau qui en découlent,
- par certaines vallées adjacentes.
La nappe libre principale s’écoule d’Est en Ouest avec un gradient piézométrique de 0,6% ; sa
profondeur est située entre 360 m et 370 m NGF avec des hautes eaux en mars et des basses eaux
en septembre.
Hydrologie
Le site d’étude appartient au sous bassin versant « Bièvre Liers Valloire ». La plaine de Bièvre, qui
est une « vallée fossile », n’a pas été creusée par les cours d’eau qui la traversent actuellement,
mais par le glacier de l’Isère. D’autre part, la bonne perméabilité des formations superficielles a
conduit à l’établissement d’un réseau hydrographique peu développé.
Il n’y a aucun cours d’eau dans la zone d’étude.
Les cours d’eau les plus proches du site d’étude sont :
le Barbaillon (à 1,4 km au Nord-Ouest) ;
la Coule (à 1 km au Sud) prenant également le nom de ruisseau des Marais ou de la
Ravageuse, et qui se rejette dans le Rival plus à l’Ouest au niveau de la commune de
Brézins.
23/100Référence R003-1613247EVE-V02
Météorologie
La station météorologique la plus représentative du secteur d’étude est celle de Grenoble-Saint-
Geoirs (aéroport) située à 1 km à l’ouest du site, pour une altitude de 384 m NGF.
Les températures
Les relevés des températures moyennes enregistrées sur la station météorologique la plus proche
se répartissent ainsi sur l’année :
Tableau 5 Températures moyennes mensuelles en °C sur la période 1971-2008 sur la station de
Grenoble-Saint-Geoirs
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
2,4 3,9 6,8 9,4 14,0 17,5 20,0 19,7 16,0 11,9 6,1 3,2
Source : Météo France
La température moyenne interannuelle est voisine de 11°C.
Les minimas sont observés au mois de janvier, avec une moyenne mensuelle de 2,4°C et les
maximas au mois de juillet avec une moyenne mensuelle de 20°C.
Zone de collines prolongeant vers l'ouest le massif de la Chartreuse et culminant à 800 m environ,
les Terres froides, bien que d'altitude modeste, connaissent un nombre assez élevés de jours de
gel, neige et brouillard.
L'aéroport de Grenoble Alpes Isère à 384 m d'altitude, est assez représentatif de cette zone, cette
station a un climat de type Cfb (Océanique) avec comme record de chaleur 39,5 °C le 13 aout 2003
et comme record de froid −27,1 °C le 3 janvier 1971. La température moyenne annuelle est de 10,9
°C.
Les précipitations
La moyenne des précipitations interannuelles sur la période de 1971 à 2008, est de 940 mm sur la
station de de Grenoble-Saint-Geoirs.
La répartition des pluies est hétérogène avec des mois très pluvieux et des mois beaucoup plus
secs sans saisonnalité particulière. Les plus fortes précipitations sont observées à l’automne. Les
moyennes mensuelles fluctuent de façon importante autour de la value moyenne de 78,5 mm par
mois. Les pluies sont assez fréquentes (108 jours/an) mais peu importantes (29 jours/an où les
précipitations dépassent 10 mm).
Tableau 6 Hauteur moyenne des précipitations mensuelles en mm sur la période 1971-2008 sur la
station de Grenoble-Saint-Geoirs
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
63,0 57,4 73,2 82,5 98,8 79,1 64,5 72,0 102,4 105,2 85,2 65,1
Source : Météo France
24/100Référence R003-1613247EVE-V02
Régime des vents
Les vents dominants au droit de la station de Grenoble-Saint-Geoirs sont majoritairement en
provenance de secteurs Est avec une fréquence annuelle de 26,6 % (groupes de vitesses entre 80
et 120°). Au total, près de 56% des vitesses des vents sont comprises entre 5 et 16 km/h et moins
de 2% sont supérieures à 29 km/h.
La répartition moyenne annuelle des classes de vitesses est la suivante :
Tableau 7 Fréquence des vents par vitesse - Station de station de Grenoble-Saint-Geoirs (Source
météo France)
Vitesse du vent en km/h < 5,4 5,4-16,2 16-28,8 > 28,8
Fréquence en % 24,1 55,7 18,4 1,8
Le secteur d’étude est une zone peu venteuse avec peu de fortes rafales.
La rose des vents de la station de Grenoble-Saint-Geoirs pour la période 1971-2008 est présentée
en Figure 6 ci-après.
Figure 6 Rose des vents - station de Grenoble-Saint-Geoirs
Source : Météo France
25/100Référence R003-1613247EVE-V02
Risques naturels
Séismes
La commune de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs est classée en zone de sismicité 3 (modérée).
Aucun PPR sismique n’est présent sur la commune
Inondation
D’après la base de données GEORISQUES, la commune de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs est
recensé dans l’atlas des zones inondables du Rival et de l’Oron.
Les risques inondation concernent, en termes de surfaces impactées, plus particulièrement les
zones situées en plaine, depuis Saint-Siméon-de-Bressieux jusqu’au Rhône. Ils sont liés
notamment aux cours d’eau le Rival, l’Oron et les Collières.
La majorité des zones urbaines sont en partie protégées contre les inondations. Les différentes
études hydrauliques menées font cependant apparaître des zones à enjeux forts sous protégées :
La Frette, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Brézins (en cours de résolution par projet de bassin de
rétention en amont de la commune), ZI du Rival à la Côte St André, Marcilloles, St Barthélemy,
Beaurepaire.
En effet, les analyses hydrauliques des crues, notamment de 1988 et 1993 (Sogreah, 2000 ; Lefort,
1996), ont mis en évidence la vaste étendue de la zone inondable qui touche, entre autres, des
zones urbaines situées en plaine (Brézins, Marcilloles, St Barthélemy, Beaurepaire, Manthes,
Epinouze, Anneyron, St Rambert d’Albon,...) et en limite de coteaux (Izeaux, Sillans, Saint-Étienne-
de-Saint-Geoirs, St Siméon de Bressieux, Sardieu, Albon, St Sorlin en Valloire).
Les sols des plaines sont généralement favorables à l’infiltration des eaux de crue. Ce phénomène
couplé aux surfaces importantes d’expansion de crue permet d’écrêter les pics de crue et de
diminuer les volumes écoulés. Les zones concernées se situent notamment dans les basses
terrasses le long du Rival de part et d’autre en amont de Beaufort et dans la Valloire entre St-Sorlin-
en-Valloire et Coinaud à Anneyron (SRAE, 1981). De ce fait dans les plaines, l’aléa va de faible
à moyen, sauf à proximité immédiate du cours d’eau ou derrière un ouvrage, type digue. En effet
la hauteur d’eau et la vitesse de l’eau des zones d’expansion restent relativement modérées.
De plus la commune de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs n’est concernée par aucun plan de
prévention du risque inondation (PPRI).
Foudre
Le tableau ci-dessous recense le nombre de jour moyen d’orage (Nk) à la station de Saint-Étienne-
de-Saint-Geoirs pour la période comprise entre 2009 et 2018.
En France, les valeurs de la densité de foudroiement sont déterminées par le réseau Météorage.
La densité de foudroiement Ng qui exprime la valeur annuelle moyenne du nombre d’impacts de
foudre, est de 1,27 impacts par km² par an sur la commune de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
26/100Vous pouvez aussi lire