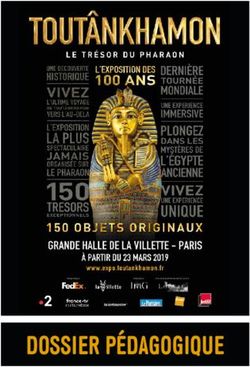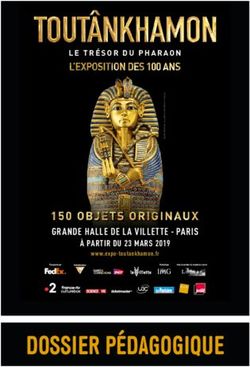DOSSIER PEDAGOGIQUE Amours - Arbre Compagnie, d'après le roman " Amours " de Leonor de Recondo Collégiens et Lycéens à partir de 13 ans
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
DOSSIER PEDAGOGIQUE
Amours - Arbre Compagnie, d’après le roman « Amours » de Leonor de Recondo
Collégiens et Lycéens à partir de 13 ans2 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
SOMMAIRE
LA PIÈCE ....................................................................................................................................... 3
Soutiens ................................................................................................................................... 3
Calendrier de production : ...................................................................................................... 3
Résumé de la pièce.................................................................................................................. 4
L’ŒUVRE ORIGINALE .................................................................................................................. 5
LA MISE EN SCENE ...................................................................................................................... 6
Intentions de la metteuse en scène ....................................................................................... 6
Note d’intention scénographique - Blandine Vieillot ............................................................ 7
Note d’intention son - David Gubitsch ................................................................................... 8
LES THÈMES DE LA PIÈCE ........................................................................................................... 9
L’amour et la vie conjugale ..................................................................................................... 9
Les corps et les classes sociales ............................................................................................. 9
La place de la religion .............................................................................................................10
L’homosexualité .....................................................................................................................10
Le rapport au corps et à l’intimité .........................................................................................10
PISTES DE TRAVAIL .................................................................................................................... 11
Avant la représentation ......................................................................................................... 11
Après la représentation ........................................................................................................ 28
EXTRAITS ................................................................................................................................... 30
ANNEXES.................................................................................................................................... 38
Présentation de la compagnie .............................................................................................. 38
Biographies ............................................................................................................................ 40
Photos du spectacle .............................................................................................................. 44
Bibliographie indicative......................................................................................................... 453 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
LA PIÈCE
D’après le roman de Léonor de Recondo
Adaptation et mise en scène : Vanessa Sanchez
Pièce pour 3 comédien.ne.s/danseur.se.s et des marionnettes
Soutiens
Coproducteurs :
DRAC Centre-Val de Loire,
Conseil Régional Centre-Val de Loire,
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir,
Atelier à Spectacle scène conventionnée de l’agglomération de Dreux (28),
La Forge d’Aubigny-sur-Nère (18),
Grange Théâtre Vaugarni (37),
La Grange de Luynes (37) ;
Espace Paul Eluard de Stains (93),
Soutiens :
Le 5 Côté Jardin de Torçay (28)
Cercle Laïque de Dreux,
Ciné bébé.
Calendrier de production :
Adaptation du roman :
Entre février et juin 20 / aller-retours possibles avec Léonor de Recondo et/ou son éditrice
et Vanessa Sanchez (suggestions, corrections)
Répétitions :
De juin 20 à février 21 / 8 semaines de résidence de création
Création :
- 3 représentations prévues à la Grange Théâtre Vaugarni (37) en juillet 2021
- 2 représentation prévue à l’Atelier à Spectacle Scène Conventionnée Agglo Dreux (28)
les 18 et 19 octobre 20214 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
Résumé de la pièce
Voici le récit d’une histoire d’amour impossible entre deux femmes.
Nous sommes en 1908, une maison bourgeoise, un bourg cossu du Cher, où la chair
est triste pour tous les êtres. Victoire est mariée depuis cinq ans avec Anselme de
Boisvaillant. Victoire s’ennuie, elle relit Madame Bovary et fuit l’enchevêtrement immonde
que son époux impose à la jeune domestique, Céleste, bientôt enceinte. Rien ne destinait
Victoire, jeune fille de son temps, précipitée dans un mariage arrangé avec un notaire, à
prendre en mains sa destinée.
Quand elle découvre la grossesse de Céleste, sa détermination se montre pourtant sans
faille et elle transforme cette situation délicate en opportunité. Méfiez-vous des maisons
aux ardoises trop bien alignées, nous dit Léonor de Récondo. Elles dissimulent des
tempêtes intérieures et des révolutions à pas feutrés. Cet enfant sera celui du couple,
l’héritier Boisvaillant tant espéré.
Céleste, quant à elle, a grandi dans une famille tellement nombreuse qu'elle ne s'est jamais
considérée comme une personne digne d'égards. L'enfant qui s'annonce en elle va réveiller
ses sens, ainsi que ceux de son entourage, en dépit des règles de bienséance. C’est dans ce
huis clos que Léonor de Recondo va laisser s’épanouir le sentiment amoureux le plus pur-
et le plus inattendu. Comme elle l’a déjà fait dans le passé, la maison aux murs épais
s’apprête à enfouir le secret de famille. Mais Victoire n’a pas la fibre maternelle, et le
nourrisson dépérit dans le couffin glissé sous le piano dont elle martèle inlassablement les
touches.
Céleste, mue par son instinct, va retrouver chaque nuit son petit pour le réchauffer. Quand
une nuit Victoire s’éveille seule, ses pas la conduisent vers la chambre sous les combles…
Elle découvre le corps de Céleste avec cet enfant sur sa peau, c’est une immense
découverte : la découverte de la beauté du corps, alors que Victoire elle-même était dans
une sorte de haine vis-à-vis de soi. Elle découvre la beauté du corps de la femme, et cette
révélation va aussi lui permettre de se découvrir elle-même ; elle va se voir.
Ces corps d'abord déniés, enserrés dans un corset de faux-semblants et de convenances.
Mais ces corps affamés, bientôt mis au jour et libérés, dans une ode superbe à la féminité
et aux ressources que l'on ne soupçonnerait pas en soi.
Les barrières sociales et les convenances explosent alors, laissant la place à la ferveur d’un
sentiment qui balayera tout.
Cependant… la religion viendra y remettre bon ordre, et ne resteront que les rassurants
clichés photographiques d’une famille modèle.5 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
L’ŒUVRE ORIGINALE
Amours, Leonor de Recondo, Sabine Wespieser Editeur,
Paris, 2015
Amours a été récompensé par le Grand Prix RTL-Lire et le Prix
des Libraires en 2015.
Née en 1976, Léonor de Récondo est violoniste et écrivaine. Elle
se produit avec de nombreuses formations et est lauréate du
concours international de musique baroque Van Wassenaer en
2004. Elle est l’auteur de Rêves oubliés (2012), Pietra viva (2013),
Point cardinal (2017) et La Leçon de ténèbres (2020).
« Léonor de Recondo excelle à promener un regard très contemporain sur les époques
passées. Son style spontané, concis, direct, passe au laser les existences les plus troubles, pour
révéler leur nature profonde. Hontes sociales, désirs intimes et peurs ancestrales sont mis à
nu avec évidence et fraîcheur. » Télérama
« Sous la patine classique du roman de mœurs (difficile de ne pas penser à Flaubert),
Amours conjugue au présent les diverses formes de violences faites aux femmes, du
moyenâgeux droit de cuissage à l'interdiction du plaisir pour le corps féminin. Si le récit est
ancré dans un village de province à l'aube du XXe siècle, ses deux héroïnes témoignent d'une
même voix, et ce, en dépit de leur différence de statut social, de problématiques loin d'être
disparues dans nos sociétés contemporaines où plaisir rime tantôt avec injonction, tantôt
avec interdiction. La parfaite maîtrise du huis clos renforce page après page une sensation
d'étouffement qui, en dépit d'apparentes libérations (les corsets brûlés dans le jardin), fait se
fissurer l'édifice bourgeois jusqu'au drame final. » Journal du Dimanche6 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
LA MISE EN SCENE
Intentions de la metteuse en scène
« En adaptant le roman, j’ai respecté le récit et l’écriture de l’autrice. Je me suis
recentrée sur le lien entre les deux femmes. Le récit du livre se déroulant au présent, cela
a facilité ma tâche. On est déjà dans l’action. A noter que Léonor de Recondo a cautionné
mon adaptation. L’écriture passe de la forme narrative en adresse publique, au jeu dans le
ring central : l’intimité de cette maison. Ainsi les deux femmes s’extraient parfois de cet
intérieur en cassant le « 4ème mur », comme on va à confesse. Le personnage se fait alors
voix ou regard un peu clinique, qui tire les ficelles, qui manipule. Marionnettiste.
INFLUENCES HISTORIQUES
Amours c’est l’époque de Colette, de Virginia Woolf. La Belle Epoque. Un peu plus
tard, il y aura Henry Miller aussi, de l’autre côté de l’Atlantique dont les lectures m’ont
fortement marquée. C’est l’époque de Klimt, de Schiele. Tant de figures émancipatrices.
Mais toutes ces influences arrivent doucement et à retardement dans la province où
habitent les de Boisvaillant. On voit Victoire et Céleste chez Maxim’s, on les regarde brûler
leurs corsets… Mais l’issue fatale nous permet de nous questionner sur les murs que l’on
se prend à nouveau aujourd’hui, les murs de régression, de violence sociale, les murs
religieux, communautaires, patriarcaux. Toutes ces réflexions soulevées par le texte
raisonnent fortement en moi, avec ce que je veux porter sur scène. Fort écho avec ma
révolte.
Mon écriture scénique est très influencée par mes années de théâtre de rue. J’aime soigner
le visuel, plonger dans des univers esthétiques forts. Je vise à situer mon travail au
carrefour du théâtre, de la poésie visuelle et de la danse.
MOUVEMENT
Je vais m’attacher avec cette nouvelle pièce à creuser le théâtre dansé. Dans ce
travail, je serai accompagnée par Jessica Fouché. On se connaît bien. Elle n’a pas son pareil
pour mettre en danse les images que j’ai dans ma tête ! Tout en y apportant sa touche
personnelle très créative.
Ce travail me fascine. Par son approche corporelle, une scène prend alors une ampleur
percutante qui atteint directement l’essence du propos, sa poésie.
Les parties dansées représenteront principalement les scènes charnelles entre les deux
femmes, les scènes de révélation maternelle, mais aussi par exemple la scène
d’introduction du spectacle, à savoir le viol de Céleste par Anselme. Elles pourront7 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
également apparaître comme un gimmick pour représenter l’ennui de Victoire, le travail
des bonnes, la raideur d’Anselme… » - Vanessa Sanchez
Ainsi, Vanessa Sanchez dirige ses comédien.ne.s vers un jeu vibrant et corporel. Elle
suggère tous les moments charnels par des moments de mouvement et de danse figuratifs.
Tout est suggéré, rien n’est choquant.
MARIONNETTE
« On se concentre sur le parcours de ces deux femmes, leur corps. J’imagine les
autres personnages comme des satellites, représentés sous forme de marionnettes (la
vieille domestique Huguette, le couple d’amis Joseph et Odette, le bébé etc…).
Ce n’est pas que je considère la marionnette comme un art de second plan, bien au
contraire, mais ce stratagème me permet de poser une convention ludique avec le
spectateur, et mettre une distance poétique et drôle avec le propos.
Les 3 interprètes (2 femmes, 1 homme) sont tour à tour comédiens, danseurs, narrateurs
et manipulateurs, dans un ensemble que j’espère fluide et rythmé.
Note d’intention scénographique
La scénographie est au plus proche des sensations des personnages, elle accompagne
leurs émotions et évolue en même temps qu’eux. La pièce commence dans un lieu clos et
sans couleur, il semble figé dans le temps, sans échappatoire possible. Cet espace va
s'éclater progressivement et prendre vie au cours de la pièce. La couleur va
progressivement envahir le plateau au sein de l'espace, elle sera révélatrice des sentiments
et libérateur des corps. » - Vanessa Sanchez
« Un code couleur est imposé : camaïeu rouge / rose chair / rose / crème / orange rouille.
Un décor non figuratif et évolutif. Le décor et les costumes sont patinés dans un ensemble
formant comme une aquarelle composée d’un mélange diffus du sang qui tâche, du lait qui
coule, des larmes qui diluent la couleur dans un halo, du liquide amniotique, et toutes sortes
de sécrétions organiques ! » - Blandine Vieillot scénographe8 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
Note d’intention son - David Gubitsch
« Lorsque Vanessa Sanchez me contacte pour me proposer de prendre en main la mise
en son de son nouveau projet, nous sommes alors en plein confinement. Mes recherches
sonores de la période se portent autour de la redécouverte du silence ou du moins
d’ambiances confinées. C’est une envie commune avec Vanessa sur ce projet. Aller vers une
certaine simplicité dans le son permettant de dégager une émotion très particulière dans
cette histoire. L’idée est alors de commencer par construire une sorte de second décor,
sonore cette fois ci. Je mets à profit mes quelques années d'expérience dans la musique
de film et mon choix (malheureusement trop rare dans ce métier) de travailler étroitement
avec le montage son du film. Ce que l’on appelle les fonds d’air (faux silences en cinéma)
et percevoir l’espace dans lequel se déroule la scène. La mise en son de la maison et de ses
différentes pièces, quelques espaces extérieurs, un hôtel, une église... permettront de faire
apparaître plus subtilement les musiques et de garder ainsi une certaine proximité - intimité
avec les personnages. Cela permettra également de jouer sur les contrastes et une certaine
profondeur de champ sonore. Le choix des instruments : en dehors des instruments
imposés par le texte original (piano, orgue), je fais le choix de démarrer la partition de cette
pièce avec des ensembles assez fournis (musiques plutôt bourgeoises & faux-semblants)
mêlant instruments classiques traditionnels et une part de sons électroniques-organiques
plus introspectifs. Ce travail sur les sons organiques mettra en évidence « le grondement »,
forme tellurique de l’instinct et émotions du personnage de Céleste, mais également ce
grondement annonciateur d’une libération, de la découverte et de l’ouverture de son
monde intérieur. Le travail sur les voix : l’histoire d’amour de Céleste & Victoire sera
l’occasion de se débarrasser des oripeaux musicaux. Plus nous avancerons dans le temps,
plus nous irons vers ces voix intérieures laissant apparaître les émotions aux plus près des
corps d’un amour hors du temps et des conventions de ce début de XXème siècle. Ainsi la
construction de cette bande son s'apparente plus que d’habitude au travail appliqué en
cinéma ou encore dans les fictions radiophoniques. Le spectateur sera immédiatement
plongé dans un espace sonore hors de son temps mais également plus intime,
l'accompagnant au plus près des émotions des protagonistes de cette pièce. »9 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
LES THÈMES DE LA PIÈCE
L’amour et la vie conjugale
Amours raconte les amours au pluriel. L’amour maternel entre Céleste et son fils Adrien,
l’amour interdit entre Céleste et Victoire. Mais le spectacle raconte aussi l’absence
d’amour. L’absence d’amour dans un couple issu d’un mariage arrangé, entre Victoire et
Anselme, mais aussi la difficulté à aimer un enfant issu de la violence et du mensonge, dans
le cas de Victoire. Ainsi, l’amour n’est pas toujours où on l’imagine. Alors que le couple
Champsfleury - Boisvaillant faisait figure de fierté pour leurs familles, et devait mener à la
conception d’un foyer chaleureux, c’est finalement entre la bourgeoise et sa bonne que
l’amour est né, contre les conventions morales et religieuses de l’époque. Dans Amours, la
vie conjugale est montrée comme pesante, contraignante pour deux individus qui ne se
sont pas choisis. Victoire peine à se plier aux devoirs de la bonne épouse, c’est-à-dire
concevoir un enfant, l’absence de désir charnel pour son mari très rangé ne l’y aide pas. Au
début du XXe siècle, le mariage bourgeois est encore largement un mariage homogame,
souvent arrangé et destiné à protéger les fortunes familiales. Mais la froideur de cette
procédure et l’absence d’amour qui en découle sont petit à petit dénoncés, par George
Sand et Léon Blum notamment. Aujourd’hui, le mariage forcé ou arrangé est toujours une
réalité pour nombre de jeunes filles dans le monde.
Les corps et les classes sociales
Amours rappelle comment le corps des femmes est toujours contraint, que l’on soit
bourgeoise ou bonne. Mais le transport, d’allégresse et d’amour de Céleste et Victoire va
les emmener ailleurs dans leur vie auparavant toute tracée et bousculer leur place. Encore
du mouvement, encore de la danse ! L’émancipation vient de la plus « éduquée », celle qui
a le temps, celle qui prend le moins de risques. Elle va involontairement pousser l’autre à
sa perte. La classe dominante s’en sort toujours. Le bon sens populaire. La bonne va se
sacrifier. Elle est soumise à la loi judéo-chrétienne. Elle se sacrifie pour son fils, pour l’ordre
des choses. Elle n’a jamais été que le jouet de ces gens, elle n’a aucune estime pour elle-
même. Être laborieux, bête de somme. Elle sait. Elle n’y croit pas depuis le début. Elle
connaît la chanson, même si elle a envie d’y croire, même si elle chope un bout de bonheur
et de bouffée d’air, elle connaît d’avance l’implacabilité du système. Elle libère son fils. Elle
offre son fils. L’homme. L’homme lui aussi est ici victime. Victime de sa classe, de son
éducation. Il ne comprend rien à ce qui se joue dans son antre d’où il est peu à peu chassé.
Il est le maître en apparence, le bon patriarche notaire qui faute de trouver du réconfort
dans les bras de sa femme, va l’arracher dans ceux de sa bonne. Comme il ira ensuite
l’acheter dans ceux des prostitués. Sans se poser de questions, en suivant les codes de sa
caste, du paraître.10 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
La place de la religion
L’intervention du religieux est comme le deus ex-machina qui va faire tout basculer,
alors que l’assomption de l’amour des deux femmes semble acquise. La religion permet de
manipuler la prolétaire. Céleste supporte sa pauvre vie d’ici-bas grâce à son adoration de la
vierge. Victoire est prête à s’émanciper de ses croyances. Céleste est rattrapée par sa
culpabilité. La religion vient casser leur transport / trans-classe. La figure du religieux, ici,
comme un bon père protecteur qui veille depuis son enfance sur Victoire, va s’avérer
surtout protecteur de l’ordre établi. Où l’on voit comment les notables s’arrangent. La
photo de famille est l’une des dernières images du spectacle. Exit la petite bonne. On garde
la face, on expose l’image d’une famille idéale. Pulvérisée de l’intérieur mais propre sur elle
à l’extérieur. Avec le papa, la maman, le fils et le curé de famille.
L’homosexualité
Innocemment elles se découvrent attirées l’une par l’autre. Ce n’est pas le sujet
principal de l’histoire. Mais l’homosexualité arrive par surprise. Elle n’est pas appuyée, elle
est. Point. Amours donne à voir une émancipation par le biais de l’homosexualité. Ça
résonne fort encore. On peut y voir un parallèle contemporain : les homosexuel.le.s sont
toujours et encore victimes de violences et de rejet et pourtant les grandes avancées sur
les questions de mœurs aujourd’hui sont portées par eux et elles; PACS, mariage pour tous,
homoparentalité, droit à l’adoption, à la GPA. Ils bousculent là aussi l’ordre établi.
Le rapport au corps et à l’intimité
C’est le sujet central de la pièce. Ici l’émancipation arrive par le corps, la chair. Ça ne
passe pas par la tête. Vanessa Sanchez se sert de la danse pour montrer/évoquer la
sexualité, comme une exultation/exaltation qui répare et libère. De même, elle utilise la
danse pour aborder la maternité, à la fois douloureuse et charnelle, et qui reconnecte avec
le corps. La bourgeoise en est coupée, trop cérébrale, d’éducation trop froide. La prolétaire
y vient malgré elle, naturellement. Ce spectacle partage un amour du corps. On ne dit pas
aux mères l’aventure charnelle qu’est la maternité. La sensualité, au sens large du terme.
A trop médicaliser, on se coupe de cette expérience primitive, ce que le roman décrit très
bien. On se coupe de cet ancrage à la terre.11 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
PISTES DE TRAVAIL
Avant la représentation
Le contexte historique : la Belle Epoque
Programme d’histoire de 4e :
Thème 2 : L'Europe et le monde au XIXe siècle
Thème 3 : Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle
Programme d’histoire de 1ère G (enseignement commun) :
Thème 2 : La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871)
Chapitre 2. L’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et
sociales en France
Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire
colonial
Chapitre 1. La mise en œuvre du projet républicain
Chapitre 2. Permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914
Programme d’histoire de 1ère technologique (enseignement commun) :
Thème 2 : Les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 1870
Thème 3 : La Troisième République : un régime, un empire colonial
On appelle chrononyme le nom donné à une période temporelle : ‘Belle Époque’,
‘Années Folles’ (années 1920), ’Trente Glorieuses’, ‘Moyen-Âge’ ou ‘Ancien Régime’.
La Belle Epoque s’étend ainsi du début du XXème siècle jusqu’en 1914, avec le début de la
Première Guerre Mondiale. Ce nom a été donné a posteriori avec une certaine nostalgie de
cette période insouciante précédant les horreurs de la Grande Guerre. Sur l’événement
marquant le début de la Belle époque, les avis sont plus partagés. Plusieurs dates sont
évoquées : 1889, avec la Tour Eiffel et le centenaire de la Révolution, 1894 ou 1898, des
étapes importantes de l’Affaire Dreyfus, 1900 et la « grande » Exposition Universelle (plus
de 50 millions de visiteurs), 1901, la première année du siècle, ou encore 1896, année de
départ d’un cycle de forte croissance selon les économistes1.
La Belle Epoque correspond à une période d’effervescence culturelle, intellectuelle,
scientifique et politique. Cette vivacité est portée par une bourgeoisie opulente qui se
retrouve à Paris dans les théâtres ou les cafés littéraires.
La troisième république est par ailleurs solidement installée et portée par une grande partie
de la population, de la bourgeoisie aux ouvriers. L’instauration de l’éducation laïque (1882),
1
https://www.canal-u.tv/video/culture_g_num/la_veritable_histoire_de_la_belle_epoque.4196312 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
le réseau de chemins de fer, et l’Affaire Dreyfus ont renforcé le sentiment d’appartenance
et la cohésion nationale et ont participé au renforcement de la république2.
En images :
Le développement de l’automobile : https://histoire-
image.org/fr/etudes/premieres-competitions-automobiles
Les théâtres parisiens : https://histoire-image.org/fr/etudes/theatre-boulevard-
belle-epoque
Les rapports de classe
On ajoute souvent au chrononyme l’expression « et cette Belle Époque ne le fut pas
pour tous ». En effet, les inégalités économiques étaient très fortes. D’un côté, la
bourgeoisie se développe au sein de la population (environ 1 quart des 40 millions
habitants). Depuis la Révolution Française, les banquiers, avocats, médecins ont remplacé
la noblesse de l’Ancien Régime. Les idées capitalistes et libérales comme celles d’Adam
Smith se diffusent et permettent à des industriels de construire de gigantesques fortunes.
La bourgeoisie devient par ailleurs une « classe de loisirs ». La Belle Epoque voit s’installer
les progrès technologiques issus de la première et de la deuxième révolution industrielle.
L’automobile, la « fée électricité », le gramophone, le cinéma des Frères Lumières, le métro
parisien, toutes ces innovations s’installent progressivement dans le quotidien des foyers
bourgeois3.
De l’autre côté, le prolétariat est toujours majoritaire. L’exode rural se poursuit et les
ouvriers sont toujours de plus en plus nombreux à venir s’entasser dans les villes. Les
hommes travaillent à l’usine et les femmes peuvent être bonnes dans les foyers bourgeois,
ou ouvrières. Le droit du travail se construit peu à peu avec le repos dominical (1907) et les
retraites ouvrières (1910). La population paysanne reste encore très importante dans les
campagnes. La situation y a peu changé, et les identités régionales sont encore très
fortes4. Face à la situation précaire du prolétariat, les idées socialistes de Karl Marx se
développe fortement dans toute l’Europe5.
En images :
Le portrait de la famille bourgeoise : https://histoire-image.org/fr/etudes/portrait-
famille-bourgeoise
La place de la religion : https://histoire-image.org/fr/etudes/etre-catholique-fin-
xixe-siecle
2
https://www.herodote.net/La_France_en_effervescence-synthese-423.php
3
https://www.espacefrancais.com/histoire-de-la-france-au-xxe-siecle/
4
https://www.herodote.net/La_France_en_effervescence-synthese-423.php
5
https://www.histoiredumonde.net/Les-classes-sociales-au-XIXeme-siecle.html13 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
Place et voix des femmes au début du XXe siècle
Au début du XXème siècle, la situation des femmes commence à évoluer. Leur
infériorité vis-à-vis de l’homme est toujours inscrit dans le Code Civil depuis 1804, ainsi la
femme « doit obéissance à son mari ». Néanmoins, certains progrès annoncent le siècle de
libération qui suivra.
Avec la Révolution Industrielle, les femmes ne travaillent plus seulement à la maison, dans
les champs ou comme bonnes, mais accèdent à des métiers ouvriers dans le textile, ou dans
le tertiaire comme secrétaire (1890 : arrivée de la machine à écrire), « demoiselle du
téléphone » (1879 : arrivée du téléphone en France) ou receveuse de postes. Elles ont donc
un statut salarié proche de celui de leur époux6.
En 1907, le député Léopold Goirand réussit à promulguer la loi « établissant le libre salaire
de la femme mariée » elle peut donc dépenser son salaire comme elle le souhaite.
Cependant, les biens acquis reviennent à la propriété de l’époux. Bien que limitée, cette loi
ouvre une brèche pour la libération économique et politique des femmes.
Le mouvement des suffragettes naît d’ailleurs au même moment en Grande Bretagne pour
revendiquer le droit de vote aux femmes. En France, les actions fortes de suffragettes se
développent à partir de 1908. Par exemple Madame Pelletier, docteure en médecine a
lancé une pierre dans une vitre du bureau de vote alors qu’on lui refusait l’entrée lors du
deuxième tour des élections municipales7.
L’émancipation des femmes passe aussi par l’accès au sport. Celles-ci sont encore écartées
des grandes compétitions sportives, leur rôle se limitant à couronner les vainqueurs. Pierre
de Coubertin, créateur des Jeux Olympiques modernes écrit d’ailleurs en 1922 « une
olympiade femelle est impensable, elle serait impraticable ». Malgré cela, les clubs sportifs
féminins commencent à se développer, comme l’Ondine à Lyon en 1906. La bicyclette
devient d’ailleurs un objet de libération pour les femmes qui profitent de l’occasion pour
des délaisser de leurs corsets. Ainsi grands couturiers comme Paul Poiret ou Gabrielle
Chanel initient un mode favorisant des vêtements moins contraignants et donc plus
adaptés à la petite reine. Les bourgeoises se découvrent peu à peu lors de leurs séjours à la
mer, et les femmes instruites peuvent lire Colette ou admirer Camille Claudel, des artistes
qui participeront à affirmer la place de la femme au sein de la création artistique.
En images :
L’amour maternel : https://histoire-image.org/fr/etudes/amour-maternel-xixe-siecle
L’image de la femme moderne : https://histoire-image.org/fr/etudes/femmes-
cigarette-belle-epoque
La libération du corset : https://histoire-image.org/fr/etudes/fin-corset-liberation-
corps-femme
6
https://www.herodote.net/XXe_siecle_grandes_esperances-synthese-2538.php
7
https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr/n/l-emancipation-des-femmes/n:12714 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
L’homosexualité à la Belle Epoque
A la fin du XIXème siècle, l’homosexualité devient un terme médical porté par les
médecins ou les psychiatres. Ils prennent le relais des prêtres pour « traiter » ce qu’ils
considèrent comme une maladie mentale. Le mot « homosexuel » a d’ailleurs été inventé
en 1869 par le médecin autrichien Benkert. La littérature médicale sur le sujet est vaste à
cette époque8.
Néanmoins, à la Belle Epoque, l’homosexualité peut être tolérée dans les milieux
bourgeois et littéraires parisiens. Dans le milieu clos du théâtre, les femmes de spectacle
rivalisent d’excentricité et d’exotisme. Elles peuvent se travestir, jouer des relations
interdites et les amours saphiques s’exposent sous couverts du divertissement. Malgré
tout, le mariage avec un homme reste une obligation pour être acceptée dans la vie
mondaine.
Le recul de la religion dans les classes aisées participe aussi à cette libération des mœurs.
Des communautés homosexuelles vont ainsi pouvoir se développer secrètement dans des
lieux de sociabilité comme des cafés ou des magasins de Paris, à l’époque ville de
modernité aux yeux du monde.
Cependant, les politiques de répression des relations homosexuelles se poursuivent et
s’institutionnalisent, prenant le relais des principes religieux9.
En images :
Une figure historique, Liane de Pougy : https://histoire-image.org/fr/etudes/liane-
pougy-charme-ambiguite-belle-epoque
8
https://www.universalis.fr/encyclopedie/homosexualite/4-le-xixe-siecle-alieniste/
9
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2006-4-page-74.htm?contenu=article15 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
Décrypter l’affiche
Crédit photographique : Delphine Jouanneau
Conception graphique : Marie Colucci
Questions :
Qu’observez-vous ?
Que peuvent signifier les couleurs, les effets ?
Que peut-on comprendre de l’attitude de la silhouette ? Quelle place occupe-t-
elle ? Que représente-t-elle ?
Que dit le texte ? Comment est-il organisé et qu’est-ce que cela peut vouloir dire ?
A quoi se réfèrent les logos en bas ?
Qu’est-ce que cela vous informe du spectacle ?
Lexique :
Couleurs froides, chaudes, vives, pâles, primaires, complémentaires, camaïeu,
monochrome, nuance, teinte, dégradé, contrasté, équilibre, premier plan, deuxième plan,
arrière-plan, forme, informe, ligne, trait, figuratif, abstrait, flou...16 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
Les intentions de Vanessa Sanchez :
Le choix de la photographe :
« Je connais bien le travail de Delphine Jouanneau et il me semblait que tous ses flous, ou
autres recherches artistiques pouvaient bien coller avec l'univers de notre spectacle. »
Le choix de la graphiste :
« Je travaille depuis quelque temps avec Marie Colucci. Je lui ai demandé de montrer le côté
double de l'histoire et le pluriel d'Amours. Je voulais que ça empêche la femme
représentée. Comme si ça lui barrait le corps. Car pour moi c'est Céleste que l'on voit. Je
voulais comme des grilles, comme le barreau de son lit dans le spectacle qui est à la fois le
lieu de l'oppression et le lieu de la libération. Comme le corset qui contraint aussi. Elle m'a
fait plusieurs propositions et celle que j'ai retenu m'a parlé car je trouvais qu'à la fois elle
contraignait et à la fois elles pouvaient symboliser des ailes dans le dos qui pouvaient aussi
libérer. Comme Céleste. »
Pour la photo :
« C'est ma fille qui a posé. Je voulais de la chair, bien sûr pour cette histoire, mais il fallait
que ça reste chaste (pour la diffuser). C'est pourquoi on a choisi de voir son dos et de ne
pas montrer le visage afin que ce ne soit pas personnifié. J'aime bien l'intention que la pose
dégage : comme si la femme entendait quelque chose ou quelqu'un. Comme si elle était à
l'affût. Pour moi ça représente à la fois le danger de la venue d'Anselme mais aussi le plaisir
et l'espérance de la venue de Victoire.
Je voulais que la photo ne soit pas juste belle, voire romantique. Je voulais qu'il y ait de la
violence. Ça a été dur à trouver, cet aspect violent. C'est pourquoi Delphine a superposé
une photo très floue de tissu rouge. D'où les tâches rouges. Pour moi c'est très important
ces tâches car elles rappellent la scénographie du spectacle. Pour le décor du spectacle, on
voulait que tout soit monochrome au début du spectacle, d'où l'idée des voiles (qui
peuvent avoir plein de sens) et que la couleur apparaisse progressivement. La couleur
rouge et vive comme le sang qui tâche : le sang de l'accouchement, des règles, de l’amour,
et de la violence de ces rapports sociaux. Souvent je disais à ma scénographe et à la
photographe : la vie, ça tâche ! D'où ces tâches sur le visuel.
Enfin, j'ai choisi une photo bien floue car, déjà je trouve ça beau et très évocateur, et aussi
car ça me rappelait l'esthétique du début du 20ème siècle, période à laquelle se déroule
notre histoire. »17 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
Etudier les personnages
Les personnages :
Céleste, la bonne
Victoire de Champfleury-Boisvaillant
Anselme Boisvaillant, le mari
Adrien, l’enfant
Huguette, la vieille bonne
Odette et Joseph Vedel, le couple bourgeois parisien
Les parents de Champfleury
Le curé
L’organiste
Questions :
A partir des extraits présents à la fin du dossier, que pouvez-vous comprendre des
personnages, de leurs relations et de leurs rôles dans l’histoire ?
Quels archétypes représentent-ils, et comment sortent-ils de ces rôles prédéfinis ?
Exercices :
Etablissez une carte des liens qui unissent les personnages les uns aux autres et
qualifiez la nature de ces liens (positif, négatif, pouvoir, entraide, méfiance, lien
familial, amical…).
Relever les passages où les paroles des personnages diffèrent de leurs pensées, de
leur attitude ou de leurs actes, qu’est-ce que cela indique de leurs relations, du
contexte culturel ?
Tentez d’interpréter une scène en mobilisant votre propre compréhension du
personnage.18 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
Lectures croisées
Le réalisme littéraire
Bibliographie indicative du programme de HLP de Première G & Technologique :
Un cœur simple (Flaubert), Une vie (Maupassant), Thérèse Raquin (Emile Zola), La dame
aux camélias (Alexandre Dumas), La Princesse de Clèves (Madame de la Fayette)
Littérature contemporaine : Chanson Douce (Leïla Slimani)
« Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route » - Stendhal
Le Réalisme est un mouvement littéraire français de la deuxième moitié du XIXème
siècle. Il est apparu à la suite du réalisme pictural et de l’œuvre de Courbet Enterrement à
Ornans (1850). Critiqué dans la presse, il sera défendu par Champfleury, se revendiquant
écrivain réaliste. Sa Lettre à Mme Sand de Champfleury parue dans l'Artiste le 2 septembre
1855 peut d’ailleurs être considérée comme le manifeste du réalisme.
« L'artiste ne dit pas aujourd'hui : venez voir des œuvres sans défauts, mais venez voir des
œuvres sincères » - Edouard Manet
Les auteurs réalistes cherchent à refléter les préoccupations sociales et politiques de
l'époque. Ils s’intéressent à des groupes sociaux en particulier comme les ouvriers, les
bourgeois, ou les prostituées, et cherchent à montrer l’influence des milieux sociaux sur
les comportements des individus. Pour reproduire le plus fidèlement possible la réalité, les
auteurs se documentent et vont observer sur le terrain. Les théories sociales et médicales
et des sciences expérimentales ont d’ailleurs une grande influence sur le mouvement
littéraire qui s’ne inspire pour créer les personnages10. Les théories de Freud, ou le progrès
technologique incitent les auteurs à penser que le monde entier est compréhensible et
explicable. Ainsi les auteurs s’attachent à décrire précisément des conditions ou tâches
pour enseigner ce que c’est d’être un ouvrier ou un artisan (Balzac explique ce que c'est
qu'une faillite ou une imprimerie. Zola expliquera ce que c'est qu'une locomotive).
D’autre part, La révolution industrielle a marqué de grands bouleversements sociaux et
a créé de nouvelles catégories de pauvreté qui sont peu représentées sur la scène culturelle
ou politique. Les réalistes cherchent à représenter l’ensemble de la société et s’intéressent
donc à ces couches sociales invisibles. Les écrivains ont adopté différentes postures face à
ces situations sociales : Champfleury ou Duranty travaillaient avec un format proche du
reportage, avec en essayant d’être le plus objectif possible ; Flaubert, Baudelaire ou Proust
suivaient les principes de Vrai et de beau de la philosophie de Hegel ; enfin Dickens ou Zola
écrivaient de façon engagées avec un but politique.
10
Le Réalisme et le naturalisme sur le site de l’académie de la Réunion [archive].19 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
Les thèmes du réalisme peuvent être11 :
- L’ascension et la chute sociale (Le Rouge et le Noir de Stendhal ; La Peau de chagrin de
Balzac ; L'Education sentimentale de Flaubert)
- Le pouvoir de l’argent
- L'amour et le désenchantement (Madame Bovary de Flaubert),
- La misère du peuple. (Les Misérables de Victor Hugo).
Les procédés du réalisme :
- Le point de vue interne : l’auteur s'appuie sur le regard du personnage pour faire
découvrir au lecteur le monde qui l'entoure, il utilise le "Je" ou se place en narrateur
externe pour suivre le personnage principal.
- La place centrale de la description : l’auteur se documente et décrit de façon très
détaillée les actions et les situations rencontrées
- Le discours indirect libre : l’auteur alterne entre sa parole et celle du personnage dans
une continuité du récit et du discours. Le lecteur peut ainsi accéder aux pensées du
personnage, ce qui lui donne une personnalité et des sentiments propres.
- L’introduction de documents : l’auteur peut créer des cartes postales, des cartes de
visites, des lettres, des articles de presse pour étoffer le récit et donner l'illusion de la
réalité, c’est l’effet de réel
- Le retour en arrière : l’auteur utilise un récit du passé de son personnage pour expliquer
ses actions, ou le faire se souvenir.
- Les études sociologiques et géopolitiques : l’auteur est omniscient, il détient toutes les
clés de compréhension de son récit, ce qui renforce le réalisme de l’histoire.
Cependant, le réalisme reste porté par des écrivains issus de la bourgeoisie. Elle est
d’ailleurs souvent influencée par la vie de l’auteur lui-même. La reproduction fidèle du réel
et la contestation sociale sont donc intrinsèquement limitée dans le réalisme.
« La reproduction de la nature par l'homme ne sera jamais une reproduction, une imitation, ce sera
toujours une interprétation » - Champfleury, 185712.
Questions :
A partir du contexte historique que vous avez pu étudier, les personnages et les
actions de la pièce sont-ils caractéristiques, ou décrivent-ils justement leur époque ?
Quels procédés d’écriture du mouvement réaliste retrouvez-vous dans la pièce
Amours ? En quoi cela participe-t-il à concrétiser une histoire fictive ?
Quelles réalités sociales précises la pièce cherche-t-elle à décrire, voire à dénoncer ?
Selon vous, la littérature et les Arts en général peuvent-il avoir une influence ou un
rôle politique ?
11
https://www.superprof.fr/ressources/langues/francais/autres-niveaux-fr1/tout-niveau-fr1/auteurs-
romanciers-realistes.html
12
https://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/r%c3%a9alisme/17638220 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
Les femmes dans la littérature
Au XIXème siècle, les femmes sont encore largement écartées des professions
littéraires. Les nombreuses expressions péjoratives des femmes de lettres en attestent
d’ailleurs parfaitement (femmes auteurs, femmes écrivains, littérature féminine, bas-bleu,
précieuse). Elles doivent alors utiliser différents stratagèmes pour réussir à être éditées.
Elles peuvent prendre un nom masculin (George Sand) ou publier anonymement (Madame
de la Fayette). Elles peuvent aussi être publiées sous le nom de leur conjoint ou membre
familial (Madame de Scudéry). Elles peuvent être soutenues par un écrivain déjà réputé
(Delphine de Girardin soutenue par Balzac), ou bénéficier de l’aura d’un père ou d’un frère
pour prétendre à la même profession.
Elles soulèvent chez les auteurs masculins la crainte d’une trop forte concurrence ou de
voir la qualité des ouvrages baisser. La Société des Gens de Lettres restent très frileuse à
les accueillir, elle multiplie les contraintes à l’entrée et en accepte certaines « à condition
qu’un numerus clausus implicite en limite singulièrement le nombre13 ». Accorder aux femmes
la capacité à produire et à vivre des œuvres littéraires autant qu’un homme est par ailleurs
vu comme un danger pour la structure familiale, elles ne seraient plus assez disponibles
pour leur époux et leurs enfants.
Pourtant, le XIXème siècle voit le nombre d’écrivaines exploser. Ainsi, « d'une
vingtaine en 1860, les femmes de lettres sont passées à plus de 700 en 1908, chiffre maintenu
en 1928 sur un total de 3 000 écrivains français14 ». Les écrivaines publient désormais sous
leur vrai nom. Les palmarès, ou les listes d’écrivaines se développent dans lesquelles elles
tendent à être jugée au regard de leur sexe plutôt que de leur qualités d’écriture (Julia
Alphonse Daudet est jugée « d’une féminité exquise »). On réduit leur travail à une activité
de loisirs. Jean de Bonnefon, dans son ouvrage de 190915, utilise l’expression « corbeille de
roses » pour décrire la production littéraire des femmes. Il écrit qu'« aucun ornement ne
convient mieux à la femme que le littéraire ». Il ajoute « les femmes de lettres étaient jadis des
monstres. Elles sont maintenant des femmes parfaitement femmes, avec tout le charme des
yeux et des rondeurs qui sont les orbes du monde en réduction ».
La dépréciation du style des femmes s’effectue dès l’édition des livres, puisqu’on leur
refuse le droit d’aborder des sujets politiques ou sociaux. Delphine de Girardin décrivait en
avant-propos à son roman La canne de M. de Balzac, sa rencontre avec un éditeur ainsi « il
est resté avec cette conviction : Qu'une femme qui vit dans le monde ne doit pas écrire,
puisqu'on ne lui permet de publier un livre qu'autant qu'il est parfaitement insignifiant ». C’est
donc un véritable parcours du combattant pour qu’une femme réussisse à vivre de ces
écrits. Au final, les femmes sachant toutes ces difficultés, s’empêchaient elles-mêmes
d’envisager la possibilité d’en faire un métier.
13
https://www.cairn.info/revue-historique-2006-2-page-313.htm
14
https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1990_num_83_1_2936
15
J. de Bonnefon, La corbeille des roses ou les dames de lettres, Paris, Société d'édition de Bonville et cie,
1909.21 Dossier pédagogique – AMOURS – Arbre Compagnie – Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
« Nous le répétons ; en France, où rien de grand et d’héroïque ne s’est jamais fait sans que les femmes y
participassent ; où depuis le bûcher de Jeanne d’arc jusqu’à l’échafaud de Mme Roland, les femmes ont apporté
leur génie, leur amour, leur sang au besoin, sur les autels de la patrie et de la liberté, on est encore sous
l’empire d’un préjugé grossier qui fait tolérer les femmes écrivains à titre d’excentricité, d’exception. […] Ce
monopole littéraire si obstinément défendu, ces cris poussés par des paons qui se croiraient déplumés par la
concurrence, […]est à la fois une anomalie choquante et un véritable danger ; […] l’homme lettré ne veut pas
que la femme instruite, spirituelle, oisive, consacre ses loisirs à partager sa tâche16. » - Daniel Stern
Quelques figures incontournables :
Colette (1873-1954)
Ecrivaine phare de la Belle Epoque, elle est nommée au Prix Nobel de littérature en 1948,
et devient présidente de l’Académie Goncourt (1949-1954). Ses personnages féminins
reflètent la liberté qu’elle porte dans sa vie personnelle, son style est précis et moderne.
Parmi ses œuvres : Claudine à l’école, Chéri, Le Blé en herbe, La Chatte.
George Sand (1804-1876)
Elle a écrit une grande quantité de romand, de nouvelles, contes et pièces de théâtre. Elle
s’engage politiquement à partir de la Révolution de 1848 contre les valeurs bourgeoises,
bien qu’elle en fait elle-même partie. Dans son œuvre, elle montre des femmes qui
outrepassent les conventions sociales et se révoltent contre les préjugés et les inégalités.
Dans la Confession d’une jeune fille, elle souligne la difficulté pour les femmes du XIXe
siècle de réclamer le droit à l’égalité. La contrainte du mariage est opposée à la liberté du
célibat. Pour elle, le roman exprime « le cri de la femme contre la tyrannie de l’homme17 ».
Parmi ses œuvres : Indiana, La mare au diable, Consuelo, La petite Fadette, Confession d’une
jeune fille.
Marie d’Agoult (1805-1876)
Connue sous le pseudonyme de Daniel Stern, Marie d’Agoult dénonce dans ses romans la
tyrannie de la société contre les faibles et les marginaux. Ses personnages féminins se
libèrent des figures masculines comme le père, le prêtre ou le mari et rejoignent les autres
opprimés pour vivre en marge. Elles questionnent les notions de justice et de devoir morale
et invite à repenser les fondements idéologiques de la société de l’époque18. Parmi ses
œuvres : Nélida, Lettres républicaines, Esquisses morales et politiques, Histoire de la
Révolution de 1848, Dante et Goethe…
Germaine de Staël (1766-1817)
Romancière et philosophe, elle soutient les idées de la Révolution Française. Elle est
interdite de séjour par Napoléon Bonaparte qui la considère comme une menace. Elle
favorise l’introduction en France du romantisme allemand. Elle représente des
16
Louis ULBACH, « Chroniques de la quinzaine. Revue littéraire. Esquisses morales, pensées, réflexions et
maximes par Daniel Stern. » Revue de Paris, 15 novembre 1886. https://femmes-de-
lettres.com/2013/06/12/lecriture-feminine-au-xixe-siecle/
17
https://www.erudit.org/fr/revues/tce/2010-n94-tce1521340/1003488ar/
18
https://www.erudit.org/fr/revues/tce/2010-n94-tce1521340/1003489ar/Vous pouvez aussi lire