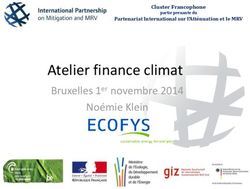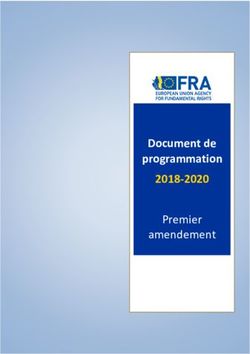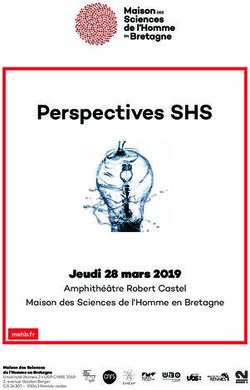FAVORISER LA COMMUNICATION AVEC LA FAMILLE DANS LE PARCOURS DU JEUNE
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
FAVORISER LA COMMUNICATION AVEC LA
FAMILLE DANS LE PARCOURS DU JEUNE
Dossier IMPLICATION DANS LES DYNAMIQUES
INSTITUTIONELLES
Note de réflexion sur l’accompagnement – DC4
Formation en vue de l’obtention du Diplôme d’Etat de Moniteur
Educateur
CHARPENTIER Léo
Année 2018/2020Sommaire
Introduction ......................................................................................................................... 1
1 Présentation de l’Ime ................................................................................................... 2
1.1 L’établissement en quelques mots.................................................................... 2
1.2 Cadre légal ......................................................................................................... 3
1.3 Public accueilli ................................................................................................... 4
1.4 Composition de l’équipe ................................................................................... 4
1.5 Financement et mode d’admission ................................................................... 5
2 Travail avec la famille .................................................................................................. 6
2.1 La co-construction du projet personnalisé de l’enfant .................................. 6
2.1.1 Repérer et mieux comprendre le positionnement des parents............................. 6
2.2 L’organisation de la communication et des relations entre la structure et
les parents ........................................................................................................... 7
2.3 Les partenariats ................................................................................................. 8
2.3.1 Développer le partenariat au bénéfice des enfants et des parents ....................... 8
3 Mise en œuvre du travail avec la famille .................................................................... 9
3.1 Le transport ....................................................................................................... 9
3.2 La situation de Simon........................................................................................ 9
3.3 Travail avec la famille, proposition ................................................................. 9
3.4 Temps de lien et d’échange ............................................................................. 10
Conclusion .......................................................................................................................... 12
Bibliographie ...................................................................................................................... 13
Liste des annexes.......................................................................... Erreur ! Signet non défini.Liste des sigles utilisés IME = Institut Médico Éducatif RBPP = Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles HAS = Haute Autorité de Santé SESSAD = Services d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile MDPH = Maison Départementale des Personnes Handicapées TSA = Troubles du Spectre de l’Autisme PP = Projet Personnalisé CPOM = Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens CDAPH = Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées
1
Introduction
Depuis septembre 2018, je suis en formation de moniteur éducateur en apprentissage dans
un Institut Médico Éducatif1.
Après une phase d’observation et de nombreux échanges avec l’équipe, mon attention
s’est portée sur la situation du jeune Simon2. En effet, nous rencontrons certaines difficultés pour
travailler avec sa famille (construction de son projet personnalisé, suivi du quotidien,
accompagnement somatique).
Dans un premier temps, je présenterai l’établissement dans lequel j’effectue ma
formation, puis je poursuivrai en explicitant le travail avec la famille, en m’appuyant sur les
RBPP3 de l’HAS4, sur le projet d’établissement, ainsi que sur la loi 2002-2 du 2 janvier 2002.
Pour finir, je m’appuierai sur les échanges que j’ai pu avoir avec les professionnels ainsi que sur
ma propre expérience pour évoquer la mise en œuvre du travail avec la famille de Simon.
1
IME
2
Que je renomme ainsi par soucis d’anonymat
3
Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnels
4
Haute Autorité de Santé
CHARPENTIER Léo Implication dans les dynamiques institutionnelles - ME
Année 2018-20202
1 Présentation de l’Ime
1.1 L’établissement en quelques mots
L’implantation géographique des locaux de l’institut permet d’accéder facilement au centre-
ville et aux nombreux lieux d’activités extérieures à la structure. En effet, en fonction des projets
des jeunes accueillis, les équipes peuvent se rapprocher des partenaires notamment la ville, qui
met à disposition : gymnases, piscine, médiathèque, dojo ou autre centre équestre.
Les partenaires de l'IME sont la ville, la Station Sport Nature, la psychiatrie, le SESSAD5, les
autres établissements de la même association, l’épicerie sociale, la MDPH6.
La périphérie de la ville est aussi très facile d’accès, ainsi de belles promenades et
randonnées peuvent se faire depuis l’IME et donne accès à des zones non urbaines qui
permettent de s’aérer et de profiter de moments agréables en plein air dans une région très verte.
L’IME comprend plusieurs bâtiments. Un internat sur quatre étages (accessible à tout
moment de la journée par les jeunes, accompagnés d’un éducateur). Un bâtiment abritant
lingerie, locaux d’entretien ainsi que le service de restauration. Un bâtiment constitué de
différents ateliers (cuisine, couture, et groupe socio-éducatif), un gymnase et une salle de
rééducation motrice. Une unité d’enseignement composée de trois classes et de deux salles
d’activités éducatives, bâtiment abritant un bassin de balnéothérapie. À l’étage se trouvent deux
salles d’activité et une salle Snoezelen.
Un bâtiment administratif rassemblant des bureaux : secrétariat, comptabilité, direction, chef
de service éducatif, médecin psychiatre, psychologue, assistante sociale. Une infirmerie et une
salle du personnel.
Tous ces bâtiments sont accessibles très facilement du fait de leur proximité. En effet, les
bâtiments sont très bien placés et agencés, leurs dispositions forment une cour centrale qui donne
accès à tous ces derniers.
5
Services d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile
6
Maison Départementale des Personnes Handicapées
CHARPENTIER Léo Implication dans les dynamiques institutionnelles - ME
Année 2018-20203
1.2 Cadre légal
Le projet d’établissement est rédigé conformément à la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale, il permet de donner une ligne directive aux
établissements et donc aux équipes. « Pour chaque établissement ou service social ou médico-
social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment
en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des
prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement (...*). Ce projet est
établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le
cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation. »7.
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 définit la place de l’usager, en s’appuyant sur
différents outils, dont le projet personnalisé, mais aussi le projet d’établissement, l’évaluation
interne et l’évaluation externe, la charte des droits et libertés.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, quant à elle, rappelle les principes d’égalité des
droits et des chances, de la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, leur
reconnaissant ainsi un droit à la compensation des conséquences de leur handicap quelles que
soient l’origine et la nature de leur déficience, leur âge ou leur mode de vie. Cette loi vient
modifier certains aspects de la loi du 30 juin 1975, elle traite des évolutions fondamentales pour
répondre aux attentes des personnes handicapées (accessibilité, scolarité, emploi, droit à la
compensation, MDPH).
Les missions de l'IME sont l’accueil et l’évaluation des potentialités de jeunes présentant
un déficit intellectuel avec ou sans troubles associés, leur permettre d’acquérir les connaissances
nécessaires pour leur offrir l'opportunité d’être le plus autonomes possible dans leur
environnement social, et de préparer à la vie d'adulte.
7
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/lois_reglements_projet_etablissement_anesm.pdf
08/02/2020 à 15h
CHARPENTIER Léo Implication dans les dynamiques institutionnelles - ME
Année 2018-20204
1.3 Public accueilli
L'IME accueille 50 enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans présentant une déficience
intellectuelle moyenne à sévère. Un pôle autisme est dédié à l’accueil d’un public d’enfants
atteints de TSA (trouble du spectre autistique) et de troubles du comportement.
Les groupes sont construits en fonction de l’âge et des besoins des jeunes. Il existe 4 groupes
au sein de l’IME : le groupe des petits qui accueille les enfants de 6 à 10 ans, le groupe des
moyens qui accueille les enfants de 10 à 16 ans, le groupe des grands qui accueille les jeunes de
16 à 20 et plus (Amendement Creton), et deux groupes du pôle autisme accueillant chacun 8
jeunes (de 9 à 22 ans). Le pôle A1 et le pôle A2, groupe sur lequel je suis affecté.
L'IME assure également différents types d’hébergements : l’internat à la semaine, l’internat
aménagé et le semi-internat. Cela depuis plusieurs années mais de plus en plus actuellement en
lien avec les évolutions du secteur social et médico-social et la notion de parcours partagé.
1.4 Composition de l’équipe
L'équipe éducative du groupe auquel je suis rattaché se compose, d'une éducatrice
spécialisée référente des projets personnalisés, d'une monitrice éducatrice et de deux aides
médico psychologiques. Nous participons tous à l’accompagnement des jeunes de
l’établissement afin de leur offrir l’accompagnement individualisé que nécessite leur état
physique et psychique.
C’est une équipe de quatre professionnels avec un planning à la semaine : du lundi au
vendredi. Les horaires peuvent aller de 7h à 22h sachant que l’établissement possède un internat.
Le plus souvent, il y a deux professionnels : un le matin et deux personnes l'après-midi, mais le
planning s'adapte en fonction des activités proposées et des besoins des jeunes.
Nous communiquons par échanges formels : transmissions écrites (cahier de liaison,
classeur personnalisé pour chaque jeune) et orales (Réunion de fonctionnement tous les mois en
présence de la chef de service et la psychologue, réunions éducatives afin de préparer les
activités, suivre les projets des jeunes, les synthèses et co-construction des PP8). Nous
8
Projet Personnalisé
CHARPENTIER Léo Implication dans les dynamiques institutionnelles - ME
Année 2018-20205
communiquons également par le biais d'échanges informels, qui sont également porteurs de
données importantes et non négligeables.
L’équipe pluridisciplinaire est qu’en a elle composée d’un service paramédical et médical,
d’un service social, d’une unité d’enseignement (éducation nationale), ainsi que d’un service de
sensibilisation à la formation préprofessionnelle.
1.5 Financement et mode d’admission
Le budget de l’établissement est négocié au sein de l’association dans le cadre du
CPOM9. La prise en charge au sein de l’établissement est financée entièrement par les caisses
d’assurance maladie jusqu’à 20 ans. Au-delà de 20 ans, les jeunes adultes maintenus au titre de
l’Amendement Creton, doivent participer aux frais de fonctionnement de l’établissement dans
lequel ils sont maintenus en internat, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
établissements dans lesquels ils ont été orientés et à la condition d’être solvables, et plus
particulièrement de bénéficier des prestations sociales prévues pour les adultes handicapés
(AAH10 en particulier).
« L’amendement « Creton », du nom du comédien Michel Creton qui l’avait défendu,
permet depuis 1989 le maintien dans un établissement pour enfants handicapés de jeunes adultes
ayant atteint l’âge limite pour lequel leur établissement est autorisé, en attente d’une place en
structure pour adultes »11.
Les enfants sont orientés par la MDPH après décision de la CDAPH12. Cette dernière
précise le mode d’accueil (internat, demi-pension) ainsi que la durée du séjour. En cours de
placement la CDAPH peut décider soit de la prolongation du séjour, soit de l'orientation vers une
autre structure. Elle prononce aussi la fin de placement.
9
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
10
Allocation aux adultes handicapés
11
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-jeunes-
adultes-relevant-de-l-amendement-creton 24/02/2020 à 16h
12
Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées
CHARPENTIER Léo Implication dans les dynamiques institutionnelles - ME
Année 2018-20206
2 Travail avec la famille
2.1 La co-construction du projet personnalisé de l’enfant
2.1.1 Repérer et mieux comprendre le positionnement des parents
Commençons par une définition de la parentalité : c’est la « fonction de parent,
notamment sur les plans juridique, moral et socioculturel »13. Cela implique pour les
professionnels de penser leur accompagnement en collaboration avec la famille. En effet, il est
important à mon sens de prendre en compte la place des parents, ils sont les experts de leur
enfant. Nous devons donc nous appuyer sur les informations qu’ils nous transmettent. En tant
que professionnel, je veille à offrir un espace de parole aux parents où ils peuvent se livrer
librement sur leurs besoins, leurs craintes et les objectifs qu’ils souhaitent pour leur enfant. Pour
cela, la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 vient préciser un certain nombre de points.
« Les lois de 2002 comme celle de 2005 ont acté un certain nombre d’évolutions qui
avaient vu le jour dans les institutions sociales et médico-sociales, concernant notamment la
participation des usagers et de leurs familles et la reconnaissance de leurs droits, en instaurant
le principe de la place centrale de l’usager. Elles l’ont fait par le biais d’outils et de dispositifs
qui ont vocation à favoriser l’exercice de la citoyenneté des usagers et de leurs
familles/représentants légaux. Le projet personnalisé est devenu l’outil emblématique de ces
évolutions. »14.
« Et l’usager considéré dans une acception large, à savoir la personne accueillie ou
accompagnée, ainsi que son entourage (famille, parents, représentants légaux), dont le droit à
participer à son projet est affirmé avec vigueur. Les relations professionnels-usagers sont donc
interrogées par ces évolutions, et notamment les relations professionnels-familles, dans les
structures accompagnant des enfants. »15
« Parmi les thématiques pouvant se trouver dans les projets d’établissement ou de service
rédigés après la promulgation de la loi du 2 janvier 2002, on observe que les liens et
collaborations avec les familles sont souvent développés, mettant ainsi en avant le chemin
parcouru par les équipes en direction de ces dernières, et donc le travail qu’elles poursuivent
avec elles. Cette évolution, qui ne signifie pas que ce travail n’existait pas auparavant, n’est pas
13
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/parentalité/58145 09/02/2020 à 16h30
14
Demoustier Séverine, Priou Johan, « Les lois de 2002 et la participation des usagers dix ans après », Contraste,
2013/1 (N° 37), p. 73-92. DOI : 10.3917/cont.037.0073. URL : https://www.cairn.info/revue-contraste-2013-1-page-
73.htm 09/02/2020 à 18h
15
Idem note de bas de page n°14
CHARPENTIER Léo Implication dans les dynamiques institutionnelles - ME
Année 2018-20207
anodine en ce qu’elle démontre les volontés institutionnelles et professionnelles d’objectiver par
écrit ces collaborations, voire de les favoriser, le passage par l’écrit nécessitant au préalable
une réflexion collective. »16
2.2 L’organisation de la communication et des relations entre la structure et les
parents
D’un point de vue éthique, il est important d’entretenir une communication régulière avec
les parents. Pour cela, l’établissement dans lequel je travaille a défini des outils de
communication à destination des parents : cahier de liaison, téléphone, rencontres (rentrée
scolaire, projet personnalisé, évaluations, ainsi qu’à leur demande). L’équipe du pôle autisme à
laquelle j’appartiens, a développé et réfléchi à la communication avec les familles. Notre
intervention consiste à répondre aux besoins des enfants tout en leur apportant des outils, des
méthodes pour mieux vivre leur autisme, mais cela n’est qu’une partie du parcours. Il est
important qu’ils puissent généraliser ces acquis en dehors de l’IME, et notamment à la maison.
Le but principal étant que chaque jeune soit capable d’acquérir de nouvelles compétences et de
pouvoir les transposer dans un ailleurs.
« Parents et professionnels s’accordent sur les supports de communication, les modalités de
transmission d’informations et de signatures des autorisations, le rythme et le type de rencontres
autour du projet de l’enfant (entretiens, réunions…). ».
« Les parents sont informés de la vie de l’enfant, tout en respectant son intimité et son droit
au secret. Les professionnels adaptent les supports de communication aux situations : cahier de
liaison, calendrier mis à jour, internet. » 17.
« Des rencontres formelles régulières sont programmées avec les parents afin d’échanger,
faire le point sur les aspects de la vie de l’enfant et d’ajuster l’organisation de la suppléance.
Les contraintes matérielles des parents sont prises en compte pour fixer les lieux et horaires des
rendez-vous. En cas de difficulté et après l’accord des parents, des rencontres peuvent être
organisées dans un lieu neutre de type centre social, voire parfois à domicile. Les départs et
16
Idem note de bas de page n°14
17
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/anesm_synthese-orange-autoriteparentale.pdf
22/01/2020 à 11h00
CHARPENTIER Léo Implication dans les dynamiques institutionnelles - ME
Année 2018-20208
retours de week-ends ou de vacances, les déplacements conjoints, sont l’occasion d’avoir des
échanges informels avec les parents. »18.
2.3 Les partenariats
2.3.1 Développer le partenariat au bénéfice des enfants et des parents
Les politiques sociales évoluent, ouverture des établissements, parcours partagés, besoins
et partenariats sont des notions actuelles avec lesquelles nous devons composer. Travaillant en
Ime, l’accompagnement « physique » se termine le vendredi à 14h mais nous ne devons pas
perdre de vue que celui-ci doit se prolonger dans un ailleurs (famille, amis, centre de loisirs…).
Pour cela, en fonction des situations nous devons veiller à penser l’après. Par exemple, pour l’un
des jeunes que j’accompagne, nous avons anticipé en travaillant avec une structure partenaire la
période de vacances que nous savions compliquée, en collaboration avec sa mère afin de trouver
une solution adaptée à son besoin.
Je pars du postulat que les parents sont des partenaires directs dans mon travail. Fabrice
Dhume définit le partenariat comme : « Une méthode d’action coopérative fondée sur un
engagement libre, mutuel et contractuel d’acteurs différents mais égaux, qui constituent un
acteur collectif dans la perspective d’un changement des modalités de l’action – faire autrement
ou faire mieux - sur un objet commun - de par sa complexité et/ou le fait qu’il transcende le
cadre d’action de chacun des acteurs -, et élaborent à cette fin un cadre d’action adapté au
projet qui les rassemble, pour agir ensemble à partir de ce cadre. »19.
« Des partenariats spécifiques seront développés, en fonction des types de situations des
enfants placés. La structure participe aux actions de soutien à la parentalité avec les acteurs
concernés. Elle informe les établissements scolaires et de formation professionnelle, afin qu’ils
prennent en compte les spécificités de l’exercice de l’autorité parentale. »20.
18
Idem note de bas de page n°17
19
« Du travail social au travail ensemble, le partenariat dans le champ des politiques sociales », Ed. ASH, 2001.6,
cité dans Qu’est-ce que le partenariat ?
http://rnrsms.ac-creteil.fr/IMG/pdf/le_partenariat_dans_le_travail_social-final.pdf 27/01/2020 à 20h
20
Idem note de bas de page n°19
CHARPENTIER Léo Implication dans les dynamiques institutionnelles - ME
Année 2018-20209
3 Mise en œuvre du travail avec la famille
3.1 Le transport
Je suis régulièrement accompagnateur lors des transports en début et en fin de semaine.
Ces derniers consistent à accompagner les jeunes chez eux à Limoges, qui est à environ 1h45 de
route de l’Ime. L'établissement où je travaille confie régulièrement cette « mission » aux
stagiaires. Mon rôle dans cet espace-temps est de garantir la sécurité des jeunes, de les rassurer,
d'apprendre à connaître ceux qui ne sont pas sur mon groupe et de transmettre d'éventuelles
informations aux parents.
Durant ce transport, j'accompagne Simon, un jeune qui ne pose aucune difficulté lors du
voyage, mais avec qui nous rencontrons certaines difficultés à travailler avec sa famille.
3.2 La situation de Simon
La mère de Simon vit seule avec son autre fils. Le père de Simon lui habite et travaille à
Paris. Madame a des horaires contraignants, ce qui la rend donc difficilement joignable. De plus,
elle n'a pas le permis et n'est donc pas très mobile. N’étant pas à l’aise avec la langue française,
l’investissement du cahier de liaison n’est pas concluant.
Simon s'exprime grâce à un classeur de communication qu'il a investi à l’Ime. Il l’utilise
dans tous les temps du quotidien, pour faire des demandes et exprimer des envies. En partant le
vendredi Simon laisse son classeur à l’Ime, il n'en a donc pas à la maison. Je me questionne :
comment Simon peut-il s’exprimer à la maison s’il n’a pas son outil de communication ?
Comment peut-il généraliser ses acquis et compétences dans un ailleurs ? La maison est un lieu
de vie tout comme l’Ime, Simon ne pourrait-il pas avoir un classeur chez lui ? La famille est-elle
en demande ?
3.3 Travail avec la famille, proposition
J’ai pu échanger avec l’équipe, je leur ai fait part de mes questions et observations. En
effet, en reprenant l’histoire de cette famille, je comprends que ce travail n’a jamais pu être
réalisé par manque de rencontres, d’échanges et de liens.
CHARPENTIER Léo Implication dans les dynamiques institutionnelles - ME
Année 2018-202010
L’éducatrice spécialisée référente du projet de Simon a rencontré Madame C l’année
passée pour la signature du projet personnalisé (seule rencontre et échange de l’année scolaire).
Lors de cette rencontre a été abordé le sujet de la communication à la maison. La famille s’est
montrée plutôt favorable à la mise en place d’un classeur de communication par échange
d’image chez eux. Mais celle-ci a pointé le manque de lien et d’aide pour investir un tel outil.
Ne pourrais-je pas être la personne faisant le lien entre l'IME et la famille de Simon ?
« L’instauration d’un rapport d’égalité entre ces partenaires que sont les familles et les
institutions d’accueil et de soins reste difficile à construire et demande aux protagonistes une
extrême vigilance et une grande ténacité pour construire un rapport de confiance. »21.
3.4 Temps de lien et d’échange
Une année aura été nécessaire pour mettre en place cette rencontre à domicile, pour
plusieurs raisons : accord de la direction, disponibilité de la famille, disponibilité des éducateurs.
Nous avons pu échanger sur l’organisation de cette rencontre lors d’une réunion de
fonctionnement. La chef de service a statué après plusieurs échanges et propositions. Il nous a
semblé plus pertinent de rencontrer la mère de Simon lors d’un temps plus officiel pour faire le
retour du projet personnalisé et lui présenter l’utilisation du classeur de communication. Lors des
transports, le temps est plus court et l’espace de parole n’aurait pas été propice à l’échange.
Après accord de la direction, j’ai pris soin de contacter la mère de Simon pour lui demander ses
disponibilités et lui expliquer l’objet précis de notre visite. Celle-ci s’est montrée très réceptive
lors de mon appel. Elle a pu me faire part de certaines de ses questions, interrogations concernant
son fils. Cela m’a permis d’établir un premier lien et certainement de rendre la rencontre plus
sécurisante et rassurante pour elle.
Je me suis rendu au domicile de Madame C le 31 janvier 2020 accompagné de
l’éducatrice spécialisée référente de Simon. Nous avions au préalable réfléchi et préparé cet
entretien. Je me suis chargé de la partie présentation du classeur de communication avec support
et mise en situation afin de rendre le moment vivant et concret.
Madame C nous attendait, nous avons été très bien reçus. Après le retour des objectifs du
projet, nous avons longuement échangé sur le quotidien de Simon à la maison, ses habitudes, ses
goûts, et anecdotes. Ce qui a également participé à crée un climat de confiance. Durant
21
Chavaroche Philippe (2003). Le projet individuel. Repères pour une pratique avec les personnes gravement
handicapées mentales. (p 36), Editions ERES
CHARPENTIER Léo Implication dans les dynamiques institutionnelles - ME
Année 2018-202011
l’entretien, j’ai veillé à adopter une posture attentive, donner la parole à Madame C afin de lui
permettre de s’exprimer et lui laisser sa place de mère. L’environnement dans lequel nous nous
trouvions était rassurant pour Madame C, je pense que cela a également contribué à instaurer un
échange bienveillant. « La question de la collaboration avec le lieu d’accueil se définit à travers
deux valeurs fondamentales que sont la communication et la confiance. »22.
Les retours de projet s’effectuent conventionnellement à l’Ime lors d’une réunion qui
regroupe l’ensemble des professionnels intervenant auprès de Simon. Ce temps me semble
important mais peut à mon sens être difficile à vivre pour les parents qui se retrouvent, seuls face
à une équipe de professionnels. « Avez-vous déjà remarqué dans les réunions partenariales cet
instant de gêne où les professionnels et acteurs sociaux, éducatifs ou médicaux se présentent
avec plein de titres et de fonctions, et où on termine toujours par la pauvre personne, qui ne sera
que « parent », et encore même « parent de … » ? »23. Peut-être serait-il intéressant de réfléchir à
des améliorations concernant ce temps d’échange cela afin de rendre l’atmosphère plus
sécurisant et bienveillant pour les parents ?
Depuis notre rencontre au domicile de Madame C, une relation de confiance s’est
installée, ce qui lui permet aujourd’hui de nous contacter plus facilement par téléphone afin
d’échanger sur la situation de son fils. En revanche, la barrière de la langue ne lui permet
toujours pas d’investir le cahier de liaison. Mon investissement dans cette situation à changer ma
place auprès de Madame C mais aussi auprès de l’équipe, je suis à présent une personne
ressource dans la situation de Simon. Les membres de l’équipe me sollicitent davantage pour
faire passer des informations à la famille de Simon ou pour suivre son projet personnalisé.
22
Revue petite enfance, N°127, « Quelle place et quel rôle pour les parents ? », Septembre 2018, p79
23
LIEN SOCIAL, 1247, « Quelle place pour les parents face aux professionnels ? », 19.03 au 1er.04.19, p16
CHARPENTIER Léo Implication dans les dynamiques institutionnelles - ME
Année 2018-202012
Conclusion
Au fil de la formation, mon regard sur l'accompagnement mené auprès des personnes
s’est élargi. Ce dernier ne se restreint pas seulement au travail éducatif, c'est un travail de
collaboration et de partage entre les différents protagonistes (le jeune, sa famille, les
professionnels, les partenaires). C’est pour ces raisons, que dans cet écrit, j’ai choisi de
m’orienter vers le travail avec la famille.
Ce travail de rédaction m’a permis d’approfondir les notions de réseau et de partenariat.
Je sais aujourd’hui qualifier la famille de partenaire direct dans le parcours du jeune. J’ai
également mieux compris ce que les familles peuvent attendre « du lien. » Cela va m’amener,
lors de mes prochains accompagnements, à être plus vigilant à la place que je laisse aux familles.
De ne pas être dans le jugement et la toute-puissance, mais plutôt dans la tolérance, l’acceptation
de la culture, des habitudes et visions. De plus, le fait d’intervenir au domicile de la famille est, à
mon sens, une dimension qui a facilité la création d’un premier lien. En effet, en nous ouvrant la
porte de chez eux, de leur intimité, cette famille, cette maman, nous a laissé envisager la
possibilité d’un possible travail ensemble.
Je pense que la famille, en tant qu’expert de leur enfant, doit être consultée régulièrement,
pas seulement au moment de réunions annuelles de projet. Toutefois, la rencontre au moment de
la réunion de projet reste incontournable. En effet, l’engagement de la famille par la signature du
projet vient faire d’elle un partenaire à part entière dans l’accompagnement.
En tant que moniteur éducateur, je mesure tous les bienfaits d’un travail avec la famille,
d’une part pour assurer de la cohérence dans l’accompagnement du jeune et pour bénéficier de
leur apport d’expert, d’autre part aussi, dans le respect du cadre législatif.
Pour conclure, ce travail m’a amené à réfléchir sur certains points, et notamment sur la
question de l’adhésion de la famille et sur la sémantique des mots. Nous parlons de participation
de la famille mais ne devrions-nous pas parler plutôt de participation des institutions dans la vie
des familles ? « Je préconise donc un renversement sémantique en parlant de la participation
des institutions. Car enfin, si l’on regarde bien de toutes les façons, ce sont les services sociaux
et autres institutions qui participent à la vie des familles et aux histoires de familles. Ces familles
en seraient positionnées tout à fait autrement dans nos psychés et dans nos pratiques. »24.
24
LIEN SOCIAL, 1247, « Quelle place pour les parents face aux professionnels ? », 19.03 au 1er.04.19, p17
CHARPENTIER Léo Implication dans les dynamiques institutionnelles - ME
Année 2018-2020Bibliographie
OUVRAGES
• Chavaroche Philippe, 2003. « Le projet individuel. Repères pour une pratique avec
les personnes gravement handicapées mentales ». Editions ERES
REVUES
• LIEN SOCIAL, 1247, « Quelle place pour les parents face aux professionnels ? »,
19.03 au 1er.04.19
• Revue [petite] enfance, N°127, « Quelle place et quel rôle pour les parents ? »,
Septembre 2018
DOCUMENTS INTERNET
• http://rnrsms.ac-creteil.fr/IMG/pdf/le_partenariat_dans_le_travail_social-final.pdf
27/01/2020 à 20h
• https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/anesm_synthese-
orange-autoriteparentale.pdf 22/01/2020 à 11h00
• https://www.cairn.info/revue-contraste-2013-1-page-73.htm 09/02/2020 à 18h
• https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/parentalité/58145 09/02/2020 à
16h30
• https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-
dossiers-de-la-drees/article/les-jeunes-adultes-relevant-de-l-amendement-creton
24/02/2020 à 16h
• https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-
03/lois_reglements_projet_etablissement_anesm.pdf 08/02/2020 à 15hI
Vous pouvez aussi lire