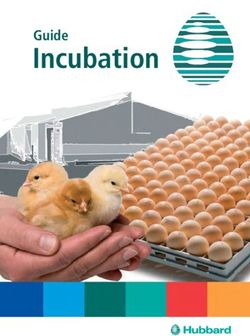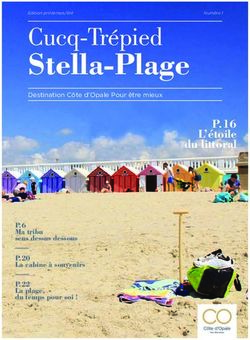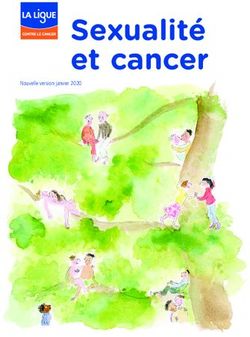L'agent Orange au Vietnam, dégâts et questions soulevées
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
L’agent Orange au Vietnam, dégâts et questions soulevées
Voici un aperçu des problèmes posés par les herbicides et défoliants et parmi eux l'agent
orange, le plus utilisé au Vietnam, contenant de la dioxine, dont les effets sont encore
ressentis 30 ans après la fin de la guerre.
Herbicides et défoliants
But de l’utilisation des herbicides et défoliants au Vietnam
Lors de la guerre américaine, ce fut une des technologies de destruction employées par les
Etats-Unis avec les objectifs suivants :
• détruire la végétation le long des routes et des pistes, aux abords des cours d’eau de
l’intérieur et sur les bords de mer, facilitant ainsi la surveillance, ainsi qu'autour des
installations militaires pour dégager leur périmètre,
• éclaircir des forêts de l’intérieur, révélant alors des camps ou des caches nord-vietnamiens,
• et enfin anéantir les cultures dans des zones tenues par les Vietcongs.
L’utilisation des herbicides à des fins militaires
Dès 1943-44, des experts militaires avaient testé 12 000 produits chimiques et en avaient
retenu 7 000 comme armes de guerre utilisables au cours de conflits.
En 1945, les Américains établirent un plan d’épandage de produits destructeurs de récoltes sur
des rizières autour de plusieurs grandes agglomérations japonaises, mais la fin de la guerre
contre le Japon survint avant la réalisation de ce programme.
L’emploi au Vietnam des défoliants et des herbicides
Dans les années 60, le gouvernement des États-Unis, de plus en plus impliqué en Indochine,
eut à faire face à des soulèvements populaires et à un développement du mouvement
révolutionnaire au Sud Vietnam et, dans le contexte du plan Stanley-Taylor pour pacifier le
pays et contrôler routes et voies d’eau, il envisagea l’usage, avec l’agrément du régime de Ngo
Dinh Diem, des défoliants et des herbicides, dont le plus connu, utilisé au Vietnam, sera l'agent
orange. Par extension, les divers herbicides et défoliants sont parfois dénommés agent orange
dans un certain nombre d’articles de vulgarisation, bien qu’ils soient chimiquement très
différents les uns des autres et de toxicité variée.
Le 11 mai 1961, lors d’une réunion du Conseil National de Sécurité, le Président Kennedy
obtint que le gouvernement Sud Vietnamien soit aidé pour la création d’un Centre de
Développement et d’Essai de Matériel de Guerre et donna l’autorisation de tester l’emploi des
herbicides et défoliants à la frontière entre Laos et Vietnam, zone particulièrement sensible.
La défoliation, appelée Opération Trail Dust (traînée de poussière), devint pour sa partie
principale, par voie aérienne, l’opération Hadès, Dieu des morts et des enfers chez les Grecs,
ensuite rebaptisée opération Ranch Hand (ouvrier agricole), nom plus civil, plus anodin.
Un premier épandage eut lieu en août 1961, mais l’opération proprement dite, décidée par le
gouvernement américain en 1961 lors de la présidence Kennedy, ne commença réellement
qu’en 1962, continuée lors de la présidence Johnson et ne se termina qu’en 1971 durant la
présidence Nixon, sous la pression de l’opinion publique et des protestations de scientifiques
de divers pays mais essentiellement américains.
Qu’est-ce que l'agent orange ?
L'agent orange est un herbicide, rose brunâtre en fait, qui tient son nom de la bande de
couleur orange peinte sur les bidons contenant ce produit pour les identifier et les distinguer
d’autres herbicides dénommés agents blanc, bleu, pourpre, rose ou vert. Cette dénomination
discrète, presque innocente, voire poétique, pour des produits éminemment toxiques, n’est pas
sans rappeler les "bidons spéciaux", contenant du napalm, utilisés sous d’autres cieux en
1d’autres temps.
Chimiquement l'agent orange est un mélange à parties égales de 2,4-D et de 2,4,5-T, avec de
la dioxine comme sous-produit de fabrication à une dose évaluée entre 3 et 4 mg/litre, mais
beaucoup plus élevée en cas de fabrication massive ou accélérée.
Qu’est-ce que la dioxine ou plutôt les dioxines ?
Chimie
La dioxine, parfois dite de Seveso1, est un produit chimique de formule "2,3,7,8-tétra-chloro-
dibenzo-para-dioxine" ou TCDD.
Pour les plus curieux, savoir qu’il existe, selon la position spatiale et le nombre d’atomes de
chlore dans la structure de base, 75 congénères (proches par la formule chimique) de PCDD
(poly-chloro-dibenzo-dioxines) et 135 de PCDF, famille voisine des poly-chloro-dibenzo-
furanes, de toxicité variable et d’autres produits apparentés, les PCB (polychloro-biphényles),
dioxine-like, en tout 419 produits chimiques, dont 29 sont particulièrement dangereux et le
plus toxique est la TCDD.
Propriétés physico-chimiques de la dioxine
C’est un produit particulièrement stable, résistant à la chaleur jusqu’à 1 000°, voire plus, peu
soluble dans l’eau, mais liposoluble, c’est-à-dire soluble dans les graisses, et qui peut donc
s’accumuler dans divers tissus ou liquides d’organismes vivants, humains ou animaux, en
particulier dans le lait maternel, d’où un risque de transmission aux nourrissons.
Nocivité de la dioxine
Cette nocivité pour les êtres vivants, humains ou animaux s’exprime à doses infinitésimales.
Expérimentalement, en laboratoire, la dose mortelle pour des rongeurs ou des poissons se
mesure en microgrammes, soit en millionièmes de gramme (10-6 g) par kilogramme de poids
corporel et des doses mesurées en nanogrammes (milliardièmes de gramme, 10-9 g) peuvent
provoquer des fausses couches, naissances prématurées et monstruosités. L’exposition à long
terme à la dioxine provoque des cancers chez des animaux de laboratoire.
La dose létale (mortelle) pour l’homme, non clairement définie, serait de 0,1mg/kg, en cas
d’intoxication massive, comme lors de l’accident de Seveso1 ou lors d’épandages directs au
Vietnam. Par contre une intoxication moindre mais prolongée, quotidienne, de tout individu
peut entraîner des problèmes de santé évoqués plus loin.
Demi-vie de la dioxine
La demi-vie est le temps nécessaire pour que la moitié d’une substance disparaisse, soit
détruite ou devienne inefficace. Pour la dioxine, elle a d’abord été estimée à 3 ans, puis
précisée être de 7 et 8,2 ans mais, chez les êtres vivants ainsi que dans la boue des rivières et
des lacs, on pense qu’elle serait plus longue et on parle de 10 à 17 ans. De toute façon, plus
de 30 ans après la fin de son utilisation au Vietnam, on constate qu’il en reste une quantité
non négligeable, dans des zones réserves ou points chauds (voir ci-après).
Processus d’action de la dioxine
Il a été démontré que les manifestations toxiques de la dioxine se produisent en intervenant
dans un processus moléculaire complexe au niveau des cellules, en particulier des cellules
reproductives, et nécessitent la participation d’un récepteur particulier dénommé Ahr
(récepteur aryl hydrocarbone), qui serait 10 à 15 fois plus sensible chez les rongeurs utilisés
dans les laboratoires que chez l’homme. La transposition des résultats n’est donc pas possible
et serait discutable.
Il y a encore de nombreuses inconnues dans la chaîne des réactions chimiques cellulaires et les
résultats des diverses études, parfois contradictoires, ne permettent pas de conclure avec
certitude sur le rôle toxique de la dioxine dans toutes les pathologies où elle est cependant
1
- Du nom de la ville située en Italie, près de Milan, où un accident se produisit en juillet 1976 à l'usine
Icmesa, dans un réacteur chimique produisant du chlorophénol, avec émission de vapeurs contenant de
la dioxine.
2soupçonnée d’intervenir.
Une étude australienne par exemple, dans les années 90, n’a pas trouvé de lien entre dioxine
et cancer chez l’homme. Certains chercheurs sont plus nuancés et d’autres affirmatifs.
Où apparaît la dioxine ?
Elle peut apparaître lors de phénomènes naturels, tels des éruptions volcaniques, des feux de
forêts, ou lors d’activités humaines, telles la sidérurgie, le blanchiment de pâte à papier, la
fabrication d’eau de Javel, le recyclage de métaux non ferreux, le fonctionnement de centrales
thermiques, la combustion d’ordures ménagères, les feux de tourbe ou comme sous-produit,
c’est-à-dire composant indésirable mais inévitable, de la production de substances chimiques,
dont les pesticides et surtout les herbicides. En fait toute activité naturelle ou humaine
comportant une chaleur élevée et la présence d’atomes de chlore peut entraîner la production
de dioxines ou de furanes (produits chimiques voisins des dioxines, avec un seul atome
d’oxygène au lieu de deux, de toxicité moindre : le chef de file est le 2,3,7,8 térachloro-
dibenzo-furane).
Effets de la dioxine
Une exposition directe, accidentelle ou provoquée, entraîne des effets selon la quantité de
toxique et selon la durée d’exposition évaluées scientifiquement en terme d’équivalents de
toxicité (codification internationale datant de 1989, en anglais, TEQ) et peut faire apparaître
des lésions directement décelables : des lésions cutanées rappelant l’acné (chloracné) ou des
taches sombres diffuses ; plus sournoisement et plus tardivement, des altérations des
fonctions hépatiques, une altération du système de défense immunitaire, divers cancers, des
dysfonctionnements des glandes endocrines et de la fonction de reproduction tant chez
l’homme que chez la femme.
Selon l’Encyclopedia Britannica 2, la dioxine est un composé stable, qui s’accumule dans
l’environnement, toxique, cancérigène et tératogène (produisant des malformations chez les
nouveau-nés) lors d’expérimentations animales.
Voies de contamination
• Voie aérienne, en cas de vaporisation directe massive ou de séjours prolongés dans une zone
polluée de façon chronique.
• Voie transcutanée, mais il faut des contacts répétés.
• Voie digestive enfin, par contamination de la chaîne alimentaire : lait maternel, lait de vache,
consommation de viandes ou poissons contaminés, qui concentrent la dioxine dans leurs
diverses réserves lipidiques ou tissus graisseux.
Métabolisme ou devenir de la dioxine dans un organisme vivant
La dioxine absorbée avec les aliments passe dans le sang, s’accumule dans le foie, les muscles
et se concentre lentement dans les tissus graisseux. Expulsée par la bile, elle peut être
réabsorbée partiellement au niveau de l’intestin et son élimination est donc très lente.
Chez la femme enceinte, la dioxine peut être transmise au fœtus à travers le placenta et, chez
la mère, passer dans le lait et ainsi être transmise au nourrisson. Des effets secondaires
définitifs, plus ou moins tardifs, peuvent apparaître chez le fœtus, le nourrisson ou l’enfant, qui
sont particulièrement sensibles à ces molécules.
Par des processus analogues, la dioxine peut être trouvée dans les oeufs de poules, de canards
et d’oiseaux et dans la descendance des divers animaux domestiques et sauvages.
Populations particulièrement exposées
Elles varient selon les époques et les précautions prises en fonction du progrès des
connaissances : personnel des usines de fabrication de produits chimiques, agriculteurs et
toutes personnes utilisant des herbicides et défoliants, professionnels de l’industrie de la pâte à
papier et des usines d’incinération d'ordures ménagères, enfin les populations soumises à des
épandages à des fins militaires comme au Vietnam, Laos et Cambodge dans les années 1961-
1971 et même 1971-75, où les plus vulnérables semblent avoir été et sont encore les fœtus et
2
- Londres, édition de 1998 – imprimée aux USA.
3les nourrissons, donc les générations suivant celle contemporaine de la guerre.
La toxicité de la dioxine a-t-elle entraîné des accidents ?
Dès 1957, cette toxicité s’est manifestée en Allemagne dans une usine de fabrication
d’herbicides où des ouvriers présentèrent des signes d’intolérance cutanée à la manipulation
de produits contenant de la dioxine et chez des fermiers utilisant des herbicides.
Puis il y eut des accidents, lors de la fabrication industrielle de certains produits chimiques,
dont les plus connus sont : à Seveso en Italie en juillet 1976, mais aussi à Yusho au Japon, à
Yu Cheng à Taiwan, avec plusieurs milliers de personnes plus ou moins gravement intoxiquées
(37 000 à Seveso), présentant des conséquences sanitaires immédiates ou secondaires.
Il faut noter, à Seveso, plusieurs années après l’accident, l’apparition d’une mutation
génétique chez des souris, sans altération des chromosomes des cellules de la reproduction,
mais par échanges de paires de chromosomes, donc en fait création d’une nouvelle espèce3.
Au final,
la pulvérisation d’herbicides et de défoliants au Vietnam a entraîné, outre ses effets sur
l'environnement, une intoxication à la fois de populations civiles vietnamiennes et de militaires,
tant vietnamiens qu’américains ou alliés des américains. L’ignorance initiale des dangers
encourus a laissé place à l’entêtement du gouvernement des États-Unis à utiliser des produits
éminemment dangereux, dont la nocivité était clamée par des scientifiques de diverses
nationalités, dont des Américains.
L’utilisation des herbicides et défoliants au Vietnam
Quantités d’herbicides et défoliants vaporisées sur le Vietnam
Selon A. Westing (1984 ; voir aussi le texte de Westing ci-après], une quantité de près de 45
millions de litres d’agent orange a été épandue de 1961 à 1971. A laquelle il faut ajouter près
de 20 millions de litres d’agent blanc et plus de 8 millions de litres d’agent bleu, soit 73
millions de litres de produits chimiques contenant environ 170 kilogrammes de dioxine.
Ces chiffres ont été revus récemment à la hausse (Stellman et al., 2003), portant le total
d’herbicides vaporisés par voie aérienne sur le Vietnam à plus de 79 millions de litres, et une
estimation de 386 kg de dioxine, d’une phénoménale capacité de nuisance, sans oublier de
mentionner l’utilisation d’autres produits chimiques tels du malathion, 100 000 tonnes au
moins de napalm selon le Département de la Défense des USA, du phosphore blanc et des gaz
neurotoxiques
Les surfaces vaporisées, une ou plusieurs fois, avec des herbicides sont estimées à 1 360 000
hectares par Westing et à près de 2 millions d’hectares selon l’Institut d’Inventaire et de
Planning Forestier (FIPI), dont une partie resterait impropre à la culture ou à l’élevage, 30 ans
plus tard.
Sociétés ayant fabriqué les produits chimiques
Pour répondre aux besoins du gouvernement des États-Unis, une cinquantaine de sociétés de
produits chimiques furent sollicitées : Dow Chemical et Monsanto principalement, mais aussi
Ansul, Diamond Alkali, Hercules, Thompson Chemical, Thompson Hayward et Uniroyal
Chemical entre autres.
Le gouvernement américain face à diverses oppositions concernant l’utilisation des herbicides
au Vietnam
• Opposition de scientifiques
Depuis le tout début de l’utilisation des produits chimiques dans la guerre du Vietnam
l’opposition de nombreux scientifiques internationaux, dont des Américains, se manifesta, ainsi
qu’en témoigne ci-après le texte d'Y. Capdeville.
• Opposition de la presse
3
- Selon le Professeur Redi, de l’Université de Pavie, dans une communication en l’an 2000.
4En mai 1964, le Washington Post a publié un article de Jim G. Lucas affirmant la destruction
accidentelle de récoltes dans le village de Cha La (Delta du Mékong) suite à l’opération Ranch
Hand. Quelques jours plus tard, le journal a demandé l’arrêt de l’utilisation des herbicides au
Sud Vietnam car inappropriée contre une guérilla infiltrée dans une population civile.
Le 30 mars 1970, le journal américain Express News publia un article relatant que le 2,4,5-T
pouvait causer des malformations néo-natales et était beaucoup plus dangereux que la
thalidomide, médicament ayant provoqué des malformations génétiques majeures chez les
enfants lors de sa prescription à des femmes enceintes dans les années 60 et d’utilisation
strictement contrôlée depuis.
Le journal anglais The Times du 28 décembre 1970 publia : "Depuis 1962, selon des
estimations prudentes, plus de 5 millions d’acres (environ 2 millions d’hectares) ont été
vaporisés avec des herbicides, ce qui équivaut au 1/8 de la surface du Sud Vietnam, à des
doses qui sont en moyenne 15 fois plus élevées que celles autorisées aux États-Unis par le
Département américain à l’agriculture".
Le photographe reporter Philip Jones Griffiths, qui couvrit la guerre du Vietnam et adressa à
des organes de presse de nombreux clichés particulièrement démonstratifs des évènements
dont il était le témoin et qui pesèrent beaucoup sur l’opinion publique pour réclamer la fin des
hostilités a écrit : "Je maintiens que l’intervention américaine au Vietnam, comme son
dramatique échec sont des défaillances structurelles, inhérentes au système américain.
Toutefois, ce livre ne veut en aucun cas dresser la liste des tactiques qui ont échoué ni assurer
un succès la fois prochaine. Les erreurs de calcul au Vietnam ne sont rien en comparaison avec
la folle idée qui y a prévalu et qui voudrait qu’une société comme la société américaine puisse
s’imposer sur celle du Vietnam" (Griffiths, 2001).
• Opposition de l’opinion publique
En raison de la pression de l’opinion publique, le 29 octobre 1969, les États-Unis furent obligés
d’annoncer la fin de l’utilisation des herbicides dans les zones à forte densité de population.
Le 1er janvier 1970, le produit chimique 2,4,5,-T fut banni d’utilisation aux États-Unis, mais au
Sud Vietnam les Américains continuèrent à le pulvériser à des doses 5 à 10 fois plus élevées
que celles utilisées précédemment chez eux en agriculture.
Décision d’arrêter l’opération Ranch Hand
En avril 1970, aux États-Unis, le Département de la Santé, de l’Education et du Bien-être
(Department of Health, Education and Welfare), en accord avec le Département de
l’Agriculture, annonça sa décision d’arrêter l’utilisation du 2,4,5-T en agriculture et le
Département de la Défense annonça qu’il envisageait la fin de l’utilisation des herbicides au
Vietnam.
L’utilisation des herbicides et défoliants au Vietnam ne fut réellement arrêtée qu’en janvier
1971, quant à l’épandage par avions, et seulement en septembre 1971 quant à celui par
hélicoptères. Mais, selon le Professeur Le Cao Dai, le régime de Saigon aurait continué à
utiliser, jusqu’à son effondrement total en avril 1975, des stocks de l’armée américaine et son
matériel.
Cependant, une réserve de 5,2 millions de litres d’agent orange, laissée après l’opération
Ranch Hand, fut entreposée sur une île américaine du Pacifique en avril 1972 et détruite en
1977, deux ans après la fin des combats au Sud Vietnam.
Qu’en est-il des victimes ?
Nombre de personnes touchées par les herbicides au Vietnam
Des estimations récentes oscillent de 2,1 à 4,8 millions de victimes potentielles, qui étaient des
civils vietnamiens, répertoriés dans plus de 20 500 villages entre 1961 et 1971, soit atteints
directement lors des épandages ou ayant manipulé sans précautions particulières les produits
chimiques toxiques, soit ayant vécu dans des zones contaminées.
Ces estimations ne prennent pas en compte les descendants de parents intoxiqués, ni les
personnes qui ont vécu par la suite dans les zones contaminées, ni les militaires vietnamiens
5et américains, ni les soldats alliés des États-Unis venus combattre au Vietnam dans les années
70 : Australiens, Néo-zélandais, Sud-coréens, etc. Elles ne comptabilisent pas non plus les
Cambodgiens et les Laotiens. En tout, plusieurs millions de personnes.
Les victimes appartiennent à plusieurs générations : les contemporains des opérations
d’épandages qui ont présenté des atteintes toxiques précoces, par exemple des affections
cutanées ou des maladies d’apparition plus tardive, dont différents cancers, à des taux
supérieurs à ceux de personnes n’ayant pas été soumises à l’action des produits chimiques
incriminés, et des victimes plus récentes, nées après l’arrêt de cette guerre chimique et
constituant la deuxième, voire la troisième génération.
Envers le peuple vietnamien, la responsabilité des États-Unis n’a pas encore été reconnue,
mais il faut savoir que jusqu’ici, le gouvernement vietnamien n’avait pas voulu porter plainte,
afin de pouvoir rétablir des relations diplomatiques et économiques avec son ancien adversaire
et de ne pas jeter de discrédit sur ses produits exportables.
Un revirement récent se manifeste avec la création fin 2003 au Vietnam d’une association des
victimes de l'agent orange, présidée par une ancienne personnalité politique de premier rang
et dont vingt-sept membres (19 adultes et 8 enfants) ont porté plainte, à titre personnel,
devant un tribunal de Brooklyn début 2004. L’instruction du procès a commencé en mars 2004
(voir ci-après le texte de M. Chemillier-Gendreau).
L'agent orange et les Vétérans américains
• Premières requêtes des Vétérans
Après la défaite au Vietnam, les risques de l’utilisation massive des herbicides et défoliants
interpellèrent les scientifiques et les organisations d’anciens combattants. Au début, le
gouvernement américain nia vigoureusement, pendant plusieurs années, que les produits
chimiques utilisés pendant la guerre aient pu avoir des effets nocifs sur la santé humaine,
relayé en 1975 par l’Institut de Médecine de l'Académie nationale des sciences, affirmant que
les herbicides avaient seulement un effet à court terme sur la nature et ne provoquaient
aucune maladie. Cependant sous la pression des associations d’anciens combattants, une
recherche fut financée par le gouvernement, sans résultats probants.
A partir de 1979, des vétérans et leurs familles intentèrent des actions en justice pour obtenir
un dédommagement des maladies estimées être en relation avec l'agent orange, donc la
dioxine.
• Création d’un Fonds de compensation
Le 7 mai 1984, la Cour fédérale de Brooklyn à New York, annonça un règlement à l’amiable, en
échange de l’arrêt de toute poursuite, par lequel les sociétés acceptaient de verser 197 millions
de dollars à un Fonds de compensation des anciens combattants, victimes de l'agent orange,
sans connaître exactement le nombre de plaignants possibles ni l’importance des préjudices
subis ou à venir. La Cour fédérale nomma un bureau exécutif pour gérer ce fonds.
En vue d’obtenir une compensation, les vétérans devaient prouver que les symptômes
présentés étaient dus à l'agent orange et qu’ils avaient une perte totale de leur capacité de
travail, ne résultant pas de blessures de guerre. Il fallait que le handicap survienne avant le 31
décembre 1994.
Sur les 105 000 demandes reçues, 52 000 furent acceptées, soit un traitement moyen de
3 800 dollars, les subventions, destinées à une personne ou à une famille, s’étageant de 256 à
12 800 dollars pour la plus importante. Le fonds ferma le 27 septembre 1997.
• L’intervention de l’Amiral Zumwalt
A la fin des années 80, un élan fut donné à la recherche sur l'agent orange à la suite de
l’intervention de l’ancien Commandant en chef de la Marine américaine durant la guerre du
Vietnam, l’Amiral E.R. Zumwalt, qui avait décidé de faire épandre des herbicides le long des
canaux et des fossés pour protéger les bateaux patrouilleurs des forces navales américaines
dont il avait la charge, afin d’éviter les embuscades des forces de la guérilla.
Tragiquement pour la famille Zumwalt, le fils, le Capitaine Elmo Zumwalt, commandait durant
cette même période, un bateau patrouilleur de rivière dans une région vaporisée avec des
6herbicides. Il allait chaque jour en patrouille sur les rivières de Quang Nam et Ca Mau et les
après-midi, il avait l’habitude de nager dans les rivières et de manger sur les marchés le long
des rives des cours d’eau.
Après son temps de service au Vietnam, le Capitaine Zumwalt retourna aux États-Unis, se
maria, eut un fils, dont le développement fut anormal, l’enfant présentant une déficience
mentale. Durant cette même période, le Capitaine Zumwalt développa deux cancers différents
et mourut en 1988 (Zumwalt et al., 1986).
• Décision du Congrès américain d’enquêter sur l'agent orange
Suite à l’expérience de sa propre famille, en 1987-1988, l’Amiral Zumwalt amena un groupe de
scientifiques à rouvrir les dossiers des précédents programmes de recherche où des anomalies
graves furent découvertes et il mena le combat pour demander au Congrès américain de
conduire un enquête publique sur les effets de l'agent orange (Zumwalt, 1990). Durant le
débat au Congrès, il témoigna que, selon son enquête, jusqu’à 28 maladies différentes étaient
en rapport avec l'agent orange et la dioxine.
• En février 1991, l’acte PL 102-4 du Congrès des Etats-Unis imposa au Secrétaire aux Affaires
des Anciens combattants d’exiger que l’Académie des Sciences fasse une étude indépendante
et exhaustive et une évaluation de l’information médicale concernant les effets secondaires de
l’exposition à l’Agent Orange.
• Des listes de maladies imputables ou non à l'agent orange apparaissent
En 1994, l’Institut de Médecine fut autorisé par l’Académie Nationale des Sciences à publier la
première liste de maladies et un livre de documents (National Academy of Science, 1994).
Dans ces documents, l’Institut reconnaissait pour la première fois l'agent orange comme cause
de certaines maladies et recommandait de continuer la recherche dans certaines directions,
promettant en même temps que les résultats de recherche seraient publiés tous les deux ans.
Le Département des Affaires des Anciens Combattants fut aussi chargé d’indemniser les
familles de ceux qui étaient décédés, d’indemniser aussi les invalides et de prendre en charge
les consultations médicales et la réhabilitation des victimes de l'agent orange.
Liste de maladies imputables ou non à l'agent orange (National Academy of
Science, Update 2002)
• Maladies offrant une preuve suffisante d’une association avec une exposition aux herbicides :
leucémie lymphoïde chronique (LLC), sarcome des tissus mous (tumeur maligne), lymphome
non hodgkinien (maladie sanguine maligne), maladie de Hodgkin (affection sanguine
maligne), chloracné.
• Maladies offrant une preuve limitée d’une association avec une exposition aux herbicides :
cancers respiratoires (poumons et bronches, larynx, trachée), cancer de la prostate,
myélome multiple (tumeur maligne), neuropathie périphérique aiguë ou subaiguë, porphyrie
cutanée tardive (affection dermatologique avec manifestation urinaire), diabètes de type 2,
spina bifida (malformation congénitale vertébrale).
• Maladies offrant une preuve inadéquate ou insuffisante d’une association avec une exposition
aux herbicides : cancer hépatobiliaire (foie, voies biliaires), cancer nasal ou naso-pharyngé,
cancer osseux, cancers cutanés, cancer du sein, cancer de l’appareil de reproduction féminin
(col, utérus, ovaires), cancer du testicule, cancer de la vessie, cancer du rein, leucémie
(autre que LLC), avortement spontané, malformation néo-natale (autre que spina-bifida),
mort-né et mort néo-natale du nourrisson, faible poids à la naissance, cancer de l’enfance
dans la descendance incluant les leucémies myéloïdes aiguës, paramètres spermatiques
anormaux et infertilité, maladies cognitives et neuropsychiatriques, dysfonctionnement
moteur et de la coordination, maladies chroniques du système nerveux périphérique,
maladies gastro-intestinales, métaboliques et digestives (altérations des enzymes
hépatiques, anomalies lipidiques, ulcères), maladies du système immunitaire (déficit
immunitaire et maladies auto-immunes), troubles circulatoires, affections respiratoires,
amyloïdose primaire de type AL, endométriose, effets sur le fonctionnement de la thyroïde.
• Maladies offrant une preuve évidente de non association avec une exposition aux herbicides :
tumeurs gastro-intestinales (cancer de l’estomac, du pancréas, du colon, du rectum),
7tumeurs cérébrales.
En mai 1996, le Président Clinton approuva la législation accordant des avantages réels aux
vétérans américains et parla de "la souffrance causée involontairement par notre nation à ses
propres fils et filles en les exposant à l'agent orange au Vietnam".
Le 9 juin 2003, la Cour suprême des États-Unis a rendu un arbitrage qui permet aux vétérans
américains touchés par l'agent orange de porter plainte à nouveau contre les fabricants des
herbicides et défoliants. Cela concerne les victimes dont les symptômes se sont manifestés
après que le fonds d’indemnisation de 1984 eut été complètement utilisé.
Autres résultats de la recherche internationale
• L’affaiblissement du système immun
Des recherches aux Etats-Unis, ont montré que la dioxine affecte la capacité de l’organisme à
se défendre, en affaiblissant le système immunitaire, en particulier l’immunité cellulaire. Selon
une étude, des vétérans exposés fréquemment aux herbicides présentaient un taux élevé
d’anticorps anti-nucléaires, s’exprimant par une accélération du processus de vieillissement.
• Désordres endocriniens et métaboliques
La recherche internationale récente a montré que la dioxine provoque des désordres
endocriniens : dans le métabolisme de l’insuline, induisant le diabète ; dans le fonctionnement
de la thyroïde ; dans les métabolismes du cholestérol et de la testostérone et qu’elle peut
favoriser des affections cardio-vasculaires, coronariennes en particulier.
Autres combattants
Des Australiens, vétérans de la guerre du Vietnam, ont porté plainte auprès de leur
gouvernement pour les préjudices sanitaires ressentis, de même que des vétérans néo-
zélandais auprès du leur en décembre 2003.
Dégâts sur l’environnement naturel
Le Sud Vietnam était couvert avant la guerre de forêts à feuillage persistant, de mangroves ou
forêts en bordure de mer, où abondaient des palétuviers et de nombreux types d’arbres
acclimatés à l’eau salée, de plantations d’hévéas et d'environ 3 millions d’ha de terres
agricoles.
Les dégâts de la défoliation furent considérables et sont traités plus complètement dans les
textes ci-après de A. Westing et de Vo Quy. Rappelons seulement quelques points importants.
Les forêts de l’intérieur
Beaucoup de forêts détruites n’ont pas encore repris vie et des arbres ont été remplacés par
des herbes épaisses et des bambous de peu de valeur économique. Le destruction de forêts a
entraîné une perte de l’équilibre écologique, avec des répercussions sur l’exploitation du bois,
la faune sauvage, la possibilité de reforestation, la protection des nutriments et sur le régime
des eaux avec le risque de crues subites et une aridité entraînant une érosion et laissant la
terre pauvre, épuisée, latéritique. La forêt de Ma Da, dans la province de Dong Naï, fut
particulièrement touchée.
La régénération spontanée est difficile et lente et pourrait demander 80 à 100 ans Une
reforestation était donc nécessaire et a largement commencé.
Les mangroves
Les mangroves ont normalement un rendement élevé en bois. Outre l’assèchement des
mangroves par des tranchées de drainage et la destruction de massifs d’arbustes au lance-
flamme, les épandages furent importants, en particulier dans la forêt de Sat près de Ho Chi
Minh Ville et dans celle de la presqu’île de Ca Mau où de nombreux hectares furent détruits,
causant la perte de millions de m3 de bois et une perte de 60 à 100 kg de crevettes par an et
par hectare selon Snedaker. L’effet le plus important sur le sol fut son oxydation, qui le laissa à
la fois acide et salé et donc inutilisable.
La repousse naturelle des mangroves est longue et difficile. Des plantations d’arbres furent
8donc décidées par le Ministère des forêts sur de nombreux sites et la vie animale réapparut
progressivement.
Les terres agricoles
La surface des terres cultivées vaporisées atteignit environ 200 000 ha ; le sol fut érodé et le
taux de nutriments (azote, phosphates, calcium, magnésium) décrut, d’où une perte de 40 à
100 % de productivité pour diverses cultures.
La population rurale
Avant les combats au Sud Vietnam, 85 % de la population était rurale, vivant dans la
simplicité au milieu d’une campagne luxuriante. A la fin de la guerre, 3 des 17 millions
d’habitants étaient devenus des réfugiés vivant dans les villes, au cœur d’un pays ravagé, dont
une partie désertifiée, inutilisable pour l’agriculture et la sylviculture, sans parler de la perte
symbolique forte de la forêt et des cours d’eau, lieux de vie de génies protecteurs familiers
(voir le texte de J. Maître et B. Doray ci-après).
La faune
Les bombardements massifs et l’épandage d’herbicides contribuèrent à la disparition d’espèces
d’animaux sauvages et à la quasi-disparition d’autres espèces. Dans les forêts, des animaux de
valeur furent détruits. A l'inverse, des nuisibles ont pu prospérer : des rongeurs, destructeurs
de récoltes et des moustiques, qui augmentent le risque de paludisme et de fièvre dengue. La
destruction des forêts de mangroves entraîna la mort ou la fuite d’animaux rares et précieux,
tels des loups, alligators, sangliers, singes, iguanes, serpents et des oiseaux. De nombreux
animaux domestiques furent tués ou tombèrent malades. La guerre a aussi provoqué des
anomalies dans les descendances : mort-nés, monstres et des maladies provoquèrent des
morts, par tonnes, chez des poissons. Il y eut donc une baisse importante de la production et
de l’exportation des poissons et crevettes.
Recherche de la dioxine dans le sol, la nourriture et dans des prélèvements
humains ou animaux
Intérêt de la recherche de dioxine
Analyser la quantité de dioxine restant dans l’environnement et chez les êtres vivants a été
important pour étudier les conséquences de la guerre chimique en général et celles de
l’utilisation de l'agent orange en particulier, pour plusieurs raisons : premièrement, la dioxine,
composé stable, persiste très longtemps tandis que les herbicides se désintègrent plus
rapidement, deuxièmement, l’analyse de la dioxine aide aussi à déterminer les régions encore
contaminées, contribuant à l’établissement des mesures de nettoyage et de protection pour la
population et les animaux domestiques et sauvages.
Difficultés de cette recherche
Ce travail d’analyse est difficile, car il n’y a dans le monde que peu de laboratoires bien
équipés et entraînés pour des résultats fiables, et les analyses coûtent cher (1 000 à 2 000 $,
voire plus par échantillon, en l’an 2000). De plus, il faut rappeler qu’environ 30 ans ou plus se
sont écoulés depuis l’utilisation des produits chimiques et les quantités restantes ont donc
décru, malgré des incertitudes sur la demi-vie de la dioxine selon sa localisation.
Dans les années passées, grâce à la coopération internationale, plusieurs milliers d’échantillons
(environ 4 000 avant 1999) ont été analysés et les résultats de ces études furent publiés au
Vietnam et dans d’autres pays et rapportés dans de nombreux livres et revues scientifiques.
Laboratoires pratiquant les analyses de dioxine
Des scientifiques et des laboratoires des États-Unis, du Canada, des Pays-Bas, de Finlande,
d’Allemagne, du Japon et de France ont participé à l’examen des échantillons provenant du
Vietnam.
Résultats d’analyses de dioxine dans la terre et la boue de rivières ou de lacs
• Données chiffrées
9Selon les les estimations, 386 kg de dioxine furent épandus au Sud Vietnam sur une surface
de 10 400 km2 selon les Américains, de 30 100 km2 selon le FIPI.
La concentration théorique moyenne de dioxine dans la terre serait de 25 pg/g (pg :
picogramme, ou 10-12 g ou millionième de millionième de gramme4).
Dans des échantillons de terre prélevés en forêt de Sat, près de Ho Chi Minh Ville en 1983, on
trouva des taux 3 à 7 fois plus élevés que ceux de pays industrialisés.
Dans les années 1985-86, 121 échantillons de terre et 8 échantillons de boue de rivières,
réputées être des lieux de forte concentration de dioxine, révélèrent la présence de dioxine
dans 25 échantillons de terre à des taux pas trop élevés : 1 à 14 pg/g ou ppt et quelques
échantillons de 16 à 59 pg/g. Dans la boue des rivières, la dioxine ne fut pas retrouvée, sauf
dans une branche de la rivière Saigon où il y avait une très forte concentration : 210 pg/g,
mais qui pourrait être due en partie à une pollution industrielle.
• Disparition naturelle progressive de la dioxine
En 1990, près de 20 ans après la fin de la majeure partie des épandages, bon nombre
d’échantillons de terre provenant du sud ne révélaient pas de trace de dioxine ou des taux bas.
La disparition relativement rapide de la dioxine de l’environnement peut être expliquée par le
climat tropical, la géographie et la topographie du sud, l’existence de fortes marées, dont
l’influence est ressentie jusqu’à 70-80 km à l’intérieur des terres. Grâce à ces conditions, en 30
ans, la majorité de la dioxine du sol a disparu, en partie détruite par les rayons solaires
ultraviolets et en partie emportée par les eaux vers la mer.
La dioxine persiste longtemps dans les sols à l’ombre, comme dans les jungles, ainsi que le
montrent des analyses d’échantillons prélevés sur les mêmes sites en 1990 et 1999, à A Luoi
et à Tabat, révélant des taux analogues de dioxine, parfois très élevés, tandis que, dans un sol
labouré de façon répétitive et exposé au soleil, la dioxine, souvent située dans les premières
dizaines de centimètres supérieurs du sol, peut être détruite.
Les points chauds
Il est important de noter que certains "points chauds" sont toujours fortement contaminés par
la dioxine : anciens aéroports, quais de déchargement, aires de stockage, aires de chargement
des avions et hélicoptères.
D'autres lieux peuvent être aussi fortement contaminés : ceux où des avions ont eu des
incidents sur le trajet de l’épandage, soit qu’ils furent abattus, soit qu’ils durent larguer leur
chargement entier, c’est-à-dire 3 700 litres sur seulement 1 ou 2 hectares, alors que la dose
vaporisée habituellement était de 28 litres/ha. Dans certaines régions, le taux de dioxine
pouvait donc être 100 à 150 fois celui d’autres régions.
Des contrôles ont été faits assez récemment par Wayne Dwernychuck et ses collaborateurs en
2002 et par Arnold Shecter et ses collaborateurs en 2001, 2002 et 2003 à Bien Hoa, près de
Ho Chi Minh Ville, sur un groupe de 43 personnes, dont 36 ont des taux sanguins de dioxine
toujours élevés, 7 à 16 fois ceux d’échantillons prélevés sur des groupes contrôles de Hanoi. Il
en est de même pour des échantillons de nourriture provenant du lac de Bien Hung ou de ses
abords et pour des échantillons de sol de la base aérienne de Bien Hoa, près de Ho Chi Minh
Ville.
Analyses de la dioxine dans les produits alimentaires
• Principaux vecteurs de la dioxine
Pour pénétrer dans l’organisme humain, la voie principale est digestive, par l’ingestion de
nourriture, en particulier poissons, crevettes, viande et produits laitiers.
• Taux de dioxine peu après la guerre
En 1973, peu après la fin des raids américains d’épandage d’herbicides et de défoliants, la
concentration de dioxine dans les poissons et crevettes d’eau douce et d’eau de mer était
forte : en moyenne 250 fois celle trouvée aux États-Unis. En 1986, les taux avaient décru et
4
- Les résultats des dosages sont souvent exprimés en pourcentages, avec le symbole ppt (part par
trillion, 10–12). Le trillion est 1018 en français et anglais, mais 1012 en américain.
10étaient soit égaux aux taux américains, soit 5 fois ces taux. En 1990, les pourcentages de
dioxine dans les produits vietnamiens étaient égaux à ceux d’autres pays.
• Amélioration des taux avec le temps
La dose journalière tolérable (DJT) de consommation de dioxine fixée par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) était jusqu’à 1998 de 10 picogramme par kilogramme de poids
corporel, qui correspondrait à environ 500 pg, pour un Vietnamien moyen de 50 kg, afin de
rester au-dessous du seuil de risque.
En 1973, la quantité de dioxine ingérée quotidiennement au Vietnam était de 20 000 à
118 000 pg/personne/jour, soit 40 à 235 fois le taux acceptable établi par l’OMS. En 1986,
l’absorption quotidienne, calculée de 14 à 52 pg/personne/jour était nettement inférieure au
taux admissible reconnu : 500 pg/pers/j.
En 1998, la dose journalière tolérable, tenant compte sans doute du phénomène de bio-
accumulation, a été abaissée à une fourchette de 1 à 4 pg/kg de poids corporel par l’OMS, soit
de 50 à 200 pg/personne/jour en moyenne au Vietnam.
Il est intéressant de savoir qu’une étude récente aux États-Unis a trouvé que le taux moyen de
dioxine chez les vétérans américains est inférieur à celui d’ouvriers travaillant dans des ateliers
industriels.
La dioxine chez les animaux sauvages
On a trouvé, en 1986, des taux de dioxine 20 à 70 fois ceux d’animaux de pays industrialisés
sur quelques échantillons provenant d’animaux ayant vécu assez longtemps, peut-être depuis
la fin de la guerre, rampant sur un sol contaminé par la dioxine, mangeant des insectes et des
vers, dans une région qui avait été fortement vaporisée.
La dioxine dans l’organisme humain
• Intérêt des dosages et choix des groupes étudiés
Dès 1970-1973, il parut intéressant de doser la quantité de dioxine des organismes de ceux
qui furent en contact avec les produits chimiques toxiques, puis après 1984, la population fut
divisée en deux groupes, soit des gens vivant au sud dans les zones vaporisées par les
produits chimiques, soit des fonctionnaires, des soldats et des jeunes volontaires, nés dans le
nord mais combattant sur les champs de bataille du sud durant la guerre. Des analyses de
dioxine furent faites sur divers échantillons organiques : sang, lait, tissus graisseux sous-
cutané, plus rarement sperme, avec toutes les précautions d’usage de prélèvement et
conservation, aboutissant à une évaluation de la charge corporelle, qui est l’indicateur
convenable pour relier effets et exposition aux produits toxiques.
• Position de l’Organisation Mondiale de la Santé
Selon l’OMS, la TCDD n’atteint pas le matériel génétique et il existe un degré d’exposition en
dessous duquel le risque de cancer serait négligeable. Cependant un taux sanguin de dioxine
supérieur ou égal à 4, voir 1 pg/g, serait considéré comme anormal et dangereux pour la santé
en général.
• Recherche de la dioxine dans les tissus graisseux
En 1970-1973, la dioxine est présente dans 83 % d’échantillons d’un groupe de personnes du
sud, contre 12 % dans ceux d’un groupe témoin de personnes du nord dans des études faites
par des nord-américains.
La population qui n’a jamais subi les épandages, à Ho Chi Minh Ville par exemple, a aussi de
fortes concentrations en dioxine, preuve que la dioxine pénètre dans l’organisme avec la
nourriture apportée depuis les zones vaporisées vers les villes.
Le taux de dioxine augmente avec l’âge des sujets examinés, rendant compte du phénomène
important de bio-accumulation.
• Recherche de la dioxine dans le lait maternel
La concentration de la dioxine dans le lait maternel est un bon indicateur pour l’exposition
fœtale. En 1970, le taux moyen de dioxine dans le lait maternel, trouvé au Vietnam par des
11chercheurs américains, était de 480 pg/g, soit 140 fois celui trouvé aux USA, avec un taux
maximum à 1 450 pg/g, le plus élevé jamais trouvé dans le monde et représentant plus de
400 fois le taux moyen aux Etats-Unis.
Rappelons aussi une étude faite aux Pays-Bas, de recherche de dioxine dans du lait maternel
de Vietnamiennes, qui associait une recherche de dioxine dans le sérum sanguin maternel et,
si possible, dans le sang prélevé au cordon ombilical. Progressivement, les taux moyens de
dioxine dans le lait maternel ont diminué : 131 pg/g en 1973, 20 pg/g en 1985-1988, soit 5 à
6 fois les taux d’échantillons du nord. En 1998, ces taux restent plus élevés que dans de
nombreux pays, y compris des pays industrialisés.
La présence de dioxine est une tragédie, parce que même si la charge de toxique chez la mère
diminue, elle est peut-être transférée à l’enfant. Et quelles peuvent être les conséquences chez
des enfants, qui ont été allaités avec du lait contaminé par la dioxine ?
• Recherche de la dioxine chez le fœtus
Des échantillons de tissu hépatique prélevés sur des fœtus monstrueux, mort-nés à l’hôpital
Song Be et à l’hôpital Tu Du de Ho Chi Minh Ville ont montré des taux détectables de dioxine
dans les lipides de 1,3 à 3,5 pg/g. La dioxine était donc passée de la femme enceinte au fœtus
à travers le placenta.
• La dioxine chez les anciens combattants du Nord
Le taux de dioxine des anciens combattants des zones vaporisées par les herbicides, qui
retournèrent vivre au Nord dans leurs familles fut trouvé, dans les années 80, 5 à 6 fois plus
élevé que celui des personnes qui avaient toujours vécu au Nord, non vaporisé par les
herbicides et défoliants. De même, une étude comparative en 1991-1992 entre un groupe de
33 vétérans ayant combattu au Sud et un groupe de personnes restées au Nord montrait aussi
des taux 3 fois plus élevés dans le premier groupe.
• Variations des taux de dioxine selon les lieux de vie
En janvier 1995, une étude portant sur des pools d’échantillons sanguins provenant de 2 750
personnes a montré des taux de dioxine 2 à 15 fois et des taux de TEQ 40 à 100 fois plus
élevés au sud qu’au nord.
Les concentrations les plus élevées correspondent aux aéroports de Da Nang, Bien Hoa et Tra
Noc et deux sont dans les régions fortement vaporisées de Tan Uyen dans la Province de Song
Be et A Luoi dans celle de Thua Thien Hue, sur la piste Ho Chi Minh.
Les régions ayant des taux bas de dioxine sont celles qui furent peu vaporisées, y compris les
provinces du Delta du Mékong de Chau Doc, Long Xuyen, les villes de Can Tho, Rach Gia et la
partie sud de la région centrale : Nha Trang et Phan Rang.
Enfin, la durée du séjour est un facteur important, significatif, du risque de toxicité et par
exemple, dans l’étude menée en 2001 par le Pr Nguyen Thi Ngoc Phuong de l’hôpital Tu Du à
Ho Chi Minh Ville sur les malformations néonatales et anomalies de grossesse, la durée de 15
ans de séjour dans une zone contaminée est un critère essentiel d’évaluation du risque.
• Conclusion
Des analyses d’échantillons de sang humain, de lait, de tissu graisseux montrent toutes que
les personnes qui avaient été exposées aux produits chimiques durant la guerre, avaient des
taux de dioxine nettement plus élevés que les taux trouvés chez les résidents des régions du
Nord, non concernés par les épandages. Ces taux sont restés élevés dans les deux décennies
suivant la guerre, mais ont progressivement retrouvé ceux constatés dans les pays
industrialisés, sauf dans des régions particulières : sur ou autour des points chauds.
La recherche au Vietnam
Très tôt, des médecins vietnamiens ont signalé l’apparition de pathologies inhabituelles.
Rappelons que le premier à donner l’alerte, avant 1970, d’une augmentation possible du
nombre de cancers hépatiques (du foie) par l’exposition aux herbicides fut un chirurgien, le
Professeur Ton That Tung. Des échanges eurent lieu avec des scientifiques nord-américains et
12Vous pouvez aussi lire