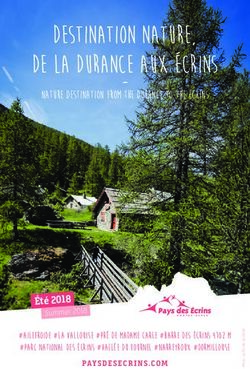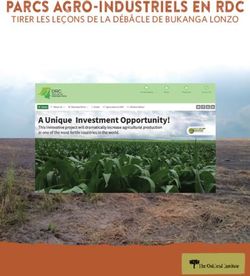Les caféiculteurs du Burundi face à la Banque Mondiale - Luttes pour une réelle participation dans les privatisations.
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Les caféiculteurs
du Burundi
face à la
Banque Mondiale
Luttes pour une
réelle participation dans
les privatisations.
1I. Pourquoi cette publication ?
Pour la plupart des citoyens suisses, le café est synonyme de Le café est une des matières premières qui a la plus grande Gouvernement burundais à l’application de ce processus de pri-
pause, un petit plaisir qui permet pendant un instant de sortir valeur commerciale après le pétrole. C’est un des produits les vatisation. Parallèlement, la Suisse a des engagements en matière
du travail avant de s’y replonger en ayant retrouvé un peu plus plus échangé dans le monde. Mais comme souvent en agri- de coopération au développement et de solidarité internationale.
d’énergie. Pour la majorité des paysans burundais, le café est au culture, le producteur ne reçoit qu’une infime partie de cette L’aide publique qu’elle a investit au Burundi en 2010 s’est mon-
contraire synonyme de travail, un des seuls moyens d’obtenir un manne : on estime qu’environ 5 à 6% du prix de vente du café tée à 12.2 millions de francs.
revenu sous forme d’argent. Mais sur ce que vous avez payé pour en magasin revient à celui qui le cultive. Les distributeurs, eux,
votre café durant votre pause, seul quelques centimes sont parve- en gardent 12 à 20%, les torréfacteurs environ 70%2 ! Cette Nos entreprises sont sur le terrain.
nus aux producteurs. Le prix auquel ils sont contraints de vendre différence de marge n’est pas sans conséquence pour les habi-
SOMMAIRE leur café ne couvre souvent même pas les frais de production. tants du Burundi, la culture du café y étant pratiquée par près La seule entreprise qui a racheté des usines de transformation
de la moitié de la population. du café au Burundi est une multinationale suisse : Webcor. Celle-
I. Pourquoi cette publication? 2 En crise depuis plusieurs années, la filière du café burundais ci a effectué cet achat malgré un appel des caféiculteurs à at-
est en train d’être réformée. Mais loin d’être impliqués, les pay- Le gouvernement suisse tendre que leurs revendications soient prises en compte. Notons
II. Parcours du café 4 sans sont ignorés. Le processus de privatisation imposé par la encore que, si elle n’est pas directement impliquée, la multinatio-
Banque Mondiale et le Fond Monétaire International, au lieu de Le gouvernement suisse est impliqué dans la privatisation qui est nale suisse Nestlé n’est pas sans influence sur le secteur du café
III. Pourquoi une réforme est-elle leur permettre d’obtenir un meilleur revenu de leur production, en cours actuellement. En effet, la Banque mondiale, dont fait puisqu’elle fait partie des 5 entreprises qui acquièrent entre elles
indispensable ? 8 est en train de mettre encore plus de pression pour diminuer partie la Suisse (282 millions de francs de contribution en 2010), près de la moitié de la production mondiale. La Suisse est donc
les prix et leur ôte toute possibilité de participer à la gestion est fortement active dans le processus de la réforme de la filière impliquée à tous les niveaux : gouvernement, entreprises
La filière café (encadré) 12 de la filière. café au Burundi. Elle a notamment conditionné son appui au et citoyens.
IV. Stratégie des acteurs 14 Les producteurs de café du Burundi, à travers la Confédération
nationale des associations de producteurs (CNAC), ont lancé un
V. Revendications des caféiculteurs 19 appel international pour faire entendre leur voix. Ils appellent à
un changement de méthode de la Banque Mondiale qui néglige
VI. Que faire ? 21 trop souvent la participation des producteurs dans les projets
qu’elle finance. Son approche est technique, financière, écono-
Campagne de lobbying (encadré) 24 mique et la dimension humaine souvent ignorée.
Nous sommes tous concernés par cette appel, notamment parce
que :
Editeur : Burundi et CAfé en quelques mots
www.ired.org Le citoyen suisse est le troisième plus grand
consommateur de café du monde. Le Burundi est classé parmi les pays les plus pauvres de la planète. L’indice de développement humain calculé par les Nations
Communication / Lay Out: Unies le place comme le 4ème pays le moins développé 3. La caféiculture occupe une place centrale pour la population, elle
www. noyauzeronetwork.org Avec 9,15 kilos1 par personne par an, le citoyen suisse est le troi- est pratiquée par environ 580 000 ménages ruraux (soit près de 45% de la population).
sième plus grand consommateur de café du monde. Le café fait
Impression: partie de ces produits qui sont cultivés exclusivement par les pays Le café arabica, fortement apprécié pour relever l’arome des autres cafés, constitue la principale source de devises pour le
Sro-Kundig, Genève du Sud (suite notamment à l’implantation de cultures forcées lors pays. Il est le véritable moteur de l’Etat burundais. Selon les années, la part du café arabica varie entre 50 et 87% des recettes
de la colonisation) mais qui sont consommés essentiellement par d’exportation du pays. A cette forte dépendance du Gouvernement au café, s’ajoute une très forte dépendance à l’aide inter-
Avec le soutien de la Ville de les pays du Nord. nationale, puisque la Banque Mondiale fournit 51% du budget de l’Etat. Le Burundi se trouve pris en otage économiquement
Genève à travers la Fédération d’un côté par le café, de l’autre par les exigences des institutions financières internationales.
genevoise de coopération
Depuis les années ‘90, le Burundi connait une crise du secteur café qui s’explique entre autre par la chute des cours mondiaux
du café, l’inefficacité de certaines structures de production et de commercialisation et le climat de conflit qui régnait dans le pays.
A partir de 2005, avec le retour à un climat de paix, la question du redressement de la filière s’est placée au centre des priori-
tés. Mais les caféiculteurs, pourtant les premiers concernés par la réforme, sont rapidement mis à l’écart des décisions.
Dans un premier temps, ceux-ci s’étaient organisés et s’étaient pleinement impliqués dans la gestion de toute la filière. Leur si-
tuation semblait commencer à s’améliorer. Mais les exigences des Institutions de Bretton Woods (IBW) ont poussé l’Etat burun-
dais à suivre les recommandations d’un bureau d’étude international qui n’a pas jugé nécessaire de consulter les caféiculteurs.
Ces recommandations remettent en question tous leurs acquis.
© Copyright Ired.org 2011
2 1
Donnée pour 2008, source : ICO, rapport annuel 2
Benoit Daviron, Stefano Ponté, « Le Paradoxe du café ». Ed. QUAE, 2007. 3
3
Rapport sur le développement humain 2010. Publié par le Programme des Nations Unies pour le développement.II. Parcours du café
Du point de vue de la Belgique,
Historique: la caféiculture constituait, dès le
Période coloniale
début des années 30, le moyen le
plus sûr d’obtenir l’attachement En quoi le processus
Le café a été introduit au Burundi au début du 20ème siècle par
des missionnaires catholiques (les Pères Blancs). A partir des an- des paysans à l’économie de mar- de privatisation pose-
nées 20, sous la tutelle belge, la production va s’étendre pour ché, en favorisant l’élargissement t-il problème ?
finalement devenir le moteur économique du pays. La première
préoccupation de la Belgique était de rentabiliser sa colonie, qui et le développement d’une mi-
n’exportait jusque là presque rien. Poussant bien dans cette ré-
gion, le café a été désigné pour jouer ce rôle.
cro bourgeoisie rurale qui reste Précisons d’emblée que le problème n’est pas dans la pri-
vatisation en elle même, puisque tous les acteurs concer-
jusqu’à nos jours un rêve. nés y sont favorables. Par contre, la stratégie adoptée ne
Pour développer des cultures rentables économiquement alors fait pas l’unanimité.
que la population n’en avait à l’époque aucune utilité, la Bel-
gique a créé un besoin qui n’existait pas jusque là, celui d’avoir Alexandre Hatungimana, «Le Deux visions s’opposent :
de l’argent. Un impôt monétaire a été instauré pour que les pay-
sans soient obligés de cultiver du café et de le vendre. Produc- café au Burundi au XXe siècle». - Celle de la Banque Mondiale pour qui il faut favoriser
tion forcée, imposition d’amendes, emprisonnement, punition au
fouet étaient des méthodes utilisées pour obliger ceux qui ne s’y
Ed. Karthala, 2005. des investisseurs étrangers car se sont eux qui ont le plus
de moyens et de compétences pour redresser un secteur
pliaient pas, à produire du café. Le paysan devait donc abandon- à la dérive.
ner une partie de son temps et de son terrain utilisé pour des
cultures vivrières afin de se consacrer à des cultures d’exportation - Celle des producteurs, pour qui le meilleur moyen de
pour payer un impôt au colonisateur. «La première préoccupation de l’Etat redresser la filière est de les impliquer directement pour
qu’ils puissent, eux-mêmes, développer cette activité qui
Le verger caféicole a connu différents programmes d’extension à mandataire est d’assurer le progrès leur permet de vivre.
partir de 1930. La production s’est progressivement intégrée au
mode de vie des paysans. En 1959, on dénombrait 38 millions de
et le bien-être aux populations dont
Le rapport de force inégal qui s’établi entre la Banque
caféiers, produisant près de 20’000 tonnes de fruits. il a accepté la tutelle… L’autorité Mondiale et les petits producteurs fait que jusqu’à main-
tenant, la première vision a été appliquée fidèlement,
Malgré ses efforts et ses méthodes, la Belgique n’a pas réussi à mandataire parvient à leur mettre alors que la deuxième n’a même pas été prise en compte.
mettre en place un système dégageant suffisamment de revenus dans les mains un précieux élément Les caféiculteurs du Burundi se sentent ignorés et dé-
aux paysans pour améliorer significativement leurs conditions de possédés par les réformes qu’exige la Banque Mondiale.
vie. Le gain du paysan était faible en comparaison de ses efforts. de ce bien être… Ce précieux élé- Lors de la première année d’activité de l’entreprise suisse
Elle a toutefois réussi à rentabiliser le territoire qu’elle occupait,
amenant parallèlement le pays et le paysan burundais à être dé-
ment, c’est la culture du caféier». Webcor au Burundi en 2010, les paysans qui lui ont
vendu leur récolte ont été payés 40% de moins que les
pendant de la culture du café. autres producteurs de café du pays…
Période d’indépendance E. de Wildeman, professeur de Les pages qui suivent ont pour but de donner une voix aux
l’Université coloniale (1937) paysans du Burundi, afin que leur situation soit connue,
Le Burundi accède à l’indépendance le 1er juillet 1962 et aban- leurs revendications entendues. Elles ont pour but égale-
donne la gestion centralisée de la filière. De 1962 à 1976, la ment de mettre en avant les contradictions entre discours
culture du café est privée. La production oscillait alors entre et actions de ceux qui ont (auraient) les moyens d’agir
15.000 et 27.000 tonnes. pour améliorer la sécurité et les conditions d’existence de
580’000 familles au Burundi. Des possibilités d’actions
Suite à un coup d’Etat le 1er novembre 1976, le Burundi change concrètes sont proposées pour prendre cette direction.
complètement d’orientation : les usines privées de transformation
du café (lavage, déparchage) sont nationalisées. Un office natio-
nal (OCIBU) est créé pour gérer la commercialisation et l’exporta-
tion. L’Etat emprunte des fonds à la Banque Mondiale et construit
des routes de liaison ainsi que des stations de lavage (SDL) pour
la production de café de haute qualité (café fully washed). A tra-
vers une politique de plantation forcée, la taille du verger est
multipliée par deux et demi en quinze ans. Au milieu des années
1990, le nombre de caféiers, dépasse les 190 millions de pieds.
Le Burundi compte alors plus d’un million de caféiculteurs pour
une population totale de 5,6 millions.
4 5Café washed : café faiblement
fermenté, de moindre qualité,
Malgré cette augmentation des plantations, la production va transformé artisanalement dans
tomber, passant de 30.000-40.000 tonnes dans les années ‘80 à
15.000-25.000 tonnes par an dans les années ‘90 4. Cette baisse les ménages. A qui profite le
s’explique notamment par une extension des caféiers dans des
zones peu propices à cette culture et par une surcharge de travail
commerce du
des producteurs. Beaucoup de caféiers n’ont jamais rien donné Café fully washed : café de bonne café ?
alors que le nombre de caféiers dont les agriculteurs devaient
s’occuper était plus important. qualité soigneusement lavé dans Le travail que représente la production du café
Période de conflit
les stations de lavage est considérable. Les coûts en termes de main
d’œuvre et d’achats matériels (engrais, etc.) sont
souvent au-delà des moyens des paysans.
De 1993 à 2002 la situation va s’aggraver. La crise politique et la
guerre civile qui suivent l’assassinat du président Melchior Nda- Pourtant, comme le montre le graphique ci-des-
daye en octobre 1993 entraînent une régression de l’économie sous, ce travail est extrêmement peu valorisé.
burundaise et du secteur café. Celui-ci a été durement touché par Pour un café arabica, les producteurs reçoivent
l’abandon des caféiers liés au déplacement de population (plus moins de 4% du prix de vente final ! Les détail-
de 1,2 million de déplacés), la destruction d’usines de transfor- lants en gardent 20% et les torréfacteurs 70%.
mation, l’évacuation difficile du café, la décote du café burundais Cela signifie que lorsqu’on paie un paquet de
sur le marché, l’assassinat du personnel, etc. café à 10 francs en magasin, le producteur touche
40 centimes…
La récolte de café vert par pied, qui était supérieure à 700
grammes à la fin de la période coloniale, passe à 300g dans les Le consommateur verrait-il vraiment une grande
années 1980 et à moins de 150 grammes en 1995. Le verger différence si on doublait le prix payé au produc-
caféicole quant à lui tombe à environ 148 millions de pieds en teur ? Est-il vraiment normal que le torréfacteur
1998 soit une diminution de 30% par rapport au verger de 1991. garde 7 francs, soit 17 fois plus, alors que la va-
leur qu’il génère est avant tout symbolique, liée
Retour de la paix au marquage, à la promotion et à la publicité ?
Suite au retour de la paix observé depuis 2005, l’Etat fait des
efforts pour améliorer la culture du café. On observe cependant
toujours une régression de la culture. Entre 1998 et 2007, le
nombre de caféiers diminue encore de 17% pour atteindre 123
millions. Le contrôle du Gouvernement sur la filière semble être le
principal obstacle au redressement de celle-ci. Malgré la fragilité
d’un Etat qui ne s’est pas encore remis de la guerre et l’impor-
tance de ce secteur pour tout le pays, la privatisation est posée
comme une solution à appliquer en urgence.
Part du prix au détail à divers maillons (%)
(Exemple sur la chaîne de valeur du café haut
de gamme arabica Tanzanie –Italie, 1999-2000)
Source : Benoit Daviron, Stefano Ponté, « Le
Paradoxe du café ». Ed. QUAE, 2007.
6 4
Oxfam GB, Recherches entreprises à la demande d’Oxfam GB 7
dans le cadre d’un programme sur les moyens d’existence dans
la Province de Gitega, Burundi, décembre 2003.III. Pourquoi une réforme indispensable ?
1. La production doit être renforcée La qualité du café a également subi les conséquences des difficul- tions de leurs prestations qui ne leur permettaient souvent pas de
tés que rencontrent les paysans pour l’entretien de leurs cultures. rentrer dans leurs frais.
Depuis plusieurs années, le café se caractérise par une alternance Un cercle vicieux s’enclenche : un manque d’entretien conduit à
d’années de bonnes et de mauvaises productions, ce qu’on ap- une baisse de qualité et de rendement par plant ; cette baisse Notons toutefois que depuis la prise en mains de la gestion de la com-
pelle la « cyclicité ». Par exemple, la production est passée de conduit à une plus faible rémunération du paysan ; une faible mercialisation par les caféiculteurs et l’instauration d’une nouvelle
30.000 tonnes en 2006 à 6.000 tonnes en 2007, pour remonter rémunération décourage le paysan à consacrer plus de temps grille de répartition des revenus, ces entreprises ne connaissent
à 24.000 tonnes en 2008 et de repasser ensuite à 6.700 tonnes à cette culture (qui se fait souvent au détriment des cultures plus de déficit, même si elles continuent d’exiger des marges plus
en 2009. Les écarts de production entre deux années successives vivrières). importantes.
ont parfois atteint 85 %. On attribue cette variation notamment
à la vieillesse des plants qui n’ont pas été remplacés depuis très 3. Les usines doivent être mieux gérées 4. Les producteurs doivent être rémunérés à
longtemps, à la baisse de fertilité et la dégradation des sols ainsi hauteur de leur travail
qu’à un manque d’entretien. Au-delà des problèmes matériels que connaissent les usines suite
aux déprédations que nombreuses d’entre elles ont subi en pé- De manière générale, le paysan a été très mal rémunéré pour son
2. Amélioration de la productivité et de la riode de conflit, l’état financier de ces dernières est également travail. Il a dû accepter un prix qui lui était imposé par l’Etat et qui
qualité préoccupant. Si les comptes montrent de bons résultats pour les dépendait des humeurs du marché mondial, se retrouvant ainsi
années de bonne production, les déficits s’accumulent avec la souvent avec un revenu inférieur au coût de production.
Parallèlement au problème quantitatif (la production ne sui- baisse générale de la production et les difficultés de gestion que
vant pas la croissance du verger), les rendements atteignent rencontrent la plupart d’entre elles. Le retour de la paix ne suffit Prix sur le marché mondial
difficilement les critères de qualité espérés pour mieux se pas à rétablir la situation.
Simon Tschopp
positionner sur le marché, ceci en dépit des investissements Le marché mondial du café connait depuis longtemps une offre
dans des usines de lavage et de dépulpage visant à augmen- Pour les usines de déparchage, cet aspect est encore renforcé du qui a tendance à dépasser la demande. Cette situation fait pres-
ter la production de café « fully washed ». La qualité du café fait qu’elles ont été construites pour des capacités dépassant lar- sion sur les prix payés aux paysans.
vert connaît ainsi depuis la décennie 1990 une détérioration gement les besoins du pays. Les frais d’entretien et de gestion
constante due essentiellement à la dégradation de la qualité sont par conséquent disproportionnés par rapport à la quantité Un accord international avait été établi en 1962 pour remédier à
de la production de cerises (à cause de problèmes agrono- de café transformé. cette situation en instaurant des quotas de production par pays
miques), malgré une proportion en hausse du « fully washed » pour rééquilibrer l’offre à la demande et faire remonter les prix. A
par rapport au « washed ». On observe toutefois des premiers De nombreuses plaintes sont exprimées par les sociétés de lavage partir de 1989, avec la fin de la guerre froide, les pays importa-
signes d’amélioration à partir de l’année 2002. (SOGESTAL) et de déparchage (SODECO) au sujet des rémunéra- teurs, Etats-Unis en tête, ne voient plus d’intérêt à maintenir cet
La vaste majorité du café cultivé au Burundi est du café arabica, cultivé sur ses hautes terres des plateaux.
L’arabica est fortement recherché pour la qualité des arômes qu’il contient, mais sa production est difficile et
nécessite des conditions bien particulières. Une petite quantité de café robusta est également produite dans les
régions de basse altitude. Le robusta est plus facile à cultiver, mais également moins savoureux et moins cher.
8 9accord qui favorise l’économie des petits pays producteurs et qui L’inflation a en réalité diminué par deux le pouvoir d’achat des
avait pour but de les inciter à ne pas s’orienter vers le commu- producteurs entre les années soixantes et les années nonantes.
nisme. Par ailleurs, les pays exportateurs commençaient à avoir Depuis 2006 on constate toutefois une réelle montée des prix
de la peine à s’entendre sur les quotas à fixer par pays. Le prix du payés aux producteurs . Celle -ci est due en partie à l’envolée des
café a chuté dans le mois suivant la fin de l’accord. Or, en dehors cours mondiaux du café qui est devenu une valeur sûre de refuge
d’une période de hausse au début des années ’90 en raison de pour les spéculateurs. Mais elle reflète surtout une meilleure or-
mauvaises conditions climatiques qui ont réduit la production du ganisation des paysans qui créent la Confédération Nationale des
Brésil, le prix du café est resté très bas depuis cette période. Associations de Producteurs (CNAC).
Selon Oxfam (Comité d’Oxford contre la Faim), les saisons ca- Conclusion
féières de 2001-2002 ont rapporté au Burundi 20 millions de dol-
lars américains. Si les prix avaient été ceux d’avant la fin de l’ac- La filière du café bénéficie de moins en moins aux produc-
cord, le pays aurait gagné 48 millions de dollars, c’est-à-dire une teurs ainsi qu’au Gouvernement. Un programme de relance
différence de 28 millions de dollars qui représente presque 1/5 du est devenu indispensable pour: améliorer la qualité et aug-
budget national Burundais pour l’année 2001/2002. Beaucoup menter la quantité; permettre une meilleure rémunération des
plus que les dépenses annuelles investies dans le secteur de la caféiculteurs;augmenter les devises de l’Etat. C’est donc à travers
santé et de l’éducation. La perte de revenus annuels du Burundi tous les maillons de la filière qu’il faut intervenir.
dépasse le niveau d’investissement de la Banque Mondiale dans
le pays et égale pratiquement le montant total des aides interna-
tionales qu’il reçoit.
Prix payé par l’Etat
Au début de la campagne annuelle du café, l’Etat fixe le prix à
payer au producteur par kilo, en fonction du prix auquel il pense
pouvoir le vendre ensuite sur le marché de vente à l’exportation.
Ce prix minimum c’est généralement révélé être le prix plafond.
Jusqu’à récemment seul 41% du prix de vente à l’exportation du
café revenait au producteur. L’Etat versait parfois un deuxième
paiement lorsque les cours internationaux étaient bons, mais cela
ne compensait que maigrement la hausse.
Un changement d’importance intervient en 2007. Le président du
Burundi déclare que les caféiculteurs sont propriétaires de leur Part du café dans le total des exportations
café jusqu’au moment de l’exportation. C’est-à-dire que le café en valeur, de 1996 à 2000. Source : OIC
leur appartient toujours après les premières phases de transfor-
mation (lavage, dépulpage, déparchage). Le prix qui leur revient
n’est donc plus celui des cerises de café à l’état brut, mais celui du
café vert qui se vend directement sur les marchés internationaux.
Parallèlement à cela, les organisations paysannes arrivent à négo-
cier une nouvelle clé de répartition des revenus issus des ventes
de café. Au lieu de 41% du prix de vente qu’ils recevaient en
moyenne, les caféiculteurs sont maintenant assurés d’en recevoir
72%. Mais ces améliorations pour les producteurs sont déjà lar-
gement remises en question aujourd’hui.
Le prix aux producteurs augmente constamment, mais reste ce-
pendant très faible. Cela s’explique notamment par les faibles
prix de vente du café burundais liés à un système de vente peu
Burundi : composition du stock de la dette extérieure à fin
performant, à l’enclavement du pays et à la décote du prix du décembre 2006
café burundais à la bourse de New York (en partie a cause de la
situation conflictuelle du pays), et à la dépréciation de la monnaie Source : INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION AND
nationale (BIF) par rapport au dollar 5. INTERNATIONAL MONETARY FUND «Burundi. Joint World Bank/IMF
Debt Sustainability Analysis» 2007.
10 5
International Alert, « Prévention des conflits dans le processus de privatisation de la filière café au Burundi », juillet 2008. 11La filière café de la production à l’exportation
Production Lavage / Dépulpage Déparchage Exportation / Torréfaction Consommation
La production du café est un travail très exigent Immédiatement après la récolte, les cerises de • Après le lavage et le dépulpage, le « café parche » • Les grains verts, une fois mis en sacs, sont ex- Le café est ensuite emballé sous différentes
en terme de temps et de main d’œuvre, particuliè- café vont subir une première transformation près est acheminé vers des usines pour subir un dépar- portés vers les pays consommateurs où ils su- formes (sachets sous vide, capsules, moulu, entier,
rement lors du paillage et de la récolte. des lieux de production. chage ou un décorticage qui libère le grain de son bissent une torréfaction. soluble,...)
enveloppe. • La torréfaction consiste à chauffer les grains Il est finalement vendu pour la
La récolte des cerises de café est essentiellement La transformation primaire consiste dans les opé- à 250°. Ils perdent alors de l’eau, doublent de consommation.
manuelle. Elle est déterminante pour la qualité rations de dépulpage et de lavage du café qui • Le café sera encore nettoyé, trié par tailles, den- volume, changent de couleur et leurs arômes
future du grain. Au delà de 5% de cerises vertes, aboutissent à la production du « café parche ». sités et couleurs, et mis en sacs pour ainsi obtenir s’élaborent.
la qualité de la boisson obtenue est altérée. Elle 5 kg de cerises donnent 1 kg de « café parche ». le « café vert ». • Durant la torréfaction, le café subit en effet des
devient plus âpre et amère. Les cueilleurs ne pré- transformations physiques et chimiques détermi-
lèvent que les cerises arrivées à pleine maturité. Différentes étapes sont nécessaires : nantes pour sa qualité.
- Le dépulpage : la peau et une partie du muci- - une torréfaction légère donne un café
Ce travail, long et délicat, est fait à la main en lage de la cerise sont retirées par des dépulpeurs doux et acidulé.
plusieurs fois car les fruits ne sont jamais mûrs mécaniques. - plus les grains sont torréfiés, plus le café
en même temps (jusqu’à 5 passages par récolte). - Le lavage : il évite la prolifération de sera amer.
micro-organismes.
De plus, pour éviter les mauvais goûts, les cerises - Le séchage : le grain entouré de sa seule parche
doivent être traitées immédiatement, au maxi- est séché (séchage solaire ou artificiel). Il passe de
mum 6 heures après la cueillette. 55 à 12% d’humidité.
Usines de déparchage
Caféiers producteurs Usines de lavage
Vente pour exportateurs Consommateurs
La filière café au Burundi
Exploitations familiales Lavage - SOGESTAL Déparchage - SODECO OCIBU / Producteurs
Le producteur Burundais reçoit moins de 5 cen-
Au Burundi, la caféiculture est presque entière- Le Burundi utilise 2 systèmes de transformation Le déparchage se fait dans les deux usines appar- Pendant des années, la commercialisation était uni- times CHF pour un espresso (7g de café) que le
ment l’affaire des petits paysans qui produisent primaire : le système industriel et le système arti- tenant à l’Etat et gérées par la SODECO (une so- quement du ressort de l’Etat. consommateur paie 3,50CHF, ce qui représente
du café à partir d’exploitations familiales (moins sanal. 80 à 85% des cerises de café sont traitées ciété mixte), ou bien une usine privée. Les usines 1,3%.
d’un hectare cultivé par famille), dépassant rare- industriellement dans les stations de lavage pour de déparchage traitent le café entièrement lavé et Depuis 2008 le Comité de Commercialisation mis
ment plus de 200 caféiers par producteur. produire ce qu’on appelle le « café parche fully le semi-lavé. en place par la CNAC (Confédération nationale des
washed », c’est-à-dire un café de haute qualité. producteurs) a repris cette gestion Les ventes se dé-
Ils représentent aujourd’hui 580.000 ménages Le reste est transformé artisanalement et donne Chacune des deux usines a une capacité de 60 roulent chaque semaine dans la capitale Bujumbura,
ruraux. La récolte du café se fait de mars à mai. du «café parche washed» 000 tonnes de café parche. Récemment, deux et tout propriétaire d’une licence peut y participer.
usines plus petites, privées et en propriété coopé-
Le café fully washed de qualité supérieure se vend rative, ont été mises en fonction avec des capaci- Si le café atteint le prix de réserve fixé par le Co-
30 % de plus que le café washed 133 des 145 tés approchant chacune les 5 000 tonnes. mité, le café est vendu au plus offrant. Dans le cas
stations de lavage du pays appartiennent à l’État, contraire, le Comité le retire de la vente jusqu’aux
et elles sont gérées par des sociétés mixtes (pu- Webcor commence aussi la construction de son prochaines ventes. De là, il est transporté par bateau
bliques/privées) appelées SOGESTAL. Quelques usine de déparchage jusqu’à l’importateur
acteurs privés ont récemment construit leurs
propres stations de lavage. Depuis 2007, la SODECO est un prestataire de Le Burundi ne torréfie que 5% de sa production
services. Elle est payée selon le travail accompli.
Depuis 2007, les SOGESTAL sont des prestataires
de services qui sont payés selon le travail accompli. Le caféiculteur reste propriétaire de son café.
Le caféiculteur reste propriétaire de son café.
12 13IV. Stratégie des acteurs
1. Le processus de privatisation. Depuis 2005, la privatisation de la filière, adoptée par le stratégie qui en ressort. Le non respect des conditions posées
gouvernement de transition sur recommandation du FMI, est pro- par la Banque Mondiale supprimerait toute l’aide que celle-ci
La question de la privatisation du secteur café n’est pas récente grammée par décret. La liberté d’établissement et d’exercice dans fournit, y compris un don de 25 millions de dollars pour financer
au Burundi. Le contrôle total qu’a exercé l’Etat pendant des an- tous les maillons de la chaîne de production, de commercialisa- la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de cinq
nées a conduit à de trop nombreux abus et blocages. tion, de transformation, d’exportation et de financement dans le ans et les femmes qui accouchent.
secteur café est ainsi sacralisée. La Banque Mondiale est chargée
Par conséquent, au début des années 1990, tous les acteurs, de l’encadrement du processus Résultat, le Gouvernement démarre la réforme de la filière qui
caféiculteurs y compris, étaient d’accord de privatiser la filière. fait vivre près de la moitié de la population rurale et qui lui
Conseillé et financé par les Institutions de Bretton Woods (la 2007 : reconnaissance des droits des producteurs apporte la majorité de ses devises sur les conseils d’un bureau
Banque Mondiale et le FMI), le Burundi, comme la plupart des d’étude étranger qui n’a même pas jugé nécessaire de consul-
pays africains, initie un Programme d’ajustement structurel (PAS). Le 1er mai 2007, le Président de la République reconnaît aux ter les producteurs et leurs associations respectives. Cette
Il procède à la restructuration et à la réforme de son secteur pu- producteurs la propriété du café, depuis la production jusqu’à stratégie remet en question tous les acquis qu’ils avaient ob-
blic, dont la filière café. l’exportation. Depuis cette année, la jouissance et l’exercice tenus l’année précédente.
de ce droit de propriété par les caféiculteurs a fait évoluer
Réformes initiales : 1992-96 plusieurs processus. Les producteurs, à travers la Confédération Nationale des Asso-
ciations de Producteurs (CNAC), ont largement protesté, mais
En 1992, le gouvernement Burundais s’est engagé dans une pri- Les usines de lavage (SOGESTAL) et de déparchage (SODECO) leurs revendications n’ont pas été écoutées.
vatisation limitée du sous-secteur café en se retirant de la gestion travaillent désormais comme des prestataires de services et le
directe. La responsabilité des opérations pour les 133 stations café est commercialisé par un comité de commercialisation mis Pour les caféiculteurs, les principales conséquences sont :
de lavage appartenant au gouvernement est alors confiée à cinq en place par les caféiculteurs/propriétaires ;
sociétés de gestion publique et privées, les Sociétés de gestion • La perte du droit de propriété sur le café dès le lavage
des stations de lavage (SOGESTAL), chacune responsable de 27 • Les caféiculteurs négocient directement (sans intermédiaires)
stations de lavage en moyenne, dans l'une des cinq régions produc- avec les acheteurs internationaux à travers leur comité de com- • La perte de contrôle sur le prix de vente de leur propre
trices : Ngozi, Kayanza, Kirimro, Kirundi-Muyinga et Mumirwa. mercialisation ; production
Quant à la deuxième phase de transformation, le déparchage, • Les caféiculteurs négocient des crédits localement ; • Le passage de la propriété des usines, qu’ils ont aidé à financer,
la gestion des deux usines étatiques est confiée à la Société de à des multinationales étrangères
déparchage et de conditionnement (SODECO). • Une innovation a été introduite dans la vente du café burundais:
le système des ventes directes (plutôt que des ventes à terme sur 2.La stratégie de la Banque Mondiale
Il ne s’agit toujours que d’un premier pas vers la privatisation. Les enchères);
usines de lavage et de déparchage appartiennent toujours à l’Etat Le modèle appliqué au Burundi par la Banque Mondiale n’a rien
et les employés sont des fonctionnaires. • Les différentiels se sont nettement améliorés avec une influence d’innovant ni de spécifique. Lorsqu’elle intervient dans un pays, la
positive sur le prix au producteur ; Banque Mondiale arrive avec une vision prédéfinie. Elle se centre
Suspension des réformes : 1996-2000 sur les aspects macro-économiques, élabore de grands projets,
• Le producteur profite pleinement des recettes de son café choisit des bureaux d’étude venant du Nord, se centre sur les
Un coup d’Etat mené par Pierre Buyoya en 1996 conduit le pays jusqu’à un pourcentage de 72% aspects techniques. Ayant une position très forte et une longue
à être sanctionné par un embargo économique. Cette situation expérience, elle arrive avec une grande confiance en elle.
touche durement la commercialisation du café et entraîne des 2008 : les producteurs mis à l’écart
pertes financières importantes pour les entreprises de la filière. La stratégie qu’elle applique au Burundi est en tout point iden-
L’instabilité institutionnelle de cette période provoque l’arrêt de Jusqu’ici, la mise en application de la privatisation est restée tique à celle qu’elle mène depuis des décennies dans la majeure
la plupart des réformes économiques que le pays avait entamées limitée, l’Etat demeurant le principal acteur. Les bailleurs de fonds partie des pays où elle intervient et qui avait d’abord pris le nom
avec le programme d’ajustement structurel. En outre, la plupart internationaux mettent alors la pression pour accélérer la vente de Programme d’Ajustement Structurel (PAS) :
des bailleurs de fonds suspendent leur assistance technique et des usines, qui semble être à leurs yeux plus importante que de
financière au pays. trouver la meilleure stratégie pour redresser la filière. Le rapport • Retrait complet de l’Etat et vente des actifs. Le gouvernement
d’achèvement du Programme d’appui aux réformes économiques obtient ainsi des rentrées financières directes et est dégagé de
Reprise des mesures de privatisation : dès 2000 (2008) mentionne ainsi que la vente de 50% des stations de ses responsabilités. Il perd toutefois une possibilité importante de
lavage exigée n’a pas pu se faire car aucune stratégie de privati- revenus en cas de redressement de la filière. Il ne peut plus assurer
Après l’accord de paix d’Arusha, signé en septembre 2000, la sation n’avait encore été définie! 6 aux producteurs un prix minimum qui leur permette de vivre
Banque Mondiale, le FMI et l’Union Européenne reprennent de leur travail.
leur coopération économique avec le Burundi. Un Cadre stra- Le gouvernement se retrouve obligé de demander un délai sup-
tégique de croissance et de lutte contre la pauvreté intéri- plémentaire à la Banque Mondiale. Le délai est accordé, mais • Favoritisme envers les gros investisseurs étrangers, ce qui per-
maire (CSCLP-I) est adopté. La réforme du secteur café est le Gouvernement n’a plus de marge de manœuvre. Il doit com- met d’injecter de l’argent frais et d’assurer que tout sera fait pour
l’une des conditions mises en avant par le FMI et la Banque- manditer une étude à un Groupe international (Marlagne Capi- garantir la rentabilité. Le Burundi perd toutefois la plus-value de
Mondiale qui permet au Burundi d’accéder à l’initiative Pays tal Advisers, AGRER et EUREKA Consulting) pour définir la stra- la transformation de la matière première, qui revient directement
Pauvres Très Endettés (PPTE) pour un allégement de dette. tégie de mise en œuvre de la privatisation et doit adopter la aux multinationales. Les producteurs sont déresponsabilisés et
14 6
République du Burundi, Fonds Africain de Développement, Programme d’appui aux réformes économiques phase I (PARE) : Rapport d’achèvement. Octobre 2008. 15perdent toute marge de manœuvre. La dénomination PAS a été au lancement d’un nouvel appel d’offre pour les 103 stations de
abandonnée suite au flot de critiques que ces programmes ont lavage publiques restantes.
reçu. L’inéficacité de ces mesures pour assurer le développement
des pays et les larges effets négatifs qu’ont subi les populations 3. Le rôle des multinationales
déjà fragilisées en sont les principales causes. Si on ne parle pas
actuellement de programme d’ajustement structurel au Burundi, Crise du café et baisse des cours mondiaux ne signifient par for-
la stratégie qui est appliquée pour réformer la filière café sous le cément baisse des revenus pour tout le monde. Depuis la fin des
suivi, les recommandations et la pression de la Banque Mondiale, années 80, la tendance mondiale dans le secteur café est une di-
n’en est pas pour autant différente. Les termes ont changé mais il minution des revenus du café dans les pays producteurs par rap-
n’ont fait qu’édulcorer sur le papier les mêmes projets. port aux pays consommateurs. Ainsi, entre 1980 et 1989, les pro-
ducteurs contrôlaient encore 20% du revenu total, contre 55%
Sur le terrain, on constate que: pour les pays consommateurs. Entre 1989 et 1995, la part perçue
par les producteurs s’effondra à 13% alors que celle retenue par
• La population du Burundi ne vient qu’en arrière plan d’une les pays consommateurs grimpait à 78%. On estime que cette
stratégie proposée par un bureau d’étude essentiellement étran- tendance s’est encore aggravée.
ger premier signe d’un don financier qui retourne directement
au Nord. Une multinationale comme Webcor qui rachète les usines de la-
vage au Burundi et qui investit dans la construction d’une usine
• Le Gouvernement est amené à lancer un appel d’offres interna- de déparchage, supprime toute opportunité au pays d’augmenter
tional en 2009 pour la vente de 117 stations de lavage en 26 lots sa part de revenu dans la chaîne.
et 2 lots d’usines de déparchage. Les conditions de l’appel d’offre
excluent de fait tout opérateur burundais. Les candidats doivent L’achat des usines de lavage est un enjeu particulièrement impor-
notamment disposer d’un compte qui accuse pendant trois ans tant du fait qu’elle donne la possibilité de fixer le prix d’achat
un solde de 1 million de dollars. Aucun opérateur burundais ne aux producteurs. Il est presque impossible pour les caféiculteurs
remplit ces conditions.. Finalement, la première vente a été attri- de faire jouer une éventuelle concurrence entre les usines car ils
buée à la société Webcor, basée à Genève, qui possède désormais doivent acheminer leurs cerises de café en moins de 6 heures
13 stations. sous peine de voir leur qualité se dégrader. La priorité d’une mul-
tinationale étant d’offrir la meilleure plus-value possible à ses
• Pour la Banque Mondiale, la manière de faire participer les pro- actionnaires, et non aux paysans, elle fixera logiquement le prix
ducteurs est de leur proposer de devenir co-propriétaires des sta- minimum qu’elle estime nécessaire. Vendre les usines à des mul-
tions de lavage, en leur laissant la possibilité d’acheter jusqu’à tinationales étrangères conduit donc à une pression vers le bas
25% des actions des usines (mais la multinationnale peut les des prix payés aux producteurs et favorise le transfert d’argent
racheter si les caféiculteurs n’ont pas pu le faire en deux ans). vers le Nord.
Une réponse qui semble en décalage total avec les réalités des
paysans et qui ne leur permet même pas d’avoir une quelconque La société Webcor tire par ailleurs directement profit de l’argent
influence sur les décisions. de l’aide au développement. Alors qu’en 2008, l’Union Euro-
péenne injecte 19 millions d’euros du Fonds STABEX pour la ré-
Même si la rentabilité de la filière s’améliore, quelle part revien- novation de 145 stations de lavage et des pistes de desserte du
dra aux producteurs et quelle part bénéficiera aux entreprises du café (soit une moyenne de 130.000 dollars par station), en 2009,
Nord? La première vente des usines à Webcor (qui achète le café la multinationale Webcor obtient 13 stations au prix nettement
aux producteurs et le revend sur le plan mondial) a déjà conduit inférieur de 75.000 dollars en moyenne. S’agit-il d’aide au déve-
à de sérieux problèmes. : loppement ou de subvention à une entreprise du Nord ?
• La CNAC a déposé une plainte pour vice de procédures lors de la 4. Rôle du gouvernement
vente. Le Ministère Public a lui-même recommandé la suspension de la vente
des usines et l’arrêt du transfert de propriété des stations vendues à Webcor. Malgré sa forte dépendance envers d’une part les revenus du sec-
Ses recommandations n’ont toutefois pas été suivies. teur du café et d’autre part les bailleurs de fonds étrangers, le
gouvernement ne doit pas perdre de vue ses responsabilités et
• Ayant payé le café aux producteurs 40% de moins que les son rôle. Un Etat souverain doit se prononcer sur les conditions
usines étatiques, la multinationale a dû demander au Gouverne- liées d’un don. C’est à lui d’imposer la participation des produc-
ment d’assurer physiquement la protection des usines qu’elle a teurs. Le fait que la Banque Mondiale conditionne des dons à
achetées, de peur que des émeutes conduisent à leur déprédation. but sociaux à l’application de sa propre stratégie de privatisation
viole la souveraineté nationale et ne devrait pas être accepté.
• Alors qu’aucune solution n’a encore été trouvée (les paysans
refusent maintenant de vendre leur production à Webcor), la La situation actuelle empêche le gouvernement de développer et de dé-
Banque Mondiale conditionne encore une fois son appui financier fendre sa propre politique. Il n’arrive tout simplement pas à jouer son rôle.
16 17V. Revendications des cafeiculteurs
5. Les problèmes posés par cette stratégie Les caféiculteurs sont mis en marge et, alors même qu’ils ont Les revendications des caféiculteurs sont portées par des associa- de garantie des caféiculteurs pour la promotion de la filière.
de privatisation de la peine à obtenir des prix rentables pour leur travail, on leur tions de la société civile actives dans le domaine.
demande de payer une deuxième fois des usines qui seront en (voir encadré page suivante) • Ne pas contraindre les caféiculteurs à vendre leur produit uni-
La dépendance majorité en mains étrangères. quement à l’état de cerises, mais de permettre aux organisations-
Un appel au changement. coopératives de vendre leur café à l’état parche, mais aussi vert
La stratégie ne résout pas le problème de la dépendance du pays La propriété de la terre (Prestations de services).
envers la seule culture du café. Une solution doit être trouvée La gestion de la filière par l’Etat a montré ses limites et une ré-
pour que les Burundais puissent bénéficier de cette culture sans Lors de la construction des usines, les paysans ont été expro- forme doit être menée. Les caféiculteurs n’ont jamais été contre • Sécuriser les caféiculteurs au niveau des prix en assurant
en être totalement dépendant. Mais dans un premier temps il faut priés des terrains par l’Etat pour cause d’intérêt public. Mais la loi la privatisation mais ils contestent la manière dont elle se déroule. une clé de répartition équitable entre les différents interve-
agir pour que les privatisations en cours actuellement puissent burundaise stipule que si le terrain n’est pas utilisé dans ce but, La réforme proposée par la Banque Mondiale ressemble davan- nants de la filière.
leur être directement bénéfique. les propriétaires ont le droit de les reprendre. Webcor ne peut tage à système de transfert d’argent vers le Nord qu’à un déve-
en aucun cas être considéré comme relevant de l’utilité publique. loppement en faveur des paysans du Burundi. • Elaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de
Les caféiculteurs mettent en avant des problèmes de fonds L’entreprise est pourtant en train d’obtenir les titres de propriété renforcement des capacités des organisations (coopératives)
auxquels conduit la privatisation telle qu’elle est appliquée des terrains sur lesquels elle a acheté des usines, ceci au détri- Aujourd’hui les caféiculteurs revendiquent la pleine propriété des caféiculteurs.
aujourd’hui. ment des propriétaires locaux. Le risque d’un sérieux conflit fon- sur leur café, des parts importantes dans les entreprises et une
cier se profile. participation active et réelle dans les décisions de la filière. La • Arrêter la vente des terrains sur lesquels sont construites les
La propriété du café Confédération nationale des producteurs de café (CNAC) pose stations de lavage et prendre en compte leur propriétaires d’ori-
ses revendications pour améliorer les conditions de vie des pay- gine, comme le mentionne la loi.
Sur décision du Gouvernement, depuis 2007, le café restait la sans et les remotiver à produire un café de qualité, principal
propriété des producteurs jusqu’à l’exportation. Les usines de atout du pays.
transformations agissaient comme prestataires de services. Les
caféiculteurs avaient ainsi plus de responsabilités, plus d’in- Les revendications
fluence sur les prix et pouvaient obtenir une plus grande plus-
value. Ils s’organisaient de mieux en mieux pour gérer cette res- • Le gel du second appel d’offre pour la vente des stations aux
ponsabilité. La stratégie actuelle redonne la propriété du café aux multinationales extérieures, tant que les acteurs concernés ne se
multinationales dès la première étape de transformation. Les pro- sont pas concertés quant à la meilleure stratégie de privatisation
ducteurs doivent de nouveau accepter le prix qui leur est proposé, à mettre en œuvre. Malgré un allégement de la dette
même s’il ne couvre pas leurs coûts de production. Le caféiculteur de 226 milions de dollars en 2004,
retombe dans la situation qu’il avait durant la colonisation. • Que la Banque Mondiale revoie les conditions de soumission
aux appels d’offre, qui excluent de fait les caféiculteurs burun- la dépendance du Burundi face
L’amélioration de la production dais, non seulement du processus de décision, mais aussi de à l’aide ne fait qu’augmenter.
l’acquisition de stations.
Au moment d’adopter la stratégie de privatisation, le Conseil des
Entre 2000 et 2005, les recettes
ministres émet plusieurs recommandations, soulignant que celle- • Que l’Etat burundais et ses partenaires reconnaissent la pro- de l’Etat passent de 86,6 à 141,
ci ne prend pas en compte la question de la relance de la produc- priété des stations aux caféiculteurs, qui les ont remboursées via 5 milliards de francs burundais
tion, sur le déclin depuis plusieurs années. Ces recommandations la taxe prélevée par l’Etat sur le prix de leur café.
n’ont pas été suivies. Peu considérés, mal rémunérés et mal enca- (équivalent au US dollar) pendant
drés, les producteurs pourraient abandonner la culture du café. • La CNAC appelle également de ses vœux une stratégie alter- que les dons passent de 15, 9 à
Les jeunes Burundais tentent de s’orienter vers d’autres cultures. native de la part de l’Etat burundais et de la Banque Mondiale
Des mesures sont nécessaires pour éviter l’abandon de la prin- qui permettrait de dégager des moyens pour appuyer les paysans
103 milliards.
cipale ressource économique du pays. pour améliorer la productivité de la filière.
L’aide extérieure ne suffit pas à
La propriété des usines • La révision de la stratégie actuelle de privatisation pour intégrer
toutes leurs préoccupations. combler la totalité du trou bu-
Les usines sont vendues à des sociétés étrangères. Les caféicul- gétaire. les intérêts de la dette
teurs ont le droit d’acquérir 25% des actions, dans un délai de Et plus précisément :
deux ans. Ceux-ci considèrent pourtant avoir déjà payé bien plus
triplent quasiment, passant de
que cette part à travers une taxe sur la vente qui leur a été impo- • Reconnaitre les organisations des producteurs comme des opé- 11, 8 à 31, 8 milliards. Le gou-
sée (en plus des impôts payés par tous les Burundais) depuis plus rateurs économiques incontournables dans la filière café. vernement ne peut tout simple-
de dix ans. Cette taxe était spécifiquement destinée au rembour-
sement de la dette contracté par l’Etat auprès de la Banque Mon- • Pour les stations de lavage une part réservataire de 51% est ment plus fonctionner sans aide,
diale pour la construction des stations de lavage et l’extension du réclamée pour pouvoir influencer la politique/la gestion de ces et plus particulièrement celle de
verger caféicole. D’après le service du patrimoine de l’OCIBU le stations de lavage.
montant total des prélèvements s’élève à près de 12 milliards de
la Banque Mondiale.
francs burundais. • Transformer le Fonds de Stabilisation (réserves constituées lors
des années de bonnes récoltes) et les autres fonds, en un fonds Chiffres: République du Burundi, Ministère de la pla-
nification, du développement et de la reconstruc-
tion nationale, «Economie burundaise 2005»
18 19
Décembre 2006Vous pouvez aussi lire