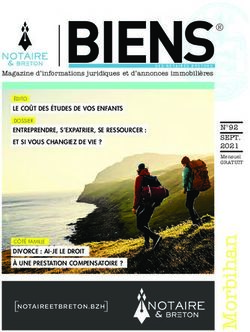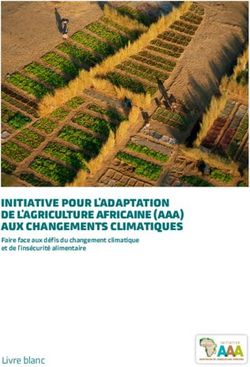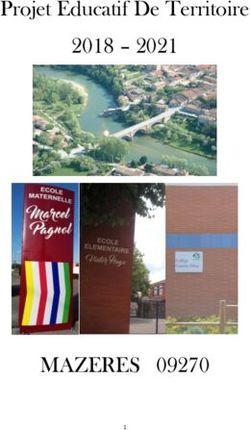LIVRET METEO " Atelier météo et énergie "
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Appel à projets de Promotion de la Culture Scientifique et Technique
« Atelier météo et énergie »
LIVRET METEO
Réalisé par :
Forum des Jeunes pour la Promotion du Développement (FOJEPDE)
BP : 30286 Yaoundé-Cameroun
Tél.: (00237) 99 44 20 93/ 77 48 93 76/ 99 19 28 58
Janvier 2008Sommaire
Introduction ……………………………………………….2
I- Climat et Changements climatiques ……………3
II- Quelques phénomènes météorologiques
et leur formation…………………………………4
III- Mesures des paramètres météorologiques ……...5
IV- Fonctionnement des appareils de mesures
rencontrées dans les stations météorologiques….6
V- Album photo atelier météo …………………….15
VI- Lexique météorologique ……………………….18
Quelques références ……………………………………..27
Et pour en savoir plus ……………………………………28Introduction La météorologie est la science des phénomènes atmosphériques qui déterminent le temps. Elle a pour but de connaître l’état de l’atmosphère terrestre, de comprendre les phénomènes qui s’y déroulent, de décrire le temps qu’il fait et de prédire le temps qu’il fera. A partir de cette définition, on peut à tord ou à raison penser que la météo est inaccessible pour la plupart des jeunes collégiens. Pourtant, sans entrer dans les subtilités les plus complexes, il est possible pour eux de comprendre un bon nombre de phénomènes météorologiques qu’ils rencontrent dans la vie courante. Ceci les empêcherait de recourir aux méthodes peut orthodoxes telles les pratiques magico religieuses, et de développer en eux les bases d’une compréhension de la nature sous la houlette d’une solide logique cartésienne. Dès lors l’initiative du FOJEPDE peut à juste titre être qualifié de prométhéenne car elle s’inscrit dans une perspective de vulgarisation et de démystification à la fois de l’univers de la science météorologique et celui très conjecturé du fonctionnement climatique. Le présent livret, qui fait suite aux ateliers météo organisés par le FOJEPDE à Yaoundé, Douala et Bafoussam, se donne pour principales ambitions de permettre aux différents participants d’en conserver le maximum de connaissance, de mieux comprendre l’utilisation des différents appareils de mesures rencontrés dans les stations météorologiques, de ne plus être surpris face à la manifestation des phénomènes météorologiques et d’assurer la maintenance d’une station de mesures, car ayant compris le principe de fonctionnement des appareils de mesure.
« Atelier météo&énergie » FOJEPDE
I- Climat et Changements climatiques
Le climat est l’ensemble des phénomènes météorologiques
terrestres caractéristiques d’une région et moyennés sur
plusieurs décennies. Le mot climat vient du grec klima, qui fait
référence à l’inclinaison des rayons solaires par rapport à la
surface de la Terre. Cette étymologie souligne le rôle moteur
que joue le rayonnement solaire incident et l’énergie reçus par
notre planète. En fonction de celle-ci, nous avons plusieurs
types de climat correspondant aux grandes zones terrestres. Les
04 grands types de climat sont : le climat équatorial, le climat
tropical, le climat tempéré et le climat polaire.
Le principal facteur qui influence le climat est le soleil, car ce
dernier est la source d’énergie qui alimente la manifestation
des phénomènes atmosphériques. Comme autre facteur du
climat, nous pouvons également évoquer la position
géographique qui détermine la quantité d’énergie reçue par
l’espace géographique du soleil. Les zones intertropicales
reçoivent par exemple plus d’énergie solaire que les zones
polaires, tout simplement parce que les rayons solaires y
arrivent verticalement. Le relief est un autre facteur du climat ;
en effet, la pression atmosphérique, les précipitations et la
vitesse du vent sont fonction du type de relief qui caractérise
une région donnée.
On entend par changement climatique la variation anormale
des paramètres qui caractérisent le climat d’une région. En
particulier, le réchauffement climatique est l’augmentation
anormale de la température. Ce réchauffement anormal est
essentiellement dû aux activités humaines, qui perturbent le
climat. Les rejets atmosphériques anthropiques sont la
principale cause d’accentuation de l’effet de serre, qui tend à
augmenter significativement la température moyenne terrestre
3Livret météo
et diminue la couche d’ozone qui arrête une grande partie des
rayons ultraviolets solaires, nocifs pour le règne animal. Cette
couche est située dans la stratosphère, vers 40 km d’altitude.
Elle est formée par des réactions photochimiques (combinaison
d’oxygène moléculaire (O2) et d’oxygène atomique (O)),
catalysées par le rayonnement solaire. Plusieurs phénomènes
visibles sont aujourd’hui imputables au changement
climatique. Nous pouvons citer entre autre les perturbations de
délimitation des saisons, la diminution des pluies, la
manifestation à des fréquences inhabituelles des cyclones,
l’augmentation du niveau de la mer, les échecs dans la
prévision du temps, etc.
II- Quelques phénomènes météorologiques et leur
formation
La pluie est une précipitation d’eau atmosphérique sous forme
de gouttes, résultat de la liquéfaction de la vapeur d’eau
contenue dans l’air atmosphérique sous l’effet de son
refroidissement. Le nuage qui se forme ne donne des pluies
qu’avec l’accroissement de la taille des gouttelettes, qui ne
peuvent plus alors rester en suspension. Le refroidissement de
l’air peut être obtenu de trois manières différentes :
- suite à une ascension par convection naturelle, l’air
chaud, moins dense monte et rencontre une zone plus
froide (car la température diminue avec l’altitude);
- les structures montagneuses peuvent changer la
direction d’un vent humide et lui donner une direction
verticale ascendante. L’air chaud se déplaçant vers une
région plus froide se refroidit ;
- à la rencontre d’un vent venant en sens opposé, l’air
chaud monte et se refroidit.
L’orage est un ensemble de manifestations atmosphériques des
systèmes nuageux de grandes dimensions, caractérisées par la
4« Atelier météo&énergie » FOJEPDE
présence simultanée des nuages, des pluies violentes, de la
grêle, éclairs, tonnerre, rafales de vent.
L’éclair est un phénomène lumineux intense et bref qui
accompagne une décharge électrique d’orage dans
l’atmosphère. Les éclairs peuvent se produire dans un nuage,
entre deux nuages ou entre un nuage et le sol.
Le Brouillard est un mélange d’air humide et de gouttelettes
d’eau en suspension dans l’atmosphère, tout près du sol.
La neige est une précipitation de cristaux de glace agglomérés
en flocons, dont la plupart sont ramifiés, parfois en étoile.
La prévision de ces phénomènes se fait après une étude des
mécanismes de base qui conduisent à leur formation ou leur
manifestation, en se basant essentiellement sur les principes de
continuité spatiale et temporelle et sur le caractère déterministe
de la physique. Ces études ont comme support de longue série
de données provenant de plusieurs stations basées au sol.
III- Mesures des paramètres météorologiques
On appelle paramètre météorologique toute grandeur physique
mesurable ou observable, dont la connaissance peut apporter
un renseignement sur l’état de l’atmosphère.
Les observations les plus répandues s'effectuent dans des
stations météorologiques. L'équipement de base est l'abri
météorologique installé dans un lieu dégagé. Placé à 2 m au-
dessus du sol, il renferme des instruments de mesure
homologués, protégés des rayons solaires et de l'agitation du
vent. Ce sont les thermomètres à minima et à maxima, qui
marquent la température la plus basse et la plus élevée de la
journée ; le thermographe, qui enregistre les variations de la
température au fil des heures, des jours, des semaines ;
5Livret météo
l'évaporomètre, qui mesure la hauteur d'eau évaporée ;
l'hygromètre ou psychromètre qui, par la température de l'air
sec et de l'air humide, indique l'humidité de l'air, tandis que
l'hygrographe enregistre les variations du taux d'humidité ; le
barographe ou baromètre enregistreur signale les variations de
la pression. À proximité de l'abri météorologique se trouvent
un pluviomètre et un pluviographe qui mesurent les hauteurs
d'eau précipitées, une girouette qui indique la direction d'où
vient le vent, un pyranomètre qui mesure le rayonnement
solaire, un anémomètre qui en mesure la vitesse et un
héliographe qui enregistre la durée d'insolation quotidienne. La
nébulosité, exprimée en octas ou huitièmes de ciel couvert, doit
être appréciée par l'observateur au moment des relevés.
L'Organisation Météorologique Mondiale repose sur le relevé
et la collecte des mesures au même moment partout dans le
monde et dans les mêmes conditions. Dans les stations de base,
les mesures courantes (température, pression, humidité,
nébulosité, etc.) sont effectuées toutes les 6 heures (0 h, 6 h,
12 h, 18 h) en temps universel (heure du méridien de
Greenwich).
IV- Fonctionnement des appareils de mesures
rencontrées dans les stations météorologiques
En plus des méthodes numériques qui permettent de
conjecturer l’évolution de l’état atmosphérique vers un futur
proche, les mesures des paramètres météorologiques sont un
support indéniable dans les prévisions météorologiques. Les
prévisions seront donc de bonne qualité si les données utilisées
le sont aussi. La qualité des données est par ailleurs
directement fonction de celle des appareils de mesure. C’est
pour cette raison que les appareils utilisés dans les stations de
mesure doivent être bien étalonnées, et avoir une précision
jugée acceptable par l’Organisation Météorologique Mondiale.
6« Atelier météo&énergie » FOJEPDE
Dans ce qui suit, nous présenterons quelques appareils
couramment rencontrés dans les stations météorologiques.
Abri météorologique
L'abri météorologique réalise
l'équilibre thermique du thermomètre
avec l'air, en minimisant les échanges
avec des sources de chaleur ou de
froid qui pourrait fausser la mesure
(par ses parois latérales et
supérieures), il protège également le
thermomètre du rayonnement solaire
qui le réchaufferait. Pour éviter au
mieux la pénétration des rayons
solaires, ses portes d'accès doivent
s'ouvrir au NORD dans l'hémisphère
Nord et au SUD dans l'hémisphère Sud.
Thermomètre à maxima-minima
Un thermomètre à maxima-minima indique la
température la plus haute et la température la
plus basse de la journée ainsi que la
température à l'instant du relevé. Le mercure
contenu dans le réservoir repousse devant lui
deux index colorés qui restent bloqués par le
frottement contre la paroi lorsque la colonne de
mercure se retire.
Le minimum atteint se lit donc à la base de
l'index de gauche ( -10°C sur le schéma) et le
maximum atteint se lit à la base de l'index de
droite ( +35°C sur le schéma). La température à l'instant du
relevé se lit au sommet de la colonne de mercure à droite ou à
7Livret météo
gauche ( +23°C sur le schéma). Après chaque relevé, on
ramène les index au contact du mercure. Suivant le modèle,
- on les déplace avec un aimant
- on appuie sur un bouton poussoir qui écarte la paroi.
Les index redescendent sous leur propre poids.
Thermomètre simple :
Le thermomètre est sans aucun doute l'instrument
météorologique le plus utilisé. Le principe de
fonctionnement d'un thermomètre utilise la propriété
qu'ont certains corps de se dilater ou de se contracter
suivant la température.
Il existe des thermomètres à alcool (peu précis), à
mercure (précis mais coût plus élevé), à bilames
(peu précis) et enfin, les électroniques (précis et coût
variable). Certains d'entre eux existent en
enregistreur. (thermographe)
Hygromètre :
L'hygromètre permet d’effectuer la mesure
de l’humidité. Il convient toutefois de
distinguer l'humidité absolue
(correspondant à la masse d'eau contenue
à un moment donné dans un certain volume
d'air) et l'humidité relative (pourcentage
correspondant au rapport entre le poids
d'eau existant et le poids d'eau limite que
pourrait contenir la masse d'air). Il existe
plusieurs types d'hygromètres. Le plus simple étant
l'hygromètre à cheveux (présenté sur la figure ci-dessus) puis
l'hygromètre électronique, tous deux permettant une lecture
directe de l'humidité relative. Le principe de l'hygromètre à
cheveux repose sur la propriété qu'ont les cheveux humains et
plus particulièrement les cheveux féminins naturellement
blonds de s'allonger quand l'humidité relative est élevée et
inversement. Comme le capteur est une mèche de cheveux
8« Atelier météo&énergie » FOJEPDE
morts, l'hygromètre doit être étalonner tous les six mois.
Il existe un autre type d'instrument pour mesurer ou évaluer
l'humidité de l'air : le psychromètre.
Le psychromètre, qui est une combinaison
entre un thermomètre sec et un autre humide,
peut être utilisé, mais un calcul (ou l'utilisation
d'une table psychrométrique) est nécessaire
pour en déterminer l'hygrométrie.
Baromètre :
Il existe 3 types de baromètres :
baromètres avec colonne de mercure,
baromètres anéroïdes et baromètres
électroniques. Le baromètre permet
de mesurer la pression
atmosphérique. Il en existe différents
modèles. Le plus ancien, le
baromètre de Torricelli, était
constitué d'un long tube rempli de
Baromètre anéroïde mercure retourné sur une cuve
contenant du mercure. Le plus
couramment utilisé est le baromètre anéroïde. Il est constitué
d'une boîte métallique vidée de son air qui se déforme plus ou
moins selon la valeur de la pression atmosphérique. L'unité
utilisée pour mesurer la pression atmosphérique est
l'hectopascal (hPa). On utilise parfois le millibar ( 1 mbar =
1hPa). La pression atmosphérique " normale ", au niveau de la
mer, vaut 1013 hPa. Si elle augmente on parle alors
d'anticyclone, signe de beau temps. Si elle diminue, on parle
alors de dépression, signe de mauvais temps. La météorologie
s’intéresse plus à la variation de pression (dans un intervalle de
temps connu), que la valeur absolue de la pression.
9Livret météo
Pluviomètre
Un pluviomètre permet de mesurer la quantité
d'eau tombée en un lieu donné et pendant une
durée donnée. Il est constitué :
· D'un entonnoir ou cône de réception
· D'un réservoir gradué en " mm de
précipitations"
Les précipitations solides sont mesurées après
qu'elles aient fondu. Certains pluviomètres sont
munis d'un dispositif de "pré-chauffage"
permettant entre autre, de faire fondre la neige ou la grêle avant
d'effectuer la mesure.1mm de précipitations correspond à 1 L
d'eau par m2. Le pluviomètre doit ne recevoir que l'eau tombée
du ciel et non celle qui pourrait s'égoutter des arbres, d'un toit
ou projetée par rebondissement sur le sol. Sans quoi, toute
mesure ne serait plus significative. L'emplacement idéal serait
de le maintenir sur un piquet à une hauteur d'au moins 1 mètre
et dans un endroit parfaitement dégagé et plat.
Girouette
Une girouette permet de connaître la direction du
vent. Elle doit être au préalable orientée avec une
boussole. La direction du vent à considérer n'est
pas celle observée au sol mais plutôt sa direction en
altitude. Les vents au sol subissent une déviation et
un freinage, dus aux frottements de l'air sur la
surface terrestre et à la rotation terrestre. Girouettes
et anémomètres sont donc installés le plus haut possible.
Anémomètre
Un anémomètre mesure la vitesse du vent. Cette
vitesse peut s'exprimer dans différentes unités : - en
échelle Beaufort (graduée de 0 à 12) - en m/s - en
km/h - en nœuds 1 nœud = 1,85 km/h = 0,514 m/s.
10« Atelier météo&énergie » FOJEPDE
Evaporomètre
Il permet d'évaluer l’importance de
la vitesse d’évaporation d'un volume
d'eau donné (exprimée en mm par
jour, par mois ou par an). Le pouvoir
évaporant de l'air est mesuré par
l'intermédiaire d'une surface
normalisée imbibée d'eau.
Pyranomètre
Le pyranomètre est constitué
d’une thermopile comportant
plusieurs pseudo thermocouples
de type cuivre constantan. Ils
mesurent la différence d’énergie
reçue par une surface noire et une
blanche. Une coupelle en verre
limite la perte de chaleur par
convection et les effets perturbateurs du vent. Ce dispositif
accroît les fuites thermiques vers le boîtier et évite un
échauffement trop important de la thermopile. Une cartouche
contenant un produit desséchant (Silicagel par ex.) se fixe sous
la surface réceptrice de l’instrument. Il limite la condensation
interne sur la coupelle qui entacherait les mesures.
La bande spectrale de mesure correspond à l’ensemble des
longueurs d’onde émises par le Soleil et reçues par la surface
de la Terre. Cette gamme couvre du rayonnement visible à
l’infrarouge thermique. Les données horaires sont le résultat
d’une intégration dont le pas de l’échantillonnage est de 5
secondes. Il doit être installé dans un endroit dégagé, sans
obstacle projetant son ombre sur le capteur et loin d’un mur
blanc qui réfléchi le rayonnement solaire. Il est installé sur un
mât de 1.5 mètre environ. Un niveau à bulle solidaire du corps
de l’instrument permet de surveiller l’horizontalité. Elle est
réglée à l’aide de vis de calages à molette.
11Livret météo
Héliographe
L’héliographe Campbell-Stokes se
compose essentiellement d'une
sphère de verre de 0,10 m de
diamètre fixée concentriquement
sur un support de forme circulaire.
Celui-ci est muni de trois paires de
rainures dans lesquelles une bande
de carton spécial peut être passée.
Elles permettent d'installer la
bande de carton à différents niveaux en fonction de la saison.
Lorsque le soleil brille, son image se forme sur la bande de
carton qui est carbonisée à cet emplacement. Comme la Terre
tourne, on a pas besoin de mouvement mécanique sur l’appareil
: la lumière qui passe par une fente se déplace régulièrement et
quand il n' y a pas de soleil, la feuille reste vierge. Les bandes
sont graduées en heures et le dépouillement des données
consiste à mesurer la longueur des traces et à les convertir en
temps. Ce type de mesure est relativement imprécis car la
combustion du carton est possible à différents degrés et loin
d'être toujours évidente à discerner. On distingue également
des héliographes automatiques. Certains sont constitués de
deux cellules photovoltaïques dont l'une reçoit le rayonnement
solaire global et l'autre uniquement le rayonnement diffus grâce
à un écran. Lorsque le soleil est présent, les deux cellules
délivrent des signaux déséquilibrés, suivant une valeur seuil
donnée.
Thermographe
Cet appareil est utilisé pour
enregistrer l'évolution des
températures en fonction du
temps. Le thermographe
utilise en fait un bilame
métallique dont l'une des
extrémités est reliée à une pointe feutre qui inscrit les
12« Atelier météo&énergie » FOJEPDE
variations de température sur un diagramme, lui même enroulé
sur un cylindre tournant, mû par un mouvement d'horlogerie.
Hygrographe
L'hygrographe utilise la propriété de
certaines molécules organiques
(comme la kératine des cheveux) qui
se dilatent ou se rétractent en
fonction de l'humidité relative
ambiante. Une mèche de cheveux est
fixée sur un support par une
extrémité. L'autre extrémité mobile,
est reliée à un mécanisme qui en
amplifie les variations de
mouvement. Un stylet, asservi à
l'ensemble, inscrit les variations
d'humidité sur un diagramme, lui même enroulé sur un cylindre
tournant, mû par un mouvement d'horlogerie (ensemble
mécanique similaire à celui d'un thermographe ou d'un
barographe).
Pluviographe
Le pluviographe se distingue du pluviomètre en ce sens que la
précipitation, au lieu de s'écouler directement dans un récipient
collecteur, passe d'abord dans un dispositif
particulier (réservoir à flotteur, augets, etc) qui
permet l'enregistrement automatique de la
hauteur instantanée de précipitation.
L'enregistrement est permanent et continu, et
permet de déterminer non seulement la hauteur
de précipitation, mais aussi sa répartition dans
le temps donc son intensité. Les pluviographes
fournissent des diagrammes de hauteurs de
précipitations cumulées en fonction du temps. Le pluviographe
à augets basculeurs comporte, en dessous de son entonnoir de
13Livret météo
collecte de l'eau, une pièce pivotante dont les deux
compartiments peuvent recevoir l'eau tour à tour (augets
basculeurs). Quand un poids d'eau déterminé (correspondant en
général à 0,1 ou 0,2 mm de pluie) s'est accumulé dans un des
compartiments, la bascule change de position : le premier auget
se vide et le deuxième commence à se remplir. Les
basculements sont comptés soit mécaniquement avec
enregistrement sur papier enroulé autour d'un tambour rotatif,
soit électriquement par comptage d'impulsions : appareil
permettant l'acquisition d'événements en temps réel, développé
par l'HYDRAM en 1983.
Les pluviographes à augets basculeurs sont actuellement les
plus précis et les plus utilisés.
Pluviographe à augets et système d’enregistrement électronique
14« Atelier météo&énergie » FOJEPDE
V- Album photo atelier météo
Date : 12 octobre 2007
Lieu : laboratoire de recherches énergétiques de Nkolbisson
Sujet : atelier météo de Yaoundé avec les jeunes
Photo réalisée par le FOJEPDE
Date : 13 octobre 2007
Lieu : Nsimi-zoetelé (Ebolowa-Cameroun)
Sujet : atelier météo avec les jeunes
Le pluviomètre enregistreur et à lecture directe Photo réalisée par le FOJEPDE
Date : 13 octobre 2007
Lieu : Nsimi-zoetelé (Ebolowa-Cameroun)
Sujet : atelier météo avec les jeunes Photo réalisée par le FOJEPDE
15Livret météo
Date : 20 octobre 2007
Lieu : Bibliothèque du collège de la salle
Sujet : atelier météo de Douala avec les jeunes
Photo réalisée par le FOJEPDE
VI- Lexique météorologique
A
Abri météorologique : Construction légère destinée à accueillir des capteurs et des
instruments de mesures météorologiques et à les protéger des effets parasites de
l'environnement.
Absorption : Propriétés qu’ont certaines molécules de consommer une partie du
rayonnement électromagnétique à des longueurs d’onde déterminées, ainsi le CO2
absorbe le rayonnement infrarouge de la Terre mais n’absorbe pas le rayonnement du
Soleil dans le visible.
Aérosols : Minuscules particules solides (poussière) ou liquides (brouillard) en
suspension dans l’air, très finement réparties. Les aérosols jouent un rôle important dans
la chimie de l’atmosphère car il peut se produire entre eux des réactions chimiques
entraînant la formation de substances agressives.
Air : Constitué, en volume, d’azote (77%), d’oxygène (21%) d’argon (1%), de vapeur
d’eau, de gaz carbonique et autres gaz en très faible quantité, dont l'ozone. Il tient aussi
en suspension des aérosols minéraux ou organiques (poussières, micro-organismes…)
Albédo : Fraction du rayonnement solaire réfléchi par la Terre.
Anémomètre : Instrument qui sert à mesurer la vitesse du vent
Altocumulus : Type de nuages moyens pommelés, situés entre 3 et 7 km d’altitude
Altostratus : Type de nuages moyens en voile, situés entre 2 et 7 km d’altitude
Anémomètre : Instrument destiné à mesurer la vitesse du vent.
Anthropique : Résultant de ou produit par l’homme.
Anticyclone : Zone de l’atmosphère dans laquelle la pression au niveau de la mer est
élevée
Aphélie : Point de la trajectoire de la Terre autour du Soleil la plus éloignée du Soleil.
Actuellement, la Terre est à l’aphélie au début de juillet (voir périhélie).
16« Atelier météo&énergie » FOJEPDE
Arc-en-ciel : Phénomène atmosphérique lumineux, en forme d’arc de cercle, provoqué
par la séparation des couleurs de la lumière solaire dans les gouttes de pluie.
Ascendance : Courant aérien se déplaçant de bas en haut
Atmosphère : L’atmosphère terrestre se compose de plusieurs couches. De haut en bas,
on distingue la troposphère (de 8 à 17 km d’altitude environ), la stratosphère (de 12 à 30
km environ), la mésosphère (de 30 à 80 km environ), l’ionosphère (jusqu’à environ 400
km) et l’exosphère allant jusqu’à l’espace extra atmosphérique (à partir de 400km). Les
recherches se concentrent pour l’instant sur les zones de la troposphère déterminantes
pour la météorologie et les processus climatiques mondiaux. L’atmosphère de la Terre est
constitué d’azote (77%), d’oxygène (21%) d’argon (1%), de vapeur d’eau, de gaz
carbonique et autres gaz en très faible quantité.
Avalanche : Importante masse de neige qui dévale les flancs d'une montagne, en
entraînant souvent de la boue, des pierres, etc.
Averse : Pluie subite et abondante, de courte durée
B
Bar : Ancienne mesure de pression. 1 bar = 1000 hectopascal = 105 pascal.
Baromètre : Instrument destiné à mesurer la pression atmosphérique
Beaufort (échelle de) : Echelle utilisée pour mesurer la force du vent, graduée de 0 à 12
degrés
Bilan radiatif : Evaluation du flux de rayonnement "net", c'est-à-dire de la différence
entre le gain d'énergie de rayonnement fourni par l'absorption et la perte de cette même
énergie causée par l'émission, compte tenu du rayonnement incident non absorbé.
Biosphère : Ensemble des écosystèmes de la planète, comprenant tous les êtres vivants et
leurs milieux. Elle est constituée de la basse atmosphère, l’hydrosphère et le sol où la vie
est présente.
Bourrasque : Désigne tout épisode de grand vent impétueux et de courte durée ; ce terme
s’emploie en particulier pour caractériser la nature de certains coups de vent en mer.
Brise : Vent côtier dû au contraste de température entre la Terre et la mer
Brouillard : Mélange d’air humide et de gouttelettes d’eau en suspension dans
l’atmosphère, tout près du sol, le brouillard réduit la transparence de l’air et limite la
visibilité des objets. En météorologie, on dit qu’il y a du brouillard si la visibilité est
inférieure à 1 kilomètre.
Bruine : Petite pluie très fine
Brume : Lorsque l’air contient beaucoup de particules en suspension, sa transparence est
réduite et la visibilité des objets est moins bonne. En météorologie, on parle de brume si
la visibilité, près du sol, est inférieure à 5 kilomètres, mais supérieure à 1 kilomètre.
C
Carbone 14 : Isotope radioactif du carbone qui se désintègre au cours du temps, ce qui
permet de déterminer l’âge de certains fossiles trouvés dans les sédiments.
Carbonique (gaz) (CO2) : L’atmosphère en contient très peu (0.0035%) mais sa
concentration augmente très rapidement. Absorbant le rayonnement terrestre, il participe
à l’effet de serre.
Centre d’action : Région de l’atmosphère qui commande l’écoulement de l’air dans un
certain domaine géographique. Centre départemental de la météorologie. En France,
chaque département est doté d’un centre météo responsable de l’observation, de la
prévision du temps et du service aux usagers, chacun de ces centres fait partie de Météo-
France.
Chlorofluorocarbone (CFC) : Plus connus sous le nom de leur marque commerciale,
fréon, les CFC s’attaquent à la couche d’ozone et participent à l’effet de serre. Les
chlorofluorocarbones (CFC) sont des liquides ou des gaz inodores et inoffensifs. Ils sont
17Livret météo utilisés comme réfrigérants dans les réfrigérateurs et les climatisations et, jusqu’à lui y a quelques années, ont très souvent servi de propulseurs d’aérosols. Leur durée de vie est d'environ 100 ans dans l’atmosphère. Circulation générale : Description moyenne des grands mouvements de l’atmosphère. Cirrus : Type de nuages élevés, situés vers 10 km d’altitude. Climat : Ensemble des phénomènes météorologiques (température, humidité, ensoleillement, pression, vent, précipitations) qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné. Conditions atmosphériques habituelles, en un lieu particulier, dans une région, ou même sur la Terre entière. On distingue donc, entre autres, microclimat, climat local, urbain, zonal, régional ou mondial. Climatologie : Branche de la météorologie consacrée à l'étude des climats. Les observations météorologiques archivées sur le plus grand nombre possible de sites géographiques (en surface et en altitude), et d'années pour chaque site, constituent le matériel statistique grâce auquel la climatologie étudie l'état physique moyen de l'atmosphère et ses variations dans le temps et l'espace. Condensation : Passage d’une substance (par exemple l’eau) de l’état gazeux à l’état liquide. Continental (climat) : Climat dominé par l’influence du sol. Les précipitations, modérées, sont maximales en été, tandis que la température est très chaude l’été et très froide l’hiver. Convection : En météorologie, ce terme désigne les mouvements ascendants de l’air provoqués par la chaleur emmagasinée dans la surface terrestre. Coriolis (force de) : Force due à la rotation de la Terre et qui s’applique à tout corps en mouvement. Négligeable dans la vie courante, elle devient importante à l’échelle des grands mouvements de l’atmosphère et de l’océan. Corps (d’une perturbation) : Partie la plus active d’une perturbation, comprenant les deux bandes nuageuses liées aux fronts et à l’occlusion. Courant-jet : Courant aérien situé en altitude (vers 10km) et comportant des vents d’Ouest très rapides. Crue-éclair : Inondation soudaine provoquée par des pluies à caractère orageux. Cumulonimbus : Type de nuages à fort développement vertical, à l’origine des orages. Cumulus : Type de nuages à développement vertical. Cycle : Evénement qui se reproduit de façon répétitive : le cycle jour-nuit, le cycle des saisons… Cycle de l’eau : Ensemble des transformations de l’eau et de ses échanges entre l’atmosphère et la surface de la Terre. Cyclone : Zones de très basse pression qui se forme dans les régions tropicales et autour des quelles les vents peuvent dépasser 200 km/h (synonymes : ouragan, typhon). D Degré Celsius : Unité de mesure de la température de l’air, en abrégé °C. Par définition, 0°C est la température à laquelle la glace fond. 100°C est celle à laquelle l’eau bout. Dépression : Zone de l’atmosphère dans laquelle la pression au niveau de la mer est basse, associée aux perturbations météorologiques, les dépressions sont caractéristiques des climats tempérés. Dans les régions tropicales, elles peuvent donner naissance aux cyclones. Diagramme climatique : Diagramme montrant, mois par mois, la variation en un lieu donné d’une grandeur climatique (la température, les précipitations, l’ensoleillement…). Diffusion : Action par laquelle un corps matériel (par exemple une molécule de gaz ou une gouttelette) éparpille la lumière dans toutes les directions. 18
« Atelier météo&énergie » FOJEPDE
Direction (du vent) : L’une des deux grandeurs qui caractérisent le vent. En
météorologie, on donne toujours la direction d’où vient le vent. Elle est repérée par
rapport aux points cardinaux (nord, est, sud, ouest).
Dispersion (des polluants) : Action des mouvements de l’atmosphère (le vent et les
mouvements verticaux) qui évacue les polluants ou les dilue dans un plus grand espace.
Lorsque la dispersion est suffisante, les teneurs en polluants diminuent et cessent d’être
dangereuses
Durée du jour : Intervalle de temps qui sépare le lever, du coucher du soleil.
E
Echéance : Pour une prévision météorologique, intervalle de temps qui sépare l’instant
initial (le départ de la prévision) du moment auquel la prévision s’applique. Par exemple,
si l’instant initial est le 10 juillet à 0h et que la prévision est faite pour le 12 juillet à 12 h,
l’échéance de la prévision est de 60 heures.
Eclair : Phénomène lumineux intense et bref qui accompagne une décharge électrique
d’orage dans l’atmosphère. Les éclairs peuvent se produire dans un nuage, entre deux
nuages ou entre un nuage et le sol.
Ecliptique : Surface plane dans laquelle s’effectue la révolution de la Terre autour du
soleil.
Effet de serre : Par analogie avec ce qui se passe dans les serres, on appelle ainsi la
propriété qu’ont certains gaz de l’atmosphère d’absorber le rayonnement de la Terre
maintenant alors une température plus élevée que celle qui règnerait sur Terre sans ces
gaz.
El Nino : Perturbation climatique à l’échelle du Pacifique équatorial qui se produit une à
deux fois par décennie.
Ensoleillement : Temps pendant lequel un lieu est ensoleillé.
Equatoriales et tropicales (régions) : Régions de la Terre proches de l’équateur
(latitude comprise entre 0 et 30 degrés).
Equinoxe : Moments de l’année où le Soleil se trouve dans le plan équatorial de la Terre
(déclinaison nulle). L’hémisphère Nord et l’hémisphère sud reçoivent alors la même
quantité d’énergie solaire (21 mars- 21 septembre)
Erreur de prévision : Pour une grandeur météorologique (température, pression vent…),
différence entre la valeur prévue et la valeur réellement observée.
Erreur moyenne de prévision : Valeur moyenne de l’erreur de prévision pour un grand
nombre de lieux géographiques et pour un grand nombre de prévisions.
Evaporation : Passage d’une substance (par exemple, l’eau) de l’état liquide à l’état
gazeux.
F
Foudre : Nom donné à l’éclair lorsqu’il atteint la surface de la Terre.
Front : Zone qui sépare deux masses d’air de caractéristiques différentes. Un front est
presque toujours accompagné d’une bande nuageuse. Front chaud : premier front d’une
perturbation. Front froid : second front d’une perturbation
G
Giboulée : Pluie soudaine et de peu de durée, souvent accompagnée de grêle
Girouette : Instrument destiné à mesurer la direction du vent.
Givrage : Formation de givre sur les objets. Le givre est une forme particulière de glace,
qui se dépose sur des objets très froids en présence de nuages (en altitude) ou de
brouillard.
Glace : Eau congelée, liquide solidifié par le froid
19Livret météo Glaciaires (époques) : Depuis plusieurs millions d’années, la Terre oscille entre des périodes fraîches où les glaciers s’étendent sur l’Amérique et l’Europe du nord (époques glaciaires) et des périodes chaudes où ces glaciers régressent (optimum climatique). Gradient : Intensité de la variation d’un paramètre dans l’espace. Par exemple, le gradient de pression atmosphérique entre deux points est la différence de pression entre ces deux points divisée par la distance. Plus le gradient de pression est élevé, plus le vent est fort. Gravité : Force d’attraction exercée par la Terre sur un corps. La gravité varie d’un point à un autre car la Terre n’est pas une sphère homogène. Grêle : Forme de précipitation solide, constituée de petits blocs de glace - les grêlons - et provenant de nuages orageux. Golf Stream : Courant marin qui transporte des eaux chaudes tropicales vers le nord depuis les Caraïbes le long des côtes d’Amérique du Nord. H Hauteur d’eau : Grandeur mesurant la quantité de pluie tombée à un endroit pendant un intervalle de temps donné. On exprime la hauteur d’eau en millimètres. Un millimètre équivaut à un litre d’eau par mètre carré de surface. Hectopascal : Unité de mesure de la pression atmosphérique, au niveau de la mer, la pression atmosphérique est toujours voisine de 1000 hectopascals, l’abréviation pour hectopascal est hPa. Héliographe : Instrument servant à mesurer la durée de l'ensoleillement Heure solaire : Heure déterminée en un lieu par la position du Soleil dans le ciel. L’heure légale est fixée par convention pour être la même en tous les points d’un même fuseau horaire. Humidité : Etat de ce qui est humide, c'est-à-dire chargé d'eau ou de vapeur d'eau. Humidité absolue : Nombre de grammes de vapeur d'eau contenue dans un mètre cube d'air Humidité relative : Quantité qui caractérise à la fois le contenu de l’air en vapeur d’eau et l’écart à la condensation, on l’exprime en %. A 100% d’humidité relative, la vapeur d’eau se condense en gouttelettes d’eau liquide. Hydrosphère : Totalité des eaux de la planète, comprenant les océans, les mers, les lacs, les cours d'eau, les eaux souterraines Hygromètre : Instrument destiné à mesurer le degré d’humidité de l’air. Hygrométrie : Domaine de la météorologie qui étudie la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air I Indice d'assèchement : Mesure de la capacité de l'air à évaporer, en une journée, le contenu en humidité du sol et des plantes. Le calcul de cet indice tient compte de la prévision pour un jour donné du nombre d'heures d'ensoleillement, de l'humidité et de la température de l'air ambiant, ainsi que du vent. Inondation : Lorsque les pluies sont trop fortes ou durent trop longtemps, le sol ne peut plus absorber l’eau, les fleuves et les rivières débordent, l’eau envahit les terres : c’est une inondation. Insolation : Fraction de la journée pendant laquelle un lieu est ensoleillé. Instable : Région ou couche de l’atmosphère dans laquelle les mouvements verticaux sont amplifiés. Instant initial : Moment de départ de la prévision météorologique. Si on connaît l’état de l’atmosphère à l’instant initial, on peut décrire son évolution future grâce aux lois de la mécanique des fluides. Intempérie : Mauvais temps, rigueur du climat 20
« Atelier météo&énergie » FOJEPDE
Isobare : Courbe qui relie tous les points d’une carte ayant la même pression
atmosphérique.
Isohypse : Courbe qui relie tous les points d’une surface d’égale pression ayant la même
altitude. Les isohypses constituent en altitude l’équivalent des isobares en surface.
L
Latitude : Eloignement d’un point de la Terre par rapport à l’équateur.
Longitude : Eloignement d’un point de la Terre par rapport au méridien d’origine.
M
Maille : Distance horizontale séparant deux points voisins de l’atmosphère pour lesquels
le modèle effectue ses calculs.
Masse d’air : Nom donné à une partie de l’atmosphère dont les propriétés sont
semblables en tout lieu.
Méridien : Demi-cercle tracé sur la surface terrestre et passant par les pôles.
Mésosphère : Couche partielle de l’atmosphère entre 30 et 80 km d’altitude. Dans sa
partie inférieure, jusqu’à environ 50 km, la température augmente jusqu’à environ 50°C.
C’est ici qu’une fine couche d’ozone transforme une partie des radiations solaires en
chaleur. La température baisse jusqu’à –80°C à la limite supérieure de la mésosphère.
Météorologie : Science des phénomènes atmosphériques qui déterminent le temps.
Méthane (CH4) : Gaz à l’état de trace important, influençant le climat, inodore. Chaque
année, 500 millions de tonnes de méthane se déversent dans l’atmosphère, provenant de
la décomposition de substances organiques à l’abri de l’air (zones marécageuses,
décharges, estomacs des ruminants) et d’émissions dégagées lors de l’extraction du
charbon, du pétrole et du gaz naturel. Chaque ruminant rejette chaque jour 120 l de
méthane dans l’atmosphère. Contribue à l’effet de serre.
Modèle : Simulation d’un phénomène naturel. Il peut être physique : par exemple, les
modèles réduits pour simuler les phénomènes hydrauliques dans un estuaire. Il peut être
mathématique : on utilise alors des équations pour traduire des phénomènes physiques.
Les modèles utilisés en météorologie et climatologie sont des modèles mathématiques
que l’on s’efforce de résoudre par des méthodes numériques.
Modèle de prévision numérique : Logiciel informatique destiné à simuler l’évolution de
l’atmosphère sur un ordinateur. Les calculs effectués par le modèle sont l’application des
lois de la mécanique des fluides.
Molécule de gaz : L’air est un mélange de gaz : l’azote, l’oxygène, la vapeur d’eau, etc.
Chacun de ces gaz est constitué d’un très grand nombre d’éléments minuscules, appelés
des molécules.
Mousson : Phénomène saisonnier qui correspond à une inversion des vents dominants
sur une grande échelle dans l’océan indien. Le phénomène est gouverné par l’alternance
des pressions continentales au nord de l’Inde. En hiver, aux pressions élevées, correspond
un vent qui souffle du continent vers les continents apportant des pluies abondantes.
Moyenne : Opération mathématique. Pour une grandeur qui peut prendre de nombreuses
valeurs, la moyenne permet généralement de calculer la valeur la plus probable.
N
Nébulosité : Nuage ayant l'apparence d'une légère vapeur. Mais également, fraction de
ciel couverte par des nuages à un moment donné
Neige : Précipitation de cristaux de glace agglomérés en flocons, dont la plupart sont
ramifiés, parfois en étoile. Quand la température des basses couches de l'atmosphère est
inférieure à 0°C, la neige se forme par la présence, dans un nuage, de noyaux de
condensation faisant cesser le phénomène de surfusion.
Nimbostratus : Type de nuages moyens, situés entre 1 et 5 km d’altitude.
21Livret météo Normale climatique : Valeur de référence d’une grandeur météorologique (température, pression, etc.) en un lieu donné. La normale est calculée en faisant une moyenne sur une période de 30 ans. Nuage : Mélange d’air humide et de gouttelettes d’eau en suspension dans l’atmosphère. O Observateur : Météorologiste spécialisé dans l’observation du temps. Occlusion : Partie de la perturbation située à proximité de la dépression. Dans l’occlusion, les deux fronts se rejoignent et l’air chaud est rejeté en altitude. Océanique (climat) : Climat dominé par l’influence de l’océan. Les précipitations s’étalent régulièrement sur l’année, tandis que la température n’est ni très chaude en été, ni très froide en hiver. Orage : Ensemble des manifestations atmosphériques d’un système orageux : nuages, pluie violente et grêle, éclairs, tonnerre, rafales de vent. Dans le langage courant, l’orage désigne souvent uniquement les éclairs et le tonnerre. Ouragan : Nom donné au cyclone tropical dans certaines régions. Oxydes d’azote : Composés d’oxygène et d’azote. Il s’agit, entre autres, du protoxyde d’azote ou gaz hilarant (N2O) et du monoxyde d’azote (NO). La présence croissante de gaz hilarant est due à des influences anthropiques (engrais azotés, combustion de biomasse et de combustibles fossiles). Le problème, c’est que ces gaz peuvent séjourner jusqu’à plus de 150 ans dans l’atmosphère. Oxyde nitreux (NO2) : Gaz à effet de serre, produit naturel du cycle de l’azote. Ozone (O3) : Gaz à l’état de trace important, influençant le climat, d’odeur âcre, toxique pour la flore et la faune, présent dans toutes les couches de l’atmosphère jusqu’à 110 km d’altitude. L’ozone apparaît dans la stratosphère tout d’abord sous l’influence des radiations scolaires à ondes courtes. Environ 90% de l’ozone se trouvent dans une couche épaisse de la stratosphère jusqu’à 110 km d’altitude. L’ozone apparaît dans la stratosphère tout d’abord sous l’influence des radiations solaires à ondes courtes. Environ 90% de l’ozone se trouvent dans une couche épaisse de la stratosphère inférieure. La couche d’ozone, telle des lunettes de soleil, filtre les rayons ultraviolets du Soleil dangereux pour la vie. Elle s’amincit suite à l’action des CFC (trou d’ozone), ce qui l’empêche de jouer son rôle de protecteur. P Paléoclimatologie : Etude des climats anciens Parallèle : Cercle tracé sur la surface de la Terre et réunissant tous les points de même latitude. Particules : En plus des gaz, l’air de l’atmosphère contient aussi de très petits éléments solides ou liquides en suspension, qu’on appelle des particules. Pascal : Unité officielle de pression Périhélie : Point de la trajectoire de la Terre autour du Soleil le plus proche du Soleil. La Terre est au périhélie au début de janvier (voir Aphélie). Perturbation : Modification de l'état de l'atmosphère, caractérisée par des vents violents et des précipitations. Caractéristique des latitudes tempérées. Photosynthèse : Mécanisme de base de la production de matière vivante à partir d’eau, de gaz carbonique, d’éléments nutritifs et de lumière. C’est la chlorophylle qui est l’agent de la photosynthèse. Pluie : Précipitation d'eau atmosphérique sous forme de gouttes. La pluie résulte de l'ascendance de l'air, qui, se refroidissant, provoque la condensation en gouttelettes de la vapeur d'eau qu'il contient ; le nuage qui se forme ne donne des pluies qu'avec l'accroissement de la taille des gouttelettes, qui ne peuvent plus rester en suspension. Pluie continue : Episode de pluie de longue durée (plusieurs heures au moins). 22
Vous pouvez aussi lire