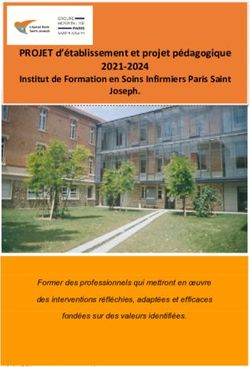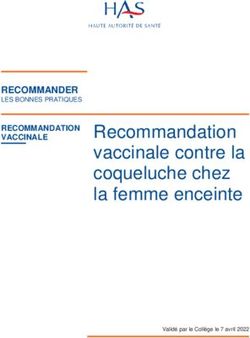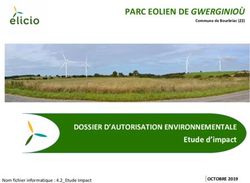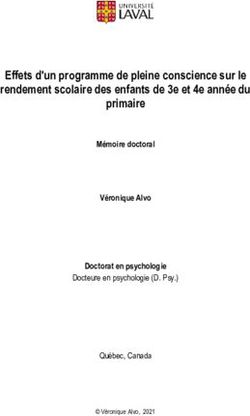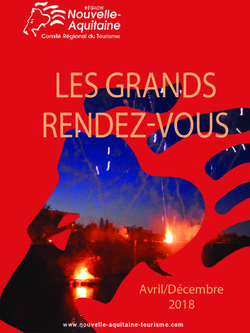MEMOIRE EN REPONSE AUX OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC AU COURS DE L'ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET DE PARC EOLIEN
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
MEMOIRE EN REPONSE
AUX OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE
PUBLIC AU COURS DE L’ENQUETE PUBLIQUE
DU PROJET DE PARC EOLIEN
DOSSIER DE DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Région Bretagne, Département de l’Ille et Vilaine
PROJET DE PARC EOLIEN DE LA SAUSSINAIS
SAS Parc Eolien de la Saussinais
1Le projet éolien de la Saussinais, objet de l’enquête publique, prend place sur les communes
de Guipry-Messac et de la Noë-Blanche, situées dans le sud de l’Ille et Vilaine.
Le projet déposé consiste en l’implantation de 3 éoliennes de 3 000 à 3 600 kilowatts pour
une puissance totale maximum de 11,7 MW.
Ce projet s’inscrit dans un programme ambitieux de développement des énergies
renouvelables et contribuera de façon significative à l’atteinte de l’objectif que s’est fixé la
région Bretagne en matière de développement de l’énergie éolienne.
Ce projet initié en 2013 a fait l’objet d’études poussées permettant de configurer au mieux
l’implantation des éoliennes pour permettre la création d’un projet de moindre impact.
Une demande d’Autorisation Environnementale a été déposée auprès des administrations en
juin 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2019, le commissaire
enquêteur a rencontré, le mercredi 26 juin 2019, le représentant du maître d’ouvrage, afin de
lui communiquer les observations du public et son propre questionnement, le tout consigné
dans le procès-verbal de synthèse.
Le Maître d’ouvrage est invité à faire connaître ses réponses dans un mémoire produit sous
quinzaine.
Ce document, rédigé à destination du commissaire enquêteur pour le projet de parc éolien de
la Saussinais, Monsieur APPERE, et des riverains de ce même projet, apporte les réponses aux
observations émises lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 17 mai 2019 au 18 juin
2019 inclus.
CONTACTS
Laura HABEGRE
EDF Renouvelables France
6, rue du Calvaire
Directrice de projets
CS 52314
44023 Nantes cedex 1
laura.habegre@edf-en.com
2Sommaires
I. Observations sur le déroulement de l’enquête publique .................................................5
II. Le projet éolien de la Saussinais : Processus de développement et information
concertation ...........................................................................................................................6
A. Processus de développement du projet .......................................................................6
B. La concertation ............................................................................................................7
III. Filière éolienne ............................................................................................................8
A. Contexte énergétique en France – Objectifs de l’Etat ...................................................8
B. Contribution du parc éolien de la Saussinais ..............................................................10
C. Coût de l’éolien et mécanisme de financement .........................................................10
D. La diminution des émissions de C02 sans compensation d’énergie fossile .................15
E. Le bilan carbone de l’éolien – une énergie verte ........................................................16
F. Création d’emploi et fabrication des éoliennes ..........................................................17
G. La pollution due aux éoliennes ...................................................................................19
IV. Effets sur le cadre de vie et le commerce et les biens ................................................20
A. Le tourisme ................................................................................................................20
B. L’impact de l’éolien sur la valeur de l’immobilier .......................................................20
C. Les retombées économiques locales ..........................................................................23
D. Réception TV et téléphonie mobile ............................................................................25
E. Capacité financière et démantèlement ......................................................................26
F. Remise en état des chemins et trafic lors des travaux ................................................29
V. Effets sur le milieu humain ............................................................................................30
A. Eloignement éolienne / habitation .............................................................................30
B. Le bruit des éoliennes ................................................................................................32
C. Infrasons et psycho-acoustiques (ou effet nocébo) ....................................................34
D. Effets stroboscopiques ...............................................................................................36
E. Emissions lumineuses ................................................................................................37
F. Les champs électromagnétiques ................................................................................38
G. Géobiologie ...............................................................................................................39
H. Santé humaine et animale .........................................................................................39
I. L’étude de danger ......................................................................................................41
VI. Impact sur le paysage ................................................................................................43
3A. Préambule : Les évolutions/modifications du paysage ...............................................43
B. Mitage et paysage......................................................................................................44
C. La pris en compte du paysage dans la conception du projet .......................................45
D. Effets cumulés avec les autres parcs éoliens en projet ...............................................46
E. Dispositifs d’atténuation de visibilité des machines ...................................................47
VII. Le parc éolien de la Saussinais ...................................................................................47
A. Absence d’avis de l’autorité environnementale .........................................................47
B. La taille des éoliennes ................................................................................................47
C. Absence de scénarii alternatif : ..................................................................................48
VIII. Impact sur le Milieu Naturel .......................................................................................48
A. Les zones humides .....................................................................................................48
B. proximité des éoliennes par rapport aux haies / Chauve-souris, ................................50
C. Impact du fonctionnement des éoliennes sur les chauves-souris ...............................51
D. Impact sur les oiseaux ................................................................................................52
IX. Questions et remarques du commissaire enquêteur ..................................................52
X. Annexes.........................................................................................................................59
4I. Observations sur le déroulement de l’enquête publique
Ce projet intervient dans le cadre d’une problématique globale et complexe, de lutte contre
le dérèglement climatique lié à l’augmentation des gaz à effet de serre et du renforcement de
l’indépendance énergétique.
Il contribue ainsi aux objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables
définis par les politiques européennes et françaises.
Devant ces enjeux complexes, s’entrecroisent l’intérêt général et les intérêts particuliers. Une
implication sérieuse du porteur de projet est nécessaire afin de répondre aux questions
soulevées par les riverains directement concernés par l’implantation de ce projet pour
expliquer le bien-fondé de la démarche, de la technologie utilisée et rétablir certaines vérités.
Il nous semble intéressant de constater que cette enquête n’a pas suscité un intérêt
important. En effet, seulement 16 personnes se sont déplacées sur les 23 7611 personnes
résidant dans le périmètre de l’enquête publique et 50 écrits ont été versés au dossier via une
participation par internet.
Une association s’est manifestée contre le projet éolien. Une pétition contre le projet, le
présentant de manière particulièrement anxiogène, a également été versée au dossier.
Par ailleurs un démarchage de porte à porte, effectué par des opposants au projet, nous a été
rapporté, et des pressions ont été réalisées sur la population pour la mobiliser contre le projet.
A noter que des pancartes d’opposition au projet ont été installées sur les accotements de
routes sur la zone d’implantation du projet.
La communication des opposants s’est basée sur des éléments inexacts, non prouvés ni
référencés et reposant sur une opposition de principe vis-à-vis de l’éolien.
Il est en effet reconnu que la diffusion d’informations fausses même lorsque les réponses
officielles ont été apportées, suffisent à dégrader l’acceptabilité du projet.
Il nous semble que ces agissements ont pu influencer de manière négative certains habitants
des communes concernées par le périmètre d’enquête publique.
Nous constatons par ailleurs qu'une majorité des thèmes abordés par les contributeurs à
l’enquête publique sont ceux classiquement traités lors d'enquêtes relatives à un projet
éolien, au rang desquelles ressortent le paysage, la santé, l’humain et l’environnement social,
l’information faite sur le projet, l’environnement écologique, le bien-fondé de la politique
énergétique et économique menée et la pertinence du projet éolien objet de l’enquête
publique à s’inscrire comme un élément de réponse.
Il n’en demeure pas moins que des inquiétudes sont bien présentes chez de nombreuses
personnes ayant alimentées les observations de l’enquête publique et qu’elles méritent des
réponses.
Le Commissaire Enquêteur a transmis via son PV de synthèse l’ensemble des contributions
versées à l’enquête publique auxquelles il nous parait indispensable d’apporter des
éclaircissements et des réponses.
1
Chiffres INSEE 2014
5Nous nous sommes occupés d’analyser chaque contribution et d’en extraire les thématiques
globales ainsi que les sous thèmes associés pour les regrouper et mieux les traiter. La première
partie du présent mémoire répond à ces grandes thématiques.
La seconde partie du mémoire s’attache à formuler des réponses précises à des questions
particulières formulées directement par le commissaire enquêteur.
II. Le projet éolien de la Saussinais : Processus de développement et
information concertation
A. Processus de développement du projet
Le développement de projet peut être scindé en 4 étapes :
1. La prospection
o Recherche d’un site aux caractéristiques favorables au développement d’un
projet éolien (dont compatibilité avec activité aérienne civile et militaire)
o Rencontre avec les élus locaux
o Rencontre avec les propriétaires fonciers et leurs exploitants agricoles
Il convient de préciser que ce type de projet ne peut en aucun cas passer par voie de
Déclaration d’Utilité Publique et d’Expropriation. Au préalable du lancement des études il est
nécessaire d’obtenir les accords des propriétaires et exploitants de l’ensemble de la zone
d’implantation potentielle, de manière à faciliter la future implantation des éoliennes hors
des zones de contraintes qui seront identifiées grâce à l’étude d’impact.
Nous précisons que l’implantation des éoliennes n’a pu être définie qu’après que les études
environnementales et techniques aient été menées sur le terrain.
2. Les études de terrain
o Etude du vent, des zones humides, de la faune et de la flore, du paysage, de
l’acoustique, des contraintes réglementaires, de la nature du sol etc.
o Détermination des enjeux relatifs à la zone d’étude
3. L’étude des impacts du projet
o Etude des éventuels impacts du projet sur l’environnement
o Proposition d’une implantation des éléments constitutifs du parc éolien dans
le cadre d’un processus itératif consistant en premier lieu à éviter les enjeux,
puis réduire les impacts éventuels en proposant des mesures adaptées et enfin
proposer des mesures compensatoires si nécessaire.
4. La finalisation des dossiers
o Dépôt du dossier administratif en préfecture.
6Lors de la phase de prospection, le porteur de projet a pu relever des éléments favorables qui
ont orienté le choix du site et sa définition :
- Il se trouve en zone favorable du Schéma Régional Eolien (SRE), annulé en 2015.
- Il est compatible avec les orientations de l’état et plus spécifiquement de la région
Bretagne.
- Il bénéficie du soutien des élus locaux.
- La distance aux habitations est supérieure à 500 m.
- Le gisement éolien est suffisant pour garantir une production d’électricité verte
optimisée et l’équilibre économique du projet.
B. La concertation
1. Avec les élus
Les conseils municipaux de Guipry-Messac et de La Noë-Blanche ont été associés dès le
lancement du projet aux étapes du développement. De façon plus large le projet éolien a
également été abordé avec la communautés de communes Moyenne Vilaine et Semnon.
2. Avec les Services de l’Etat
Depuis 2013, une consultation complète des Services de l’Etat a été réalisée.
Dès la reprise du projet en 2016 des échanges avec la police de l’eau ont permis d’identifier
de la façon la plus précise possible les zones humides sur le périmètre d’étude du projet.
La DREAL Bretagne a été rencontrée pour informer de l’étude du projet et pour échanger sur
les résultats d’ inventaires écologiques.
Une réunion a été organisée avec les services du paysage et du patrimoine de la DDT et de la
DREAL en décembre 2018. Une présentation du projet et de ses impacts paysagers a été
réalisée.
3. Avec les riverains
Pour une bonne intégration et acceptation locale du projet, EDF Renouvelables France a
attaché une attention particulière à la concertation et à l’information du public. Afin de tenir
informés la population et les riverains du projet et de ses avancées, EDF Renouvelables France
a mis en place plusieurs actions :
a) L’intégration d’articles dans les bulletins d’information de
la Noë Blanche
Plusieurs articles d’information sur le projet ont été intégrés aux bulletins municipaux tout au
long de son élaboration.
b) La diffusion d’un bulletin d’information propre au projet
Un bulletin d’information sur le projet a été distribué à l’ensemble des habitants des
communes de La Noë Blanche et de Guipry-Messac (environ 8000 personnes) pour informer
sur le projet et inviter à une réunion publique d’information.
7c) Un porte à porte
Un porte à porte réalisé auprès de toutes les habitations encadrant la zone d’étude du projet
de manière à garantir l’information sur le parc éolien et que les riverains les plus proches aient
tous été informés sur le projet. Lorsque les habitations étaient fermées, un bulletin
d’information était laissé dans les boites aux lettres.
d) Une réunion publique d’information
Une réunion publique d’information sur le projet éolien a eu lieu le 7 avril 2017. Des tracts ont
été distribués pour tenir informée la population de la tenue de cette réunion. EDF
Renouvelables France a présenté l’ensemble du dossier de demande d’autorisation, répondu
aux questions de la population, et organisé une visite du parc éolien de la Nourais localisé sur
les communes de Grand Fougeray et La Noë Blanche.
Des informations plus développées sur le sujet sont disponibles en pages 42 et 43 de l’étude
d’impact.
III. Filière éolienne
A. Contexte énergétique en France – Objectifs de l’Etat
Il ne nous appartient pas en tant qu’opérateur de prendre parti sur les décisions de politiques
énergétiques prises au niveau européen et déclinées au niveau national. Notre cadre d’action
se limite à apporter des solutions pour répondre aux objectifs identifiés et énumérés en
préambule.
Le parc éolien de la Saussinais s’inscrit pleinement dans le cadre de l’atteinte de ces objectifs
en augmentant significativement la part des énergies renouvelables au niveau national et
régional.
Les objectifs actuels en France sont les suivants :
La Loi Grenelle 1 (2009) : définition de l’objectif national
- En 2020, 23% de la consommation énergétique devra provenir des ressources
renouvelables
- Objectif de 27% d’énergies renouvelables dans la production d’électricité d’ici 2020
- Contribution majeure de l’éolien : 10 % de l’électricité produite en 2020 issue du vent
- 19 000 MW terrestres installés en 2020 et 6 000 MW en mer
La Loi Grenelle 2 (2010): définit le cadre de développement
- Mise en place des Schémas Régionaux Climat Air Energie
- Schémas Régionaux Eolien
La Loi de transition énergétique du 18 août 2015
8- 32% de la consommation énergétique devra provenir de ressources renouvelables en
2030
- porte à 40% l’objectif d’énergies renouvelables dans la production d’électricité d’ici
2030 (contre seulement 22,7 % aujourd’hui selon le dernier panorama de l’électricité
renouvelable)
Par ailleurs, l’Accord Universel sur le climat adopté du 12 décembre 2015 lors de la COP
21 engage 195 pays à réduire significativement leurs émissions de gaz à effet de serre.
L’Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies
renouvelables qui vise à doubler la puissance éolienne terrestre installée aujourd’hui en
France, confirmé par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie publiée le 28 octobre
2016:
- Objectif de 15 000 MW éoliens d’ici le 31.12.2018
- Objectif de 21 800 MW à 26 000 MW éoliens d’ici le 31.12.2023
A noter que l’objectif pris dans le Schéma Régional Eolien (en 2012) de Bretagne est de
développer une puissance de 1 800 MW de projets éolien terrestre pour 2020, objectif venu
confirmer le pacte électrique Breton signé en 2010 engageant notamment les signataires à
porter à 3 600 MW la puissance de production d’électricité renouvelable d’ici 2020, dont 1
400 MW d’éolien terrestre à l'horizon 2015 et 1 800 MW à l'horizon 2020.
Au premier trimestre 2019 la région Bretagne dispose de 1 000 MW de projets éoliens en
fonctionnement. Des projets éoliens ont été acceptés et ne sont pas encore construits
puisqu’une partie d’entre eux se trouvent en recours et en attente de jugement. Certains ne
pourront donc pas être mis en service. Ainsi la région Bretagne n’a pas encore atteint son
objectif (de 1800 MW à l’horizon 2020), qui devrait se voir augmenté pour permettre
d’absorber l’ambition de l’état affiché dans la Loi de transition énergétique.
A un an de l’échéance, il reste donc prêt de la moitié de l’objectif à atteindre :
Figure 1 : Panorama de l’énergie renouvelable en France, en 2018 – RTE-ENEDIS 2018
9B. Contribution du parc éolien de la Saussinais
Les résultats de l’étude de vent confirment le potentiel éolien du site et sa viabilité technico
économique. Tel qu’indiqué dans l’étude d’impact page 54, en prenant en compte le gisement
de vent du site après extrapolation des données vent du parc éolien de la Nourais et des
données météo, les différentes pertes techniques incluant notamment celles engendrées par
les bridages estimés pour respecter la réglementation acoustique, la production annuelle du
parc éolien est estimée à 19 900 kWh.
Le parc éolien produirait l’équivalent de la consommation électrique, chauffage inclus,
d’environ 8 000 habitants. Le parc éolien, dans le cas où il remplacerait la production
d’électricité issue d’un mix électrique, permettrait d’éviter le dégagement de 5 900 tonnes de
CO2/an soit 118 000 tonnes économisées sur 20 ans comme le précise la page 210 de l’étude.
S’agissant de la mesure de vent ou de la rentabilité du projet, certaines contributions de
l’enquête publique interrogent sur le fait de l’implantation même du projet à des altimétries
basses du bassin de la Noë Blanche.
Le projet de la Saussinais étant situé à proximité du parc éolien existant de la Nourais, les
données de vitesses de vent ont pu être évaluées sur la base des données de vents enregistrés
à la Nourais, ceci couplé aux données météo du secteur et en intégrant les données de
topographie et de rugosité particulières à la zone d’implantation des nouvelles éoliennes.
Une étude de la ressource vent a donc été réalisée préalablement au lancement du projet
pour s’assurer du fait que la zone d’implantation pouvait être propice à l’implantation
d’éoliennes.
Sur d’autres projets il arrive d’installer des mats de mesures de vent. Les couts de construction
d’un mat de mesures pour un projet modeste de 3 éoliennes étant assez importants et
disposant de la possibilité de calculer le gisement du site grâce notamment au parc éolien
voisin il a été décidé de ne pas implanter de mat sur cette zone.
C. Coût de l’éolien et mécanisme de financement
1. La CSPE.
Le financement des énergies renouvelables est notamment soutenu par le consommateur via
la CSPE.
La CSPE (Contribution au Service Public d’Electricité) est payée par tous les consommateurs
d’électricité. Elle couvre :
• L’obligation d’achat de l’électricité produite par la cogénération, et de source
renouvelable,
• Les surcoûts de production et d’achat de l’électricité dans les parties du territoire non
interconnectées au continent (ZNI),
• Les dispositions sociales (surcoût supporté par les fournisseurs en faveur des
personnes en situation de précarité),
10• Le financement des frais de gestion de la Caisse des Dépôts et Consignation,
• Les surcoûts liés au soutien à l’effacement.
Le montant de la CSPE est de 22,5 €/MWh depuis 2016, et le restera jusqu’en 2022 (loi de
finance 2018). Ceci a été permis notamment par l’introduction de la TICPE (taxe intérieure
de consommation sur les produits énergétiques). Cette taxe permet que ce ne soit plus
seulement les consommateurs d’électricité qui financent les énergies renouvelables , mais
les consommateurs d’énergie au sens plus large (carburants compris).
Pour l’année 2019, les charges de service public de l’énergie vont bénéficier par exemple pour
17% à l’éolien et 33% pour le photovoltaïque (source : commission de régulation de l’énergie).
Estimatifs CSPE pour l'année 2019 (Source : EDF)
La part de l’éolien dans la CSPE étant de 17 %, la part de l’éolien dans la facture totale
d’électricité des français est donc de l’ordre de 2,7 %.
Ainsi, le coût pour le particulier sera de 1 euro par mois et par foyer (source : Commission de
Régulation de l’Energie pour un foyer consommant 2,5 MWh par an). C’est par exemple
inférieur à ce que coutera le dispositif de soutien au raccordement des zones non
interconnectées comme la Corse.
C’est donc à tort que la contribution C.EI.19 spécifiait « Et pourtant c'est tous les Français qui
financent ces projets au travers de la Taxe CSPE. Elle représente 17% du prix de leur facture
électrique (environ 250 Euros/an pour un couple avec 2 enfants).. »
11L’éolien pèse donc peu sur le pouvoir d’achat des ménages. Enfin grâce à la baisse des coûts,
l’éolien étant de plus en plus compétitif, deux fois plus de production sera financée pour le
même montant à l’avenir.
Nous nous permettons également de préciser qu’il n’y a aucun coût caché pour l’éolien,
puisqu’ils sont connus dès le début des projets, en intégrant les couts de démantèlement :
démontage et remise en état des sites (garanties financières).
Augmentation de la facture d’électricité des Français :
Si la CSPE reste fixe depuis quelques années, les Français peuvent constater une augmentation
du coût de l’électricité, qui s’explique notamment par :
• L’augmentation structurelle du prix de marché de gros de l’électricité,
• De gros besoins d’investissements, tels que :
o L’opération « grand carénage d’EDF » : travaux de maintenance et de
modernisation des 58 réacteurs nucléaires français pour prolonger leur durée
de vie au-delà de 40 ans (durée initialement prévue). Ces travaux ont pour but
de répondre aux nouvelles exigences de l’ASN suite à l’accident de Fukushima.
o La gestion des infrastructures, et le renforcement du réseau électrique.
o Les frais de démantèlement des centrales nucléaires.
Coût / bénéfice pour la collectivité :
A l’issue d’une étude sur la filière éolienne française, l’ADEME estime que « Le développement
de l'éolien a eu des bénéfices environnementaux et sanitaires importants qui, si on les
monétarise, représentent un gain estimé pour la collectivité de l'ordre de 3,1 à 8,8 Mds€. Ces
gains dépassent largement le coût de la politique de soutien » .
Les bénéfices sont multiples : réduction des gaz à effet de serre et polluants atmosphériques,
création d’emplois et d’activités économiques dans les territoires.
« En 2014, c'est l'émission de 9,6 MtCO2éq qui a ainsi pu être évitée, représentant environ 9%
de l'effort national de réduction en 2014 des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport
au niveau de 1990, et environ 22% des émissions du secteur de production d'électricité et de
chauffage urbain ».
Coûts des autres énergies
Aujourd’hui, le prix moyen d’achat de l’éolien terrestre est de 65,4€/MWh (appel d’offre de
février 2018). Il est donc quasiment la moitié de celui du nouveau nucléaire (Hinkley Point) qui
s’élève à 109€/MWh. Dès 2016, l’ADEME indiquait que l’éolien terrestre était le moyen de
production le plus compétitif, ce que les rapports de l'Agence Internationale de l'Energie, de
l'IRENA ou encore les enquêtes de la Commission européenne confirment depuis.
12Les moyens de production électrique français (centrales nucléaires, hydrauliques ou charbon)
ne se sont pas construits sur des prix de marché, mais dans un contexte de monopole étatique.
Ils ont été financés par l’argent public et donc par le contribuable français sans corrélation
avec les problématiques de rentabilité sur le marché européen de l’énergie.
Finalement, l’évolution des modalités d’achat de l’énergie éolienne a permis le
développement de cette technologie basée sur l’exploitation d’une ressource renouvelable
qui est désormais mature, et s’inscrit totalement dans le cadre de la transition énergétique.
L’éolien terrestre est d’ailleurs le moyen de production le plus compétitif avec les moyens
conventionnels (ADEME : le coût des énergies renouvelables , 2016).
2. Mécanisme de financement
Il a existé différentes conditions d’achat de l’électricité éolienne produite jusqu’à aujourd’hui :
• Jusqu’au 31 décembre 2015 : obligation d’achat en guichet ouvert
Afin de développer la filière éolienne, l’État a mis en place en 2000 et jusqu’à fin 2015 un
dispositif incitatif : l’obligation d’achat. Il s’agissait d’un tarif fixe d’achat garanti pendant une
durée donnée, conformément aux arrêtés fixant les conditions d’achat. Dans les conditions de
2008, pour l’éolien terrestre, les contrats ont été souscrits pour 15 ans et le tarif a été fixé à
8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh pendant 5 ans selon les sites. Ce tarif
était actualisé chaque année en fonction d’un indice des coûts horaires du travail et d’un
indice des prix à la production.
À environ 82€/MWh, le tarif d’achat de l’éolien terrestre était comparable aux coûts prévus
par la Cour des Comptes en janvier 2012 pour l’EPR de Flamanville et se rapprochait des coûts
du nucléaire historique estimés par la commission sénatoriale à l’été 2012 (50 à 70€/MWh).
L’EPR Anglais devrait, quant à lui, vendre son électricité à 109€/MWh. Ainsi, l’éolien restait
abordable, et même compétitif.
• Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : complément de rémunération en guichet
ouvert
À compter du 1er janvier 2016, le dispositif de soutien à l’éolien terrestre a évolué vers le
dispositif de complément de rémunération mis en place par la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, et suite à l’adoption le 29 décembre 2015 de la Loi de
Finances rectificative. Dans le cadre de ces contrats, l’électricité produite par les installations
est vendue directement par le producteur sur le marché de l’électricité (et plus à EDF-OA), la
différence entre un tarif de référence fixé par arrêté et le prix moyen du marché constaté
chaque mois est versée au producteur par EDF-OA.
Ce système avait pour objectif de faire baisser les coûts de l’éolien. L’année 2016 constituait
pour la filière éolienne une année de transition. L’arrêté tarifaire du 13 décembre 2016 fixait
les modalités du complément de rémunération pour l’année 2016. Il prévoyait des contrats
de 15 ans et un niveau de tarif à 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh
13pendant 5 ans selon les sites, dans la continuité du niveau de soutien apporté par l’arrêté de
2014.
• A partir du 1er janvier 2017 : complément de rémunération en guichet ouvert et
appels d’offres
Depuis le début d’année 2017, un nouveau dispositif de soutien a été mis en place :
Pour les installations d’au moins 7 mâts, ou dont l’un des aérogénérateurs a une
puissance supérieure à 3 MW, la rémunération sera définie par appel d’offre biannuel.
Pour les autres installations, les conditions d’achat restent un complément de
rémunération révisé, en guichet ouvert, sur le même principe que celui appliqué pour
l’année 2016. La durée des contrats est allongée à 20 ans afin de tenir compte des
durées de vie des éoliennes.
Ce nouveau système de complément de rémunération permet de responsabiliser les
producteurs d’énergie sur leur production, en les exposant aux signaux du marché. De plus,
au regard de l’augmentation prévue du prix de marché de l’électricité, le coût du soutien aux
énergies renouvelables va mécaniquement diminuer. Le premier appel d’offre a été lancé en
mai 2017. Le tarif moyen obtenu par les lauréats de la première tranche de l’appel d’offre
éolien est de 65,40 €/MWh.
3. Rentabilité du projet de la Saussinais
Certaines observations démontrent une méconnaissance du tarif d’achat de l’éolien terrestre :
« on nous a clairement répondu qu'ils ne connaissent pas le taux de rentabilité ... Est-ce bien
normale ?» [C.EI.29].
La société SAS Parc éolien de la Saussinais candidatera en appel d’offres pour déterminer le
prix de vente de son électricité. Le prix proposé sera fonction notamment du prix des
éoliennes disponibles sur le marché au moment de la candidature et des simulations de
production du parc. Il est donc aujourd’hui impossible de présenter un business plan ni de
communiquer la rentabilité du projet.
Le prix d’achat de l’électricité sera proposé de manière à ce que la société SAS Parc éolien de
la Saussinais puisse faire face à l’ensemble de ses engagements (loyers, mesures
compensatoires, maintenance, remboursement des bailleurs de fonds…) durant la phase
d’exploitation du site et provisionner le coût du démantèlement du parc éolien. Les flux de
trésorerie opérationnels générés par le projet permettront le remboursement de la dette
bancaire et la rémunération des fonds propres selon un cas de base raisonnable agréé par les
bailleurs de fonds (les actionnaires et les banques).
Les collectivités locales bénéficieront des recettes fiscales générées par le projet. Ce sujet est
détaillé dans la partie IV.C.1 Les recettes fiscales.
14D. La diminution des émissions de C02 sans compensation
d’énergie fossile
Certaines observations démontrent une méconnaissance de l’efficacité de l’énergie éolienne
« L'énergie éolienne est aussi inefficace dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Chaque éolienne repose sur l’énergie des combustibles fossiles pour assurer son inefficacité et
son manque de fiabilité. » C.EI.19
Comme indiqué par l’ADEME2, la substitution des énergies fossiles par le vent est une réalité.
L’utilisation de l’énergie éolienne permet de produire de l’électricité sans brûler de
combustibles fossiles et renforce l’autonomie énergétique nationale. Comme il l’a été
énoncé précédemment, la France veut diminuer ses émissions de CO 2 et mieux répartir son
mix énergétique.
La fourniture d’électricité française s’appuie actuellement en majorité sur de la production
nucléaire, aussi considérée comme dé-carbonée, complétée par des centrales
hydroélectriques et thermiques à flamme. Ces dernières émettent quant à elles du CO 2 et
restent des énergies faisant appel à du combustible que la France importe. Remplacer ces
dernières par des installations fonctionnant grâce aux énergies renouvelables permet
d’éviter pour partie le recours aux énergies fossiles.
La Loi de Transition Energétique pour une croissance verte a consolidé un renfort de la
production du renouvelable en réduisant à terme la part du nucléaire français –en passant
d’une production nucléaire de 75% à 50%.
Aujourd’hui en France, selon RTE (Réseau de transport d’électricité), 100 MW éoliens
permettent de se substituer à 25 MW de production thermique à flamme dans les mêmes
conditions de disponibilité et de sécurité.
De plus, comme indiqué par l’ADEME précédemment, l’accroissement de la production
d’électricité d’origine éolienne permet d’éviter le recours aux centrales thermiques à
combustibles fossiles.
Cela est confirmé par RTE3 qui indique que sur le marché de l’électricité, l’injection
d’électricité éolienne (prioritaire sur le réseau) se fait au détriment des moyens de
production les plus chers, et se substitue donc majoritairement aux centrales à combustibles
fossiles. Par exemple, les centrales à charbon, qui produisent à peu près autant d’énergie que
l’éolien en France, sont responsables de 50% des émissions de CO2 de la France.
On peut également constater que l’augmentation de la puissance installée des parcs éoliens
en France s’accompagne d’une baisse de la puissance installée des centrales thermiques à
combustible fossile (charbon, fioul et gaz) en observant le graphique suivant :
2
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-energie-eolienne.pdf
3
RTE, Bilan électrique 2011 http://www.rte-
france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/Bilan_electrique/RTE_bilan_electrique_2011.pdf
15Evolution de la puissance installée
30
Puissance Installée (GW)
25
20 thermique à
combustible
15 fossile
10 éolien
5
2010 2012 2014 2016 2018
Evolution de la puissance installée des centrales éoliennes et thermiques à combustible fossile en France de 2010 à
2018 – Source : compilation des bilans électriques nationaux de 2010 à 2018 - RTE4
L’ADEME estime à 300 g/kWh les émissions de CO2 évitées en France par l’éolien. Grâce à une
production de 27,8 TWh d’électricité d’origine éolienne en 2018, ce sont plus de 8,3 millions
de tonnes de CO2 par an qui ont été évitées grâce à la production éolienne terrestre.
E. Le bilan carbone de l’éolien – une énergie verte
« Avec 1000m3 de béton armé pour chaque éolienne, il est difficile de dire qu'elles sont
«propre». Le béton est le premier producteur mondial de CO². » C.EI.19
Pour être complet sur les impacts liés à la diminution de CO 2 proposées par les éoliennes, il
est nécessaire de calculer le bilan énergétique des éoliennes.
Sur ce point, nous pouvons nous appuyer sur plusieurs études menées, dont celle réalisée par
une revue de la littérature (Kubiszewski et al, 20115) portant sur 119 turbines analysées.
Les quelques 50 études ont mis en évidence un EROI (Energy Return On Investment, soit le
rapport entre l’énergie cumulée totale produite par l’éolienne et l’énergie primaire cumulée
nécessaire pour son installation et son entretien). L’éolienne produit en 20 ans 25,2 fois plus
d’énergie qu’il n’en a fallu pour la construire, l’entretenir, la démanteler. La dette énergétique
est donc remboursée en 240/25,2 mois, soit un peu moins de 10 mois.
Même constat fait dans l’étude comparative de différentes études sur l’analyse du cycle de
vie éolien6, présentée par Thierry de Larochelambert, qui conclut que « Toutes les analyses de
cycle de vie rigoureuses et indépendantes menées par les plus grands laboratoires
4
https://rte-france.com/fr/article/bilans-electriques-nationaux
5
http://www.eoearth.org/view/article/152560/
6
http://www.lyc-armand-mulhouse.ac-strasbourg.fr/IMG/pdf/Economie_EnergieEolienne_A.pdf
16universitaires dans le monde montrent que l'énergie éolienne est de loin celle qui offre le plus
faible temps de retour énergétique parmi tous les systèmes de production électrique,
renouvelables ou non. L'investissement éolien est donc, avec les investissements dans
l'économie et l'efficacité énergétique, l'investissement productif électrique le plus efficace à
réaliser en urgence pour le remplacement progressif des centrales nucléaires ».
Le temps de retour énergétique, c’est-à-dire le temps qu’il faudra au parc pour produire
autant d’énergie qu’il en aura fallu pour le construire, l’exploiter et le démanteler, sera
inférieure à 1 an, alors que la durée de vie des éoliennes est comprise entre 20 et 25 ans.
F. Création d’emploi et fabrication des éoliennes
Certaines observations remettent en question la création d’emploi : « Ces éoliennes ne créent
comme vous le savez aucun emploi» C.EI.26.
Un parc éolien bénéficie aussi à un nombre important d’acteurs économiques notamment au
travers du maintien voire de la création d’emplois. Les acteurs éoliens implantés en France
couvrent l’ensemble des segments de la chaîne de valeur, sur lesquels les emplois éoliens sont
répartis :
- Etudes et développement : bureaux d’études, mesures de vent, mesures
géotechniques, expertise technique, bureaux de contrôle, développeurs, financeurs…
- Fabrication de composant : pièces de fonderie, pièces mécaniques, pales, nacelles,
mâts, brides et couronnes d’orientation, freins, équipements électriques pour
éoliennes et réseau électrique…
- Ingénierie et construction : assemblage, logistique, génie civil, génie électrique parc et
réseau, montage, raccordement réseau…
- Exploitation et maintenance : mise en service, exploitation, maintenance, réparations,
traitement des sites…
Toutes ces activités contribuent au développement économique local et à la création
d’emplois temporaires et permanents.
Voici une évaluation de l’impact emploi pour le projet éolien de la Saussinais :
- L’année de la construction : 110 emplois en équivalent temps plein en France.
- Chaque année durant l’exploitation : 2 emplois en équivalent temps plein en France.
Ces résultats sont issus de calculs réalisés à partir de l’outil TETE (Transition Ecologique
Territoires Emploi), développé par le Réseau Action Climat et l’ADEME.
La filière éolienne représentait fin 2017 en France 17 100 emplois directs et indirects. Ce vivier
s’appuie sur 1070 sociétés actives, allant de la TPE au grand groupe industriel. Avec une
augmentation annuelle d'environ 8%, c’est l'un des secteurs économiques les plus
dynamiques de France. (Source : observatoire de l’éolien 2018).
Chaque jour en France, ce sont ainsi près de 4 emplois qui sont créés par la filière.
17A la fin de l’année 2017, l’éolien générait 771 emplois en Bretagne tant dans la partie « Etude
et développement », « Fabrication des composant », « Ingénierie et Construction » et «
Exploitation et maintenance » comme le montre la carte ci-dessous :
Cartes de l’implantation du tissu éolien dans la région Bretagne
(Source : Observatoire de l’éolien 2018 – Bearing Point)
Les développeurs comme EDF Renouvelables, connaissent également une croissance continue
depuis le début des années 2000. Aujourd'hui le groupe EDF Renouvelables regroupe 3853
salariés, répartis sur plusieurs agences dont son agence Nantaise couvrant les régions du
Grands Ouest. EDF Renouvelables France possède également deux centres de maintenance
en Bretagne à :
• ST GILLES (35) : 1 base logistique : 6 techniciens (2013)
• PONTIVY (56) : Antenne O&M: 5 techniciens
Développement du projet
Les bureaux d’études (exemples acoustiques, paysagères, avifaunistiques…) participent
pleinement à la dynamique du secteur. Les études du projet éolien de la Saussinais ont déjà
créé de l’activité dans les bureaux d’études nationaux puisque :
- L’étude faune/flore a été réalisée par le bureau d’étude Biotope basé à Nantes (44),
18- L’étude paysagère et l’étude d’impact ont été réalisées par le bureau d’étude Ceresa
basé à Rennes (35),
- L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude JLBI basé à Ploemeur (56)
Construction et exploitation du parc éolien
L’installation et la maintenance des parcs nécessitent de faire appel à des prestataires locaux;
des emplois sont ainsi directement créés dans les zones où sont implantées les éoliennes.
L’éolien participe à l’économie locale en privilégiant les acteurs locaux pour la réalisation des
réseaux, la fabrication du béton, l’acheminement des pièces, les travaux d’aménagements…
G. La pollution due aux éoliennes
« l’étude d’impact ne précise aucunement les dispositions qui seront à prendre pour éviter la
pollution de la nappe phréatique. » C1
Les matériaux constitutifs de la fondation (béton)
Des études géotechniques seront réalisées en amont des travaux pour le dimensionnement
des fondations. Les risques liés aux installations éoliennes sont faibles à négligeables et
concerneront essentiellement les risques de déversement accidentels de polluants lors de la
phase de chantier ou des opérations de maintenance. Des mesures de prévention seront
mises en place pour pallier à ce genre d’accident (cf. chapitre 7.1). Il est précisé que les
composants de la fondation (béton) sont inertes et qu’aucune pollution ne peut en être issue.
« la fabrication des éoliennes est très pollueuse ». C1
- Un matériau composant potentiel de la génératrice de certaines éoliennes
Le Néodyme fait partie des lanthanides, anciennement « terres rares ». Les lanthanides
présentent des propriétés physiques particulières, avec des températures de fusion et
d’ébullition particulièrement élevées (3074°C pour le néodyme).
Les lanthanides ont toujours été largement utilisés par l’industrie pour la fabrication
d’équipements de grande consommation tels que les tubes cathodiques pour la télévision
couleur, les écrans LCD ou plasma, les lampes basse consommation, les microphones, les
enceintes acoustiques et les pierres à briquet. Les lanthanides rentrent aussi dans la
composition d’alliages métalliques avec le fer, le cuivre ou le cobalt pour réaliser des puissants
aimants. Les lanthanides constituent alors des matériaux de choix en raison de leur énergie
magnétique considérable et de leur rapport poids/puissance très intéressant, ce qui permet
la réalisation d’aimants nécessaires à de nombreuses technologies (disques durs, moteurs
électriques des électroménagers, moteurs des voitures hybrides ou dans certaines
génératrices éoliennes à entrainement direct).
Dans le cadre éolien, il n’y a pas de risque d’émission dans l’environnement des lanthanides
emprisonnés dans l’alliage métallique compte tenu de leurs températures d’ébullition
particulièrement élevées (3074°C pour le néodyme). Il n’existe donc aucun risque toxique
connu ou prévisible, dans des conditions normales d’utilisation, quant à la présence de
19Vous pouvez aussi lire