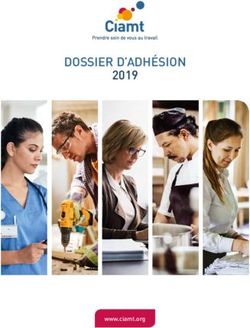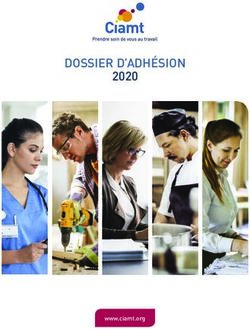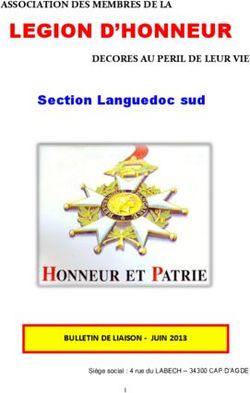Quelle était la religion des 46 présidents américains ? - Reforme.net
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Publié le 3 février 2021(Mise à jour le 3/02) Par Louis Fraysse Quelle était la religion des 46 présidents américains ? Joe Biden, le nouveau locataire de la Maison Blanche, n’est que le deuxième président catholique de l’histoire des États-Unis. 57 ans. C’est la période qu’il aura fallu attendre pour qu’un catholique soit de nouveau élu à la Maison Blanche. Comme son prédécesseur John Fitzgerald Kennedy, arrivé au pouvoir en 1961, Joe Biden est démocrate et d’ascendance irlandaise. Les deux hommes sont les deux seuls catholiques à avoir occupé la présidence – les catholiques comptent aujourd’hui pour près d’un cinquième de la population américaine. La Constitution américaine, rappelons-le, interdit tout test ou prérequis de nature religieuse pour l’attribution d’une fonction publique. Reste que la quasi-totalité des présidents des États-Unis étaient chrétiens. Pratiquement tous ont par ailleurs prêté serment sur une bible lors de leur cérémonie d’investiture, ce qui n’est pas non plus requis par la Constitution mais relève d’une coutume remontant à George Washington lui-même, le tout premier président du pays.
Épiscopaliens et presbytériens Si l’appartenance religieuse des présidents reflète celle de la société (en 2007, 78 % des Américains se définissait comme chrétiens, selon le Pew Research Center – une proportion tombée à 65 % douze ans plus tard), elle le fait toutefois à travers un miroir déformant. Parmi les 46 hommes qui se sont succédé à la Maison Blanche, presque la moitié étaient ainsi épiscopaliens ou presbytériens. Tant les presbytériens, qui s’inscrivent dans la tradition réformée, que les épiscopaliens, de rite anglican, incarnent dans le pays un protestantisme dit “mainline” (“historique”, “traditionnel”). On leur oppose habituellement les nombreux courants du protestantisme évangélique. Plus populaire, plus conservateur, ce dernier représente 25 à 30 % de la population, selon que l’on y inclut ou non les Églises protestantes noires, en majorité baptistes. Les Églises protestantes historiques, elles, rassemblent quelque 14 % des Américains. Le cas de Jefferson et de Lincoln Depuis l’après-Seconde Guerre mondiale, cependant, les présidents élus tendent à mieux refléter la diversité religieuse du pays. Les États-Unis ont ainsi connu des présidents épiscopaliens, bien sûr (Gerald Ford, George Bush senior), presbytériens (Dwight Eisenhower, Ronald Reagan), baptistes (Jimmy Carter, Bill Clinton), méthodiste (George W. Bush), quaker (Richard Nixon), calviniste (Lyndon Johnson, membre des Disciples du Christ) ou encore catholiques, comme on l’a vu. Quant à Barack Obama et Donald Trump, s’ils se définissent comme chrétiens, ils ne s’inscrivent pas dans un courant particulier. À travers l’histoire américaine, plusieurs autres présidents, et non des moindres, n’avaient pas d’appartenance religieuse précise. C’est notamment le cas de Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis et l’un des principaux rédacteurs de la Constitution. Ayant pris ses distances avec le christianisme, rapporte un article du Pew Research Center, ce père fondateur est notamment connu pour avoir édité sa propre version du Nouveau Testament – expurgée des miracles attribués à Jésus. En ce qui concerne l’emblématique Abraham Lincoln, président lors de la guerre de Sécession (1861-1865), les historiens débattent toujours de la nature de ses croyances religieuses.
Un Congrès représentatif ? Quant à l’actuel Congrès des États-Unis, l’équivalent du Parlement français, sa composition religieuse s’écarte à certains égards de celle de la population. 88 % des sénateurs et représentants se revendiquent ainsi du christianisme, contre 65 % des Américains. Les protestants (55 %), les catholiques (30 %) et les juifs (6 %) sont surreprésentés par rapport à leur poids dans la société – respectivement 43 %, 20 % et 2 %. Deux groupes, à l’inverse, sont largement sous-représentés. Seuls 0,4 % des élus à la Chambre des représentants et au Sénat sont pentecôtistes, alors que le pentecôtisme réunit 5 % de la population. Mais c’est surtout vis-à-vis des personnes “sans religion” que l’écart est le plus net. Alors qu’elles représentent aujourd’hui un quart de la population américaine, leur proportion au Congrès ne s’élève qu’à… 0,2 %. À lire également : États-Unis : le président élu doit-il obligatoirement prêter serment sur la Bible ? Élu président, Joe Biden appelle à “restaurer l’âme de l’Amérique” États-Unis : Kamala Harris, colistière de Joe Biden et protestante baptiste États-Unis : l’assaut du Capitole, ultime legs de Donald Trump ?
Publié le 28 janvier 2021(Mise à jour le 28/01) Par Noémie Taylor-Rosner Josh Dickson, un évangélique à la Maison Blanche Cet ex-républicain très impliqué dans la campagne de Joe Biden est aujourd’hui pressenti pour diriger le Bureau pour les partenariats avec les organisations confessionnelles et de proximité à la Maison Blanche. Ce bureau qui fait le lien entre la Maison Blanche et les communautés religieuses du pays pourrait jouer un rôle clef dans la reconstruction d’une nation ultra-divisée. Du haut de ses 36 ans, Josh Dickson est aussi discret que Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump, était exubérante. Encore peu connu des médias, ce jeune évangélique à la barbe blonde et au sourire timide a pourtant joué, en coulisse, un rôle de premier plan dans la campagne présidentielle de Joe Biden. C’est à lui que le camp démocrate a confié la lourde tâche de tenter de convaincre les leaders religieux et les croyants du pays de voter pour l’ancien vice-président américain. L’équipe de Joe Biden entendait notamment profiter de l’érosion du soutien d’un certain nombre de chrétiens républicains à Trump pour conquérir une partie de son électorat, de plus en plus mal à l’aise face au scandale des enfants migrants séparés de leurs parents, aux innombrables frasques du président et à la montée
des tensions raciales. « Nous avons notamment vu un nombre grandissant d’évangéliques descendre dans les rues, parler du mouvement Black Lives Matter et lui apporter leur soutien », expliquait il y a quelques mois Josh Dickson au Christian Post. Parmi eux, « se trouvaient des pasteurs très connus et des élus issus de milieux évangéliques ». Guerre pour le vote évangélique Pendant des mois, les équipes de Donald Trump et de Joe Biden se sont livré une guerre sans merci autour du vote évangélique, un électorat clef comptant un peu plus de 90 millions de personnes, soit environ un quart de la population adulte américaine. Tandis que le milliardaire républicain tentait de discréditer la sincérité de l’engagement religieux de son adversaire et multipliait les gestes à l’encontre des évangéliques blancs (sa base électorale qui l’a soutenu à plus de 80 % en 2016), Josh Dickson, lui, menait des réunions secrètes avec des leaders religieux de plus en plus réfractaires à Trump, dont certains responsables de la très influente National Association of Evangelicals. Cette association qui compte plus de 45 000 églises issues d’une quarantaine de dénominations différentes – libérales comme conservatrices –, avait à plusieurs reprises critiqué en filigrane la politique migratoire de Trump et appelé ses adhérents à se repentir de ne s’être pas montrés assez généreux envers les migrants ou les personnes issues de minorités. La stratégie déployée par Josh Dickson s’est révélée payante le 3 novembre. Des sondages ont montré que le soutien des évangéliques blancs à Donald Trump avait baissé par rapport à 2016, passant de 81 à 78 %. Un glissement certes léger mais suffisant pour permettre à Joe Biden de s’imposer sur le fil dans certains États clefs comme la Pennsylvanie, le Wisconsin ou encore la Géorgie. Dans ce dernier État, où plus d’un électeur sur trois est un évangélique conservateur, le démocrate a remporté 14 % du vote évangélique blanc, là où Hillary Clinton n’était parvenue à séduire que 5 % d’entre eux en 2016. Un ancien sympathisant de Bush Le fait que Josh Dickson soit lui-même évangélique a indubitablement aidé à convaincre certains de ses coreligionnaires de tourner le dos à Donald Trump.
Quant à son ralliement à Joe Biden, il est le fruit d’un long cheminement personnel. Josh Dickson, qui a grandi à Rochester dans la région de New York, au sein d’une famille protestante très pieuse, n’aurait jamais pu imaginer qu’il exercerait un jour des responsabilités au sein de l’équipe de campagne d’un candidat démocrate. « Mon père, trois de ses frères, ses parents et ses grands-parents sont tous passés par l’Institut biblique Moody (un établissement chrétien évangélique basé à Chicago, NDLR) », racontait-il l’été dernier à l’agence Religion News Service, quelques mois avant la présidentielle. Enfant, il fréquente aussi deux églises évangéliques, l’American Baptist Church et la Free Methodist Church. Fidèle aux idées du milieu conservateur dans lequel il a baigné, il vote George W. Bush en 2004. Mais quelques années plus tard, son expérience d’enseignant dans une banlieue pauvre du Sud-Ouest de Chicago va lui ouvrir de nouvelles perspectives et changer sa vision du monde : « J’ai compris que les jeunes enfants auxquels j’enseignais étaient bloqués dans leur apprentissage par des barrières systémiques. Toutes ces inégalités m’ont poussé à repenser la compréhension que j’avais de ma foi et tout particulièrement les enseignements de Jésus. » Panser les plaies d’une Amérique ultra- divisée Au début des années 2010, il s’engage auprès des jeunes démocrates avant de rejoindre la campagne de Joe Biden en 2020. Ses efforts pourraient être bientôt récompensés : Josh Dickson est aujourd’hui pressenti pour prendre la tête du Bureau pour les partenariats, qui fait le lien entre la Maison Blanche et les communautés religieuses aux États-Unis. Alors que l’Amérique est plus divisée que jamais après quatre années de présidence Trump, cette agence pourrait jouer un rôle déterminant en aidant le pays et ses croyants à renouer le dialogue. Dickson pourrait se révéler un excellent médiateur entre le monde évangélique américain qu’il connaît bien et le camp démocrate qu’il côtoie depuis une dizaine d’années maintenant. Les obstacles s’annoncent toutefois nombreux : les démocrates entendent notamment revenir sur l’amendement Hyde qui interdit au gouvernement fédéral de financer des avortements. Joe Biden a aussi promis de faire adopter l’Equality
Act, une loi interdisant les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle, à laquelle s’opposent certains conservateurs qui estiment qu’elle porte atteinte au respect des libertés religieuses. En revanche, Josh Dickson se dit confiant : des terrains d’entente peuvent être trouvés entre croyants conservateurs et libéraux sur des sujets comme la pauvreté, le racisme systémique, les réfugiés ou encore la crise du coronavirus qui a fait plus de 400 000 morts aux États-Unis. Comme il aime à le répéter : « Les choses qui nous rassemblent sont plus nombreuses que celles qui nous divisent. » Noémie Taylor-Rosner, correspondance de Los Angeles Plus d’articles sur les évangéliques américains La gauche évangélique américaine, un ovni politique ? Élections américaines : les évangéliques conservateurs fidèles à Trump, envers et contre tout Aux États-Unis, les évangéliques divisés sur la double nature de Jésus Aux États-Unis, le dirigeant évangélique Jerry Falwell démissionne, à la suite de scandales sexuels Pour certains évangéliques américains, Donald Trump est un nouveau Cyrus
Publié le 21 janvier 2021(Mise à jour le 2/02) Par Philippe Malidor États-Unis: les accents religieux de la cérémonie d’investiture de Joe Biden Philippe Malidor, conseiller presbytéral, livre son regard sur l’investiture de Joe Biden, le 20 janvier et rend compte d’une cérémonie quasi liturgique. Regardée en direct sur CNN, l’investiture de Joseph Biden en tant que 46 e président des États-Unis avait de quoi être émouvante. L’Amérique telle qu’on l’aime, avec sa joie retrouvée, son métissage revendiqué (la vice-présidente Kamala Harris a été la première femme noire et indienne à prêter serment), ses grands sentiments, son optimisme, son exubérance (au moins, ils savent chanter !). Et sa religion civile, très déconcertante dans une fédération pourtant laïque. Citation de l’épître de Jacques (1, 5) pour invoquer la sagesse divine sur les nouveaux élus et prestations de serments sur la Bible tandis que le nouveau président, pour conclure une allocution en forme de prédication, propose un temps de « prière silencieuse ». Temps que des commentateurs français ont transformé en « minute de silence »… Enfin, la prière très énergique de ce pasteur noir (bien que Biden soit catholique) a notamment rappelé que « de nos ennemis nous ferons des amis ».
Comme un écho au rêve de Martin Luther King Un peu plus tôt, pour mettre fin à quatre années d’uncivil war (« guerre incivique »), le Président avait déclaré : « Les désaccords ne sont pas un motif de guerre totale ». Une façon de souligner qu’on a le droit d’avoir des avis différents et que l’unité reste malgré tout possible autour de valeurs essentielles claires. Jamais on n’avait entendu, en écho au rêve de Martin Luther King, la promesse de combattre explicitement le suprémacisme blanc. « J’y mettrai toute mon âme », a martelé Biden, citant Abraham Lincoln puis Saint-Augustin. À nos sociétés relativistes, après quatre ans de fake news (« fausses informations »), il a rappelé que la vérité se distingue clairement du mensonge, lequel sert la puissance et le profit personnel. Ce que El País a appelé « le voyage au bout de la nuit » s’arrête ici. Le chanteur de country Garth Brooks a pris le micro et invité chacun à reprendre, y compris à la maison, le fameux « Amazing Grace ». Que cet hymne ait été composé par un trafiquant d’esclaves repenti n’est pas anodin. Les États-Unis s’éveillent comme après une nuit trop alcoolisée. Il n’est pas déshonorant de le reconnaître, et de retrouver une saine sobriété. Publié le 19 janvier 2021(Mise à jour le 20/01) Par Louis Fraysse
États-Unis : l’assaut du Capitole, ultime legs de Donald Trump ? Alors que Joe Biden s’apprête à succéder à Donald Trump, Réforme a proposé à deux historiens de réfléchir au trumpisme et au tournant qu’a constitué l’assaut du Capitole, le 6 janvier dernier. Le 20 janvier 2021, le démocrate Joe Biden sera officiellement investi 46e président des États-Unis d’Amérique. Donald Trump, le premier président de l’histoire du pays à être visé par deux procédures de destitution, a annoncé qu’il ne participerait pas à la cérémonie d’investiture de son successeur. Le milliardaire refuse toujours de reconnaître sa défaite lors de l’élection de novembre dernier, une élection entachée selon lui de fraudes massives – sans qu’il en ait fourni la moindre preuve. Chercheuse associée à l’université Paris-3 Sorbonne nouvelle, Maya Kandel est une spécialiste reconnue de la politique étrangère américaine. Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, Romain Huret est l’un des meilleurs connaisseurs du conservatisme américain. Le 6 janvier dernier, une foule de manifestants proTrump ont pénétré de force dans l’enceinte du Capitole, à Washington D. C., pour contester la validation par le Congrès de l’élection de Joe Biden. Au-delà de la violence de cet assaut, on est frappé par sa portée symbolique. Que nous dit cet épisode de l’état du pays aujourd’hui ? Maya Kandel : Ce qui s’est déroulé au Capitole le 6 janvier est à la fois logique mais choquant, prévisible mais sidérant. Prévisible, car depuis plusieurs décennies, le Parti républicain a entrepris un glissement vers la droite, dont la présidence de Donald Trump marque l’aboutissement. Avec le milliardaire, l’extrême droite est entrée à la Maison Blanche et, pour le dire schématiquement, l’extrême droite n’aime pas rendre le pouvoir une fois qu’elle l’a acquis. Par ailleurs, cela faisait des mois que les analystes mettaient en garde contre le risque de violences de nature politique en cas de défaite du candidat républicain. Cela étant dit, la prise du Capitole constitue un choc, elle est le signe qu’un nouveau palier a été franchi. Cet événement sans précédent est une atteinte
directe aux institutions des États-Unis et au processus démocratique, dont la transition ordonnée du pouvoir constitue une caractéristique fondamentale. Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat et allié fidèle de Trump, ne s’y est pas trompé lorsqu’il a qualifié ces violences d’attaque « contre la souveraineté du peuple qui légitime notre République ». Romain Huret : Nous venons assurément d’assister à un moment extraordinaire, dont on mesure mal encore les conséquences à long terme. Jamais on n’avait vu un président appeler ouvertement à jouer ainsi avec les limites du légal et de l’illégal, à remettre en cause de façon systématique la légitimité de l’exercice démocratique. Quant à la dimension symbolique de cette occupation physique, violente, de l’un des lieux fondateurs de la nation américaine, elle saute aux yeux. Les militants qui sont entrés de force dans le Capitole ne l’ont pas fait par hasard ; occuper ce lieu est une manière de signifier que les élus à Washington ne sont pas les vrais dépositaires de la démocratie, cette dernière appartenant au peuple américain, qui est prêt à la défendre les armes à la main si nécessaire. Vous reliez l’attaque du Capitole à la “militarisation” de la société américaine. Comment expliquer ce phénomène ? R. H. : Les États-Unis ne se voient pas assez comme ce qu’ils sont, à savoir une société en guerre. Depuis l’après-Seconde Guerre mondiale, le pays vit dans un état de guerre permanent, largement accentué après le 11 septembre 2001. La militarisation de la société est entretenue par le complexe militaro-industriel, qui emploie des millions d’Américains, et plus encore par l’engagement de millions d’hommes et de femmes dans des théâtres d’opérations militaires. Aujourd’hui, le pays compte deux millions de soldats et quelque dix-huit millions d’anciens combattants. Cela fait donc vingt millions de personnes, sans même parler de leurs familles, qui ont connu l’expérience du feu, soit environ 9 % de la population. C’est considérable. Or les guerres qu’ont menées les États-Unis, en Irak ou en Afghanistan, ont été extrêmement violentes, et l’on sait les séquelles physiques et psychologiques qu’elles laissent sur les militaires de retour du front. Des militaires qui constituent des recrues de choix pour les milices paramilitaires… R. H. : Nombre de ces anciens combattants peinent à se réinsérer dans la vie civile, à suivre les traitements médicaux qui s’imposent à eux étant donné leur
état de fragilité mentale – le suicide et la crise des opiacés ont fait des ravages parmi eux. Comme l’a très bien montré l’historienne Kathleen Belew, un certain nombre de ces ex-soldats ont trouvé dans les milices paramilitaires des espaces de sociabilité, de camaraderie, un point de repère dans leurs vies. Longtemps à la marge du mouvement conservateur, car considérées comme trop radicales, ces milices ont bénéficié de l’accession au pouvoir de Donald Trump, qui leur a accordé son soutien. La translation semble évidente entre cette poudrière sociale qu’est la militarisation de la société et l’explosion ponctuelle de violences, à l’image du 6 janvier. Dans notre société française pacifiée et sécularisée, on peine à saisir l’influence de l’armée et de la religion sur la société américaine, deux éléments pourtant structurels. Comment cela ? R. H. : La lecture religieuse du trumpisme (voir Réforme n° 3867 et sur reforme.net) est fondamentale pour comprendre les motivations de ses acteurs. Il en va de même pour sa lecture militaire. À plusieurs reprises dans son histoire, la France a connu des moments où les anciens combattants étaient très nombreux dans la société. Les historiens parlent à ce sujet de “brutalisation” du corps social, soit la traduction, dans la vie civile, en temps de paix, de l’expérience de guerre. On a alors des millions de personnes qui ont connu le feu et qui en gardent des traces, jusque dans leur comportement ou leur vocabulaire. Ce que peut enseigner la vieille Europe aux États-Unis, c’est que l’on n’engage pas autant de soldats dans des conflits violents sans en subir à terme les effets dans l’ensemble du corps social. L’un des grands enjeux de la présidence de Joe Biden sera de réussir à réinsérer ces anciens combattants dans la vie civile. “Avec le recul que nous offre ce premier mandat, il s’avère que la présidence de Donald Trump incarne à merveille le concept de “tribalisme” en politique” Vous avez utilisé le mot « trumpisme ». Comment définiriez-vous ce mouvement ? R. H. : Le trumpisme incarne selon moi la version la plus épurée, la plus radicale et la plus violente du conservatisme américain. Ce dernier se caractérise par sa profonde diversité : il y a ainsi des conservateurs sociaux, fiscaux ou encore religieux. Donald Trump s’est emparé de chacune des facettes du conservatisme
et les a renvoyées à leur radicalité la plus extrême, et sa personnalité même lui a permis de trouver un écho au sein d’une frange de la population qui lui est restée particulièrement fidèle. Si l’on étudie dans le détail la parole du milliardaire, on constate que chacun peut se reconnaître dans ses propos. En restant somme toute assez vague sur le fond, mais en employant un langage direct, décomplexé, Donald Trump a noué une relation fusionnelle avec ses partisans, qui se retrouvent dans sa personne, même s’ils viennent d’horizons différents – chrétiens évangéliques, ouvriers de la Rust belt [littéralement « Ceinture de la rouille », région industrielle du nord-est des États-Unis en plein déclin, ndlr] ou membres de milices suprémacistes par exemple. M. K. : La grande force de Donald Trump est d’être parvenu à mobiliser des millions d’Américains qui, auparavant, ne participaient pas à la vie politique. Ces militants sont avant tout attachés à sa personne, et l’on peut se demander ce qu’ils vont faire si le milliardaire disparaît du paysage politique – c’est sans doute la préoccupation première de la majorité des élus républicains à l’heure actuelle. Avec le recul que nous offre ce premier mandat, il s’avère que la présidence de Donald Trump incarne à merveille le concept de “tribalisme” en politique. On doit notamment cette notion à la politologue Liliana Mason qui démontre, dans l’un de ses ouvrages, comment les identités partisanes, idéologiques, religieuses et raciales des Américains se sont progressivement alignées, rendant les partis républicain et démocrate de plus en plus homogènes. Pour Mason, cet « alignement » identitaire a des conséquences politiques majeures. Quand la politique devient une question identitaire, il est en effet de plus en plus difficile d’établir le moindre compromis, et chaque électorat devient à la fois plus partial et moins tolérant vis-à-vis du bord opposé. Cette notion de tribalisme est particulièrement utile pour comprendre le soutien indéfectible de dizaines de millions d’électeurs républicains à Donald Trump, malgré les nombreux revirements de ce dernier : si l’affiliation à un parti est une affaire d’identité, écrit Liliana Mason, alors les positions politiques concrètes importent peu ; elles peuvent être modifiées au gré du positionnement du parti ou de son leader. Le génie de Trump est donc d’être parvenu à s’adresser directement aux différents groupes qui composent le Parti républicain en parlant avant tout à leurs identités, et en saisissant cette angoisse de « perte de statut » qui définit les motivations du vote populiste, comme l’a montré par exemple la politiste Pippa Norris.
R. H. : Cette dimension identitaire est en effet essentielle pour comprendre le trumpisme. À bien des égards, ce dernier s’inscrit dans la continuité du Tea Party, ce grand mouvement populaire de protestation fiscale qui avait submergé le pays en 2009. Mais là où le ciment du Tea Party était l’économie, le trumpisme repose avant tout sur une obsession identitaire. La thématique de la défense de l’identité blanche et chrétienne n’est pas chose nouvelle aux États-Unis, on peut penser à l’émergence puis au retour du Ku Klux Klan, aux XIXe et XXe siècles. La différence, c’est que Donald Trump et les idéologues qui l’entourent ont replacé ce combat identitaire dans un contexte mondial, avec leur soutien apporté au Brésil de Jair Bolsonaro et à la Hongrie de Viktor Orban. M. K : Le trumpisme est aussi le produit direct de l’évolution du Parti républicain depuis une quarantaine d’années. Dans les années 1980, Newt Gingrich, futur président de la Chambre des représentants, met au point une stratégie pour rendre aux républicains le contrôle du Congrès. Ces derniers, argue-t-il, doivent tenir un discours “antisystème” et “anti-élites” décomplexé. Le trumpisme, on l’a beaucoup souligné, est un populisme : il repose sur l’idée qu’il existe un “vrai” peuple, qui a légitimement le droit de reprendre le pouvoir aux “élites” de Washington. En refusant systématiquement de condamner les suprémacistes blancs qui le soutiennent, Donald Trump a greffé à ce populisme une forte composante ethnoculturelle, soit la défense de l’identité blanche et chrétienne des États-Unis, menacée par la progression démographique des minorités et par l’idéologie des progressistes (liberals, en anglais). J’ajouterais à cela une réelle dimension antidémocratique, illustrée par les obstacles que doivent affronter certains électeurs pour pouvoir voter dans certains États républicains – aucune autre démocratie moderne n’impose des heures d’attente à ses citoyens qui souhaitent exercer leur devoir civique. R. H. : Parmi les manifestants qui ont participé à l’assaut du Capitole, il y a pourtant la conviction profonde de participer à une action démocratique. Tout comme le Tea Party, qui rejouait à sa façon un épisode emblématique de l’histoire américaine, ces partisans de Trump ont le sentiment de défendre la démocratie américaine originelle, une démocratie directe, transparente, dans laquelle le peuple exerce le pouvoir. Aux côtés de la Bible, la Constitution est érigée en texte sacré, louée pour sa simplicité et la liberté qu’elle accorde à l’individu. À cette vision pure et largement fantasmée de l’exercice démocratique, on oppose les élus, les lobbys et les agents de l’État fédéral, accusés d’avoir capturé, dénaturé
l’idéal des Pères fondateurs. De façon paradoxale, ces militants sont prêts à désobéir aux lois de la démocratie actuelle pour promouvoir, y compris par la force, leur propre vision de la démocratie. Maya Kandel, vous écrivez dans un article paru dans la revue Le Grand Continent qu’il faut « reconnaître à Trump d’avoir provoqué aux États- Unis le plus large débat sur les objectifs, les moyens et la finalité de la politique étrangère depuis des décennies ». Pouvez-vous préciser votre pensée ? M. K. : Barack Obama, le successeur de George W. Bush, président de la guerre en Irak, avait annoncé que les États-Unis n’avaient plus les moyens d’être les “gendarmes du monde” ; il avait aussi amorcé une réflexion sur la raison d’être de l’exceptionnalisme américain. Le fait est qu’à l’époque, la politique étrangère interventionniste du pays n’était déjà plus en phase avec les attentes d’une majorité de la population. Donald Trump, lui, a fait de la redéfinition du rapport au monde des États-Unis un axe majeur de sa campagne de 2016. Qualifiée de “jacksonnienne”, en référence au président Andrew Jackson (1767-1845), la “doctrine Trump” en matière étrangère rejette par principe toute mission universelle : America First, “l’Amérique d’abord”. Le milliardaire a su répondre aux inquiétudes de sa base électorale, qui se considère comme perdante dans la mondialisation face à une “élite” mondialisée, volontiers qualifiée d’anti-américaine. Le trumpisme a donc consacré l’évolution idéologique du Parti républicain, dont l’opposition viscérale à toute forme de multilatéralisme ou de gouvernance mondiale est allée croissant depuis plusieurs décennies, la Constitution étant brandie comme seule source de légitimité et de droit. Donald Trump a parachevé cette mutation, en retirant son pays de l’Unesco et de la Commission des droits de l’homme de l’ONU et en tenant un discours agressif à l’endroit des Européens, accusés d’être des “profiteurs”. Notons toutefois que tout au long du mandat de Trump, le Congrès, y compris les élus républicains, a su faire barrage au président sur un certain nombre de points, comme la défense de l’Otan, le maintien d’une position dure contre la Russie et la préservation du budget de la diplomatie. Toute la question, maintenant, est de savoir ce que le Parti républicain va faire de cet héritage du trumpisme – au sujet des alliances ou vis-à-vis de la Chine, qui pourrait bien
devenir le nouvel adversaire idéologique par essence, dans une sorte de nouvelle guerre froide. “Le trumpisme incarne selon moi la version la plus épurée, la plus radicale et la plus violente du conservatisme américain” Quels sont les défis que va devoir affronter Joe Biden ? M. K. : Ils sont immenses. En politique étrangère, il va s’agir pour l’administration Biden de rétablir la confiance avec les alliés traditionnels des États-Unis et de renforcer l’engagement diplomatique du pays. Mais je pense que dans les mois à venir la politique étrangère va passer au second plan, car le nouveau président va avant tout s’attacher à répondre aux difficultés intérieures, en premier lieu la pandémie et la récession économique qu’elle a causée. R. H. : Ne nous y trompons pas : les États-Unis traversent actuellement une crise extrêmement grave. Tous les indicateurs sociaux sont au rouge dans le pays, frappé de plein fouet par la pandémie et le fléau des opiacés, et l’on ne peut pas exclure un risque d’effondrement généralisé, comme on a pu le voir par le passé en URSS. Je pense que Joe Biden, qui a fait campagne sur l’empathie, la compassion, aura à cœur de rétablir une vieille tradition américaine, celle de l’État “compatissant” (Sympathetic State). Il s’agit là d’un État qui intervient au moment des catastrophes, pour soutenir les plus fragiles, les plus démunis, en investissant largement dans l’économie. M. K. : Joe Biden devra également tenir compte de l’aile progressiste du Parti démocrate, qui a déporté à gauche le centre de gravité du parti. Au Congrès, ces élus, dont la figure emblématique est la jeune représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez, n’hésitent plus à se revendiquer du « socialisme », terme autrefois anathème dans le pays. Outre leur souci de “justice raciale”, manifeste dans leur soutien au mouvement Black Lives Matter, ils défendent une politique étrangère et commerciale “pour les classes moyennes américaines”, rejoignant en cela la doctrine trumpiste. Mais contrairement à cette dernière, ils militent activement pour la prise en compte d’un défi jugé existentiel pour les États-Unis et le monde : le changement climatique, que Trump avait balayé du revers de la main. C’est une priorité absolue pour l’électorat démocrate. R. H. : L’émergence de cette aile progressiste au sein du Parti démocrate
correspond tout simplement à l’évolution de la société américaine, caractérisée par une grande diversité sociale, ethnique et culturelle. Là où l’administration Trump renvoyait à une Amérique quelque peu idéalisée, celle, blanche, des années 1950, l’administration Biden veut brandir un miroir à la société telle qu’elle est aujourd’hui. Reste qu’il est très difficile, pour une partie de la population, d’accepter cette évolution démographique, qui va faire à terme des Blancs une minorité comme les autres aux États-Unis. C’est là quelque chose d’insupportable pour une grande partie des électeurs de Donald Trump, qui voient dans ces changements une menace existentielle. Lors d’un grand entretien accordé à Réforme en janvier 2018, vous reveniez, Maya Kandel, sur l’extrême “polarisation” de la vie politique américaine. Trois ans plus tard, alors que Donald Trump va quitter le pouvoir, s’est-elle résorbée ou au contraire accentuée ? M. K. : Tout au long de sa présidence, Donald Trump s’est nourri et a alimenté cette polarisation, en faisant uniquement la politique de ses électeurs, sans jamais prétendre agir au nom de tous les Américains – ses adversaires étaient des losers (“ratés”), des haters (“rageux”, “aigris”), etc. Au-delà de la violence de la parole présidentielle, le problème majeur pour la démocratie américaine tient à l’absence de bases communes entre les Américains ; une partie croissante d’entre eux ne s’accordent désormais plus sur les faits, sur ce que constitue une information fiable. Ces quatre années de mensonges, de manipulation de l’information et d’attisement des divisions de la part de Donald Trump ont eu pour résultat, pour reprendre une expression de mon confrère Corentin Sellin, qu’aujourd’hui une partie des États-Unis a tout simplement « fait sécession avec la réalité ». R. H. : Les États-Unis sont aujourd’hui confrontés à un moment de défiance généralisée d’une partie de la population contre toute forme d’autorité, qu’elle soit politique, sociale ou scientifique. Or, toute société a besoin d’autorités, ne serait-ce que, dans le cas actuel, pour surmonter la pandémie. On sait le rôle que jouent certains accélérateurs, comme les réseaux sociaux, dans la propagation de cette hostilité de principe aux discours d’autorité. L’un des défis majeurs de Joe Biden sera de parvenir à reconstruire un centre dans la vie politique, sans quoi les tensions au sein de la société vont continuer à croître et à saper encore davantage la démocratie américaine.
M. K. : En alimentant la peur, en multipliant les mensonges, en usant d’un vocabulaire martial, Donald Trump a contribué à radicaliser une partie de la population, qui représente une frange importante de l’électorat républicain (un quart, à un tiers). Je n’emploie pas ce terme de « radicalisation » par hasard, car l’histoire nous enseigne, des guerres des Balkans aux attentats djihadistes, qu’il est extrêmement difficile de déradicaliser les personnes radicalisées. L’héritage de Trump, c’est aussi qu’une majorité de républicains considèrent le président Biden comme illégitime. Ce dont témoigne le mandat de Donald Trump, et l’assaut du Capitole en est l’emblème, c’est qu’à force de pulvériser les normes, on finit par atteindre les institutions. La démocratie, rappelons-le, n’est pas invulnérable. Propos recueillis par Louis Fraysse Aller plus loin Les États-Unis et le monde. De George Washington à Donald Trump, Maya Kandel, Perrin, 2018, 18 €. “Le conservatisme national américain. La nouvelle droite américaine et le monde“, Le Débat, 2020 (n° 208). Le blog de Maya Kandel : froggybottomblog.com “Climat, une guerre américaine”, un documentaire coécrit par Romain Huret et Cédric Tourbe, sur france.tv jusqu’au 16 février 2021.
Publié le 19 janvier 2021(Mise à jour le 26/01) Par Louis Fraysse États-Unis : le président élu doit-il obligatoirement prêter serment sur la Bible ? Les présidents élus américains ont pour coutume de prêter serment une main posée sur une bible. Mais qu’en dit la Constitution ? C’est un moment toujours solennel, empreint de gravité. Tous les quatre ans, le 20 janvier, lors de la cérémonie d’investiture, le président élu des États-Unis prête serment en énonçant cette phrase tirée de la Constitution américaine, article II, section une, alinéa 8 : “Je jure (ou je déclare) solennellement que je remplirai fidèlement les fonctions de président des États-Unis et que, dans toute la mesure de mes moyens, je sauvegarderai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis.” Traditionnellement, le Juge en chef (Chief Justice) de la Cour suprême prononce ce serment avant que le président élu ne le répète mot à mot, la main droite levée et la gauche posée sur une bible. Toutefois, tout comme le “Help me God” (“Que Dieu me vienne en aide”), prononcé en guise de conclusion par tous les présidents depuis Chester A. Arthur en 1881, la Constitution n’impose en aucun cas de prêter serment sur la Bible, ou sur tout autre texte d’ailleurs. Défendre la Constitution L’article VI, alinéa 3 de la Constitution l’indique noir sur blanc : “Les sénateurs et représentants susmentionnés, les membres des diverses législatures des États et
tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant des États-Unis que des divers États, seront tenus par serment ou affirmation de défendre la présente Constitution ; mais aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition d’aptitude aux fonctions au charges publiques sous l’autorité des États- Unis.” Au XVIIIe siècle, au Royaume-Uni, tout futur titulaire d’une charge publique se doit d’attester des doctrines religieuses de l’Église d’Angleterre et de prêter allégeance au souverain. Une pratique contre laquelle vont s’élever les pères fondateurs, soucieux de garantir la liberté religieuse dans la jeune république américaine. Si la prestation de serment est maintenue, il ne s’agit plus de jurer de “protéger et défendre” le roi ou la reine… mais la Constitution elle-même. Une coutume bien ancrée Prêter serment sur la Bible n’est donc pas un prérequis pour devenir président des États-Unis. Lors de sa cérémonie d’investiture, le 4 mars 1825, John Quincy Adams, le sixième président américain, utilisa ainsi un livre de droit constitutionnel. La religion chrétienne, cela étant dit, est constitutive de la formation des États- Unis. Et lorsque son premier président, George Washington, prêta serment, le 30 avril 1789, il le fit sur une bible. La coutume, depuis, est restée ; Joe Biden n’y dérogera pas. Le second président catholique de l’histoire du pays a annoncé qu’il prêterait serment sur une bible familiale du XIXe siècle, la même qu’il avait utilisée lors de son entrée au Sénat, il y a tout juste 48 ans. À lire également : États-Unis : l’assaut du Capitole, ultime legs de Donald Trump ?
Publié le 14 janvier 2021(Mise à jour le 14/01) Par Sophie Esposito Film : “No Country for Old Men”, course poursuite métaphorique Cavale haletante et jubilatoire ou journal d’un shérif désabusé et philosophe ? No Country for Old Men est une épopée macabre teintée d’humour à froid et une puissante méditation sur la déshumanisation d’un monde. Dans No Country for Old Men (Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme), sorti en 2008, les frères Coen reviennent explorer la mythique frontière américano- mexicaine de leurs débuts au cinéma en 1984. Ils adaptent le roman de Cormac McCarthy : l’histoire d’un trafic de drogue qui tourne mal au Texas, en 1980. C’est linéaire, sans musique, parfaitement rythmé, avec un sens du tempo qui s’ajoute à la beauté de la photographie. Le fuyard, le tueur et le redresseur de torts forment un trio de personnages masculins passionnant. Mention spéciale pour Javier Bardem en psychopathe déglingué qui symbolise la violence gratuite et sa toute-puissance terrifiante. L’action avance grâce aux ruptures de ton (tristesse, ironie, mélancolie) et au mélange des genres : des grands espaces contemplatifs du western à l’angoisse du film de survie, en passant par le suspense du polar et l’errance du road-movie. C’est intense et virtuose ! On y parle du temps qui passe et des choses qui changent. D’une
époque devenue implacable et cynique du point de vue d’un vieux shérif en plein questionnement. Un homme de loi, honnête et droit, désemparé par la violence des nouvelles formes de criminalité. Interrogeant notre liberté d’agir, le film est une belle allégorie de la déchéance d’une société américaine fondée sur la violence et la fausse providence du dollar… Attention, contenu choquant pouvant heurter la sensibilité des personnes. À voir No Country for Old Men, Joël et Ethan Coen, diffusion jeudi 14 janvier à 21 h 05, sur France 3, durée 1 h 40. Publié le 8 janvier 2021(Mise à jour le 19/01) Par Rédaction Réforme Stanley Hauerwas : “Nous vivons les derniers jours de la Réforme” Dans cet entretien accordé à l’équipe de Réforme, le célèbre théologien américain revient sur une année 2020 mouvementée aux États-Unis et esquisse quelques pistes pour l’avenir.
Né en 1940 à Dallas, aux États-Unis, le méthodiste Stanley Hauerwas est l’un des grands théologiens protestants contemporains. Auteur prolifique, il a notamment consacré de nombreux travaux aux questions d’éthique. Peu de ses ouvrages ont été traduits en français, comme Des étrangers dans la cité (Cerf, 2016) et L’Amérique, Dieu et la guerre (Bayard culture, 2018). Dans cet entretien donné à Réforme à la fin de l’année passée, il dresse un bilan sans concession des défis auxquels son pays est confronté, et expose ce qu’être chrétien signifie aujourd’hui dans un monde marqué par la pandémie. Quel est votre regard sur la situation inédite qu’ont traversée les États- Unis lors de la dernière élection présidentielle ? Nous avons connu une crise constitutionnelle d’une extrême gravité. Comme toute démocratie digne de ce nom, la démocratie américaine repose sur l’État de droit, et l’État de droit a tant été malmené par Donald Trump que je crains qu’il ne soit difficile de s’en remettre. Le rôle qu’ont joué les chrétiens, tout au long du mandat de Trump, a été profondément ambigu. En le soutenant sans ambages, la droite religieuse et plus particulièrement les évangéliques se sont discrédités, au point que nous risquons d’assister je pense à la fin du témoignage évangélique aux États-Unis. Le problème, avec les évangéliques américains, est qu’ils sont américains avant d’être chrétiens, et on l’a vu de façon très nette dans leur soutien sans faille au président. Dans les années 1990, ces mêmes évangéliques tenaient un discours extrêmement critique à l’endroit de Bill Clinton, le président d’alors. C’était d’ailleurs justifié à bien des égards. Pourquoi n’ont-ils pas maintenu cette exigence avec Donald Trump ? Pourquoi ont-ils fermé les yeux sur chacune de ses frasques ? Voilà ce dont je parle quand j’emploie le mot « ambigu ». Outre la pandémie et la campagne pour l’élection présidentielle, l’année 2020 a été marquée aux États-Unis par le mouvement Black Lives Matter et ses revendications de justice sociale et “raciale”. Quelles relations les Églises protestantes noires entretiennent-elles avec ce mouvement ? Ces Églises, ou tout du moins certains de leurs pasteurs, ont été beaucoup critiqués pour leur soutien à Black Lives Matter, car certaines manifestations ont été entachées de violence. Mais c’est vraiment faire un mauvais procès aux Églises noires, car on oublie souvent que ce sont elles qui ont rendu possible le succès d’un Martin Luther King.
L’émergence de ce dernier, un pasteur baptiste, a été rendue possible par l’expérience des Noirs-Américains, qui eux aussi ont vécu des générations durant dans ce qu’ils ont assimilé au pays de Goshen [où les Hébreux ont habité lors de leur exil en Égypte, ndlr]. Ces hommes et ces femmes sont parvenus à mettre au point une méthode qui leur a permis de confronter une société oppressive à sa propre violence. Cette méthode, c’est justement la non-violence : si les compagnons de Martin Luther King se refusaient à employer la violence, c’est parce qu’ils se considéraient avant tout comme des disciples du Christ. Comment analysez-vous l’ampleur qu’a prise Black Lives Matter ? J’ai toujours pensé que les questions liées à la couleur de peau constituaient le défi moral fondamental de l’Amérique. Pouvons-nous, Américains, reconnaître que nous sommes une nation esclavagiste, une nation bâtie sur un génocide, que nos fautes sont si grandes qu’il n’y a rien que nous puissions faire pour les racheter ? La seule solution, à mon avis, c’est confesser nos péchés et demander pardon, en ayant conscience qu’il existe, au cœur même de l’ethos américain, des défis à surmonter qui pourraient nous mener au bord de la rupture. Il est trop facile de balayer Black Lives Matter d’un revers de main en affirmant que « toutes les vies comptent », et pas seulement celles des Noirs. Je note d’ailleurs que les manifestations pour la justice « raciale » ont réuni un nombre significatif de Blancs, ce qui est une nouveauté. Si ce mouvement a émergé de façon aussi visible, c’est qu’il en dit long sur la façon dont l’histoire est enseignée aux États-Unis. Comment cela ? L’idée générale, dans notre pays, a toujours été de considérer que nous sommes un exemple à suivre, une société où, mieux qu’ailleurs, peuvent s’épanouir des individus libres et éclairés. Bien sûr, la France aussi s’enorgueillit d’être un pays des Lumières, mais c’est encore plus le cas aux États-Unis : la majorité des Américains imaginent que tous les autres peuples voudrait leur ressembler. Et si cette idée est si solidement enracinée dans les mentalités, c’est qu’elle est portée par le récit que fait l’Amérique de sa propre histoire. Et c’est avant tout un récit de légitimation. À ce sujet, vous avancez que si les États-Unis avaient su regarder en face leur histoire, le pays ne se serait pas lancé dans la guerre d’Irak en 2003…
Vous pouvez aussi lire