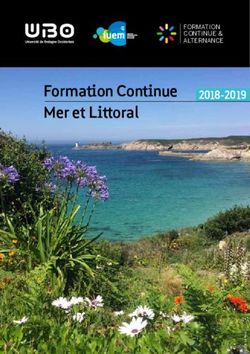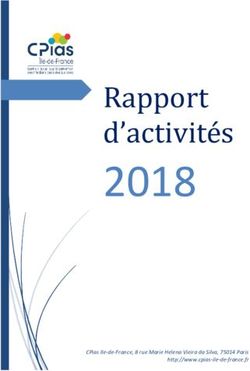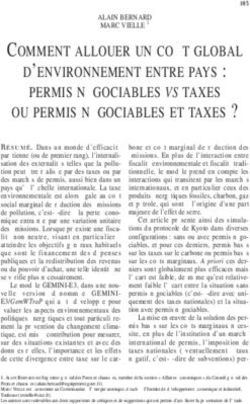Retransmission illicite de matchs : 300 000 euros - Actoba.com
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Retransmission illicite de matchs : 300 000 euros Affaire Rojadirecta Une condamnation sous astreinte est à prendre au sérieux, elle ne donne que peu de marge de manœuvre à la société condamnée. Le site « Rojadirecta » a vu son astreinte liquidée à hauteur de 300 000 euros. Le site avait été condamné à supprimer tous les liens hypertextes, permettant de visionner en direct ou léger différé, depuis le territoire français, les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe de la Ligue, du Trophée des Champions ou de toute autre compétition organisée par la Ligue de Football Professionnel. Suivre à la lettre une condamnation sous astreinte La demande de liquidation d’astreinte était fondée pour soixante-trois liens recensés par l’huissier de justice dans son constat de non-respect de la condamnation, peu important que ce dernier ne les ait pas tous ouverts et n’ait pas visionné tous les matchs, dès lors que la société, qui exerçait un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus, contrôlait nécessairement ces liens et ne faisait figurer sur son site que ceux permettant de visionner les matchs annoncés. Par ailleurs, compte tenu de sa qualité d’éditeur du site, retenue par le tribunal, la société exploitant le site ne pouvait se prévaloir d’aucune difficulté particulière pour
exécuter l’obligation mise à sa charge consistant à rendre impossible la mise en ligne de liens hypertextes permettant de visionner les matchs. Finalité de l’astreinte L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution. Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère laquelle s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l’injonction du juge. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il appartient par ailleurs au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge.
Télécharger la Décision Télécharger Contrat sur cette thématique Vous disposez d’un modèle de document juridique sur cette thématique ? Besoin d’un modèle ? Complétez vos revenus en le vendant sur Uplex.fr, la 1ère plateforme de France en modèles de contrats professionnels Vous avez une expertise dans ce domaine ? Référencez votre profil sur Lexsider.com, la 1ère plateforme de mise en relation gratuite Avocats / Clients Poser une Question Posez une Question Juridique sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h. E-réputation | Surveillance de marques Surveillez et analysez la réputation d’une Marque (la vôtre ou celle d’un concurrent), d’une Personne publique (homme politique, acteur, sportif …) sur tous les réseaux sociaux (Twitter, Facebook …). Testez gratuitement notre plateforme de Surveillance de Marque et de Réputation numérique. Paramétrer une Alerte Paramétrez une alerte de Jurisprudence sur ce thème pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème Propriété des archives
audiovisuelles du Football En cas de litige de propriété intellectuelle avec une association sportive telle que la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel, le Tribunal de commerce est-il compétent ? C’était la question posée aux juges dans cette affaire portant sur la propriété des images d’archives du Football. Compétence du Tribunal de commerce ou du TGI ? La Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel sont des associations déclarées d’utilité publique, elles sont délégataires d’une mission de service public qui consiste à encourager, développer, diriger et réglementer le football dont elles défendent les intérêts ; si elles développent des activités commerciales notamment en organisant des matches, en exploitant les droits de diffusion des mêmes matches ou en négociant des contrats de parrainage ou de sponsoring, ces activités ne priment pas leur objet statuaire de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme des commerçantes et qu’elles sont fondées à assigner un tiers devant le tribunal de grande instance de Paris. Les dispositions de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire définissent la compétence de droit commun du tribunal de grande instance: «Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction »
Celles de l’article L721-3 du code de commerce disposent : « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » L’article L.121-1 du code de commerce du même code précise : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. » Objet et statuts des Ligues sportives Il est constant que les Associations de Ligues sportives ne sont pas des sociétés. Pour qu’une association soit qualifiée de société commerciale, doit être rapportée la preuve du caractère répétitif de son activité commerciale et que du fait que cette activité prime l’objet statutaire de l’association. Le caractère spéculatif de l’activité commerciale est un critère sans pertinence, une activité commerciale ayant par essence un caractère spéculatif dans le sens qu’il existe une prise de risque dans les choix de l’activité et de son développement. Le jugement du TPIUE du 26 janvier 2005 (aff. Piau c/ Commission) a précisé que la FIFA, les clubs professionnels et les associations nationales regroupées au sein de la FIFA (y compris donc la FFF) étaient « des entreprises au sens de l’article 81 CE » : « les associations nationales, qui, selon les statuts de la FIFA, sont tenues de participer aux compétitions organisées par elle, doivent lui reverser un pourcentage de la recette brute de chaque match international
et sont reconnues, par les mêmes statuts, avec la FIFA, comme propriétaires des droits exclusifs de diffusion et de transmission des manifestations sportives concernées, exercent également à ce titre une activité économique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 novembre 1994, Scottish Football/Commission, T-46/92, Rec. p. II-1039). Ce jugement consacre le fait que les associations nationales de football développent une activité commerciale en organisant des compétitions et en exploitant les droits de diffusion des matches Missions de la FFF L’organisation des matches de football ne représente qu’une partie des missions de la FFF et de la LFP, qui ont également pour objet d’encourager, de développer, de diriger et de réglementer le football dont elles défendent les intérêts. A ce titre, le rapport annuel de la FFF explique que la FFF a notamment poursuivi d’importants chantiers tels que : i) la refonte de l’offre de « pratique entreprise », ii) le déploiement du programme fédéral éducatif sous l’égide de la ligue du football amateur, iii) la mise en place de centres inter régionaux de formation, iv) la réforme de l’arbitrage, v) la mise en place d’une feuille de match informatisée, vi) le « plan féminisation » … Le football amateur, dont la FFF a la charge, représente pas moins de 400 000 bénévoles (dont en moyenne 455 au niveau de la FFF), 2 millions de licenciés, un million de matches par an toutes catégories sociales et classes d’âge confondues, et qu’il est présent à l’école dans pas moins de 34 500 communes de France. Toutefois, la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel ont échoué à établir, chiffres certifiés à l’appui, que les activités commerciales restent accessoires par rapport à leurs activités statutaires et ne
constituent pas des actes de commerce spéculatifs répétitifs primant son objet statutaire, aucune démonstration in concreto du rapport entre la charge des missions et le personnel consacré à ces missions et la charge financière et humaine de l’activité commerciale n’étant faite. Il n’est notamment pas établi que les recettes tirées des matches organisés par la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel comme les autres recettes (contrats de licence ou parrainage figurant dans la rubrique marketing et diffusion des images des matches) ne sont qu’un moyen de financer la réalisation de son objet statutaire non lucratif à savoir le développement et la promotion du football. Le problème sur lequel le Tribunal de commerce devra se prononcer porte sur la propriété des images d’archives du Football et leur exploitation en ligne par la société Gaumont Pathé Archives. Pour rappel, de 1909 jusqu’à la fin des années 1960, les sociétés Gaumont et Pathé ont produit des journaux d’actualités cinématographiques qu’elles diffusaient ensuite dans leurs salles de cinéma dans un but d’information du public. Ces images étaient filmées à l’initiative et intégralement financées par Gaumont et Pathé. Affaire au fond à suivre … Télécharger la Décision Télécharger Poser une Question Poser une question sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h
Paramétrer une Alerte Paramétrer une alerte jurisprudentielle, pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème Commander un Casier judiciaire Commander un bilan judiciaire sur l’une des personnes morales citées dans cette affaire (ou sur toute autre personne morale). Vous avez traité un dossier similaire? Maître Obligation de must carry Périmètre du must carry L’article 34-2, I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pose le principe du must carry. Cet article est la transposition en droit interne de l’article 31 de la directive n° 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive “service universel”), lequel instaure une obligation légale de diffusion dite ‘must carry’. Cette obligation, qui trouve son origine dans la réglementation américaine édictée par la Federal communications commission dans les Cable Act de 1984 et 1992
pour limiter les effets du quasi-monopole des câblo- opérateurs, a pour but d’assurer à tous les téléspectateurs, en particulier ceux n’ayant accès à la télévision que par l’intermédiaire d’offres privées (par câble ou satellite à l’origine, puis par les nouveaux réseaux tels que l’ADSL ou la téléphonie mobile), l’accès aux chaînes publiques d’intérêt général dans le respect du pluralisme, de la liberté d’expression et de la diversité culturelle. Cette règle représente donc l’obligation en France pour un distributeur de services de communication audiovisuelle de reprendre les chaînes publiques diffusées par voie hertzienne, normalement reçues dans la zone de service, ainsi que TV5 et la chaîne Réseau France Outre-mer. Limites du must carry Cette obligation de must carry ne permet toutefois pas aux éditeurs de sites internet d’invoquer le droit d’accéder librement aux programmes des radiodiffuseurs (exemple : la SA France Télévisions) aux fins de leur rediffusion en simultané sur l’Internet. L’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 dispose que si la communication au public par voie électronique est libre, l’exercice de cette liberté par la libre retransmission des programmes audiovisuels ne peut se faire que dans le respect de la propriété d’autrui. Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, a rappelé que la propriété figure au nom des droits de l’homme consacrés par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et ‘que les finalités et les conditions d’exercice de ce droit ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figurent les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit d’auteur et les droits voisins’.
L’article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que ‘pour l’application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L 32 du code des postes et des communications électroniques’. La condition préalable et nécessaire de relations contractuelles pour pouvoir revendiquer le statut de distributeur de services de communication audiovisuelles et, partant, l’application du ‘must carry’ permet ainsi d’assurer le respect des droits d’auteur et des droits voisins de l’éditeur de services de communication audiovisuelle et des tiers auprès desquels il a acquis ces droits, tel que prévu expressément par le second alinéa de l’article 1er de la loi. Une déclaration effectuée auprès du CSA en application des dispositions des articles 7 et suivants du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 ‘relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d’initiative publique locale’, n’a qu’un effet déclaratif et ne saurait donc valoir autorisation ou validation de l’offre ou des activités du distributeur, ni créer un nouvel état de droit par l’application automatique à ce distributeur du ‘must carry’. En effet, l’article 10 du décret ne permet au CSA que de vérifier si le déclarant a ‘la qualité de distributeur de services au sens du deuxième alinéa du I de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986″, c’est-à-dire que le déclarant est bien une société, en ce compris les sociétés d’économie mixte locale, les organismes d’habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues au II de l’article 34 précité, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l’électricité et du gaz. Application pratique : Playmédia / France Télévisions Dans l’affaire l’opposant à la société Playmedia, la SA France Télévisions a obtenu gain de cause. Cette dernière est bien un éditeur de services de communication audiovisuelle ainsi que le précise l’article 44, I de la loi du 30 septembre 1986 et qu’il s’ensuit que pour pouvoir prétendre à la qualité de distributeur de services de communication audiovisuelle et invoquer le ‘must carry’ à l’encontre de la SA France Télévisions, la société Playmédia devait avoir au préalable établi avec cette société une relation contractuelle en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle (ce qui n’était pas le cas). Sans avoir conclu aucun contrat de distribution de services de communication audiovisuelle avec la SA France Télévisions, la SAS Playmédia a diffusé en ‘streaming’ les programmes diffusés par cette dernière, sans payer la moindre redevance et en se finançant par l’affichage de publicités en ‘pré-roll’ avant la diffusion des programmes. En tout état de cause, les obligations légales de diffusion (‘must carry’) doivent, aux termes de l’article 31, point 1 de la directive du 07 mars 2002, être ‘raisonnables, proportionnées, transparentes et nécessaires pour garantir la réalisation d’objectifs d’intérêt général clairement définis’ ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne au point 28 de son arrêt Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co du 22 décembre 2008. Par ailleurs, l’article 34-2, I de la loi du 30 septembre 1986 ne vise expressément que les seuls services sur abonnement, or la société Playmédia ne proposait pas réellement « d’abonnement » au sens de la loi. Enfin, l’article 31, point 1 de la directive du 07 mars 2002 précise que le ‘must carry’ ne s’applique qu’aux entreprises ‘qui
fournissent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finals utilisent ces réseaux comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision’ ; or, il ressort d’une étude effectuée par le CSA en février 2015 sur ‘la télévision de rattrapage’, que la télévision en direct sur Internet ne concerne qu’entre 4 et 8 % de la consommation totale de télévision en ligne, la quasi-totalité (entre 81 et 87 %) relevant de la télévision de rattrapage. L’étude réalisée en décembre 2014 par le CNC sur ‘les nouveaux usages audiovisuels’ relève de même que près de 80 % des téléspectateurs de plus de quinze ans regardent quotidiennement la télévision en direct ou en différé sur un téléviseur et que seulement 6 % d’entre eux la regardent quotidiennement sur un autre écran (ordinateur, téléphone mobile, tablette). Il s’ensuit que la société Playmédia ne pouvait arguer d’un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisant l’Internet comme moyen principal pour recevoir des chaînes de télévision. Le préjudice subi par la SA France Télévisions au titre des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur et droits voisins, a été évalué à la somme de 1.000.000 €.
Les évènements d’importance
majeure
Le droit du public à l’information
Le dispositif légal des évènements d’importance majeure a été adopté pour assurer au public un droit à
l’information, notamment sur les rencontres sportives importantes telles que les jeux Olympiques, la Coupe du
monde et le Championnat d’Europe de football.. En ce ce sens, le dispositif est une exception au droit de
propriété des fédérations sportives.
En la matière, le principe est posé par l’article L333-1 du Code du sport : les fédérations sportives, ainsi
que les organisateurs de manifestations sportives autorisés (voir infra) sont propriétaires du droit
d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. Ce droit d’exploitation inclut
notamment les droits de retransmission audiovisuelle mais également toutes les exploitations de droits
dérivés. Depuis la loi sur la libéralisation des jeux d’argent et paris (loi n°2010-476 du 12 mai 2010), le
droit d’exploitation inclut également le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations
ou compétitions sportives (par des licences).
Deux dispositions pivots ont été adoptées par la directive Services de médias audiovisuels (1) :
i) Les Etats membres peuvent adopter une exception à l’exclusivité des droits de retransmission pour
permettre au public de visionner, sur les chaînes en libre accès, les évènements d’importance majeure. A ce
titre, chaque État membre établit une liste dans laquelle sont désignés les événements, nationaux ou non,
jugés d’importance majeure. L’État membre détermine aussi si ces événements doivent être diffusés
intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt
général, diffusés intégralement ou partiellement en différé. L’adoption de cette liste donne lieu à une
notification de la Commission européenne. Dans le délai de trois mois après la notification, la Commission
vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union.
ii) Les États membres veillent également à assurer un « droit aux extraits » pour permettre la réalisation,
par les chaînes en libre accès et les services en ligne, de brefs reportages d’actualité sur les événements
d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet de droits de retransmission exclusifs.
Ces deux dispositions ont été intégralement transposées dans la loi du 30 septembre 1986 et le Code du sport.
L’exception d’événement d’importance majeureL’exception d’événement d’importance majeure a été transposée à l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986
qui reprend en substance les dispositions de la directive Services de médias audiovisuels.
Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à
priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service
de télévision à accès libre (2). De même, les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs
qu’ils ont acquis après le 23 août 1997 d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public
d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés
d’importance majeure par cet Etat.
Il appartient au CSA de veiller au respect par les services de télévision de l’exception de retransmission
des événements majeurs.
L’article 20-3 de la loi du 30 septembre 1986 complète le dispositif mis en place par une disposition
relative à la lutte contre le dopage : les services de télévision qui diffusent des événements d’importance
jugée majeure sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées, des programmes
courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la
préservation de la santé des sportifs.
La liste des événements majeurs
La Commission a posé qu’un événement revêtait une importance majeure lorsque au moins deux des quatre
critères suivants sont satisfaits :
1) l’événement fédère un public plus large que celui traditionnellement concerné ;
2) l’événement participe de l’identité culturelle nationale ;
3) l’événement implique l’équipe nationale dans le cadre d’une manifestation d’envergure ;
4) l’événement fait traditionnellement l’objet d’une large audience télévisée.
Le décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 a fixé la liste de 21 événements qualifiés d’importance majeure
pour la France :
1° Les jeux Olympiques d’été et d’hiver ;
2° Les matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de
football association (FIFA) ;
3° Le match d’ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;
4° Les demi-finales et la finale du Championnat d’Europe de football ;
5° La finale de la Coupe de l’Union européenne de football association (UEFA) lorsqu’un groupement sportif
inscrit dans l’un des championnats de France y participe ;
6° La finale de la Ligue des champions de football ;
7° La finale de la Coupe de France de football ;
8° Le tournoi de rugby des Six Nations ;
9° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;
10° La finale du championnat de France de rugby ;
11° La finale de la coupe d’Europe de rugby lorsqu’un groupement sportif inscrit dans l’un des championnats
de France y participe ;
12° Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;
13° Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup (si l’équipe de France y participe) ;
14° Le Grand Prix de France de formule 1 ;
15° Le Tour de France cycliste masculin ;
16° La compétition cycliste “Paris-Roubaix” ;
17° Les finales masculine et féminine du championnat d’Europe de basket-ball lorsque l’équipe de France y
participe ;
18° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball (si l’équipe de France y
participe) ;
19° Les finales masculine et féminine du championnat d’Europe de handball lorsque l’équipe de France y
participe ;
20° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l’équipe de France y
participe ;
21° Les championnats du monde d’athlétisme.
La retransmission « libre » est faite intégralement et en direct, sauf dans les cas suivants :
1° La retransmission du Tour de France cycliste masculin peut être limitée à des moments significatifs,
conformément à l’usage de diffusion de cet événement ;
2° La retransmission des jeux Olympiques d’été et d’hiver et des championnats du monde d’athlétisme peut être
limitée à des moments représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et
assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément ;
3° La retransmission des événements d’importance majeure peut aussi être assurée en différé lorsque
l’événement a lieu entre 0 et 6 heures, heure française, à la condition que sa diffusion en France débute
avant 10 heures ;
Les éditeurs de services de télévision à accès restreint ont aussi la faculté de diffuser ces événements
intégralement et en direct.
Nota : autorisation de retransmission intégrale ne veut pas dire gratuité. Une offre de retransmission est
faite par le détenteur des droits exclusifs dans un délai raisonnable avant l’événement. Celle-ci doit être
formulée selon des termes et conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires.Le droit aux extraits audiovisuels
La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de
communication au public par voie électronique ne peut faire obstacle à l’information du public par les autres
services de communication au public par voie électronique. Le vendeur ou l’acquéreur de ce droit ne peut
s’opposer à la diffusion, par d’autres services de communication au public par voie électronique, de brefs
extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par
le service non cessionnaire du droit d’exploitation qui les diffuse. Ces extraits sont diffusés gratuitement
au cours des émissions d’information.
En application de l’article L333-7 du Code du sport, cette diffusion d’extraits s’accompagne dans tous les
cas d’une identification suffisante du service de communication au public par voie électronique cessionnaire
du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition.
Les brefs extraits d’une manifestation ou d’une compétition sportive sont prélevés parmi les images du
détenteur du droit d’exploitation établi en France par tout éditeur de services de télévision, pour la
diffusion sur son antenne ou sur ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition
le même programme en différé
i) si cet éditeur est établi en France ou ii) s’il est établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne
ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dès lors qu’aucun éditeur de cet Etat n’a acquis ce
droit d’exploitation.
A noter qu’à l’image de la ligue de football, les fédérations proposent des produits “prêt à être diffusé”
aux opérateurs dont la production n’est pas le métier.
Le droit aux brefs extraits s’inscrit dans le cadre du droit de citation. Celui-ci étant par nature une
exception, il doit être interprété strictement et devrait logiquement répondre aux conditions cumulatives
posées par l’article L. 122.5° du Code de la propriété intellectuelle (brièveté de la citation, indication de
l’auteur et de la source, motifs tirés du caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d’information de la publication).
Deux décisions ont précisé la notion de ces “brefs extraits” en matière audiovisuelle. En premier lieu, les
juges (Cour d’appel de Versailles, 23 septembre 2004) ont fait référence au code de bonne conduite en matière
sportive conclu en 1992. Ce code fixe à une minute trente secondes la norme généralement admise pour la
diffusion des extraits de compétitions sportives.
La Cour d’appel après avoir rappelé le principe selon lequel la notion de brefs extraits qui constitue une
disposition exceptionnelle en ce qu’elle limite le droit de propriété suppose la recherche d’un juste
équilibre entre ce droit de propriété et le droit à l’information, a jugé que la durée de 90 secondes par
journée de championnat laquelle comporte en moyenne trois matches, qui y est préconisée, peut être retenue
comme référence pour définir la notion de “bref extrait”. Ces diffusions de brefs extraits doivent également
être écartées de deux heures. En l’espèce, la condamnation de la société E. a été confirmée : “en diffusant
une durée cumulée d’extraits de matches de 4h30 minutes et de 1h50 minutes au titre des 21ème et 22ème
journées de championnat dont la quasi-totalité des extraits dépasse 1’30’par journée et près de 50 excèdent
3′, la société Equipe TV a épuisé largement le droit à l’information du public à titre gratuit.”
En second lieu, la Cour de cassation (Cour de cassation, ch. com., 8 février 2005) a jugé que la notion de
“brefs extraits” doit être interprétée strictement et peut être limitée, pour les émissions d’information, à
la diffusion d’un bref extrait toutes les quatre heures par périodes de vingt quatre heures.
Le droit de commenter les évènements
La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de
communication au public par voie électronique ne fait pas non plus obstacle à la réalisation et à la
diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou
en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition.
La cession des droits à un service en ligne, ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de
cette manifestation ou de cette compétition par un autre service en ligne lorsque le service cessionnaire du
droit d’exploitation n’assure pas la diffusion en direct d’extraits significatifs de la manifestation ou de
la compétition sportive.
Accès des journalistes aux enceintes sportives
Condition sine qua non du droit au public de l’information, l’accès des journalistes et des personnels des
entreprises d’information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est désormais libre, sous réserve
des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d’accueil.
Toutefois, sauf autorisation de l’organisateur, les services de communication au public par voie électronique
non cessionnaires du droit d’exploitation ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la
manifestation ou de la compétition sportive proprement dites.
Dans tous les cas, les fédérations sportives gardent la faculté, dans le respect du droit à l’information,
d’adopter un règlement validé par arrêté après avis du CSA, qui définit les éventuelles modalités spécifiques
d’accès et les lieux mis à la disposition des journalistes.
(1) Directive n° 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias
audiovisuels(2) Un éditeur de services de télévision à accès libre est l’éditeur de service de télévision dont le
financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être
effectivement reçues par au moins 85 % des foyers de France métropolitaine.
Tarifs d’accès aux chaînes
payantes
Pratiques discriminatoires
Un éditeur de chaîne TV peut-il être condamné pour ses prix
abusivement bas ? C’était la question posée dans cette
affaire. Se fondant sur le seul article 1382 du code civil, il
était demandé au tribunal de dire que beIN SPORT avait commis
un acte de concurrence déloyale en adoptant un comportement
économiquement irrationnel, fondé sur la vente de l’abonnement
aux chaînes beIN SPORT à un prix anormalement bas au regard
des investissements particulièrement importants réalisés,
entraînant ainsi une désorganisation du marché.
Concurrence déloyale
Les faits caractérisant la concurrence déloyale consistent,
pour l’essentiel, dans l’utilisation de procédés contraires
aux usages et habitudes professionnels tendant à détourner la
clientèle d’un concurrent ou qui entraînent la désorganisation
du marché par des pratiques abusives, l’action en concurrence
déloyale a pour but, non pas de limiter l’exercice de la
concurrence lui-même mais, d’en éviter les abus. A ce titre,
l’article 1382 du code civil dispose : « Tout fait quelconque
de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur les prix « anormalement » bas, les juges du Tribunal decommerce ont considéré que dans la fixation du prix, si pour apprécier la désorganisation du marché les deux critères (prix et nombre d’abonnés) sont corrélés, le prix de l’abonnement n’est pas le seul critère intervenant dans la décision d’abonnement, d’autres facteurs tels que la qualité de l’image, des commentaires sportifs etc., sont aussi être pris en compte. En conséquence, il n’était pas démontré que les prix conseillés par beIN SPORT pour l’abonnement à ses chaînes soit anormalement bas par rapport à ceux du marché. Distribution de chaînes TV et concurrence Distribution de la chaîne Cfoot Dans le cadre du litige l’opposant à Numéricâble, la LPF a obtenu la levée du séquestre concernant la communication du contrat de distribution et de commercialisation des chaînes MCS, MCS Extrême et Ligue 2 Multicanaux sur le réseau NUMERICABLE. L’affaire suivra son cours pour être jugée au fond. Pour rappel, dans ce litige, la LPF reproche essentiellement à Numéricâble d’avoir : – Abusé de sa position dominante en appliquant à la chaîne Cfoot éditée par la LFP des conditions de distribution discriminatoires, – Manqué à ses obligations de non-discrimination et de transparence, telles que résultant de l’article 3-1 de la loi
n°86-1067 du 30/09/86, – Opéré un abus de droit constitutif d’une faute au regard de l’article 1382 du code civil en appliquant à la chaîne Cfoot éditée par la LFP des conditions de distribution discriminatoires, Missions de la LPF La LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, ci-après « LFP », composée de l’ensemble des clubs professionnels de football, exerce par délégation de la Fédération Française de Football, une mission de service public consistant à organiser, gérer et réglementer le football professionnel national et à ce titre, elle est chargée de la commercialisation exclusive des droits d’exploitation audiovisuelle des championnats professionnels de Ligue 1, de Ligue 2 et de la Coupe de la Ligue, ainsi que des magazines s’y rapportant, les produits ainsi générés étant intégralement reversés en accord avec les dispositions réglementaires. Les sociétés NUMERICABLE et NC NUMERICABLE, sont majoritairement détenues par la société YPSO FRANCE, elle-même co-contrôlée par le câblo-opérateur luxembourgeois ALTICE et deux fonds d’investissement. NUMERICABLE, opérateur important via son réseau câblé implanté sur le territoire national, fournit des services d’accès à internet, à la télévision et à la téléphonie fixe et a participé au lancement de la chaîne MCS en 2007, détenue à 85% par le câblo-opérateur ALTICE. A cette époque, MCS bénéficiait notamment d’une partie des droits exclusifs de diffusion de la Ligue 2 pour les saisons 2007/2008 à 2009/2010, qui lui avaient rétrocédés par YPSO, laquelle les avait elle-même acquis en 2007 auprès de la LFP. MCS qui exploite en particulier les chaînes Ma Chaîne Sport, Ma Chaîne Sport Extrême, MCS VOD et MCS Mobile, éditait
également le service Ligue 2 Multicanaux et diffusait jusqu’en 2010 le vendredi soir, à l’exception du match du lundi soir diffusé par Eurosport : 1 match de ligue 2 sur Ma Chaîne Sport, – 3 matches sur Ligue 2 multicanaux, dont celui diffusé sur Ma Chaîne Sport. La LFP a édité du 28/07/11 au 31/05/12, la chaîne thématique CFoot, consacrée au football, proposant notamment à ses abonnés la diffusion : i) des matches de la saison 2011/2012 en direct ou en différé, voire d’archives, en particulier et en exclusivité, ceux de la Ligue 2 : ii) le vendredi soir par multiplex en direct simultané, de huit matches sous forme d’extraits, iii) d’un match le samedi après-midi, – des émissions d’information sur le football tant professionnel qu’amateur. La commercialisation des droits sur les manifestations sportives
Les règles applicables
Les droits de retransmission audiovisuelle font l’objet d’enjeux financiers collossaux. A titre d’exemple, les droits audiovisuels de la Ligue 1, pour la période 2008/2012 ont représenté 668
millions d’euros par an, en moyenne sur quatre ans contre 640 millions d’euros par an, en moyenne sur les trois années précédentes. Sur ce marché, le groupe Orange a fait son entrée sur le marché
des droits en VàD, téléphonie mobile et télévision mobile personnelle (IMP). Par ailleurs, la société Canal+ Events a été désignée pour assurer la commercialisation exclusive des compétitions à
l’international (1).
Le droit de propriété des fédérations sportives
Le principe est fixé par l’article L333-1 du Code du sport : les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives autorisés (voir infra) sont propriétaires du droit
d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. Ce droit d’exploitation inclut notamment les droits de retransmission audiovisuelle mais également toutes les
exploitations de droits dérivés. Depuis la loi sur la libéralisation des jeux d’argent et paris (loi n°2010-476 du 12 mai 2010), le droit d’exploitation inclut également le droit de consentir à
l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives (par des licences).
Les licences de paris en ligne
Lorsque le droit d’organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant
lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l’ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne) mais aussi à l’Autorité de la concurrence, qui se prononcent dans un
délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document.
L’organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité sportif pour signer, avec les opérateurs de paris en
ligne, le contrat de licence de paris. Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d’organiser des paris ni
exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris.
Tout refus de conclure un contrat d’organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l’ARJEL.
Le contrat de licence consenti doit préciser les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d’échange
d’informations avec la fédération sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive. Il ouvre droit, pour les fédérations, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés
pour la détection et la prévention de la fraude.
Les associations sportives affiliées à une fédération sportive, qui participe habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes et les sociétés sportives peuvent concéder aux
opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires (à l’exclusion du droit
d’organiser des paris). La notion d’actifs incorporels devrait être prochainement définie par un décret.
Les droits de retransmission audiovisuelle
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives (les clubs), à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations
sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie
alors à chacune de ces sociétés.
Toutefois, les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle. Les négociations sont donc menées par la Ligue en charge avec
l’obligation de commercialiser les droits par constitution de lots (pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence).
En application de l’article L333-3 du Code du sport, afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à
caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d’exploitation sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés. La part de ces produits destinée à la
fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.
Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon le principe de la mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant
entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété. A ce titre, les sociétés sportives sont soumises à des obligations d’investissement dans leur infrastructures pour
développer la notoriété et la fréquentation des stades.
Le rôle pivot des fédérations
Concrètement, l’assemblée générale de la fédération sportive statue par délibération sur l’opportunité, l’objet et l’étendue de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle.
En cas de cession de la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle, la ligue professionnelle commercialise à titre exclusif les droits d’exploitation audiovisuelle et de
retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu’elle organise. Il en est de même des
extraits utilisés pour la réalisation de magazines d’information sportive.
En dépit de la cession, la fédération et la ligue professionnelle conservent la possibilité d’utiliser librement toute image en vue de la réalisation de leurs missions d’intérêt général, telles
que l’organisation et le déroulement des compétitions, la formation des arbitres, la promotion de la discipline, l’éducation des jeunes sportifs.
L’appel à candidatures / Appel d’offre par lots
La commercialisation des droits par la ligue est réalisée selon une procédure d’appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services
intéressés. L’avis d’appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l’échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d’exploitation audiovisuelle. Il
précise également le calendrier de la procédure d’attribution et les modalités d’ouverture des offres des différents candidats.
Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l’achat.
Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l’avis d’appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une
durée qui ne peut excéder quatre ans (cette durée était de trois ans anterieurement,l’Autorité de la concurrence ne s’étant pas opposé à cet allongement mais reste opposée à un délai de cinq ans).
Les lots sont généralement divisés en supports (télévision, site Internet, service linéaire …), en durée, en exclusivité et en modalités de traitement : rediffusion des matchs, réalisation de
magazines TV, résumés des meilleurs moments, droits marketing (promotion dans les stades), magazines VàD, extraits de matchs, lots Fans (matches proposés en pay per view), droits mobiles etc.
La ligue doit rejeter les propositions d’offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d’un complément de prix. Les appels à candidatures sont assortis d’un prix de réserve et
sont attribués au plus offrant.
Le droit des organisateurs des évènements sportifs
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation de
pouvoir et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l’autorisation de la fédération
délégataire concernée.
Conformément à l’article L331-5 du Code du sport, cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et des règles techniques de la fédération concernée et à la conclusion entre
l’organisateur et la fédération délégataire d’un contrat comprenant des mentions obligatoires. Le droit de l’organisateur porte notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à
l’occasion de la compétition.
Cette règle a ainsi été appliquée au bénéfice de la société Andros, organisateur de l’événement sportif “Trophée Andros”. Une société ainsi que plusieurs revues (‘Automobile magazine et Motor
presse France) avaient utilisé des clichés réalisés par un de leurs photographes couvrant le “Trophée Andros”. Sur ces photos, la marque Andros apposée sur les véhicules et la combinaison d’un
pilote avait été effacée. La société Andros, estimant que cette suppression lui portait préjudice, a obtenu une indemnisation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et de l’article L.
713-2 du Code de la propriété intellectuelle (Décision n° 402).
Liberté d’expression des joueurs
L’article L333-4 du Code du sport pose que les fédérations sportives, les sociétés sportives et les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits
d’exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d’expression.
Fiscalité des cessions de droits
La cession des droits d’exploitation audiovisuelle n’est pas prise en compte pour la détermination des résultats imposables des sociétés sportives au titre de l’exercice où cette cession
intervient. A contrario, les charges afférentes à l’accroissement d’actif (suite à la cession) ne peuvent donc venir en déduction de leurs résultats imposables.
Accès des journalistes aux enceintes sportives
L’accès des journalistes et des personnels des entreprises d’information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du
public et des sportifs, et aux capacités d’accueil.
Toutefois, sauf autorisation de l’organisateur, les services de communication au public par voie électronique (Sites Internet) non cessionnaires du droit d’exploitation ne peuvent capter que les
images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites.
Les fédérations sportives gardent la faculté, dans le respect du droit à l’information, d’adopter un règlement validé par arrêté après avis du CSA, qui définit les éventuelles modalités
spécifiques d’accès et les lieux mis à la disposition des journalistes.
Droit aux extraits
La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique (Sites Internet) ne peut faire obstacle à
l’information du public par les autres services de communication au public par voie électronique.
Le vendeur ou l’acquéreur de ce droit ne peut s’opposer à la diffusion, par d’autres services de communication au public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les
images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d’exploitation qui les diffuse. Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions
d’information.
En application de l’article L333-7 du Code du sport, cette diffusion d’extraits s’accompagne dans tous les cas d’une identification suffisante du service de communication au public par voie
électronique cessionnaire du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition.
Les brefs extraits d’une manifestation ou d’une compétition sportive sont prélevés parmi les images du détenteur du droit d’exploitation établi en France par tout éditeur de services de
télévision, pour la diffusion sur son antenne ou sur ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé i) si cet éditeur est établi en France
ou ii) s’il est établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dès lors qu’aucun éditeur de cet Etat n’a acquis ce droit
d’exploitation. A noter qu’à l’image de la ligue de football, les fédérations proposent des produits “prêt à être diffusé” aux opérateurs dont la production n’est pas le métier.
Deux décisions ont précisé la notion de “brefs extraits” en matière audiovisuelle.
En premier lieu, les juges (Cour d’appel de Versailles, 23 septembre 2004) ont fait référence au code de bonne conduite conclu en 1992. Ce code fixe à une minute trente secondes la norme
généralement admise pour la diffusion des extraits de compétitions sportives. La Cour d’appel après avoir rappelé le principe selon lequel la notion de brefs extraits qui constitue une disposition
exceptionnelle en ce qu’elle limite le droit de propriété suppose la recherche d’un juste équilibre entre ce droit de propriété et le droit à l’information, a jugé que la durée de 90 secondes par
journée de championnat laquelle comporte en moyenne trois matches, qui y est préconisée, peut être retenue comme référence pour définir la notion de “bref extrait”. Ces diffusions de brefs
extraits doivent également être écartées de deux heures. En l’espèce, la condamnation de la société Equipe TV a été confirmée : “en diffusant une durée cumulée d’extraits de matches de 4h30
minutes et de 1h50 minutes au titre des 21ème et 22ème journées de championnat dont la quasi-totalité des extraits dépasse 1’30’par journée et près de 50 excèdent 3′, la société Equipe TV a épuisé
largement le droit à l’information du public à titre gratuit.”
En second lieu, la Cour de cassation (Cour de cassation, ch. com., 8 février 2005) a jugé que la notion de “brefs extraits” doit être interprétée strictement et peut être limitée, pour les
émissions d’information, à la diffusion d’un bref extrait toutes les quatre heures par périodes de vingt quatre heures.
La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la réalisation et à la
diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition.
La cession des droits à un service en ligne, ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service en ligne lorsque le
service cessionnaire du droit d’exploitation n’assure pas la diffusion en direct d’extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive.
Les évènements d’importance majeure
Les événements sportifs peuvent revêtir la qualification d’évènements d’importance majeure, il convient alors de leur appliquer (cumulativement) ce régime.
Droits de retransmission et concurrence
Le droit de la concurrence s’applique pleinement à toute la chaîne des contrats conclus dans le cadre de l’exploitation des droits audiovisuel et des droits dérivés.
Concernant le contr ôle de la position dominante des Ligues professionnelles sur le marché de la commercialisation des droits de retransmission, la Commission européenne a admis que l’exclusivité
et la centralisation de la vente des droits ne posaient pas de problèmes spécifiques de concurrence. Cependant la Commission, en la matière, a adopté une ligne d’action qui doit permettre
d’élargir et diversifier l’offre de programmes footballistiques à la télévision et permettre aux clubs d’adapter ces droits à leurs propres supporters en prenant notamment la nécessité de donner
une impulsion aux marchés émergents des nouveaux médias (Internet et téléphonie mobile de troisième génétration)
Par une décision du 30 septembre 2009, l’Autorité de la concurrence a sanctionné la Fédération française de football et la société Sportfive à hauteur de 6,9 millions d’euros pour s’être entendues
afin d’éliminer toute concurrence dans la commercialisation des droits marketing de la Fédération. La FFF et Sportfive avaient noué des accords exclusifs de très longue durée sans faire appel à la
concurrence pour la gestion des droits marketing de l’Equipe de France et de la Coupe de France. Les contrats conclus sur 17 années combinaient des clauses d’exclusivité, des clauses de tacite
reconduction et d’indemnité de fin de contrat. Associés à des avenants de prolongation signés plusieurs années avant l’échéance théorique des contrats, ces éléments présentaient un caractère
anticoncurrentiel. L’Autorité de la concurrence a établi que les deux parties s’étaient également concertées, en empêchant un concurrent (Havas Sports) d’obtenir les informations nécessaires au
chiffrage de sa proposition suite à un premier appel d’offre. .Vous pouvez aussi lire