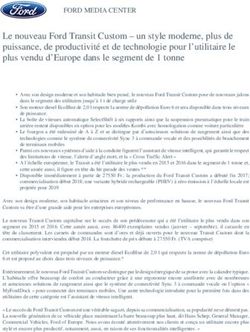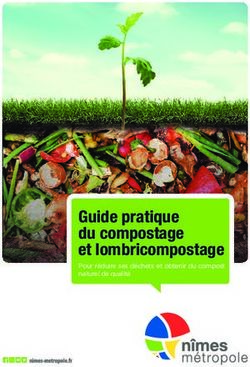ARTHUR SCHNITZLER, UN PAS DE BOURRÉE DANS LA RONDE DES FAUX-COLS VIENNOIS
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
ARTHUR SCHNITZLER,
UN PAS DE BOURRÉE
DANS LA RONDE DES
FAUX-COLS VIENNOIS
› Céline Laurens
« Un naturalisme qui sent bon », voici comment Félix
Bertaux, germaniste français, qualifiait l’œuvre d’Ar-
thur Schnitzler (1862-1931), écrivain et dramaturge
autrichien relativement délaissé par l’intelligentsia
lettrée au profit de l’œuvre d’un Robert Musil, d’un
Hugo von Hofmannsthal, mais surtout d’un Stefan Zweig. Musil ? Bien
entendu ! L’Homme sans qualités, ce mythe de l’ouvrage que presque per-
sonne n’a réussi à lire jusqu’au bout. Hofmannsthal ? Un vrai et grand
poète, très bien traduit, et ses opéras ! Zweig ? Ah, Zweig ! L’adolescence
et ses premières lectures : Amok, La Pitié
Céline Laurens est critique littéraire
dangereuse, puis vient l’âge adulte et Le pour le magazine Lire et journaliste
Monde d’hier. Mais Schnitzler ? Pourquoi à Radio Notre-Dame. Elle collabore
régulièrement avec des maisons
cette quasi-bouderie des lecteurs à l’égard de d’édition telles qu’Actes Sud théâtre
celui que Freud surnommait son « double et Rue Fromentin.
littéraire » ? Peut-être à cause des succès de › laurensceline@aol.com
films comme ceux adaptés de sa pièce La Ronde, comédie de mœurs
mise en lumière par Max Ophüls (en 1950) puis par Roger Vadim (en
1964), le reléguant dans l’imaginaire collectif au sympathique statut de
AVRIL 2020 135littérature
chantre des frivolités d’alcôve de sa ville natale, Vienne, capitale dont
l’identité est aussi consubstantielle à ses écrits que Paris pour Francis
Carco ou Dublin pour James Joyce. Certainement aussi car, contraire-
ment à Stefan Zweig, Arthur Schnitzler ne s’est pas prêté au jeu d’ac-
teur culturel, préférant le recueillement nécessaire à l’élaboration d’une
œuvre profonde plutôt que la lumière, chronophage, de la prise de posi-
tion. Car c’est aussi l’homme Zweig que le public achetait, l’image du
conférencier, l’image de l’intellectuel éclairé et voyageur, ami de Freud
et de Romain Rolland, prenant position pour l’unité, la paix et la colla-
boration des grands esprits européens.
« Un cabinet particulier au Riedhof. C’est confortable,
mais plus ou moins élégant. Le poêle à gaz est allumé…
L’Époux. La Grisette.
Sur la table, on voit les restes d’un souper… meringues
à la crème, fruits, fromages… Dans les verres, un vin
blanc de Hongrie.
L’Époux fume un havane, assis dans le coin du canapé.
La Grisette est assise à côté de lui, sur une chaise, et
avec une cuillère prend la crème d’une meringue qu’elle
savoure avec délice.
L’Époux – C’est bon ?
La Grisette sans s’interrompre – Oh !
L’Époux – En veux-tu une autre ?
La Grisette – Non, j’ai déjà trop mangé.
L’Époux – Ton verre est vide ! (Il lui verse à boire.)
La Grisette – Non… je vous en prie. De toute façon,
je ne le boirai pas !
L’Époux – Voilà que tu me redis vous. (1) »
C’est à Vienne, Vienne ville du jeu, des dettes, des duels, des bals,
des salons où défilent musettes, grisettes, lorettes, ville de l’impératrice
Sissi, qui baptisa son cheval Nihilismus, que naquit Arthur Schnitzler
dans une famille de la bourgeoisie juive, d’un père laryngologue à
la réputation au pinacle. Enfant, Arthur voyait défiler dans l’appar-
136 AVRIL 2020arthur schnitzler, un pas de bourrée dans la ronde des faux-cols viennois
tement familial actrices et cantatrices, charmante compagnie qui lui
donna le goût des femmes et des arts. De ses 13 à ses 22 ans, il avait
déjà écrit plus d’une vingtaine de pièces et débuté un journal que son
père ne se fit pas prier de lire et de confisquer ; il fallait à son aîné un
avenir sérieux.
À la génération du père, où « l’éthique de la connaissance exaltait
la vertu, la loi, l’assujettissement du corps à l’esprit, l’éducation et
le dur labeur » (2), s’opposait la génération du fils recherchant « des
valeurs esthétiques liées aux raffinements de l’individualisme, une
culture des sentiments, liée à la vie d’artiste et à l’attention orientée
vers tous les états psychiques » (3). Arthur commença donc par mener
une jeunesse « dissipée » (champs de courses, cafés, poker, billard et
maîtresses), tout en suivant les traces de Johann Schnitzler en se lan-
çant dans une carrière médicale. Bien sûr, ce style de vie inspiré par
l’imitation des mœurs aristocratiques, sensualistes et sybaritistes, célé-
brant la nature par un outrecuidant farniente, comportait de visibles
écueils et Schnitzler avait conscience du danger de devenir un « dilet-
tante hypocondriaque, un héritier brillamment raté » (4). Le travail
gardant de l’oisiveté, il attendit la mort du père pour renoncer à exer-
cer la médecine et se consacrer à temps complet à l’écriture. Il avait
31 ans, le positivisme faisait figure de vieil homme à froc poussiéreux
et à réponses surannées ; désormais, les avancées se situaient dans les
sentiers de traverse de la psyché humaine, d’autant que le XIXe siècle
avait rongé le cordon ombilical le reliant à un religieux qui illumi-
nait encore le siècle précédent. Désormais, les penseurs et les artistes
cherchaient des réponses ailleurs que dans les grandes représentations
religieuses, agrandissant le prisme des possibilités autour du « qu’est-
ce que l’homme » et décortiquant l’être jusque dans ses tréfonds, aidés
par la nouvelle lanterne qu’était la psychanalyse freudienne.
« Homme jeune et élégant, en possession de mille mil-
lions et d’un complexe d’Œdipe modeste mais avec pos-
sibilité d’évolution, recherche en tout bien tout honneur
à faire connaissance d’une infanticide en puissance pour
excursions dans l’inconscient et, si convenance, dans le
AVRIL 2020 137littérature
conscient. Écrire au journal sous le code : Plutôt sublimé
que refoulé. Préférence à jeunes filles moins de 14 ans,
pucelles poubelle. (5) »
Comme constaté dans cette parodie de petite annonce, Schnitzler
était critique envers cette grande découverte dictatoriale, doctrinaire
et s’imposant comme explication universelle qu’était la psychanalyse.
Son reproche principal avait pour objet sa généralisation abusive, et
concernait tout particulièrement l’interprétation des rêves ou encore
le complexe d’Œdipe. Comme il l’écrivait :
« Par la surdétermination à tout prix, on peut bien sûr
tout interpréter. [...] Affirmer qu’un sentiment sexuel
pour la mère est constamment présent, et que l’homme
recherche toujours dans la femme aimée sa mère ou sa
sœur est tout bonnement faux. (6) »
Pire, selon lui, Freud coupait l’individu de toute notion de libre
arbitre et donc de liberté, mantra qui fut celui guidant les pas des
protagonistes de toute son œuvre. Arthur Schnitzler ne condamnait
jamais ses personnages malgré un scepticisme lié à sa formation médi-
cale première. Comme le précisent Brigitte Vergne-Cain et Gérard
Rudent : « On a pu montrer que si Freud était devenu, au cours de sa
carrière, de plus en plus déterministe, et pessimiste pour l’évolution de
l’humanité, Arthur Schnitzler n’avait fait, lui, que cultiver son scepti-
cisme, dans tous les domaines. (7) »
Limites du positivisme, aporie du transcendant, œillères de la psy-
chanalyse freudienne, quelle fut donc la réponse apportée par Arthur
Schnitzler ? En littérature, il y avait eu le retour aux légendes nordiques
wagnériennes, la tabula rasa nietzschéenne ou comme chez Hugo von
Hofmannsthal, Paul Claudel ou André Suarès, la marche arrière vers
l’idéal que représentait l’Antiquité, son tragique et ses vertus. Loin
des baudruches d’ornements romantiques, loin des délocalisations
d’intrigues en terres mythologiques, Schnitzler, lui, situait ses drames
en pays connu, à son époque, son leitmotiv narratif reposant sur la
138 AVRIL 2020arthur schnitzler, un pas de bourrée dans la ronde des faux-cols viennois
dissection inlassablement répétée d’âmes nouvelles mues par les aléas
des circonstances. La quête de Schnitzler fut celle d’un spéléologue
des consciences, d’un entomologiste de recoins d’âmes soumises à la
tentation.
Avant le succès des trente dernières années de sa vie, Arthur Schnitz-
ler était surtout considéré comme mi-poète mi-médecin, comme un
Literat, somme toute, ce qui est faire grande offense à celui qui dans
sa pyramide des valeurs, dans ses diagrammes évoqués dans une lettre,
datant du 11 juin 1901, à Georg Brandes comme des « amusements
philosophiques non dépourvus de sens profond », plaçait l’homme de
lettres (Literat) à côté des qualificatifs « perfide » et « scélérat » (Tucke-
böld) et non loin du diable (Teufel), alors que le poète (Dichter) et le
prophète (Prophet) trouvaient place près de Dieu (Gott).
Pourtant, beau joueur : « Je suis conscient de ne pas être un artiste de
premier plan. Mais il se trouve que le fait de créer est l’élément le plus
essentiel de mon existence », se plaisait-il à coucher sur le papier. Or
c’est cette légèreté feinte qui peut expliquer pourquoi l’œuvre d’Arthur
Schnitzler n’a pas plus été goûtée. Pensez, un écrivain volontaire, un
auteur gai et heureux de son sort, ne renvoyant pas l’image de lui-même
torturé et écrasé sous le fardeau de sa tâche : diantre, quelle conspiration
contre le pessimisme courtois et avalisé comme preuve de profondeur
par le milieu littéraire ! Effectivement, le choix de la plume ne se fait
pas forcément canon accolé à la tempe et le ton ainsi que le nombre
de ses écrits louent d’eux-mêmes le choix de se consacrer aux lettres en
non-dilettante. Comme il le disait dans son autobiographie inachevée,
choisir une voie est quelque chose d’essentiel et non de circonstanciel :
« Quelques heures après ma naissance, je passai un
moment couché sur son bureau [son père prophétisant
qu’il deviendrait écrivain]. [...] Je ne crois pas à une pro-
vidence qui se soucie du destin de chacun. Mais je crois
que certains êtres existent, qui savent ce qu’il en est d’eux
[...] qui prennent librement les décisions qui sont, pour
eux, vitales [...] qui sont toujours sur le bon chemin,
même lorsqu’ils s’accusent de s’être trompés. (8) »
AVRIL 2020 139littérature
Nul doute qu’Arthur Schnitzler se savait compté au nombre de ces
élus.
« Innombrables sont les récits du monde », disait Roland Barthes.
Chez Schnitzler, les mères couchent avec leur progéniture avant de se
suicider par noyade, les ivrognes miséreux dévalisent des salles de jeux
et oublient le lendemain où ils ont dissimulé leur butin, des amants
condamnés se rongent de penser que leur moitié leur survivra, des
musiciens mourants vont discrètement s’éteindre en coulisses pour
ne pas déranger les spectateurs, des libertins s’enlisent dans des jeux
de rôle pour raviver l’enthousiasme de leurs premières amours. Chez
ce Viennois, fi de la condamnation morale manichéenne et du poli-
tiquement correct, nulle tiédeur et nul jugement à l’emporte-pièce.
L’important est de comprendre, de suivre l’être à différents carrefours
et de voir la voie qu’il choisira d’emprunter face à un nuancier de
possibilités. Le lire, c’est descendre d’un wagon moderne pour suivre
la ronde des faux-cols amidonnés de sa ville natale, « Vienne, station
météorologique de la fin du monde », comme le disait Karl Kraus.
1. Arthur Schnitzler, La Ronde, scène vi in Romans et nouvelles, édition de Brigitte Vergne-Cain et Gérard
Rudent, tome II, 1885-1908, Le Livre de poche, coll. « La Pochothèque », 1996.
2. Idem.
3. Idem.
4. Idem.
5. Idem.
6. Idem.
7. Brigitte Vergne-Cain et Gérard Rudent, « Préface », Arthur Schnitzler, Romans et nouvelles, op. cit.
8. Arthur Schnitzler, Romans et nouvelles, op. cit.
140 AVRIL 2020Vous pouvez aussi lire