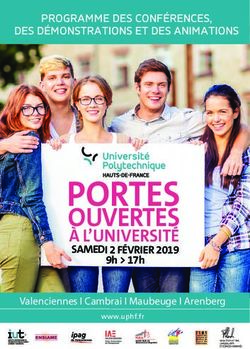Fonctionnement interne de l'EHPAD et principes de coordination - Présentation du 20 mars 2015
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Fonctionnement interne
de l’EHPAD et principes de
coordination
Présentation du 20 mars 2015
marielle.pannecocke@fces.fr 1
présentation du 20 mars 2015Fonctionnement interne de l’EHPAD et
principes de coordination
La mission des résidences de la Fondation Caisse d’Epargne
pour la solidarité est de prendre soin de personnes âgées
présentant un handicap et/ou perte d’autonomie et lutter
contre toute forme d’exclusion
La Fondation s’appuie, dans le cadre de son action, sur les trois valeurs de
référence que l’ensemble de ses équipes s’engagent à porter avec leurs
partenaires : la qualité partagée, la compétence solidaire et
l’engagement collectif
Tous les établissement de la FCEs sont habilités à 100% à l’aide sociale
La résidence La Quiétude est un ancien foyer logement
construit en 1980, repris par la FCEs qui a obtenu le statut
EHPAD en 2006 du fait d’une très grande dépendance des
résidents. Des travaux de restructuration/extension,
nécessaires pour respecter la nouvelle réglementation des
ERP*, ont duré de 2007 à 2011, en site occupé (plus de 6M
d’euros).
*ERP (établissement recevant du public)
marielle.pannecocke@fces.fr 2
présentation du 20 mars 2015ORGANIGRAME DU PERSONNEL
Moyens attendus depuis le 01/01/2011 (soit 300 000 € de
dotation) : signature de la CTP en juin 2014 (rétroactivité au
01/01/2013)
+ 0.19 ETP médecin coordonnateur +0,30 ETP psychologue
+ 1 ETP IDE + 0,50 ETP psychomotricien
+ 5,5 ETP AS/AMP + 0,50 ETP ergothérapeute
Gel de 68 000 € par l’ARS malgré le calcul du GMPS au motif de
« risque de retour à la dotation de convergeance (soit 2 AS en
moins)
marielle.pannecocke@fces.fr 3
présentation du 20 mars 2015ORGANIGRAME DU PERSONNEL
Dépendance/Soins* :
Ratio global : 0,65
0,50 médecin coordonnateur
Depuis 2014 4 infirmières
Ratio soins 0,29
16,5 aides soignantes
1 Aides Médico Psychologique
1,33 Assistante soins en gérontologie
0,50 Ergothérapeute
0,50 psychomotricien
0,30 psychologue
Administration* :
0,40 directeur de pôle
1 responsable d’établissement
Hébergement *:
1 secrétaire
1 animateur Service commun *:
2 cuisiniers 1 ouvrier d’entretien
14 ASH 1 gouvernante
Total 42,06 ETP
DERNIER GMP VALIDE : 795 DERNIER PMP VALIDE : 274
marielle.pannecocke@fces.fr 4
présentation du 20 mars 2015Projet de vie de l’EHPAD
LE PROJET REGIONAL DE SANTE
Le Schéma régional d’organisation médico-social (SROMS) du
Nord-Pas-de-Calais 2012-2016 met en avant 3 notions
fondamentales dans le champ médico-social :
autonomie, accessibilité et parcours.
Ces 3 éléments sont constitutifs du processus d’accompagnement des
personnes.
A travers ce schéma, l’ARS et les 2 départements du Nord-Pas-
de-Calais s’engagent à :
Améliorer l’accueil, l’orientation et l’aide aux personnes en perte
d’autonomie à travers le développement sur chaque territoire d’une
Maison de l’Autonomie
Améliorer l’aide aux aidants des personnes en perte d’autonomie
Promouvoir la coopération des acteurs du secteur médico-social au
service d’un projet de territoire
Promouvoir l’innovation et les conditions d’un développement durable
marielle.pannecocke@fces.fr 5
présentation du 20 mars 2015Projet de vie de l’EHPAD
LE SCHEMA DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DES PERSONNES
AGEES - 2012-2018 (Pas de Calais) s’appuie sur le schéma
régional et repose sur 6 orientations :
•le maintien de l’exercice d’une pleine citoyenneté
•le soutien à domicile
•avoir un chez soi adapté à son degré d’autonomie
•la prévention et le soin des pathologies liées au grand âge
•la protection des personnes âgées
•une organisation des dispositifs de prise en charge à l’échelle
des territoires
L’établissement suit ces préconisations en aménageant la structure
et l’environnement pour un maintien de l’autonomie des résidents,
en préservant leur sécurité tout en conservant le lien social
et l’ouverture sur l’extérieur.
marielle.pannecocke@fces.fr 6
présentation du 20 mars 2015Projet de vie de l’EHPAD
Un projet de vie, c’est essentiellement une déclaration
d’intention (suivie d’actions) faite par et pour l’ensemble des
partenaires d’une institution, et qui doit assurer la cohérence
des actions autour d’une idée commune : un nouveau lieu de
vie pour le sujet âgé.
Aménagement des structures, de l’environnement :
Le projet de vie a pour objet de rendre la parole à la personne âgée.
La structure se doit d’être au service de l’usager, ce n’est pas l’usager
qui doit s’adapter à elle : lorsque la personne âgée entre en
institution, sa vie doit se rapprocher le plus possible de celle du
domicile.
La réflexion de la réhabilitation de la résidence est donc partie de ce
principe, créant ainsi des nouveaux lieux de vie, intimes ou
conviviaux, que les résidents s’approprient comme « chez eux » (salon
TV, salon bibliothèque, salle de discussions et d’échanges, etc).
marielle.pannecocke@fces.fr 7
présentation du 20 mars 2015Projet de vie de l’EHPAD
Prévenir et soigner les pathologies liées au grand âge et
notamment :
Améliorer les soins en établissement
Assurer la prise en charge des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer
Protéger la personne âgée et notamment promouvoir la
bientraitance par l’écoute et la communication
Mettre en place une politique de bientraitance au sein de
l’établissement (formations, procédures, charte, etc).
Organiser les dispositifs d’accompagnement à l’échelle des
territoires
Travailler étroitement avec les partenaires locaux, s’intégrer dans
le réseau gériatrique, adhérer à des groupements de coopération
marielle.pannecocke@fces.fr 8
présentation du 20 mars 2015Projet de vie de l’EHPAD
réglementation des locaux
Sécurité : La sécurité incendie : l’arrêté du 29/01/2003 et du
21/03/2007 modifient le règlement de Sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les ERP. Toute résidence dont la capacité
d’accueil est supérieure ou égale à 20 personnes est classée dans la
catégorie des établissements recevant un public de type J « Structure
d’Accueil pour personnes âgées et personnes handicapées » et doivent
se mettre aux normes.
Accessibilité : modification du code de la construction :
•le décret du 16 mai 2006 impose aux ERP de respecter des normes
d’accessibilité.
•L’arrêté du 1/08/2006 et du 21/03/2007 fixent les dispositions du
code de la construction et de l’habitation recevant du public
(établissements existants ou en création).
Sécurité électrique : le Décret du 26 mai 2009 et de la Circulaire
DGAS n 2009-170 du 18/06/2009 imposent aux établissements
recevant du public d’élaborer un DARDE (document d’analyse des risques de
défaillance électrique).
marielle.pannecocke@fces.fr 9
présentation du 20 mars 2015Projet de vie de l’EHPAD
Hygiène : les normes d’hygiène en EHPAD se rapprochent de
plus en plus des normes hospitalières, les protocoles devenant
incontournables pour assurer une sécurité optimale aux résidents.
Depuis la circulaire du 30 septembre 2011, tous les EHPAD doivent
avoir établi un DARI après avoir élaboré un Document d’Analyse
des Risques Infectieux dans l’ensemble des postes à risques :
locaux, linge, déchets, soins, alimentation (document
d’autoévaluation des pratiques hospitalières : le GREPHH).
réglementation de la sécurité alimentaire : Les normes
HACCP exigées en cuisines collectives sécurisent le résident de tout
risque alimentaire (TIAC) mais engagent l’établissement dans une
obligation de moyens et de résultats très importante. La Direction
de la FCEs a fait le choix de faire appel à un prestataire extérieur
afin de garantir cette sécurité. Les repas sont confectionnés sur
place par du personnel de cuisine diplômé et formé à l’HACCP,
l’ensemble des contrôles réglementaires sont assurés par ce
prestataire qui porte la responsabilité des résultats.
marielle.pannecocke@fces.fr 10
présentation du 20 mars 2015Projet de vie de l’EHPAD
L’Animation :
l’animation et la vie sociale sont des éléments importants dans le
projet de vie qui exige l’implication de tous (l’ensemble du
personnel, les familles, les bénévoles, la direction). Un animateur
diplômé se charge de la mise en œuvre de l’animation, en étroite
relation avec le personnel soignant et en incitant les familles à
participer aux différents projets mis en place. Une approche
individualisée et adaptée à chaque résident permettra la valorisation
des activités et limitera les situations d’échec.
Les bénévoles ont un rôle très important au sein de l’établissement
car ils apportent une chaleur humaine, une attention particulière qui
réconforte les personnes âgées qui ont parfois peu ou pas de visite
La famille doit trouver sa place dans la mise en œuvre du projet de
vie : elle doit être associée aux réflexions de l’équipe qui doit
favoriser les échanges dans l’intérêt du résident. Il est également
nécessaire d’apporter un soutien psychologique à la famille, parfois
en grande souffrance devant une évolution de la dépendance
physique ou psychique souvent insupportable (maladie d’Alzheimer,
fin de vie). marielle.pannecocke@fces.fr 11
présentation du 20 mars 2015Projet de vie de l’EHPAD
Les 7 outils décrits dans la loi du 2 janvier 2002 :
Le livret d’accueil
La charte des droits et libertés
Le contrat de séjour
Un conciliateur ou médiateur (la liste doit être
affichée dans l’établissement)
Le règlement de fonctionnement de
l’établissement
Le projet d’établissement ou de service
Le conseil de vie sociale
Cette loi demande aux établissements médico-sociaux de s’engager
dans une démarche d’évaluation interne puis externe
marielle.pannecocke@fces.fr 12
présentation du 20 mars 2015Projet de vie de l’EHPAD
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)
C’est une instance obligatoire au sein de tout établissement médico-social.
Le Conseil de la vie sociale doit favoriser la participation et l’expression des personnes âgées accueillies au
sein de l’établissement, ainsi que celles de leur famille ou tuteur. La direction les associe à l’élaboration et à
la modification du Règlement de fonctionnement et du projet d’établissement.
Le CVS comprend au minimum :
• deux représentants des personnes accueillies ;
• un représentant des familles ou représentants légaux ;
• un représentant du personnel ;
• un représentant de l’organisme gestionnaire.
Ses membres formulent des avis et des propositions sur toute question intéressant le
fonctionnement de
l’établissement ou du service. Sont particulièrement concernés l’organisation intérieure, la
vie quotidienne,
les activités, l’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, et les projets de
travaux et
d’équipements.
marielle.pannecocke@fces.fr 13
présentation du 20 mars 2015Le projet d’établissement
S’il relève d’une obligation légale, le projet d’établissement
doit davantage être perçu comme un véritable outil d’anticipation, de
développement et de perspective pour l’établissement.
Le projet d’établissement est le référentiel actualisé de la
structure au regard de ses missions et de ses objectifs.
C’est un outil fédérateur et porteur de valeurs : tout le monde
trouve un sens à son action. Le projet d’établissement est un outil
prospectif, un système d’hypothèses qui devra être ajusté
régulièrement.
Il apparaît dans la loi de 2002 de rénovation de l’action sociale
et médico-sociale dans le chapitre sur les droits des usagers, il est
donc orienté « résident ». Le projet d’établissement est un document
de travail managérial c’est-à-dire qu’il traduit le fonctionnement
quotidien du service et servira de référence, d’outil de travail.
marielle.pannecocke@fces.fr 14
présentation du 20 mars 2015Le projet d’établissement
L’équipe doit considérer le résident comme une
personne « SUJET DE SOINS » nécessitant une qualité de vie
associée à une qualité de soins : c’est le Responsable et le
directeur d’établissement qui insufflent l’esprit de cette
approche globale à l’ensemble des professionnels impliqués
(soignants, personnel hôtelier et de cuisine, secrétaire, ouvrier
d’entretien, etc.) et également aux divers intervenants extérieurs
(médecins, kinés, orthophonistes, pharmaciens, bénévoles,
familles.).
Cette approche globale nécessite une COMMUNICATION
ACTIVE, autant interne qu’externe (familles, instances
représentatives) pour que le fil conducteur qu’est le projet
d’établissement serve à toute personne intervenant au sein de
l’institution
marielle.pannecocke@fces.fr 15
présentation du 20 mars 2015Le projet d’etablissement
La vie sociale et les soins prodigués au sein de l’établissement
reflètent de la mise en application du projet d’établissement :
l’objectif primordial est de conserver à la personne âgée handicapée
physiquement ou détériorée intellectuellement, la plus grande
autonomie physique et psychique possible par :
•Le traitement des maladies associées
•Le traitement de la composante dépressive, des troubles du
comportement et troubles psychiques associés
•La prévention de la grabatisation
•L’aide (directe ou incitative) pour les activités de la vie
quotidienne
•Une plus grande tolérance vis-à-vis des troubles du
comportement
Un travail pluridisciplinaire qui permet ce maintien de
l’autonomie et de la vie sociale, est coordonné par le
responsable d’établissement et le médecin
coordonnateur. Ce binôme est indissociable.
marielle.pannecocke@fces.fr 16
présentation du 20 mars 2015Le projet d’établissement
POLITIQUE D’ADMISSION : seul le critère d’âge (60 ans) est
pris en compte pour l’admission, il existe cependant des
dérogations d’âge accordées par le Conseil Général. Le dossier
médical déterminera ensuite la possibilité d’admission (l’état de la
personne devant être compatible avec la vie en établissement).
Accueil des familles et du futur résident : moment
privilégié de dialogue entre le Responsable d’établissement et
la famille, le premier contact est important car il permet de
dédramatiser l’entrée en institution (vécue parfois comme un
drame et/ou un échec personnel par la famille et souvent
associée à un sentiment de culpabilité).
marielle.pannecocke@fces.fr 17
présentation du 20 mars 2015Le projet d’établissement
Visite préalable du futur résident, accompagné de ses proches :
elle permet au responsable d’établissement de fournir tous les
renseignements utiles à la personne âgée sur le fonctionnement de la
structure (horaires des repas, animations, entretien du linge, etc.).
Cette visite permet également de recueillir diverses informations utiles
à une prise en charge optimale (habitudes de vie, régime alimentaire,
loisirs, etc.) afin de mettre en place un projet de vie personnalisé et de
faciliter l’insertion au sein de la structure. Le consentement de la
personne âgée est vivement souhaité (ou le « non refus ») de
manière à obtenir son adhésion lors de l’admission et pour permettre
une adaptation rapide à l’institution.
Arrivée du résident : le moment de l’admission doit être opportun,
pour accueillir le nouveau résident dans les meilleures conditions
possibles (disponibilité du responsable d’établissement, du personnel
soignant et hôtelier). Le résident doit se sentir « attendu » :
l’ensemble du personnel doit donc connaître son nom, sa chambre doit
être prête (de préférence décorée avec ses effets personnels).
marielle.pannecocke@fces.fr 18
présentation du 20 mars 2015Le projet d’établissement
L’ORGANISATION DE LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT repose
sur des rythmes et des lieux :
La chambre : chaque résident dispose d’un espace individuel
(minimum 30 m2) équipée d’une salle de bains avec douche de
plain-pied et d’un W.C, permettant une autonomie aussi large
que possible. Chaque chambre est meublée au minimum d’un
lit médicalisé, d’une table de chevet, d’un téléphone qui permet
également la liaison avec les équipes soignantes et dispose
d’un système d’appel d’urgence (par système de médaillon
porté au cou ou en bracelet). Le résident qui le souhaite peut
bien entendu équiper tout ou partie de la chambre avec du
mobilier personnel de manière à la personnaliser.
marielle.pannecocke@fces.fr 19
présentation du 20 mars 2015Le projet d’établissement
L’entretien : un personnel spécifique (ASL) prend en charge
l’entretien quotidien de l’ensemble des locaux. Les résident qui le
peuvent et qui le souhaitent, peuvent demander à effectuer une
partie de l’entretien courant de leur chambre (réfection de lit,
dépoussiérage du mobilier) afin de maintenir une certaine
autonomie. Une lingère entretien le linge personnel des résidents.
Un homme d’entretien assure les petits travaux de réparation et de
rénovation dans l’ensemble de l’établissement.
Les repas : considérés comme des moments de plaisir et
d’intimité, ils rythment la journée (petit déjeuner à 7h30, déjeuner
à 12h, goûter à 15h et dîner à 18h45) et sont pris en salle à
manger (sauf prescription médicale de maintien en chambre). Le
temps du repas est suffisamment long pour permettre au personnel
de stimuler les personnes à manger seules et le service est assuré
par du personnel qualifié. Chacun peut convier des hôtes afin de
maintenir des liens sociaux et familiaux. Les repas sont copieux et
variés : ils sont confectionnés sur place par des cuisiniers qualifiés .
Une commission repas est constituée afin de recueillir les goûts et
préférences alimentaires des résidents.
marielle.pannecocke@fces.fr 20
présentation du 20 mars 2015Le projet d’établissement
L’habillement :
afin de faciliter les relations sociales et la considérations de
tous, les résidents sont invités à se présenter en tenue de ville
dans les locaux de vie et d’animation collective (le personnel
veille à ce que ceux-ci aient une tenue vestimentaire soignée).
Le linge personnel est entretenu (ramassé, lavé, distribué en
chambre) par la lingère de l’établissement sans supplément de
prix.
marielle.pannecocke@fces.fr 21
présentation du 20 mars 2015Le projet d’établissement
Le personnel : l’homogénéité du personnel sur le plan de leur origine
géographique doit se rapprocher de celle des résidents afin de faciliter
la communication et l’intégration. Lors du recrutement, les points
essentiels retenus par le responsable d’établissement sont les qualités
humaines, les motivations, le sens relationnel et bien entendu la
qualification des postulants. La notion de créativité, l’écoute active et
une implication personnelle sont des éléments positifs à valoriser. Le
travail en équipe doit être compris et intégré par chacun afin de
conserver une certaine cohérence dans la prise en charge
individualisée.
La formation du personnel : au premier plan des préoccupations de
l’Association, la formation initiale permet de cibler des compétences
de base. La formation continue permet l’adaptation permanente du
savoir faire du personnel. Des budgets sont alloués annuellement afin
de proposer au personnel des formations collectives adaptées, chacun
pouvant également s’inscrire pour une formation individuelle.
22
marielle.pannecocke@fces.fr
présentation du 20 mars 2015La démarche qualité
Structurée en 4 chapitres à leur tour déclinés en thèmes
puis en références et critères :
Chapitre 1 : Valeurs et engagements
Thème 1 : Autonomie et Action sur l’Environnement
Thème 2 : Respect des Droits et Libertés
Chapitre 2 : Accompagnement du Résident
Thème 3 : Participation et Satisfaction du Résident
Thème 4 : Processus d’Accompagnement du Résident
Thème 5 : Projet de Vie personnalisé et Contrat de séjour
Chapitre 3 : Organisation et coordination
Thème 6 : Projet d’Etablissement
Thème 7 : Gestion et Coordination des Ressources
Thème 8 : Dossier du Résident
Thème 9 : Gestion De la Qualité
Chapitre 4 : Cadre de vie et logistique
Thème 10 : Cadre et Qualité de Vie
Thème 11 : Gestion Des Risques
Thème 12 : Logistique
marielle.pannecocke@fces.fr 23
présentation du 20 mars 2015La démarche qualité
Suite à la période d’évaluation
interne et au vue du diagnostic
réalisé, le comité de pilotage définira
les thèmes d’amélioration prioritaires.
De nouveaux groupes de travail se
constitueront.
Leur composition sera fonction du
thème de travail
marielle.pannecocke@fces.fr 24
présentation du 20 mars 2015La démarche qualité
Les sources de progrès peuvent être réparties en 4 familles :
•Le non respect d’objectifs ou d’engagements (internes ou
externes ou réglementaires) pris vis-à-vis des résidents ;
•La non qualité de la prise en charge (erreurs, signalements,
résultats de contrôles) ;
•La réclamation émanant du résident ou sa famille
•Les évènements perturbateurs : il s’agit de toutes les
perturbations identifiées dans l’établissement qui peuvent
générer de la non qualité (procédure pas à jour,
communication partiellement reçue ou pas reçue …).
marielle.pannecocke@fces.fr 25
présentation du 20 mars 2015STRUCTURE DU PROJET QUALITE DANS
CHAQUE ETABLISSEMENT
marielle.pannecocke@fces.fr 26
présentation du 20 mars 2015La démarche qualité
L’évaluation interne permet aux acteurs de :
-Réfléchir ensemble à leur organisation
-Renouveler le dialogue
-Reconnaitre les points forts et les points à améliorer
-Faire évoluer la façon de travailler
Tous les établissements ont obligation à adresser leur rapport d’auto-
évaluation interne avant le 4 janvier 2014 et doivent avoir effectué leur
évaluation externe avant le 5 janvier 2015 (report au 31/03/2015 pour
l’envoi des rapports)
L’évaluation externe est une obligation règlementaire :
Pratiquée tous les 7 ans par des organismes habilités par l’ANESM, elle
conditionne le renouvellement de l’autorisation. Les premières
évaluations externes ont débuté en 2010.
La résidence La Quiétude a procédé à son évaluation externe en
septembre 2013, le processus s’est déclenché en septembre 2012, par
une autoévaluation puis l’évaluation interne en mars 2013. Le résultat
de cette évaluation externe donnera lieu au renouvellement (ou non) de
l’autorisation par l’ARS et le conseil général de poursuivre l’exploitation
de la résidence.
27
marielle.pannecocke@fces.fr
présentation du 20 mars 2015la loi du 2 janvier : 6 Orientations
Affirmer les droits des usagers.
Diversifier les missions et les offres en adaptant les structures aux
besoins.
Pilotage du dispositif : Mieux articuler planification, programmation, allocation de
ressources, évaluation.
Redéfinir le régime des autorisations
Instaurer une coordination entre les différents acteurs.
L’évaluation
marielle.pannecocke@fces.fr 28
présentation du 20 mars 2015Vous pouvez aussi lire