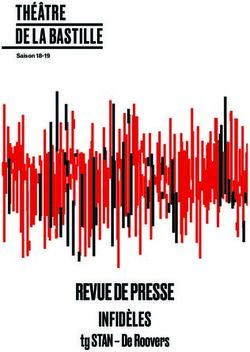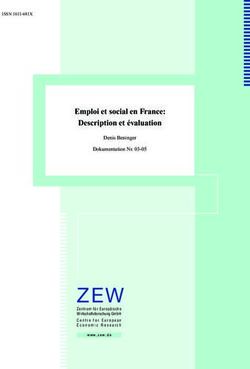Framing et reframing: communiquer autrement sur la maladie d'Alzheimer
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Framing et reframing: communiquer autrement sur la maladie d’Alzheimer Baldwin Van Gorp Tom Vercruysse Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie K.U.Leuven
Framing et Reframing: Communiquer autrement
sur la maladie d’Alzheimer
Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel:
Framing en Reframing: Anders communiceren over dementie
Une édition de la Fondation Roi Baudouin,
21 rue Brederode à 1000 Bruxelles
AUTEURS Professeur Baldwin Van Gorp et Tom Vercruysse, Centrum voor
Mediacultuur en Communicatietechnologie, K.U.Leuven
CONTRIBUTIONS Michel Teller, Cyrano
RÉDACTIONNELLES Karin Rondia, journaliste scientifique
CONTRIBUTION
COMMUNICATION Madeleine Leclercq et Marco Calant, Tramway21
STRATEGIQUE
COORDINATION POUR Gerrit Rauws, directeur
LA FONDATION ROI Saïda Sakali, responsable de projet
BAUDOUIN Bénédicte Gombault, responsable de projet
Pascale Prête, assistante
CONCEPTION GRAPHIQUE PuPiL
MISE EN PAGE Tilt Factory
PRINT ON DEMAND Manufast-ABP asbl, une entreprise de travail adapté
Cette publication peut être téléchargée gratuitement sur notre site
www.kbs-frb.be
Une version imprimée de cette publication électronique peut être
commandée (gratuitement) sur notre site www.kbs-frb.be, par
e-mail à l’adresse publi@kbs-frb.be ou auprès de notre centre de
contact, tél. + 32-70-233 728, fax + 32-70-233-727
Dépôt légal: D/2848/2011/06
ISBN-13: 978-2-87212-634-7
EAN: 9782872126347
BESTELNUMMER: 2048
Mars 2011
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 4Sommaire
Avant-propos de la Fondation Roi Baudouin . . . . . . . . . . . . . 7
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Le framing et la construction de la réalité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Objet et questions de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. À la recherche des frames et des counterframes. . . . . . . 15
Méthode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Matériel d’analyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Procédures d’analyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Six frames et six counterframes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Frames axés sur la personne malade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.A. Dualisme corps-esprit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.B. Unité corps-esprit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. L’envahisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. L’étrange compagnon de voyage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.A. La foi dans la science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.B. Le vieillissement naturel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5. La peur de la mort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6. Carpe Diem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Frames axés sur la relation entre la personne malade et son entourage. . . . . . . 30
7.A. Rôles inversés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7.B. Chacun son tour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.A. Sans contrepartie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.B. La Bonne Mère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Combinaisons de frames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Frames et counterframes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Les frames et les médias d’information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3. Pour une image plus nuancée
de la maladie d’Alzheimer –
Deux journées d’inspiration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 54. Un autre frame, un autre regard sur la démence :
campagne test en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Méthode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Expérience en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Matériel de stimulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Constitution de l’échantillon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Contrôle du risque de distorsion dû au choix des photos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
L’évaluation de la campagne et de ses variantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Différences d’évaluation entre groupes de répondants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Capacité d’action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5. Conclusions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6. Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7. Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Annexe 1: Sélection du materiel d’analyse utilisé . . . . . . . 71
Annexe 2: Frame matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Annexe 3: Liste des participants
au week-end d’inspiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 6Avant-propos de
la Fondation Roi
Baudouin
La réalité peut sembler fort différente selon la perspective,
le cadre de référence, l’angle d’approche.
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées constituent un
sérieux défi pour notre société: ces pathologies restent incurables à
l’heure actuelle tandis que la population ne cesse de vieillir. C’est ce qui
explique pourquoi on s’intéresse de plus en plus à la manière d’aborder
ces maladies et d’améliorer la qualité de vie des personnes qui en
souffrent.
La représentation sociale actuelle influence fortement la qualité de vie
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leur proches.
Le regard négatif que leur jette le reste de la société devient une partie
de leur problème.
Pour l’instant, c’est le ‘modèle de la perte’, avec diverses nuances avec
toutes les conséquences qui en résultent. La présente étude, réalisée
par la K.U. Leuven, examine comment faire émerger une image plus
nuancée de ces pathologies grâce au concept de ‘framing’. L’un des
enjeux à cet égard est de faire réapparaître l’être humain devant la
maladie et de permettre aux malades de participer plus longtemps à la
vie sociale.
Le framing s’efforce de fournir une description correcte et aisément
compréhensible de concepts ou de problèmes difficiles ou délicats. Il se
sert pour cela de valeurs, de métaphores et d’images qui ont trait à
notre connaissance quotidienne de la manière dont le monde fonctionne.
Les chercheurs ont dressé l’inventaire des modèles explicatifs de la
maladie d’Alzheimer et se sont demandé quels étaient les ‘frames’ en
vigueur dans les médias par rapport à la démence. Ils ont ensuite
recherché des ‘counterframes’ qui ouvrent de nouvelles perspectives de
communication. Ils ont aussi étudié quelles idées et conceptions se
dissimulent derrière ces frames et ‘counterframes’, comment elles sont
traduites en mots ou en images, quel est leur fondement moral et
quelles en sont les conséquences. Ensuite, lors d’un week-end différents
acteurs concernés ont été interrogés sur les ‘counterframes’ et invités à
imaginer concrètement de nouvelles images.
Finalement, une enquête d’opinion menée auprès d’un échantillon
représentatif de 1.000 Belges, a également permis d’étudier quels
frames peuvent être utilisés dans la communication afin de rendre le
thème plus compréhensible auprès du grand public, mais aussi pour
l’amener à jeter un autre regard sur la maladie d’Alzheimer.
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 7Avant-propos de la Fondation Roi Baudouin
La Fondation Roi Baudouin espère, avec tous les acteurs concernés, avoir fait ainsi un pas dans la
direction d’une société ‘Alzheimer admis’. Tout aussi cruciale est la perspective d’action qui est suggérée
dans cette étude pour les acteurs concernés. On examinera avec des acteurs qui travaillent sur la
maladie d’Alzheimer comment ils peuvent aller plus loin et renforcer ce message par une communication
commune et plus harmonisée.
La Fondation tient à remercier tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à cette étude
et à cette autre image. Elle remercie en premier lieu les chercheurs, le professeur Baldwin Van Gorp et
monsieur Tom Vercruysse, qui, par leurs travaux, ont introduit en Belgique ce concept de framing et lui
ont donné une consistance.
Nos remerciements particuliers à tous les participants du week-end d’inspiration et à Madeleine Leclercq
et Marco Calant de Tramway 21 sans qui la concrétisation de nouveaux concepts de communication
n’aurait pu se réaliser.
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 8I. Introduction
Dans la vie de tous les jours, on parle habituellement de ‘maladie
d’Alzheimer’ pour désigner divers troubles neurologiques apparentés.
Par souci de commodité, nous utiliserons également ce terme, même
s’il ne s’agit en fait que de la forme la plus connue et la plus fréquente
d’un ensemble d’affections que les spécialistes regroupent souvent sous
l’appellation de ‘démence’1. Bien que ces maladies ne soient pas
nécessairement liées au grand âge, leur prévalence augmente
fortement à partir de 65 ans. Elles se caractérisent par une dégradation
progressive des facultés cognitives, telles que la mémoire et les
capacités rationnelles et relationnelles. Il en résulte une perte
progressive de certaines fonctions et de l’autonomie, ce qui a pour effet
qu’une grande partie de la prise en charge repose sur les épaules de
l’entourage proche (Castellani, Rolston & Smith, 2010; Egidi et al. 2005;
National Institute on Aging, in Naue & Kroll, 2008).
Selon les prévisions de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le
nombre de personnes de plus de 60 ans dans le monde passera, entre
2000 et 2050, de six cents millions à deux milliards, soit une
multiplication par trois (OMS, 2008) 2. C’est pourquoi de nombreuses
études prédisent une augmentation considérable du nombre de
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer (e.a. Alzheimer Disease
International, 2008; Ferri et al., 2005; Knapp et al., 2007; Mura,
Dartigues & Berr, 2010; Plassman et al., 2007; Van Audenhove et al.,
2009). Cette augmentation, combinée à la baisse de la fécondité de la
population, à la lourdeur des soins qui doivent être prodigués et à la
durée relativement longue de la maladie, risque d’exercer un impact
socio-économique important (Fox, Kohatsu, Max & Arnsberger, 2001;
Gaymu, Ekamper & Beets, 2007; Kang et al., 2007; Luengo-Fernandes,
Leal & Gray, 2010a; Mura, 2010; Raeymaekers & Rondia, 2009; Wimo,
Winblad & Jönsson, 2007; Zhu & Sano, 2006).
Outre la pression due à ces prévisions, c’est aussi la perception de ce
que représente cette pathologie pour l’individu et pour son entourage
qui est à l’origine de l’étude que nous avons réalisée. La maladie
1 Il serait donc plus exact de parler de ‘maladies de types Alzheimer’, ce qui comprend aussi
la maladie de Pick, la maladie de Lewy, la maladie de Huntington,…
2 On prévoit que le nombre de personnes dans le monde atteintes d’une maladie de type
Alzheimer passera de 25,5 millions en 2000 à 63 millions en 2030 et 114 millions en
2050, le gros de cette hausse se situant ici aussi dans les pays en développement (Wimo,
Winblad, Aguero-Terros & Von Strauss, 2003). Les prédictions d’Alzheimer Disease
International (2008) donnent des chiffres comparables: de trente millions de malades
recensés en 2008 à plus de cent millions en 2050. Aux États-Unis, on s’attend à ce que le
nombre de cas soit multiplié par quatre (Brookmeyer, Gray & Kawas 1998; Plassman et al.,
2007) alors qu’en Europe on devrait passer de 6 millions de cas en 2010 à 14,5 millions en
2050 (Mura, 2010).
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 9I. Introduction
d’Alzheimer est de celles que l’on redoute le plus, à côté du cancer, du sida et des affections cardiaques.
Dans l’esprit des gens, il s’agit d’une maladie agressive et impitoyable dont certains ont dit qu’elle était
‘un enterrement sans fin’, ‘une lente mort de l’esprit’ ou encore ‘une perte de soi’.3
Les médias renforcent encore cette perception extrêmement négative (Clarke, 2006; Kirkman, 2006).
Les études sur l’image de la maladie d’Alzheimer mettent en évidence trois aspects importants :
• Tout d’abord, les médias se focalisent nettement sur la phase terminale de la maladie, qui semble
ainsi devenir représentative de tout le processus dégénératif. On dirait que, dès le moment où un
diagnostic d’Alzheimer est posé, la personne en question devient automatiquement incapable de
prendre des décisions de manière autonome, perd sa personnalité et son identité et a
immédiatement besoin d’une prise en charge (Carbonnelle, Casini & Klein, 2009; Clarke, 2006;
Fontana & Smith,, 1989; INPES, 2008; Naue & Kroll, 2008).
• D’autre part, on donne rarement la parole à la personne malade elle-même: en règle générale, on
parle à sa place (Carbonnelle & Klein, 2009; Clarke, 2006; Kirkwood, 2006).
• Enfin, l’accent est fortement mis sur le poids que cette maladie exerce sur l’entourage immédiat et
qui crée donc une image négative (INPES, 2009; Pin le Corre, et al., 2009).
Cette image négative va de pair avec le tabou qui s’attache à la démence et à la stigmatisation de la
vieillesse (OMS, 2002). On peut raisonnablement penser que la maladie d’Alzheimer est envisagée avec
davantage de crainte en Occident, où la mort et la vieillesse font l’objet d’un important tabou et où on
ne s’occupe plus toujours de ses parents vieillissants, que dans d’autres cultures. Cette stigmatisation et
les tabous qui en résultent affectent également les proches de la personne malade (Werner 2010;
Werner & Heinik, 2008). Les uns et les autres perdent leur réseau social, courent un risque d’isolement
et de solitude (ou de ‘mort sociale’; Sweeting & Gilhooly, 1997), ont plus difficilement accès aux services
d’aide, souffrent d’une mauvaise image d’eux-mêmes et peuvent même être discriminés (Naue, 2008).
Qui plus est, le diagnostic de la maladie d’Alzheimer est aussi un tabou pour les médecins généralistes
(Werner, 2008). Ils se sentent désemparés parce qu’ils s’imaginent qu’ils ne peuvent plus rien proposer
à leur patient, ni une guérison, ni même un appui ou une perspective d’avenir 4.
Des études récentes démontrent que le thème de la maladie d’Alzheimer a été découvert ces dernières
années par les médias les plus divers (Ngatcha-Ribert, 2008; Segers, 2007), ce qui est déjà un
indicateur de l’impact social de la maladie (Adelman & Verbrugge, 2000). Mais bien qu’elle ait été tirée
de l’oubli, celle-ci continue à faire l’objet d’une image extrêmement négative et stigmatisante. Or, à
certains égards, cette image n’est pas conforme avec la réalité, comme lorsque l’on suggère que tout
malade Alzheimer est incapable de prendre lui-même des décisions. De plus, de nombreuses
conséquences, comme la stigmatisation, les tabous, l’isolement ou les frustrations dues au sentiment
d’incompréhension, ne sont pas des symptômes physiques de la maladie d’Alzheimer, mais bien de la
perception que la société en a. Il s’agit en partie d’une prophétie autoréalisatrice: l’ignorance et les
réactions négatives de la société ont pour effet d’insécuriser et d’angoisser les personnes malades, ce
3 Blay & Peluso, 2010; Corrigan et al., 2003; Downs, 2000; Fox, 1989; Girard & Ross, 2005; Goffman, 1963; Jolley, 2000; Katz, Joiner
& Kwon, 2002; Ross, 2005; Sayce, 1998; Vittoria, 1999; Werner, 2005; WHO, 2002; Wright, Gronfein & Owens, 2000.
4 Beard et al., 2009; Cantegreil-Kallen, Turbelin, Olaya, et al., 2005; Carbonelle, 2009; Clafferty, Brown & McCabe, 1998; Clarke,
2006; De Lepeleire, Buntinx & Aertgeerts, 2004; Keighlty, 2004; Kirkman, 2006; McColgan, Valentine & Downs, 2000; Ngatcha-
Ribert, 2004, 2008; Rice, Warner, Tye, et al. 1997; Segers, 2007; Vassilas & Donaldson, 1998; Vernooij-Dassen et al. 2005; OMS,
2002.
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 10I. Introduction
qui peut les amener à des réactions maladroites, qui ne font à leur tour que susciter encore plus
d’incompréhension à leur égard. Le fardeau de la maladie devient ainsi plus lourd à porter qu’il ne l’est
en réalité.
Le but de cette recherche est d’étudier comment cette image stigmatisante peut être nuancée, ce qui
peut être un premier pas pour améliorer la qualité de vie de ces personnes (Clare, 2010) et pour
dédramatiser l’image générale de la maladie d’Alzheimer (Clément & Rolland, 2008). Le raisonnement
est que, si on parle avec plus de respect des malades Alzheimer, ceux-ci pourraient davantage se
percevoir et être perçus par d’autres comme des personnes à part entière et réintégrer le champ social
(Girard & Ross, 2005; Raeymaekers & Rondia, 2009; Sabat, 1998). Certes, la recherche scientifique et
médicale reste cruciale pour permettre des avancées thérapeutiques. Mais la qualité de vie des malades
et de leurs proches s’en trouverait déjà améliorée si on parvenait à modifier l’image de la maladie et à
lutter contre la stigmatisation dont ils font l’objet.
Dans ce rapport, nous commencerons par répertorier, au moyen d’une analyse systématique et
inductive du framing, les différentes manières dont les médias définissent la maladie d’Alzheimer.
Nous nous intéresserons tout particulièrement aux possibilités offertes par des alternatives plus
positives. Il ne s’agit pas des expériences subjectives des malade eux-mêmes, de leurs proches (famille,
amis ou aidants professionnels) ou du monde médical, mais d’une analyse de la représentation de la
maladie d’Alzheimer telle qu’elle apparaît dans la culture populaire au sens large. Nous présupposons en
effet que l’image que beaucoup de gens se font de la maladie d’Alzheimer ne provient pas de leur
expérience personnelle de la maladie, mais d’une expérience indirecte, notamment en tant que
téléspectateurs, lecteurs de romans ou internautes. Après cette analyse, nous utiliserons une campagne
de sensibilisation fictive pour voir dans quelle mesure le grand public est ouvert à d’autres conceptions
de la maladie.
Le framing et la construction de la réalité sociale
Le framing est un concept qui est en plein développement, aussi bien dans les sciences de la
communication que dans d’autres disciplines. C’est dû en partie au fait qu’il s’agit d’un concept assez
vague et qui se prête à de multiples applications. Dès qu’il est question de savoir comment un sujet est
présenté, par exemple dans les médias, un lien est immédiatement fait avec le framing. Cela a pour
effet de vider ce concept d’une grande partie de son sens. C’est pourquoi nous lui donnerons une
signification bien précise dans ce rapport d’étude, où le framing ne se réduit pas à ‘la représentation de
la maladie d’Alzheimer’ : notre objectif est de nommer clairement des frames concrets.
Les frames sont des ‘principes organisateurs’ socialement partagés. Ils sont utilisés de manière symbolique
pour structurer la réalité sociale et lui donner un sens, ce qu’ils font parfois avec obstination et pendant
longtemps (Reese, 2001). Les frames offrent une perspective, un regard sur la réalité, mais aux dépens
d’autres angles possibles, qui disparaissent du champ de vision.
Ceux qui diffusent des messages, surtout des textes destinés à convaincre, peuvent délibérément
choisir un frame dont on suppose que le destinataire le captera et se l’appropriera pour regarder
désormais la réalité de cette manière. Comme les frames font partie de la culture, beaucoup d’entre eux
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 11I. Introduction
sont communs aussi bien à l’émetteur du message qu’au destinataire. C’est pourquoi le processus de
framing passe généralement inaperçu, même si l’impact de ces frames culturels et partagés n’en est
que plus grand puisqu’ils semblent trop familiers et évidents pour être remis en question. Toute analyse
des frames doit donc être effectuée de manière systématique, sinon le risque est grand de passer à
côté de certains d’entre eux. Autrement dit, l’objectif d’une telle analyse est de reconstruire tous les
frames qui sont utilisés dans un contexte culturel donné.
Contrairement à un grand nombre d’analyses du framing qui sont décrites dans la littérature spécialisée,
il est essentiel pour nous que les frames puissent être dissociés du thème auquel on peut les appliquer.
C’est ce qui explique pourquoi ils agissent de manière symbolique: un sujet puise sa signification dans le
fait qu’il est mis en relation avec un certain frame, sans que cette relation soit pour autant indissoluble.
Les frames fonctionnent comme des métaphores: deux éléments différents sont réunis pour donner
naissance à une nouvelle signification. Ainsi, le lobby qui s’oppose aux organismes génétiquement
modifiés est parvenu à associer ce thème à l’histoire de Frankenstein, ce qui permet d’insinuer que les
OGM sont l’œuvre de scientifiques irresponsables et d’ingénieurs atteints de la folie des grandeurs: en
modifiant le matériel génétique de plantes et d’animaux, ils se prennent pratiquement pour Dieu et
créent des monstres susceptibles de se retourner contre l’humanité. Mais il est aussi possible
d’envisager les OGM sous un autre angle, par exemple celui du mythe du progrès scientifique. La
multinationale Monsanto prétend entre autres que les OGM apportent une réponse durable au problème
de la faim dans le monde étant donné que les cultures génétiquement modifiées résistent mieux à la
sécheresse et aux parasites sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des pesticides (Van Gorp & Van der Goot,
2009). La foi dans une science capable de réaliser des miracles présente donc la modification génétique
comme une nouvelle étape vers un monde meilleur. Ces exemples démontrent que chaque sujet ou
chaque question peuvent être envisagés selon différents frames et que chacun d’entre eux peut être
utilisé pour donner une signification aux sujets les plus divers.
La question de savoir si le framing est un processus conscient reste ouverte à la discussion: dans quelle
mesure le producteur d’un texte choisit-il délibérément un frame qui sert ses propres intérêts? Sous cet
angle, le framing semble avoir un côté manipulateur que l’on cherche toujours à éviter. Cependant, les
recherches donnent à penser que le framing n’est qu’un processus partiellement conscient de la part du
producteur d’un message. C’est dû au fait que les frames font intimement partie de la culture: chacun a
pu se familiariser avec eux durant son éducation, depuis les premières histoires que l’on raconte avant
d’aller dormir. Il est donc possible que les communicateurs qui véhiculent l’image dominante de la
maladie d’Alzheimer ne soient pas pleinement conscients de l’effet à long terme qu’ils produisent en
recourant chaque fois aux mêmes images mentales. En recensant et en rendant visibles ces frames si
courants, on peut sans doute les aider à évaluer, voire à modifier, leur stratégie de communication. Le
framing implique en effet l’existence de frames alternatifs et d’autres angles de vue qui peuvent donner
lieu à une perspective surprenante sur une donnée identique.
Objet et questions de la recherche
L’objectif final de cette recherche est de nuancer l’image dominante de la maladie d’Alzheimer auprès de
la population afin que le diagnostic soit moins lourdement ressenti et qu’il soit possible de briser les
tabous et les stigmatisations qui en résultent dans la société. Pour y parvenir, nous voulons pénétrer à
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 12I. Introduction
l’intérieur de ces images dominantes et proposer des alternatives, ce qui suppose que nous soyons
d’abord capables de comprendre les unes et les autres. C’est pourquoi la première question de la
recherche est la suivante:
Quels sont les frames dominants qui sont utilisés dans la représentation de la maladie d’Alzheimer et
quels sont les frames alternatifs (ou ‘counterframes’) qui peuvent être mis en regard?
La réponse à cette question doit nous amener à sélectionner un ou plusieurs frames alternatifs qui
pourront ensuite être utilisés pour faire contrepoids à l’image dominante. Bien qu’il soit difficile de
modifier une perception, et d’autant plus qu’il s’agit d’un long processus qui implique que les
counterframes deviennent également dominants, nous aimerions tout de même que ce processus ait
quelques chances de succès. Ceci suppose entre autres que les messages inspirés par le counterframe
soient crédibles, qu’ils interpellent le public et que celui-ci les interprète correctement. La deuxième
question de la recherche peut dès lors être formulée de la manière suivante:
Un message relatif à la maladie d’Alzheimer inspiré d’un frame alternatif apparaît-il comme crédible,
compréhensible et accrocheur aux yeux du public?
Pour répondre à la première question, nous avons analysé le contenu de toutes sortes de messages
délivrés par les médias en recourant à une analyse de framing inductive. En ce qui concerne la question
relative à la perception du public, nous avons réalisé une expérience en faisant évaluer une campagne-
test par un échantillon représentatif de la population belge. Ces deux aspects sont traités séparément
dans les deux parties qui suivent.
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 132. À la recherche
des frames et des
counterframes
Méthode
Matériel d’analyse
Pour mener cette recherche, nous avons rassemblé un matériel
d’analyse aussi diversifié que possible sur le sujet de la maladie
d’Alzheimer et des maladies apparentées. Concrètement, cela va de
romans (photos) à des articles dans des quotidiens et des magazines en
passant par des brochures, des films, des documentaires, des
reportages télévisés, des extraits vidéo en ligne et des sites internet
(voir l’annexe 1 pour une sélection du matériel d’analyse). Le principal
critère de sélection a été que la source soit aisément accessible pour le
grand public en Belgique (par exemple en vente dans les librairies
classiques ou diffusion à la télévision), sans pour autant qu’il s’agisse
forcément d’une production locale: le matériel comprenait donc aussi un
grand nombre de livres, de contenus en ligne et de films étrangers
(traduits).
Nous avons moins cherché la représentativité du matériel que sa
diversité. En effet, l’objectif étant de faire apparaître tout l’éventail des
frames et counterframes, nous avons délibérément recherché des
alternatives plutôt que d’analyser la énième source qui utilisait l’un des
frames dominants. À la suite de cela, nous avons opéré une sélection
systématique d’articles consacrés à la maladie d’Alzheimer parus ces
trois dernières années dans la presse belge (2008-2010).
Procédures d’analyse
Plusieurs phases d’analyse ont été menées en parallèle. Tout d’abord,
nous avons régulièrement recherché de nouvelles sources afin d’affiner
les frames que nous avions trouvés et, surtout, de trouver des
counterframes capables de ‘contredire’ les frames dominants. Cela a été
le cas entre autres pour les ouvrages Een vreemde kostganger in mijn
hoofd: Mijn leven met Alzheimer de E. van Rossum (2009) et The myth
of Alzheimer’s de P. J. Whitehouse et D. George (2008).
La deuxième phase a consisté en une codification ouverte, ce qui veut
dire que nous avons passé en revue le matériel avec un ‘regard ouvert’
et que nous avons mis dans une banque de données toutes les citations
et les illustrations possibles. Chacune d’entre elles s’est vu attribuer un
code. Dans un premier temps, il s’agissait de ‘codes in vivo’: des termes
clés qui provenaient du matériel lui-même, notamment les métaphores
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 152. À la recherche des frames et des counterframes
utilisées, les images, les arguments récurrents et les paires antinomiques. Chacun de ces éléments est
un framing device potentiel: un élément textuel ou visuel concret capable de susciter auprès du
récepteur, au niveau cognitif, un cadre de pensée qui correspond au frame tel qu’il apparaît dans le
texte. Tous les éléments qui s’intègrent dans un certain raisonnement, surtout par rapport aux causes,
aux conséquences et aux responsabilités, sont appelés des reasoning devices. Cette deuxième phase
s’est prolongée jusqu’à ce que certains modèles commencent à se dessiner.
Durant la troisième phase, appelée ‘codification axiale’, les codes sont listés et ramenés à un petit
nombre de codes significatifs. Cette liste restreinte est utilisée pour passer une nouvelle fois en revue le
matériel d’analyse et ordonner ces codes. Autrement dit, nous nous sommes efforcés de faire rentrer
les ‘framing devices’ et les ‘reasoning devices’ dans un seul et même frame. L’inventaire contenait par
exemple les énoncés suivants: ‘En fait, ce sont de pauvres malheureux qui n’arrivent pas à mourir’;
‘Quand la maladie se déclenche, on est fichu’; ‘Quand quelqu’un a Alzheimer, on est déjà en deuil alors
qu’il est toujours là’ et ‘Mon mari vit encore, mais je suis déjà veuve’. Il ressort de ces extraits que la
maladie d’Alzheimer est pratiquement perçue comme un arrêt de mort. Dans une autre source, on
disait: ‘Le verdict est: Alzheimer’. Nous avons conclu, à partir de toutes ces citations, que la peur de la
mort jouait un rôle dans la perception de la maladie.
Enfin, des frame packages ont été constitués dans la quatrième et dernière phase, avec chaque fois une
chaîne logique de ‘reasoning devices’ et de ‘framing devices’ concrets. L’idée globale, qui créé un
ensemble logique et cohérent à partir de tous les ‘devices’, est le frame proprement dit. Il est issu
d’éléments culturels comme des valeurs, des normes et des archétypes. Les ‘frame packages’ ont été
regroupés dans une frame matrix, qui est le produit fini de l’analyse de framing (voir annexe 2). À l’issue
du processus, le fichier comportait plus de 3000 citations qui se rattachaient toutes à un ou plusieurs
des ‘frame packages’ de la frame matrix.
Il n’est pas possible, en se basant sur ces données, de déterminer la fréquence d’utilisation d’un frame
ou de faire d’autres calculs de ce genre. En effet, le niveau d’analyse a évolué au cours de la recherche.
Au début, les textes ont été encodés au niveau des mots et des parties de phrase ont été isolées. Dès
que les frames ont commencé à se dessiner plus clairement, on a progressivement pu passer au niveau
du paragraphe. En fin de compte, c’est au niveau du texte que nous avons attribué des codes qui se
rapportent aux douze frames (voir matrice en annexe).
Résultats
Six frames et six counterframes
L’analyse a mis en lumière six frames dominants. Par ailleurs, nous avons recherché de manière très
ciblée six counterframes. Il y a deux possibilités: soit il s’agit de frames alternatifs qui utilisent les
mêmes formulations (ou ‘framing devices’), mais qui se servent de ce jargon pour infirmer l’idée
dominante, pour inverser le raisonnement et pour remettre en cause sa pertinence (ils sont indiqués
dans le tableau 1 par les lettres A et B); soit il s’agit de frames tout à fait nouveaux et autonomes qui
sont utilisés en tant que tels, sans reprendre les formulations et les raisonnements du frame dominant.
La grande différence entre ces deux types de counterframes est que, dans le premier cas, le frame
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 162. À la recherche des frames et des counterframes
dominant est activé au niveau cognitif du récepteur et que c’est donc la force de conviction du contre-
argument qui est importante, alors que dans l’autre cas le frame dominant est stratégiquement
maintenu en dehors du champ de vision du récepteur. Le tableau 1 présente les douze frames que nous
avons reconstitués et que nous allons développer dans la suite du texte. Huit d’entre eux sont
exclusivement centrés sur la personne malade elle-même (de 1A à 6). Dans les quatre autres cas (de 7A
à 8B), l’entourage fait lui aussi explicitement partie du raisonnement.
Nous reproduirons un grand nombre de citations et de paraphrases afin d’illustrer les expressions
concrètes prises par les frames dans le matériel d’analyse utilisé. Pour ne pas alourdir inutilement la
présentation, nous avons choisi de ne pas indiquer chaque fois la source de ces citations. La liste des
sources les plus souvent citées figure à l’annexe 1.
Tableau 1: Liste des frames et des counterframes relatifs à la maladie d’Alzheimer
Frames Counterframes
1A Dualisme corps-esprit 1B Unité corps-esprit
2 L’envahisseur 3 L’étrange compagnon de voyage
4A La foi dans la science 4B Le vieillissement naturel
5 La peur de la mort 6 Carpe diem
7A Rôles inversés 7B Chacun son tour
8A Sans contrepartie 8B La Bonne Mère
Frames axés sur la personne malade
1.A. Dualisme corps-esprit
Le premier frame, et de loin le plus dominant, repose sur une image fondamentale de l’homme dans la
culture occidentale, à savoir le dualisme. Cette vision postule qu’un être humain se compose de deux
parties distinctes, un corps matériel et un esprit immatériel. Ce dernier est le principe actif, contrôlant
et rationnel alors que le corps n’est qu’une enveloppe passive ou un simple instrument de la raison.
Cette distinction peut également être conçue de manière normative étant donné qu’un corps sans esprit
n’est plus considéré comme un être humain. La conception dualiste de l’homme remonte au platonisme
grec et a culminé au dix-septième siècle avec le cartésianisme. Elle est aussi ancrée dans le
christianisme, qui s’enracine en partie dans le platonisme: l’âme (qui a pris la place de l’esprit) est
l’élément divin et immortel qui doit contrôler le corps et qui, après la mort de celui-ci, connaît la vie
éternelle dans l’au-delà.
Si cette image dualiste de l’homme est utilisée comme frame pour définir la maladie d’Alzheimer, celle-ci
est assimilée à une pathologie qui prive peu à peu un être humain de son esprit (cf. étymologie:
‘dé-mence’ signifie ‘privé d’esprit’). Beard et al. (2009) parle à cet égard d’un ‘discours de la perte’.
L’élément majeur dans ce frame est la perte de capacités mentales, comme la mémoire, les facultés
linguistiques ou l’intelligence. Dès lors, la personne malade est capable de faire de moins en moins de
choses et finit par perdre tout contrôle sur elle-même et sur sa vie. Comme, dans cette conception,
c’est l’esprit qui définit la personnalité et l’identité humaine, le malade en arrive à ne plus savoir qui il
est. Tout ce qui lui était familier devient étranger et il souffre d’une désorientation spatiale et temporelle
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 172. À la recherche des frames et des counterframes
de plus en plus grave, ce qui se traduit entre autres par une perte de contrôle, des frustrations et des
angoisses.
Les récits ou les citations les plus caractéristiques de ce frame sont ceux qui soulignent la différence
entre la personne malade hier et aujourd’hui, depuis ‘elle n’était pas comme ça avant’ jusqu’à ‘ce n’est
plus ma mère’. Au niveau du langage figuré, les images qui expriment la perte de l’esprit comprennent
des variantes sur le thème de l’obscurité – opposée à la lumière de la raison – ou toutes les formes
possibles de confusion, de désintégration ou de vide, accompagnées ou non d’une allusion à la tête ou
au cerveau. Par exemple: ‘tomber dans un trou noir’, ‘Alzheimer éteint la lumière’, ‘aller dans le noir’, ‘se
liquéfier’, ‘le crâne qui se vide de sa substance’, ‘calme plat’, avoir de la ‘neige’ ou du ‘brouillard’ dans la
tête, ‘une mémoire comme une passoire’, la ‘vacuité de l’esprit’, ‘les sables mouvantes et arides du
désert d’Alzheimer’, ‘un court-circuit dans la tête’, ‘une cervelle transformée en meule de gruyère’.
Parmi les objets servant de métaphores, citons entre autres une passoire ou un tamis (Figure 1), des
feuilles vierges ou encore des pièces de puzzle.
Figure 1: La passoire est l’une des images utilisées dans le contexte de la maladie d’Alzheimer, comme dans
cette campagne de recrutement pour la K.U.Leuven © K.U.Leuven
Dans les médias visuels, comme Iris, Away from her et Pandora’s Box, cette confusion croissante est
souvent illustrée par le thème de l’errance. Ce n’est sans doute pas un hasard si les recherches
montrent que c’est l’un des symptômes les plus reconnaissables de la maladie d’Alzheimer auprès du
grand public (Segers, 2007; Werner, 2003). D’autres événements symboliques illustrent également ce
frame: par exemple quand on voit la personne malade contrainte de remettre son permis de conduire,
avec la perte d’autonomie qui en découle, écrire d’innombrables post-its pour ne rien oublier ou encore
ouvrir un album photo qui retrace son parcours de vie. Cela inspire souvent les artistes, comme le
montre la figure 2
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 182. À la recherche des frames et des counterframes Figure 2: Dessin de Sarah Yu Zeebroek © www.sarayuzeebroek.web-log.nl Qualifier la maladie d’Alzheimer de maladie mentale est une variante du thème de la perte des capacités intellectuelles. On parle alors de ‘folie’, ‘être un peu gaga’, ‘être malade dans sa tête’, ‘être folle’, ‘perdre la boule’, ‘de vieux fous’ ou ‘être dans la lune’. L’utilisation du terme de ‘démence’ – quoique médicalement correct, comme nous l’avons dit – peut également s’inscrire dans ce frame car il est pour beaucoup synonyme de folie. À lui seul, le choix d’un terme peut donc suffire pour évoquer certaines connotations négatives. C’est aussi le cas dans le monde arabe, où le mot kharaf, qui sert à désigner la maladie d’Alzheimer, signifie également ‘obsession’ (Alzheimer’s Australia Vic, 2008). Une alternative moins fréquente consiste à décrire un retour à des formes de vie primitives: ‘animal’, ‘trop d’animalité’, ‘hagard’, ‘se comporter comme un animal pris au piège’. On en trouve un écho dans cette description faite par Ngatcha-Ribert (2004), pour qui la maladie d’Alzheimer met à nu la vérité élémentaire de l’être humain et le ramène ‘à ses désirs primitifs, à ses mécanismes simples, aux déterminations les plus pressantes de son corps. Elle fait surgir un monde intérieur de mauvais instincts, de perversité, de souffrances et de violence, qui était resté jusqu’alors en sommeil’ (cité dans Carbonnelle, Casini & Klein, 2009, p. 21). Lorsque toutes les capacités mentales ont finalement disparu, il ne reste, dans cette conception dualiste, que l’enveloppe matérielle du corps. On qualifie dès lors les personnes malades ‘d’objets’ ou de ‘plantes’, qui ne sont plus que ‘l’ombre d’elle-même’. Plus aucun contact n’est possible avec elles. L’un des romans que nous avons étudiés (Piel, 2009) résume cela en quelques mots: ‘Alzheimer est une maladie de la communication’. Le malade a ‘perdu ‘le code pour communiquer’, ‘est passé dans un monde parallèle’, ‘n’est plus un occupant du monde’, ‘végète dans un monde parallèle’, ‘se retrouve dans une impasse’ devient ‘impénétrable’ ou ‘mentalement inaccessible’. Une variante extrême mais fréquente tient ces corps sans esprit pour morts, bien qu’ils soient encore en vie. Cela se reflète dans l’usage de l’imparfait à propos d’une personne qui est pourtant encore vivante. On appelle cela ‘une mort progressive de l’esprit dans un corps qui reste intact’, ‘un mort sans cadavre’, ‘un mort vivant’, ‘un esprit qui ne vit plus’, ‘une existence réduite à sa plus simple expression’, ‘la mort qui laisse le corps Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 19
2. À la recherche des frames et des counterframes
derrière elle’, ‘une ombre sans paroles’, ‘un temps complètement oublié’ ou ‘retomber dans le néant’.
Si on considère que c’est l’esprit qui fait notre humanité, sa perte ne peut être ressentie que très
négativement. Les personnes malades n’ont plus leur place dans une société qui célèbre les valeurs de
l’esprit (Downs, 2000). Elles n’ont plus de mémoire, de raison ou d’intelligence, ce ne sont plus des
consommateurs autonomes, mobiles et efficaces. Elles ne sont donc plus rentables dans une société qui
porte haut des valeurs telles que le développement et l’épanouissement personnel. Aux yeux des
malades eux-mêmes, leur situation est un échec puisqu’ils échouent chaque fois à répondre aux
attentes de la société. C’est pourquoi la maladie d’Alzheimer est perçue comme la pire et la plus
effroyable des choses qui puissent arriver à quelqu’un. C’est une perte de soi, une maladie qui touche
au cœur de l’existence même. Les personnes qui en souffrent se sentent atteintes dans leur dignité, se
sentent frustrées et ont souvent du mal à admettre qu’elles ne sont plus capables de faire certains
gestes banals. La maladie d’Alzheimer devient ainsi un tabou, aussi bien pour le malade lui-même, qui
voudrait se cacher de tous, que pour son entourage, qui souhaiterait le placer quelque part (cf. Naue &
Kroll, 2008). On se sent humilié et frappé de ‘déshonneur’ à devoir ‘porter le fardeau du label Alzheimer’.
Dans la logique de ce frame, la seule issue qui reste pour un malade Alzheimer est d’opter pour
l’euthanasie, qui est en quelque sorte l’ultime triomphe de l’esprit. L’euthanasie est présentée comme
‘mon acte ultime d’être humain’ parce que vivre avec Alzheimer est ‘absurde’ et ‘indigne d’une existence
humaine’. C’est pourquoi il est ‘temps de partir’ et de ‘prendre son sort en main’.
1.B. Unité corps-esprit
Le frame qui s’oppose à cette conception dominante d’une séparation entre le corps et l’esprit a pour
caractéristique essentielle de renoncer à l’aspect normatif du dualisme et de mettre le corps et l’esprit
sur le même pied. Un malade Alzheimer peut dès lors perdre progressivement ses fonctions
rationnelles, il lui reste toute la dimension physique et notamment la vie émotionnelle qui s’y rattache.
Autrement dit, l’accent n’est pas mis sur ce qui est perdu, mais sur ce qui reste : une riche vie
émotionnelle grâce à laquelle ‘la maladie ne devient jamais plus grande que l’homme’ (cf. Fazio, 2009;
Vittoria, 1999). Ce qui revient à dire que les malades ne deviennent jamais des objets : ils restent en
permanence des êtres humains, avec leur identité, leur personnalité et leur passé.
À ce frame correspond également le choix de certains termes qui mettent fortement l’accent sur les
émotions, le contact physique (‘câlins’, ‘chaleur’, ‘tendresse’) ou les messages non verbaux capables de
briser les barrières de la maladie. Dans cette perspective, le malade Alzheimer répond avec des ‘yeux
brillants et reconnaissants’ ou un ‘sourire’ (voir par exemple figure 3).
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 202. À la recherche des frames et des counterframes
Figure 3: Le sourire que l’on parvient à déclencher chez un malade Alzheimer est la preuve qu’il vaut la peine
de communiquer avec eux © www.susansermoneta.com, New York
Pour peu que l’on accepte d’entrer dans son vécu et d’apprendre ‘sa langue’, le contact redevient
possible, ce qui n’était pas le cas dans la conception d’une séparation entre le corps et l’esprit (Figure 4).
On peut citer comme exemple le livre Learning to speak Alzheimer’s 5 de J. Koenig Costes (2003) ou
encore le ‘dictionnaire de traduction Alzheimer’ de S. Braams dans Het verhaal van mijn vader (2008).
Sur le plan scientifique aussi, des études démontrent que les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer conservent leur conscience sensorielle et perceptive même à des stades avancés de la
maladie (Clare, 2010). Elles continuent à ressentir positivement la musique (Simmons-Stern, Budson &
Ally, 2010) et les stimulations sensorielles dites ‘snoezelen’ (Van Weert et al, 2005), par exemple.
5 Koenig Coste, J. (2003). Learning to speak Alzheimer’s: A groundbreaking approach for everyone dealing with the disease. New
York: Houghton Miflin Harcourt
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 212. À la recherche des frames et des counterframes
Figure 4: Communiquer avec des malades Alzheimer demande une attention particulière © Editions Saint-
Augustin, Suisse www.staugustin.ch
2. L’envahisseur
Le deuxième frame dominant exploite l’idée que la maladie est un personnage extérieur auquel on se
trouve tout à coup confronté. Cet intrus prend alors par exemple la forme d’un démon ou d’un diable qui
prend possession de quelqu’un. Parmi les variantes de cette personnification, il y a entre autres l’image
du meurtrier, du voleur ou du monstre toujours aux aguets et dont n’importe qui peut être victime, quel
que soit son âge ou son statut. Ce frame reflète davantage le processus dégénératif que son
aboutissement (cf. ci-dessous frame 5), même s’il est clair que la maladie finira par avoir le dernier mot.
L’accent est souvent mis sur la vie heureuse et harmonieuse que quelqu’un menait et qui a été tout à
coup bouleversée par un envahisseur extérieur. Les exemples sont légion: la maladie d’Alzheimer est
présentée comme ‘une énorme force qui dirige désormais tout à l’intérieur’, ‘quelque chose qui pense en
moi et qui s’arrête à mi-chemin’, un ‘monstre qui dévore le cerveau’, ‘le tueur de cerveau’, ‘une
grignoteuse de souvenirs’, ‘une visiteuse chargée de moins en moins de bagages’, un ‘démon’, ‘être
poussé par le démon’ ou ‘un petit rat agile’. Étant donné que la maladie empire graduellement, on parle
aussi d’une maladie ‘insidieuse et perfide’, ‘qui se diffuse subrepticement’, ‘qui vous trompe’, ‘[qui entre]
sans frapper dans nos souvenirs et les grignote, en silence’.
Des recherches précédentes ont déjà démontré que les métaphores militaires sont souvent utilisées
dans le contexte de la maladie (Annas, 1995; cf. sida et cancer, voir Sontag, 1978, 1989; ‘hospital
Fondation Roi Baudouin F ra m i n g e t r e fra m i n g : c o m m u n iq u e r au t r e m e n t s u r l a m a l a di e d ’a l z h e i m e r 22Vous pouvez aussi lire