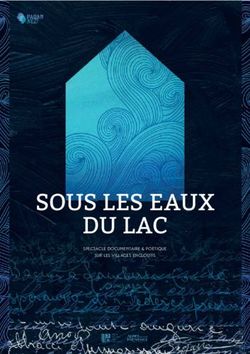LA GESTION DE L'EAU À L'ÉCHELLE DE LA PARCELLE
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
LA GESTION DE L’EAU
À L’ÉCHELLE DE LA PARCELLE
Cet article retrace en quelques lignes les enjeux de la gestion
de l’eau en Région de Bruxelles-Capitale (RBC). Il s’intéresse en-
suite aux solutions mises en œuvre en la matière dans certains
Batex – les « bâtiments exemplaires » labellisés par Bruxelles
Environnement – et se pose la question suivante : ces diffé-
rentes solutions répondent-elles aux objectifs actuels de la Ré-
gion en matière de gestion des eaux à l’échelle de la parcelle ?
Sont proposés, en complément, un arbre de décision destiné
aux concepteurs et maîtres d’ouvrage désireux de s’inscrire
dans une gestion durable de l’eau ainsi qu’un répertoire d’outils
utiles sur la question 1→ 7 et des exemples de dis-
positifs rencontrés en RBC → .
Mandaté par Bruxelles Environnement (BE), l’Observatoire des Pratiques Innovantes (OPI) est un groupe de
recherche qui effectue un travail de veille et de remontée d’information sur les innovations en matière de dé-
veloppement durable dans le secteur de la construction. Son objectif est de repérer des techniques ou procé-
dés mis en œuvre et facilement reproductibles dont BE peut ensuite faire la promotion. Ce document, réalisé
en février 2017, constitue une synthèse du « Rapport 6 : gestion de l’eau » rédigé par l’OPI en novembre 2016.
Avec le soutien de
Bruxelles Environnement
1Contexte : l’eau en Région de Bruxelles-Capitale
Statistiquement, tous les ans, 780 litres d’eau de de moins en moins de l’impact positif de l’évapo-
pluie arrosent chaque mètre carré de la RBC. Les pré- transpiration sur le micro-climat urbain. Enfin, le taux
cipitations annuelles de la Région représentent donc de ruissellement des eaux de pluie, quant à lui, aug-
131 000 000 m³. L’imperméabilisation croissante du mente fortement, au point de saturer – et de plus en
sol régional et son égout unitaire (eau usées et eaux plus souvent faire déborder – les égouts. Cette situa-
de pluie rejetées dans la même canalisation) ont pour tion engendre quatre conséquences problématiques.
conséquence que plus de 40 % de cette eau de pluie
s’écoule directement dans les égoutsI. En amont :
Conçus et réalisés à la fin du 19ème siècle, ceux-ci sont −− le risque d’inondations augmente considérable-
aujourd’hui arrivés à saturation et ne parviennent mentIV.
plus à absorber les fortes pluies et orages dont, par
ailleurs, la fréquence augmente en raison du réchauf- En aval :
fement climatique. −− les stations d’épuration fonctionnent moins bien
puisque près de la moitié des eaux à traiter est
Ainsi, l’importante imperméabilisation de la ville (en- claire, ce qui dilue les matières organiques et
viron 46 % en 2006)II a de multiples impacts sur les diminue d’autant les taux de rendement des sta-
masses d’eauIII. Tout d’abord, les nappes phréatiques tionsV ;
sont de moins en moins alimentées puisque l’infiltra- −− du fait d’apports d’eau massifs (en cas d’orages
tion des eaux pluviales directement dans le sol dimi- successifs par exemple), les déversoirs de la sta-
nue. En deuxième lieu, une plus grande imperméabili- tion sont de plus en plus souvent activés ;
sation entraîne une présence moindre de végétaux en −− ce déversement sans épuration dans les eaux de
ville. Or, ceux-ci sont nécessaires à l’évapotranspira- surface menace de destruction toute forme de
tion des eaux de pluie qui, en conséquence, diminue. vie dans les rivières et cours d’eau.
En troisième lieu, les habitants de la ville bénéficient
Les objectifs de la RBC en matière de gestion de l’eau
Il est donc absolument prioritaire aujourd’hui d’éviter de 3. Récupérer l’eau de pluie et l’utiliser avant de la
rejeter au « tout à l’égout » des eaux claires, ceci pour rejeter à l’égout.
ne pas aggraver la situation tant en amont qu’en avalVI. 4. Épurer les eaux usées.
À propos de l’épuration individuelle des eaux
La RBC a ainsi défini la priorisation des actions à usées , précisons que la Région bruxelloise a
prendre en matière de gestion de l’eau au niveau de choisi d’investir dans une infrastructure collec-
la parcelle et du bâtiment de la manière suivante : tive de grande échelle : la station d’épuration. Le
1. Gérer les eaux pluviales sur la parcelle. bon fonctionnement de cette installation dépend
a. Favoriser l’infiltration directe et l’évapo- d’un apport régulier et le plus dense possible en
transpiration ; matières chargées (eaux grises et noires). En ce
b. assurer la rétention suivie soit d’une infiltra- sens, lorsqu’il y a un égout à disposition, les bâti-
tion forcée soit d’une récupération ; ments sont obligés de s’y raccorder.
c. assurer la rétention suivie d’un écoulement à
l’égout à débit régulé. Ainsi, tenant compte des différents éléments pré-
2. Réduire la consommation d’eau de distribution sentés dans cette section, les dispositifs de gestion
(pour diminuer la quantité d’eaux usées rejetées de l’eau analysés doivent être évalués en regard des
à l’égout). objectifs suivants :
2−− diminuer / compenser les surfaces
I. BATir, EcoRes, ICEDD, Métabolisme de la Région de
imperméabilisées ; Bruxelles-Capitale : identification des flux, acteurs
−− réduire (idéalement supprimer) les eaux claires et activités économiques sur le territoire et pistes de
rejetées aux égouts ; réflexion pour l’optimisation des ressources, rapport
final, juillet 2015, p. 134
−− lors des orages et fortes pluies, écrêter les
II. Idem, p. 135
apports d’eau de pluie aux égouts ;
III. Bruxelles Environnement, Projet de plan de gestion
−− augmenter l’infiltration de l’eau de pluie dans de l’eau de la Région de Bruxelles-Capitale – 2016-
le sol vers la nappe (en s’assurant que celle-ci 2021, octobre 2015, pp. 61-62
soit propre) ; IV. BATir, EcoRes, ICEDD, op. cit., p. 143
−− charger les eaux renvoyées à la station V. Idem, p. 135
d’épuration. VI. Bruxelles Environnement, op. cit., p. 444
Gérer les eaux pluviales sur la parcelle : deux stratégies envisageables
PROJET
On distingue deux familles de straté- Nos PILIFS
gies envisageables : d’une part, favori-
ser l’infiltration et, d’autre part, stoc- 780 litres/m².an
ker l’eau en vue soit de temporiser le
rejet à l’égout, soit d’utiliser cette eau
avant de la rejeter chargée à l’égout. P
Ces stratégies ne peuvent être appli- Tuiles / Ardoises (0,75 à 0,95)
Tuiles vernissées (0,90 à 0,95)
Graviers (0,6)
EPDM / synthétique (0,7 à 0,8)
Verte extensive (0,5 à 0,7)
Verte intensive (0,1 à 0,4)
Perméable
Semi-perméable
quées dans toutes les situations et Bitume / synthétique (0,8 à 0,95) Stockante Imperméable
leurs coûts d’installation et de main- Eaux claires Eaux colorées
tenance varient fortement. Le choix
de l’application de l’une ou l’autre débourbeur
Filtre à
coalescence
technique dépendra donc de variables
technico-économiques à analyser au
cas par cas.
Un préalable :
Filtre Mécanique
25 Microns
Potagers
la surface de récolte Pilif River
Bassins -
(toiture et abords) drainants
Puits d’
infiltration
Marre
Les abords
On veillera à imperméabiliser le moins Lagunage Type INFILTRATION
MHEA
possible les abords en faisant appel aux
techniques perméables ou semi-per- STATION D’ÉPURATION
méables pour les aménagements exté-
rieurs : dalles alvéolaires, pavés non
jointifs, revêtements drainants 1.
Pour les surfaces imperméables, il est
conseillé de rassembler les eaux de Figure 1 : Synthèse des dispositifs de gestion de
ruissellement, au besoin de les filtrer, l’eau mis en place à la Ferme Nos Pilifs. Les eaux
récoltées sur le parking sont filtrées (filtre à coales-
avant de les infiltrer dans le sol . cence) avant d’être infiltrées – Source : OPI.
3S’il est impossible d’infiltrer l’eau (zone non propice retrouver avec une quantité d’eau (colorée) tel-
à l’infiltration), il est conseillé de la stocker dans une lement faible par rapport aux consommations
citerne ou un bassin d’orage et de temporiser son que les investissements en citernes, pompes et
renvoi à l’égout par un débit régulé. autres dédoublements de canalisations s’avèrent
ruineux ou, à tout le moins, hors d’échelle par
La toiture rapport aux usages attendus.
La superficie et le type de toiture (plate, à versants, vé- −− Par contre, ni la coloration, ni la faible quantité
gétalisée) ainsi que son orientation ont une incidence d’eau ne sont contre-indiqués pour l’infiltration.
non négligeable tant sur la quantité d’eau récoltée
que sur sa qualité. Le toit fait donc partie intégrante
de la gestion de l’eau, sans pour autant s’inscrire ni
dans la stratégie d’infiltration, ni dans celle du stoc-
L’infiltration :
kage à proprement parler. Bruxelles Environnement directe ou indirecte ?
met à disposition un tableau permettant d’estimer les
quantités d’eau récoltées annuellement en fonction L’infiltration directe consiste à récolter les eaux sur la
de la superficie et du type de toiture choisis 2. toiture et les ramener vers des zones du terrain où
elles pourront s’infiltrer progressivement dans le sol.
Les compatibilités L’infiltration indirecte consiste à récolter les eaux de
L’installation d’une toiture verte, en particulier inten- pluie sur la toiture pour les amener dans une citerne
sive, réduit fortement la quantité d’eau récoltée et ou les stocker directement en toiture d’où elles seront
altère significativement sa qualité . En effet : conduites vers une zone d’infiltration du terrain.
−− L’eau récoltée à travers une toiture verte est Condition première
colorée. Chargée en tanins, elle est impropre à Les deux techniques supposent une infiltrabilité du
l’usage dans un lave-linge. Par ailleurs, utilisée sol, condition première de ce dispositif.
dans les chasses d’eau des toilettes, elle pro- Avant toute chose, l’on s’enquerra donc de la capa-
voque souvent un « effet rebond » qui consiste, cité du sol à absorber l’eau. Pour ce faire, la RBC a
pour les non-connaisseurs, à tirer la chasse à mis à disposition une carte d’infiltrabilité indica-
deux reprises (parce que l’eau de la cuvette tive 3 – malheureusement peu exploitable à
n’est pas claire). En conséquence, plus d’eau est l’échelle de la parcelle. Par ailleurs, il est également
consommée et les matières organiques sont di- possible d’évaluer soi-même cette capacité d’infiltra-
luées, ce qui est néfaste au bon fonctionnement tion : la commune de Forest a mis un descriptif de la
de la station d’épuration. procédure à suivre à disposition dans son Règlement
−− La toiture verte, par évapotranspiration, dimi- Communal d’Urbanisme 4.
nue la quantité d’eau récoltée. On peut donc se
Figure 2 : Coupe d’un bassin d’infiltration du projet
Craetveld. Le fond est en argile et donc imperméable tandis
que les parois sont infiltrables – Source : AAC Architecture.
4Les différents dispositifs PROJET
CRAETVEL
Pour choisir un dispositif, on commencera
par estimer les quantités d’eau de pluie à
gérer 2, on les placera ensuite en 780 litres/m².an
regard de la surface d’infiltration dispo-
nible et des pentes naturelles pour choi-
sir judicieusement les points de récolte et
d’alimentation du système, puis le parcours Tuiles / Ardoises (0,75 à 0,95)
Tuiles vernissées (0,90 à 0,95)
Graviers (0,6)
EPDM / synthétique (0,7 à 0,8)
Verte extensive (0,5 à 0,7)
Verte intensive (0,1 à 0,4)
Perméable
Semi-perméable
Bitume / synthétique (0,8 à 0,95) Stockante Imperméable
de l’eau jusqu’au point d’infiltration ultime
. En effet, un système gravitaire simple, Eaux claires Eaux colorées
sans pompes de relevage, sera le plus éco- Filtre
nomique et facile d’entretien tant à l’instal-
lation qu’à l’usage.
3 Bassins
drainants
successifs
Au besoin (si les pentes et/ou surfaces ne 70,5
permettent pas le système gravitaire), on Berges
permébles
accumulera l’eau de pluie dans une citerne
Puits d’
ou éventuellement en toiture avant de la infiltration
Potagers
renvoyer vers les zones d’infiltration pro- Noues
Wadis
Trop-plein
prement dites. à débit
régulé
INFILTRATION
Toutes eaux
STATION D’ÉPURATION
PROJET
CAMELEON Figure 3 : Synthèse des dispositifs de ges-
tion de l’eau mis en place dans le projet
780 litres/m².an Craetveld. Les eaux de pluies sont soit infil-
trées, soit temporisées avant d’être rejetées
à l’égout – Source : OPI.
P
2462 m²
Tuiles / Ardoises (0,75 à 0,95) Graviers (0,6) Verte extensive (0,5 à 0,7) Perméable
Tuiles vernissées (0,90 à 0,95) EPDM / synthétique (0,8 à 0,95) Verte intensive (0,1 à 0,4) Semi-perméable
Bitume / synthétique (0,8 à 0,95) Stockante Imperméable
Eaux claires Eaux colorées
Filtre
180 m³
Bassins
d’orage
Potagers
Noues
Wadis
Débit
Bassins -
Régulé
drainants
Sprinklers Puits d’infiltration
INFILTRATION
Toutes eaux
Figure 4 : Synthèse des dispositifs de
STATION D’ÉPURATION gestion de l’eau mis en place dans le
projet Cameleon. Des bassins d’orage
permettent de temporiser le rejet à
l’égout tandis que des sols perméables
permettent l’infiltration – Source : OPI.
5Noues, wadis, jardins humides, mares, puits d’infiltra- de gestion de l’eau choisi est affiné par les autres
tion… Les dispositifs paysagers sont nombreux pour dispositifs mis en place : présence ou non d’une toi-
tirer parti du parcours de l’eau, entre sa récolte en ture verte en amont, temporisation en toiture ou en
toiture ou au sol et son renvoi dans la terre. Ils sont citerne, aménagements paysagers ou non…
détaillés dans le Guide Bâtiment Durable 5. Le
simple drain dispersant est également une option
envisageable si la mise en évidence du parcours de Le stockage-temporisation
l’eau n’est pas souhaitée. S’adjoindre les services d’un ou le stockage-récupération
paysagiste peut s’avérer nécessaire pour assurer la
réussite du projet en termes de végétalisation et bio- Le stockage consiste à récolter les eaux de pluie et
topes. les conserver dans une citerne pour, ensuite, soit les
renvoyer à l’égout par débit régulé – c’est la tempo-
Enfin, si l’on ne dispose pas soi-même du terrain né- risation –, soit les utiliser pour l’arrosage des plantes,
cessaire à l’infiltration, il est possible de se tourner les chasses des toilettes, les lave-linges, voire les
vers des solutions mutualisées : rassembler les eaux douches ou la potabilisation – c’est la récupération –
de pluie de plusieurs habitations, d’une rue entière, puis les rejeter, chargées, à l’égout.
voire d’un quartier, pour les renvoyer vers des zones
d’infiltration centralisées publiques. Ces disposi- Le stockage de l’eau de pluie a été fortement soutenu
tifs sont présentés dans l’outil de gestion de l’eau à en RBC par l’obligation réglementaire (RRU) de poser
l’échelle du quartier « Quadeau » 6. une citerne pour tout bâtiment neuf.
En quoi l’infiltration répond-elle aux objectifs ?
La temporisation
L’infiltration, qu’elle soit directe ou indirecte, répond
Elle consiste à récolter les eaux de pluie et à les stoc-
à 100% à l’objectif prioritaire de la Région puisque
ker, le plus souvent dans une citerne, pour les ren-
toutes les eaux de pluie récoltées sont détournées du
voyer à l’égout par débit régulé . Ainsi, en cas de
réseau d’égout.
forte pluie, les eaux claires sont retenues et ne sont
envoyées aux égouts que très progressivement pour
Arbre de décision éviter d’actionner la surverse de la station d’épuration
Actuellement (début 2017), l’infiltration di- en aval.
recte fait obligatoirement l’objet d’une de-
mande de dérogation puisque la pose d’une À noter que la temporisation peut être réalisée par
citerne est imposée par le Règlement Régional une toiture stockante et ne nécessite donc pas néces-
d’Urbanisme (RRU). Néanmoins, d’une part, la sairement l’installation d’une citerne. Ce dispositif n’est
législation est en train d’être révisée et, d’autre toutefois pas encore fréquent et demande une mise en
part, cette demande de dérogation, lorsqu’elle œuvre très soignée.
est motivée, est généralement accordée parce
qu’elle répond à l’objectif régional prioritaire
Figure 5 : Schéma d’une toiture
(ne pas renvoyer d’eaux claires aux égouts). stockante – Source : BE.
Sur le plan financier, cette solution est géné-
ralement plus économique que celle du stoc-
kage, en particulier lorsqu’elle ne nécessite ni
citerne, ni pompe. Par ailleurs, elle peut faire
partie du budget d’aménagement des abords.
Cependant, le choix de l’infiltration dépend
en toute première instance de la possibilité
de disposer d’une surface infiltrable ; que l’on
peut, éventuellement, imaginer mutualisée. Il
dépend ensuite du relief, l’idéal étant de favo-
riser un système gravitaire. Enfin, le système
6La temporisation peut également être PROJET
DROGUERIE
réalisée en surdimensionnant la citerne
de stockage, ou encore en plaçant une 780 litres/m².an
deuxième citerne en aval de la citerne
destinée à la récupération, comme dans
le projet Droguerie. 25 m²
75 m²
Tuiles / Ardoises (0,75 à 0,95) Graviers (0,6) Verte extensive (0,5 à 0,7) Perméable
En quoi la temporisation répond-elle Tuiles vernissées (0,90 à 0,95)
Bitume / synthétique (0,8 à 0,95)
EPDM / synthétique (0,8 à 0,95) Verte intensive (0,1 à 0,4)
Stockante
Semi-perméable
Imperméable
aux objectifs ? Eaux claires Eaux colorées
La temporisation (en toiture ou en
Filtre Mécanique
citerne) ne répond pas à la première
priorité régionale puisque la totalité de Trop plein
l’eau claire est renvoyée à l’égout. Elle
3580
répond néanmoins aux objectifs d’écrê- litres 1100
litres
tage des pluies d’orage grâce au débit
régulé. Elle évitera ainsi l’usage, actuel-
lement trop fréquent, de la surverse Filtre Mécanique
Sable - charbon
Potagers
de la station d’épuration et ses consé- Noues
Débit Wadis
quences néfastes. régulé Bassins -
drainants
Puits d’
infiltration
La récupération
La récupération est dépendante de la INFILTRATION
quantité et de la qualité de l’eau récol- Toutes eaux
tée (nous appelons « eau bleue » une
STATION D’ÉPURATION
eau de pluie claire, et « eau verte » une
eau de pluie récoltée sur une toiture
végétalisée).
Figure 6 : Synthèse des dispositifs de gestion de l’eau
mis en place dans le Batex Droguerie. La double ci-
Figure 7 : Gestion différenciée des flux terne permet la temporisation – Source : OPI.
« vert », « bleu » et « gris » dans le Batex
avenue des Archiducs – Source : OPI.
De nombreux dispositifs de récupé-
ration existent : les uns séparant les
« eaux bleues » des « eaux vertes » pour
en faire des usages différenciés, les
autres accumulant le tout dans une ci-
terne plus ou moins bien dimensionnée
avec, pour corollaire, une limitation
dans les types d’utilisation possibles
(une eau colorée ne peut, par exemple,
pas servir pour un lave-linge) .
Il est également possible de potabiliser
de l’eau de pluie, par exemple grâce à
un filtre à osmose inverse (ce procédé
rejetant beaucoup d’eau, il est inté-
ressant de la renvoyer dans la citerne
d’eau de pluie).
7La question du dimensionnement du stockage est au
cœur de la problématique de la récupération.
Il faut mettre les quantités récoltées (et leur qualité si
le choix d’une toiture verte a été opéré) en regard des
consommations pour les différents usages potentiels :
jardinage, WC, lave-linge, eau sanitaire, eau potable
7. L’on observera souvent que seule une petite
partie de la consommation pourra être couverte par
l’apport en eau de pluie. Ainsi, le plus souvent, il fau-
dra décider de l’usage prioritaire à faire de l’eau récol-
tée. Il s’agit d’obtenir un équilibre entre les apports
des précipitations, d’une part, et les consommations,
d’autre part, afin que la citerne ne soit ni trop sou-
vent vide, ni trop souvent débordante. Ce calcul est à
la base du dimensionnement imposé par le RRU : la Figure 8 : Sous les éviers du réfectoire de l’École
citerne doit comporter 33 litres par m² de surface de IMMI, un filtre à osmose inverse permet de potabili-
ser l’eau de pluie récoltée sur les toits – Source : OPI.
récolte. Néanmoins, en cas de fortes pluies, cette pro-
portion ne permet généralement pas d’éviter le rejet
des eaux claires à l’égout (par le trop-plein). En effet,
une intense pluie d’orage peut remplir une citerne en
deux heures et, dès la citerne remplie, l’intégralité de
l’eau claire sera renvoyée directement à l’égout par le
trop-plein.
À noter que la récupération nécessite également la
mise en œuvre de pompes afin d’envoyer l’eau de
pluie sous pression dans le système d’alimentation
des points de puisage. De plus, un système de « by-
pass » (pour passer sur l’alimentation en eau de ville)
ou de remplissage de la citerne est nécessaire pour
pallier le manque d’eau de pluie en cas de sécheresse.
La pompe et le « by-pass » consomment de l’électri- Figure 9 : Dans le réfectoire de l’École IMMI, le
robinet de gauche – raccordé à l’eau de ville
cité et doivent être entretenus. Le système de « by- – est destiné au lavage des mains tandis que
pass » peut être évité si l’on accepte, lorsque l’on celui de droite est conçu pour boire – il fournit
constate un manque d’eau, d’activer quelques vannes de l’eau de pluie potabilisée – Source : OPI.
soi-même pour remplir en partie la citerne afin de te-
nir jusqu’à la prochaine pluie. Il s’agit là d’un système
« low-tech » qui permet une moindre dépendance à
des systèmes plus complexes – et donc plus fragiles –
de pompe à bascule automatique. L’installation d’une En quoi la récupération répond-elle aux objectifs ?
jauge – un simple tube transparent alimenté par la Si elle réduit la quantité d’eaux claires renvoyées à
citerne – est également envisageable pour pouvoir, l’égout, la récupération n’est pas une solution en
à tout moment, évaluer la quantité d’eau disponible termes d’écrêtage des fortes pluies. Par ailleurs, si elle
et éventuellement reporter une consommation (une permet une diminution de la consommation d’eau du
lessive, par exemple) à la prochaine pluie. réseau de distribution, elle ne diminue pas la quantité
d’eau de pluie rejetée, et ne répond donc que partiel-
Ces techniques « low-tech » favorisent la prise de lement à la deuxième priorité régionale.
conscience et de responsabilité de l’usager, mais ne
sont envisageables que dans le cas de maisons unifa- C’est pourquoi cette technique se trouve en troisième
miliales ou de petites copropriétés. position des priorités régionales.
8préfabriquée. Dans ce cas, le recours à la maçonnerie
d’une citerne sur mesure est également envisageable,
mais coûte plus cher. Enfin, la plupart des habitations
de la RBC construites avant la deuxième guerre mon-
diale disposent d’une citerne qu’il suffit parfois de
réhabiliter.
Les systèmes d’exploitation de l’eau de pluie récol-
tée (pompes, filtres…) doivent être accessibles de
manière telle que leur contrôle et entretien puissent
être assurés.
Arbre de décision
La pose d’une citerne est aujourd’hui (début 2017)
obligatoire selon le RRU. Cependant, cette législation
est en voie d’évolution.
Sur le plan financier, les dispositifs à mettre en œuvre
pour les quantités récoltées – en regard du prix de
l’eau de ville ainsi économisée – n’atteignent la ren-
tabilité économique dans aucun des cas observés au
cours de l’étude. Il s’agit donc d’un choix environne-
Figure 10 : Une jauge (un tube transparent gradué) per-
mental plutôt qu’économique.
met d’évaluer la quantité d’eau de pluie présente dans la
citerne (projet rue de Lessines) – Source : Patrick Wouters. Par ailleurs, l’autonomie en eau, ambition courante
parmi les maîtres d’ouvrage, n’est généralement
pas non plus possible si l’on objective la situation en
plaçant les quantités récoltées face aux quantités
consommées sous un même toit.
On se demandera donc, avant toute chose, si l’infiltra-
tion directe est possible et, lorsqu’elle ne l’est pas, on
abordera la question du stockage dans l’ordre suivant :
−− Les quantités : il est nécessaire d’observer en tout
premier lieu le taux de couverture que peut assu-
rer l’eau de pluie par rapport aux consommations
des usagers.
−− La qualité de l’eau récoltée : elle sera colorée si
elle provient d’une toiture verte ; certains usages
sont donc à éviter ou requièrent une communi-
Figure 11 : Une citerne a été découverte sous la ter-
rasse ; celle-ci a été réhabilitée (projet rue de Lessines) cation adéquate (pour éviter de tirer deux fois la
– Source : Patrick Wouters. chasse, par exemple).
−− En fonction de la quantité et de la qualité dispo-
Conditions de mise en œuvre nible : il s’agit de choisir les usages à couvrir en
Sauf en cas de toiture stockante, les systèmes de ré- priorité et/ou d’envisager un rejet à l’égout par
tention nécessitent l’installation d’une citerne d’eau débit régulé.
de pluie. Il existe différents types (béton, plastique) −− Enfin, il est nécessaire d’opter pour les tech-
et volumes de citernes préfabriquées qui permettent niques les plus adaptées à l’usage et aux possi-
de les installer dans un grand nombre de situations. Il bilités d’installation (ou de réhabilitation), de
est toutefois parfois impossible de livrer une citerne contrôle et d’entretien.
9Type de toit et surfaces
Pluviométrie
aménagées 1
Quantité et qualité
d’eau à gérer 2
Sol de la parcelle infiltrable ? 3&4
V X
Gestion « in situ »
Infiltration collective possible ? 6
5 V X
Infiltration ? Infiltration ?
directe indirecte directe indirecte
Filtration, Filtration,
bassins... privés bassins... publics
Dispositif paysager ? Dispositif paysager ?
X V X V
Drainage Noues, jardins, Drainage Noues, jardins,
en sous-sol puits... privés en sous-sol puits... publics
Retour au sol et à la nappe phréatique :
dispositifs sans rejet d’eau claire à l’égout
(s’assurer que l’eau est propre)
À FAVORISER
10Exemples de dispositifs Les outils à disposition
→→ Toitures végétalisées : Cameleon, Nos 1 Revêtements de sol perméables et types de sur-
Pilifs, Droguerie faces : http://app.bruxellesenvironnement.be/guide_bati-
ment_durable/docs/EAU01_FR.pdf
→→ Sol semi et perméable + bassin d’orage : 2 Évaluer le potentiel de récupération en fonction
du type de toiture : http://www.guidebatimentdurable.
Cameleon brussels/fr/3-evaluer-le-potentiel.html?IDC=7379
→→ Sol imperméable à perméable + filtre à
3 Carte d’infiltrabilité de la RBC : http://www.
coalescence + noue («Pilif River») + bassin environnement.brussels/sites/default/files/user_files/
+ potagers : Nos Pilifs geq06_-_carte_infiltration_eau_pluviale_-_kaart_he-
→→ Sols et berges perméables + bassin d’infil- melwater_infiltratie.pdf
tration : Craetveld 4 Calcul de capacité d’infiltration d’un terrain (RCU
de Forest) : http://www.forest.irisnet.be/fr/services-com-
→→ Citerne surdimensionnée + bassin d’orage munaux/developpement-urbain/fichiers/rcu-eaux-plu-
+ débit régulé : Cameleon viales-def-fr.pdf
→→ Double citerne + débit régulé : Droguerie 5 Dispositifs d’infiltration des eaux de pluie
(Guide du Bâtiment Durable) : http://www.guidebati-
mentdurable.brussels/fr/vue-d-ensemble-des-dispositifs.
→→ Séparation des «eaux bleues» et «eaux html?IDC=5352
vertes» pour usages différenciés : avenue
6 Dispositifs collectifs publics d’infiltration des eaux
des Archiducs de pluie (outil « Quadeau ») : http://www.environnement.
→→ Potabilisation : École IMMI brussels/thematiques/ville-durable/urbanisme/la-boite-
→→ Alimentation sprinklers incendie : Cameleon outils-pour-le-developpement-de-quartiers-durables-0
7 Consommations moyennes d’eau en RBC : http://
→→ Lagunage de traitement des eaux usées : www.environnement.brussels/etat-de-lenvironnement/
Nos Pilifs synthese-2011-2012/eau-et-environnement-aquatique/
consommation-deau-de
Récupération de l’eau de pluie ?
V X
Quantité et qualité par rapport aux consommation ? 7
Stockage + temporisation ? Stockage simple ? Temporisation ?
V X
Récupération en
fonction de la qua-
lité et de la quantité
Bassin de retenue,
toiture stockante
Eaux usées
Lagunage Trop-Plein
À ne favoriser que si il Rejet des eaux claires à l’égout Rejet instantanné
n’existe pas de raccord à temporisé et/ou minimisé des eaux claires
la station d’épuration à l’égout
IMPOSSIBLE
INFILTRATION À DÉFAVORISE
R
À FAVORISER SI
11Réduire la consommation d’eau de distribution
Ce point n’a pas fait l’objet de la recherche sur les pra- Ce réservoir doit être placé en amont du réservoir
tiques innovantes de gestion de l’eau, car il est consi- de chasse pour éviter le recours à des pompes de
déré comme acquis par les acteurs du secteur. relevage. Enfin, dernier détail technique non encore
élucidé : l’alimentation des chasses ne se fait que par
Cependant, un dispositif intéressant a malgré tout un seul robinet (d’eau de ville) à travers lequel il est
été mis en évidence : l’utilisation des eaux grises interdit de faire passer de l’eau grise pour éviter la
pour alimenter les chasses d’eau. Celui-ci consiste à contamination du réseau de distribution. Au cours de
alimenter le réservoir des chasses en eau issue de la notre étude, nous n’avons relevé qu’un exemple de
douche ou de la baignoire – éventuellement après réutilisation de l’eau grise d’hygiène. Il doit être consi-
un léger filtrage ou une épuration. Il existe de longue déré comme un projet « pilote » dont il serait judi-
date puisque des articles de 1994 font mention de cieux d’observer le (bon) fonctionnement : évaluer
cette pratique au Japon. les bénéfices en termes de diminution de consomma-
tion d’eau de ville, mesurer la qualité de l’eau dans le
Dans les chiffres, cette solution semble idéale. En réservoir tampon, évaluer le risque de contamination
effet, nous consommons en moyenne 48 litres d’eau de l’eau de distribution… Disposer de données chif-
par personne et par jour pour l’hygiène corporelle et frées permettrait d’évaluer si ce dispositif aurait un
30 litres d’eau par personne et par jour pour les toi- impact significatif à l’échelle régionale.
lettes : la couverture pourrait donc être totale. Ainsi,
ce procédé permettrait à la fois de diminuer les quan- Enfin, notons qu’il n’existe actuellement pas de tech-
tités d’eau consommées et de charger les eaux ren- niques de mise en œuvre « toutes faites » dans le
voyées à l’égout. commerce (chasse à double alimentation) et que les
installateurs ne sont pas formés à leur mise en place.
Cependant, un réservoir tampon est nécessaire, dans En conséquence, le prix d’un tel dispositif est inchif-
lequel il faudra éviter la prolifération de bactéries. frable.
12Vous pouvez aussi lire